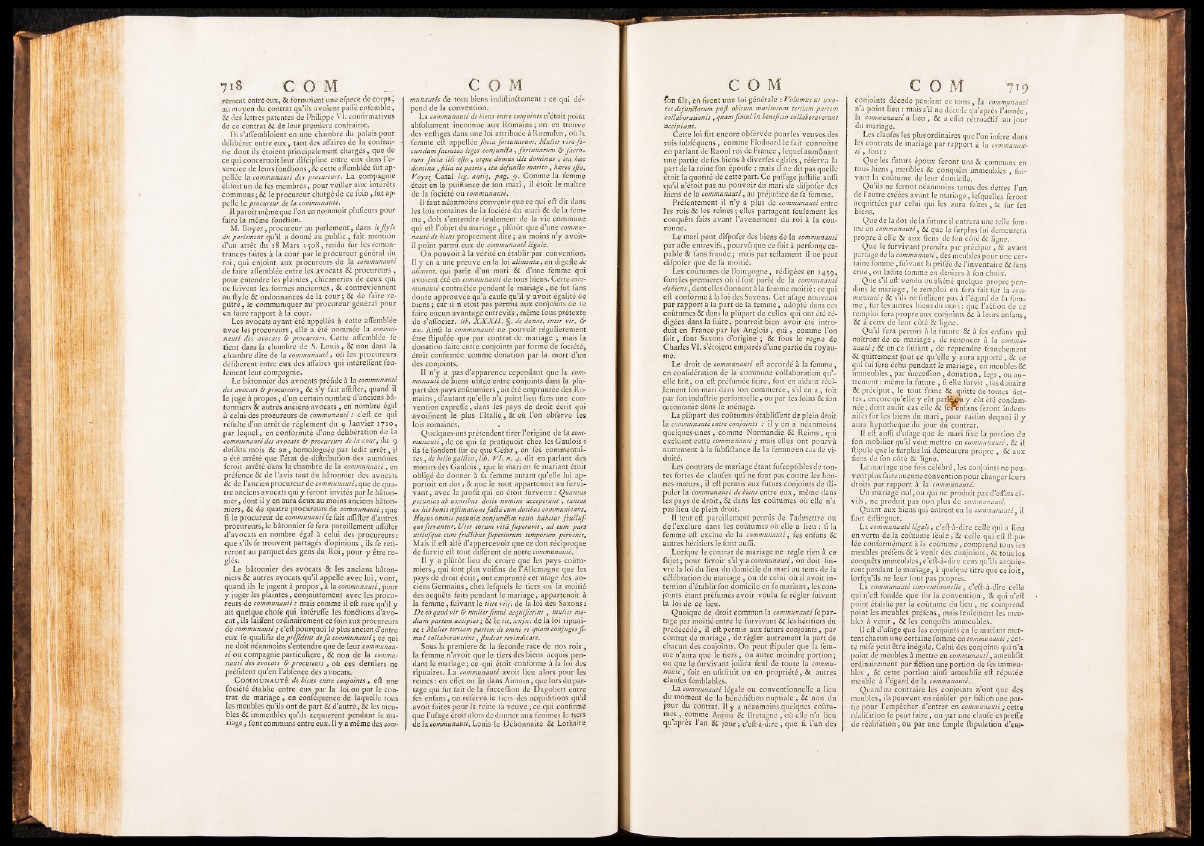
rement entre eux, & formoient une efpece dé corps,
ali moyen du contrat qu’ils a voient pâlie enfemble,
6c des lettres patentes de Philippe VI. confirmatives
de ce contrat & de leur première confrairie.
Ils s’affembloient en une chambre du palais pour
délibérer entre eu x, tant des affaires de la confrairie
dont ils étoient principalement chargés, que de
ce qui concernoit leur difcipline entre eux dans l ’exercice
de leurs fondions, 6c cette aflemblée fut ap-
pellée la communauté des procureurs. La compagnie
élifoitun de fes membres,, pour veiller aux intérêts
communs ; 6c le procureur chargé de ce foin, fut ap-
pellé \q.procureur de la communauté.
Il paroît même que l’on en nommoit plufieurs pour
faire la même fon&ion.
M. Boy er, procureur au parlement, dans lefiyle
du parlement qu’il a donné au public, fait mention
d’un arrêt du 18 Mars 1508 , rendu fur les remontrances
faites à la cour par le procureur général du
ro i, qui enjoint aux procureurs de la communauté
de faire aflemblée entre les avocats 6c procureurs ,
pour entendre les plaintes, chicaneries de ceux qui
ne fuivent les formes anciennes, & contreviennent
au ftyle 6c ordonnances de la cour ; & de faire re-
giftre, le communiquer a\i procureur général pour
en faire rapport à la cour.
Les avocats ayant été appellés à cette aflemblée
a vec les procureurs, elle a été hommée la communauté
des avocats & procureurs. Cette aflemblée fe
tient dans la chambre de Louis , & non dans la
chambre dite de la communauté, où les procureurs
délibèrent entre eux des affaires qui intéreffent feulement
leur compagnie.
Le bâtonnier des avocats préfide à la communauté
des avocats & procureurs , 6c s’y fait âflifter, quand il
le juge à propos, d’un certain nombre d’anciens bâtonniers
& autres anciens avocats , en nombre égal
à celui des procureurs de communauté : c’eft ce qui
réfulte d’un arrêt de réglement du 9 Janvier 1710 ,
par lequel , en conformité d’une délibération de la
communauté des avocats & procureurs de la cour, du 9
defdits mois & an , homologuée par ledit arrêt, il
a été arrêté que l’état de dirtribution des aumônes
feroit arrêté dans la chambre de la communauté, en
préfence 6c de l ’avis tant du bâtonnier des avocats
6c de l’ancien procureur de communauté, que de quatre
anciens avocats qui y feront invités par le bâtonnier
, dont il y en aura deux au moins anciens bâtonniers,
6c de quatre procureurs de communauté ; que
li le procureur de communauté fe fait âflifter d’autres
procureurs, le bâtonnier fe fera pareillement âflifter
d’avocats en nombre égal à celui des procureurs :
que s’ils fe trouvent partagés d’opinions , ils fe retireront
au parquet des gens du Roi , pour y être re-
i'!“ . •
Le bâtonnier des avocats & les anciens bâtonniers
6c autres avocats qu’il appelle avec lui, vont,
quand ils le jugent à propos , à la communauté, pour
y juger les plaintes, conjointement avec les procureurs
de communauté : mais comme il eft rare qu’il y
ait quelque chofe qui intéreffe les fondions d’avocat
, ils laiffent ordinairement ce foin aux procureurs
de communauté j c’eft pourquoi le plus ancien d’entre
eux fe qualifie de prejident de fa communauté ; ce qui
ne doit néanmoins s’entendre que de leur communauté
ou compagnie particulière, & non de la communauté
des avocats & procureurs , où ces derniers ne
préfident qu’en l’abfence des avocats.
COMMUNAUTÉ de biens entre conjoints, eft une
fociété établie entre eux par la loi ou par le contrat
de mariage , en coijfequence de laquelle tous
les meubles qu’ils ont de part & d’autre, 6c les meubles
& immeubles qu’ils acquièrent pendant le mariage,
font communs entre eux. 11 y a même des cornmuhautês
de tous biens indiftin&ement : ce qui dépend
de la convention.
La communauté de biens entre conjoints n’étoit point
abfolument inconnue aux Romains ; on en trouve
des veftiges dans une loi attribuée àRomulus, où la
femme eft appellée focia fortunarum. Mulier viro fe-
cundum facratas leges conjunfta , fortunarum & facro-
rum focia illi ejlo , utque domus ille dominus , ita heec
domina ,filia ut patris, ita defunclo marito, hceres ejlo.
Voyer Catal leg. antiq. pag. c). Comme la femme
étoit en la puiflance de fon mari, il étoit le maître
de la fociété ou communauté.
Il faut néanmoins convenir que ce qui eft dit dans
les lois romaines de la fociété du ‘mari 6c de la femme,
doit s’entendre feulement de la vie commune
qui eft l’objet du mariage, plutôt que d’une communauté
de biens proprement dite ; au moins n’y avoit-
il point parmi eux de communauté légale.
On pouvoit à la vérité en établir par conventiom
Il y en a une preuve en la loi alimenta, aù digefte de
aliment, qui parle d’un mari 6c d’une femme qui
avoient été en communauté de tous biens. Cette communauté
contractée pendant le mariage, ne fut fans
doute approuvée qu’àcaufe qu’il y avoit égalité de
biens ; car il n’étoit pas permis aux conjoints de fe
faire aucun avantage entrevifs, même fous prétexte
de s’aflocier. lib. X X X I I . § . de donat. inter vir. &
ux. Ainfi la communauté ne pouvoit régulièrement
être ftipulée que par contrat de mariage ; mais la
donation faite entre conjoints par forme de fociété,
étoit confirmée comme donation par la mort d’un
des conjoints.
Il n’y a pas d’apparence cependant que la communauté
de biens ufitée entre conjoints dans la plupart
des pays coutumiers, ait été empruntée des Romains
, d’autant qu’elle n’a point lieu fans une convention
exprefle, dans les pays de droit écrit qui
avoifinent le plus l’Italie, & où l’oii obferve les
lois romaines.
Quelques-uns prétendent tirer l’origine de la communauté
, de ce qui fe pratiquoit chez les Gaulois ;
ils fe fondent fur ce que Ce fa r , en fes commentair
e s ,^ bello gallico, lib. VI. n. 4. dit en parlant des
moeurs des Gaulois , que le mari en fe mariant étoit
obligé de donner à fa femme autant qu’elle lui ap-
portoit en dot i & que le tout appartenoit au furvi-
vant, avec le profit qui en étoit furvenu : Quantas
pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt , tantas
ex his bonis cefimatione faclâ cum dotibus communicant.
Hujus omnis pecunice eonjunclim ratio habetur frucluf-
que fervantur. U ter eorum vitd fuperavit, ad eum pars
utriufque cum fruciibus fuperiorum temporum pervenit.
Mais il eft aifé d’appercevoir que ce don réciproque
de furvie eft tout différent de notre communauté.
Il y a plûtôt lieu de croire que les pays coutumiers
, qui font plus voifins de l ’Allemagne que les
pays de droit écrit, ont emprunté cet ufage des anciens
Germains, chez lefquels le tiers ou la moitié
des acquêts faits pendant le mariage, appartenoit à
la femme, fuivant le titre viij. de la loi des Saxons :
Deeo quodvir & mulier fimul acquijîerint,. mulier me-
diam partem accipiat; 6c le tit. x x jx . de la loi ripuai-
re : Mulier tertiam partem de omni re quam conjuges f i mul
collaboraverint, fiudeat revindicare.
Sous la première 6c la fécondé race de nos rois
la femme n’avoit que le tiers des biens acquis pendant
le mariage ; ce qui étoit conforme à la loi des
ripuaires. La communauté avoit lieu alors pour les
reines : en effet on lit dans Aimoin, que lors du partage
qui fut fait de la fucceflion de Dagobert entre
fes enfans, on refer va le tiers des acquifitions qu’il
avoit faites pour la reine fa veuve ; ce qui confirme
que l’ufage étoit alors de donner aux femmes le tiers
de la communauté. Louis le Débonnaire 6c Lothaire
Ibti fils, èft firent une loi générale : VoltimUs ut ûxo-
res defuntlorum pofi obitum maritorum tertiam partem
collaboradonis, quam fimul in beneficio collaboraverunt
uccipiant.
Cette loi fiit encore obfervée pour les veuves des
rois fubféquens, comme Flodoard le fait connoître
en parlant de Raoul roi de France, lequel aumônant
une partie de fes biens à diverfes égli.Ies, réferva la
part de la reine fon époufe : mais il ne dit pas quelle
étoit la quotité de cette part. Ce pafîage juftifie aufli
qu’il n’étoit pas au pouvoir du mari de dilpofer des
biens de la communauté, au préjudice de fa femme.
Préfentement il n’y a plus de communauté entre
les rois & les reines ; elles partagent feulement les
conquêts faits avant l’avenement du roi à la couronne..
Le mari peut difpofer des biens de la communauté
par aôe entrevifs, pourvu que ce foit à perfonne capable
& fans fraude; mais par teftament il ne peut,
difpofer que de fa moitié.
Les coutumes de Bourgogne, rédigées en 14Ç9,
font les premières où il foit parlé de la communauté
de biens, dentelles donnent à la femme moitié : ce qui
eft conforme à la loi-des Saxons. Cet ufage nouveau
par rapport à la part de la femme, adopté dans ces
coutumes & dans la plûpart de celles qui ont été rédigées
dans la fuite, pourroit bien avoir été introduit
en France par les Anglois, q u i, comme l’on
fa it , font Saxons d’origine ; 6c fous le régné de
Charles VI. s’étoient emparés d’une partie du royaume
.L
e droit de Communauté eft accordé à la femme,
en confidération de la commune collaboration qu’elle
fait, ou eft préfumée faire, foit en aidant réellement
fon mari dans fon commerce, s’il en a , foit
par fon induftrie perfonnelle , ou par fes foins 6c fon
oeconomie dans le ménage.
La plûpart des coutumes établiffent de plein droit
la communauté entre conjoints : il y en a néanmoins
quelques-unes , comme Normandie 6c Reims , qui
excluent cette communauté ; mais elles ont pourvû
autrement à la fubfiftance de la femme en cas de viduité.
Les contrats de mariage étant fufceptibles de toutes
fortes de claufes qui ne font pas contre les bonnes
moeurs, il eft permis aux futurs conjoints de fti-
puler la communauté de biens entre eux, ‘même dans
les pays de droit, 6c dans les coûtumes où elle n’a
pas lieu de plein droit.
Il leur eft pareillement permis de l’admettre ou
de l’exclure dans les coûtumes où elle a lieu: fila
femme eft exclue de la communauté, fes enfans 6c
autres héritiers le font aufli.
Lorfque le contrat de mariage ne réglé rien à ce
fujet ; pour fa voir s’il y a communauté, on doit fui-
vre la loi du lieu du domicile du mari au tems de la
célébration du mariage , ou de celui où il avoit intention
d’établir fon domicile en fe mariant, les conjoints
étant préfumés avoir voulu fe régler fuivant
la loi de ce lieu.
Quoique de droit commun la communauté fe partage
par moitié entre le furvivant 6c les héritiers du
prédéeédé, il eft permis aux futurs conjoints, par
contrat de mariage, de régler autrement la part de
chacun des conjoints. On peut ftipuler que la femme
n’aura que le tiers , ou autre moindre portion ;
ou que le furvivant jouira feul de toute la communauté
, foit en ufufruit ou en propriété, & autres
claufes femblables.
La communauté légale ou conventionnelle a lieu
du moment de la bénédiftion nuptiale , 6c non du
jour du contrat. Il y a néanmoins quelques coûtumes
, comme Anjou 6c Bretagne , où elle n’a lieu
qu’après l’an 6c jour ; c’eft-à-clire , que fi l’un des
ciHjSmts (féccde pêndartt de tems, la communauté
n’a pôint lieu : mais s’il ne décédé qu’après l’année,
la communauté a-lieu, &c a effet retfôaaif au jour
du mariage.
Les claufes les plus ordinaires que l’on inféré dans ■
les contrats de mariage par rapport à la communauté
, font :
Que les futurs époux feront uns & communs en
tous biens , meubles & conquêts immeubles , fuivant
la -coûtume de leur domicile.
Qu’ils ne feront néanmoins tenus des dettes l’un
de 1 autre creees avant le mariage, lefquclles feront
acquittées par celui qui les aura faites, & fur fes
biens.
Que de la dot de la future il entrera une telle fom-
me en communauté, 6c que le furplus lui demeurera
propre à elle & aux liens de fon côté 6c ligne.
Que le furvivant prendra par preciput, & avant
partage de la communauté, des meubles pour une certaine
fomme , fuivant la prifée de l’inventaire & fans
crue, ou ladite fomme en deniers à fon choix.
Que s’il eft vendu ou aliéné quelque propre pen-
dans le mariage, le remploi en fera fait fur la communauté;
6c s’ils ne fuffifent pas à l’égard de la femme
, fur les autres biens du mari : que l’a&ion de ce
remploi fera propre aux conjoints 6c à leurs enfans,
6c à ceux de leur côté .Aligne.
Qu’il fera permis à la future & à feS enfans qui
naîtront de ce mariage, de renoncer à la communauté
; 6c en ce faifânt, de reprendre franchement
6c quittement tout ce qu’elle y aura apporté ,6 c ce
qui lui fera échu pendant le mariage, en meubles 6c
immeubles, par fucceflion, donation, legs, ou autrement
: même la future , fi elle furvit , fes doiiaire
6c préciput, le tout franc Sc quitte de tontes dettes
, encore qu’elle y eût p a rl^ u y eût été condamnée
; dont audit cas elle 6c fël^nfans feront indem-
nifés fur les biens du mari, pour raifon dequoi il y
aura hypotheque du jour du contrat.
Il eft aufli d’ufage que le mari fixe la portion de
fon mobilier qu’il veut mettre en communauté, 6c il
ftipule que le furplus lui demeurera propre , 6c aux
fiens de fon côté & ligne.
Le mariage une fois célébré , les conjoints ne peuvent
plus faire aucune convention pour changer leurs
droits par rapport à la communauté.
Un mariage nul, Ou qui ne produit pas d’effets c ivils
, ne produit pas non plus de communauté.
Quant aux biens qui entrent en la communauté il
faut diftinguer.
La communauté légale, c ’eft-à-dire celle qui a lieu
en vertu de la coûtume feule, & celle qui eft ftipulée
conformément à la coûtume, comprend tous les
meubles préferis 6c à venir des conjoinrs, 6c to u s les
conquêts immeubles, c ’eft-à-dire ceux qu’ils acquièrent
pendant le mariage, à quelque titre que ce foit,
lôrfqu’ils ne leur font pas propres.
La communauté conventionnelle, c’eft-à-dire celle
qui n’eft fondée que fur la convention , & qui n’eft
point établie par la coûtume du lieu , ne comprend
point les meubles préfens, mais feulement les meubles
à venir , 6c les conquêts immeubles.
Il eft d’ufage que les conjoints en fe mariant mettent
chacun une certaine fomme en communauté ; cette
mile peut être inégalé. Celui dés conjoints qui n’a
point de meubles à mettre en communauté, ameublit
ordinairement par fi&ion une portion de fes immeubles
, 6c cette portion ainfi ameublie eft réputée
meuble à l’égard de la communauté.
Quand au contraire lés conjoints n’ont que des
meubles, ils peuvent en réalifer par fiûioh une partie
pour l’empêcher d’entrer en communauté ; cette
réalifation fe peut faire, ou par une claufe exprefle
de réalifation, ou par une fimple ftipulation d’emw