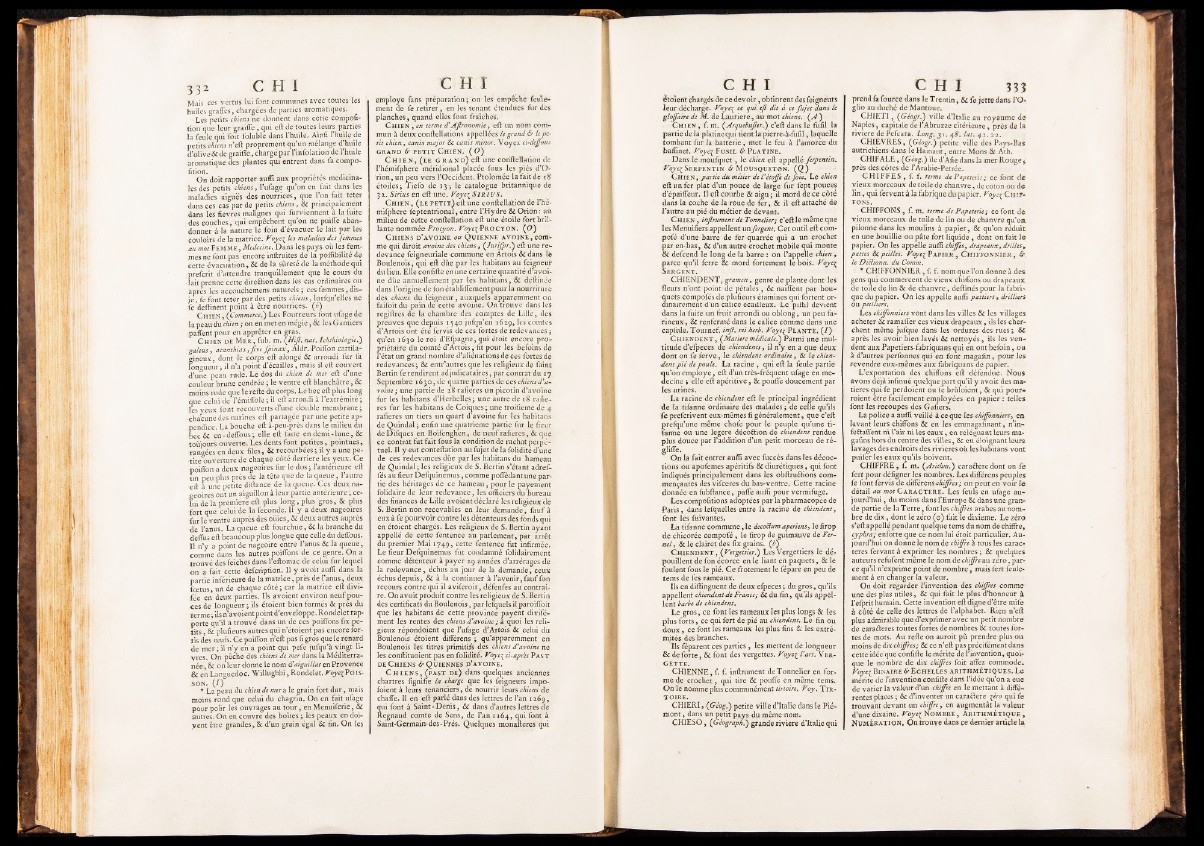
Mais ces vertus lui font communes avec toutes-les
huiles grades, chargées de parties aromatiques.
Les petits chiens ne donnent dans cette compofi-
tion que leur graiffe, qui eft de toutes leurs parties
la feule qui foit-foluble dans l’huile. Ainfi l’huile de
petits chiens n’eft proprement qu’un mélange d’huile
d’olive & de graiffe, chargé par l’infolation de l’huile
aromatique des plantes qui entrent dans facompo-
fition. /.
On doit rapporter-aufli aux propriétés médicinales
des petits chiens, l’ufage qu’on en fait dans les
maladies aiguës des-nourrices, que l’on fait teter
dans ces cas par de petits chiens, & principalement
dans les fievres malignes qui furviennent à la fuite
des couches, qui empêchent qu’on ne puiffe abandonner
à la nature le foin d’évacuer le lait par les
couloirs de la matrice. Voye{ les maladies des femmes
au mot Fem m e, Médecine. Dans les pays où les femmes
ne font pas encore inftruites de la poflibilité de
cette évacuation, &: de la sûreté de la méthode qui
prefcrit d’attendre tranquillement que le cours du
lait prenne cette dire&ion dans les cas ordinaires ou
après lesaccouchemens naturels; ces femmes, dis-
je , fe font teter par des petits chiens, lorfqu’elles ne
fe deftinen't point à être nourrices, (h)
C hten , (<Commercet) Les Fourreurs font ufage de
la peau du chien ; on en met en mégie, & les Gantiers
paffent pour en apprêter en gras.
C h ien -de Mer , fub. m. (HiJl.nat.Ichthiologk.)
;galeus, acanthias ,five fpinax, Aldr. Poiffon cartila-
gineux, dont le corps eft alongé & arrondi fur fa
longueur; il n’a point d’écailles, mais il eft couvert
d’une peau rude. Le dos du chien de mer eft d’une
couleur brune cendrée ; le ventre eft blanchâtre, &
moins rude que le refte du corps. Le bec eft plus long
que celui de l’émiffole ; il eft arrondi à l ’extrémité ;
les yeux font recouverts d’une double membrane;
•chacune des narines eft partagée par une petite appendice.
La bouche eft à-peu-près dans le milieu du
bec & en-deffous; elle eft faite en demi-lune, &
toujours ouverte. Les dents font petites, .pointues,
rangées en deux files, & recourbées ; il y a une petite
ouverture de chaque côté derrière les yeux. Ce
poiffon a deux nageoires fur le dos ; l’antérieure eft
un peu plus près de la tête que de la queue, l’autre
eft à une petite diftance de la queue. Ces deux nageoires
ont un aiguillon à leur partie antérieure ; celui
de la première eft plus long , plus gros, & plus
fort que celui de la fécondé. Il y a deux nageoires
fur le ventre auprès des oiiies, & deux autres auprès
de l’anus. La queue eft fourchue, & la branche du
deffus eft beaucoup plus longue que celle du deffous.
Il n’y a point de nageoire entre l’anus & la queue,
comme dans les autres poiffons de ce genre. On a
trouvé des feiches dans l’eftomac de celui fur lequel
on a fait cette defcription. Il y avoit aufli dans la
partie inférieure de la matrice, près de l’anus, deux
foetus, un de chaque côté ; car la matrice eft divin
e en deux parties. Ils avoient environ neuf pouces
de longueur ; ils étoient bien formés & près du
terme ; ils n’avoient point d’enveloppe. Rondelet rapporte
qu’il a trouvé dans un de ces poiffons fix petits
, & plufieurs autres qui n’étoient pas encore for-
tis des oeufs. Ce poiffon n’eft pas fi gros que le renard
de mer ; il n’y en a point qui pefe jufqu’à vingt livres.
On pêche des chiens de mer dans la Méditerranée,
& on leur donne le nom aiguillât en Provence
& en Languedoc. ‘Wiliughbi, Rondelet, Poisson
. ( / ) .
* La peau du chien de mer a le grain fort dur, mais
moins rond que celui du chagrin. On en fait ufage
pour polir les ouvrages au tour, en Menuiferie, &
autres. On en couvre des boîtes ; les peaux en doi-
yent être grandes, & d’un grain égal & fin. On les
employé fans préparation; on lés empêche feulement
de fe retirer, en les tenant étendues fur des
planches, quand elles font fraîches.
C hien , en terme d'Agronomie, eft un nom commun
à deux conftellations appellées /e grand & le petit
chien, canis major &C canis minor. Voyez ci-deffous
GRAND & PETIT CHIEN. (O )
C h i e n , ( le g r a N d) eft une conftellation de
l’hémifphere méridional placée fous les piés d’O-
rion,un peu vers l’Occident. Ptolomée la fait de 18
étoiles ; Tiefo de 13 ; le catalogue britannique de
.32. Sirius en eft une. V o y e fS iR lv s .
C hien , ( le p e t it ) eft une conftellàtiôh de l’hémifphere
feptentrional, entre l’Hydre & OriOn : ait
milieu dé cette conftellation eft une étoile fort brillante
nommée Procyon. V ?ye{PROCYON. (O)
C hiens d’a vo ine ou Q uienne a v o in e , comme
qui diroit avoine des chiens , (Jurifpr.) eft une redevance
feigneuriale commune en Artois & dans lè
Boulenois, qui eft due par les habitans au feigneur
du lieu. Elle confifte en une certaine quantité d’avoine
due annuellement par les habitans, & deftinée
dans l’origine de fonétabliffementpour la nourriture
des chiens du feigneur, auxquels apparemment on
faifoitdu pain de cette avoine. On trouve dans les
regiftres de la chambre des comptes de Lille, des
preuves que depuis 1546 jufqu?en 1619, les comtes
d’Artois ont été fervis de ces fortes de redevances ;
qu’en 1630 le roi d’Efpagne, qui étoit encore propriétaire
du comté d’Artois, fit pour les befoins de
l’état un grand nombre d’aliénations de Ces fortes de
redevances; & entr’autres que les religieux de faint
Berlin fe rendirent adjudicataires, par contrat du 17
Septembre 16.30, de quatre parties de ce $ chiens d'avoine
; une partie de z8 rafieres un picotin d’avoine
fur les habitans d’Herbelles ; une autre de 18 rafié-
res fur les -habitans de Coiques ; une troifieinè de 4
rafieres un tiers un quart d’avoine fur les habitans
de Quindal ; enfin une quatrième partie fur le fieur
de Difques en Boifenghen, de neuf rafieres, & que
ce contrat fut fait fous la condition de rachat perpétuel.
Il y eut conteftation au fujet de la folidité d’une
de ces redevances due par les habitans du hameau
de Quindal; les religieux de S. Bertin s’étant adref-
fés au fieur Defquinemus, comme poffédant une partie
des héritages de ce hameau, pour le payement
folidaire de leur redevance, les officiers du bureau
des finances de Lille avoient déclaré les religieux de
S. Bertin non recevables en leur demande, fauf à
eux à fe pourvoir contre les détenteurs des fonds qui
en étoient chargés. Les religieux de S. Bertin ayant
appellé de cette fentence au parlement, par arrêt
du premier Mai 1749, cette fentence fut infirmée.
Le fieur Defquinemus fut condamné folidairement
comme détenteur à payer 29 années d’arrérages de
la redevance, échus au jour de la demande, ceux
échus depuis, & à la continuer à l’avenir, fauf fon
recours contre qui il aviferçit, défenfes au contraire.
On avoit produit contre les religieux de S. Bertin
des certificats du Boulenois, par lesquels il paroiffoit
que les habitans de cette province payent divifé-
menf les rentes des chiens d’avoine ; à quoi les religieux
répondoient que l’ufage d’Artois & celui du
Boulenois étoient différens ; qu’apparemment en
Boulenois les titres primitifs des chiens d’avoine ne
les conftituoient pas en folidité. V iye{ ci-après Pas T
de C hiens & Q uiennes d’a vo in e .
C h i e n s , (pa st de) dans quelques anciennes
Chartres lignifie la charge que les feigneurs impo-
foient à leurs tenanciers, de nourrir leurs chiens de
chaffe. Il en eft parlé dans des lettres de l’an 1269,
qui font à Saint - Denis, & dans d’autres lettres de
Regnaud comte de Sens, de l’an 1 16 4, qui font à
Saint-Germain-des-Prés. Quelques monafteres qui
étoient chargés de ce devoir, obtinrent desfeigrteufs
leur décharge. Voye[ ce qui ejl dit à ce fujet dans le
gloffatre de M. de Lauriere, au mot chiens. (A )
C hien , f. m. (Arquebujîer.) c’eft dans le fufil la
partie de la platine qui tient la pierre-à-fufil, laquelle
tombant fur la batterie, met le feu à l’amôrce du
baffinet. Voye\ F us il £ Plaïine.
Dans le moufquet, le chien eft appellé ferpentin.
•Vqye^ Serpentin b Mousqueton. (Q)
C hien , partie du. métier de l'étoffe de foie. Le chien
eft un fer plat d’un pouce de large fur fept pouces
d’épaiffeur. Il eft courbe & aigu ; il mord de ce côté
dans la coche de la roue de fer, & il eft attaché de
l’autre au pié du métier de devant.
C hien , injlrument de Tonnelier; c’eft le même que
les Menuifiers appellent un fergent. Cet outil eft com-
pofé d’une barre de fer quarrée qui a un crochet
par en-bas, & d’un autre crochet mobile qui monte
& defcend le long de la barre : on l’appelle chien ,
parce qu’il ferre & mord fortement le bois. Voye^
Sergent.
CHIENDENT, gramen, genre de plante dont les
fleurs n’ont point de pétales , & naiffent par bouquets
compofés de plufieurs étamines qui fortent ordinairement
d’un calice écailleux. Le piftil devient
•dans la fuite un fruit arrondi ou oblong , un peu farineux
, & renfermé dans le calice comme dans une
capfule.-Tournef. injl. rei herb. Voye[ Plante. (/ )
C hiendent, (Maturemédicale?) Parmi une multitude
d’efpeces de chiendents, il n’y en a que deux
dont on fe ferve, le chiendent ordinaire , & le chiendent
pié de poule. La racine , qui eft la feule partie
qu’on employé, eft d’un très-fréquent ufage en médecine
; elle eft apéritive, & pouffe doucement par
les urines.
La racine de chiendent eft le principal ingrédient
de la tifanne ordinaire des malades ; de celle qu’ils
fe prefcrivent eux-mêmes fi généralement, que c’eft
prefqu’une même chofe pour le peuple qu’une ti-
îanne ou une legere décoftion de chiendent rendue
plus douce par l’addition d’un petit morceau de ré-
gliffe.
On la fait entrer aufli avec fuccès dans les décoctions
ou apofemes apéritifs & diurétiques, qui font
indiqués principalement dans les obftruftions commençantes
des vifceres du bas-ventre. Cette racine
donnée en fubftance, paffe aufli pour vermifuge.
Les compofitions adoptées par la pharmacopée de
Paris, dans lefquelles entre la racine de chiendent,
font les fuivantes.
La tifanne commune, le decoclum aperiens, le firop
de chicorée compofé , le firop de guimauve de Fer-
nel, & le clairet des fix grains. (b)
C hiend en t, ( Vergettier.) Les Vergettiers le dépouillent
de fon écorce en le liant en paquets, & le
foulent fous le pié. Ce frôlement le fépare en peu de
tems de fes rameaux.
Ils en diftinguent de deux efpeces ; du gros, qu’ils
appellent chiendent de France; & du fin, qu’ils appellent
barbe de chiendent.
Le gros, ce font les rameaux les plus longs & les
plus forts, ce qui fert de pié au chiendent. Le fin ou
dou x, ce font les rameaux les plus fins & les extrémités
des branches.
Ils féparent ces parties , les mettent de longueur
& de forte, & font des vergëttes. Voye^ l'art. Ver-
GETTE.
CHIENNE, f. f. infiniment de Tonnelier en forme
de crochet, qui tire & pouffe en même tems.
Oh lé nomme plus communément tirtoïre. Voy. T ir-
TOIRE.
CHIERI, (iGéog.) petite ville d’Italie dans le Piémont
, dans un petit pays du même-nom.
CHIESO, (<Géograph.) grande riviere d’Italie qui
prend fa foürce dans le Tréntin, & fe jette dans l’Q-
glio au duché de Mantoue.
CH IE T l, (Géôgr.y ville d’Italie au royaume de
Naples, capitale de l’Abruzze citérieure, près de la
riviere de Pefcara. Long. 31. 48. lat. 42.22.
CHIEVRES, (Géogr.y petite ville des Pays-Bas
autrichiens dans le Hainaut, entre Mons & Ath.
CHIFALE, (Géog?) île d’Afie dans la mer Rouge *
près des côtes de l’Arabie-Petrée.
CH IF FE S , f. f. terme de Papeterie) ce font de
vieux morceaux de toile de chanvre, de coton ou de
lin , qui fervent à la fabrique du.papier. Foye^ C hiffons.
CHIFFONS, f. m. terme de Papeterie} ce font de
vieux morceaux de toile de lin ou de chanvre qu’oa
pilonne dans les moulins à papier, & qu’on réduit
en une bouillie ou pâte fort liquide, dont on fait le
papier. On les appelle aufli chiffes, drapeaux, drilles,
pattes & peilles. F<yc{ Pa p ie r , C hif fo n n ier , <£*
le Diclionn. du Comm.
' * CHIFFONNIER, f. f. nom que l’on donne à des
gens qui commercent de vieux chiffons ou drapeaux
de toile de lin & de chanvre, deftinés pour la fabrique
du papier. On les appelle aufli pattiers, driHiers
ou peilliers.
Les chiffonniers vont dans les villes & les villages
acheter & ramaffer ces vieux drapeaux, ils les cherchent
même jufque dans les ordures des rues ; £c
après les avoir bien lavés & nettoyés, ils les vendent
aux Papetiers-fabriquans qui en ont befoin, ou
à d’autres perfonnes qui en font magafin, pour les
revendre eux-mêmes aux fabriquans de papier.
L’exportation des chiffons eft défendue. Nous
avons déjà infinué quelque part qu’il y avoit des matières
qui fe perdoient ou fe brûloient, & qui pourraient
être facilement employées en papier : telles
font les recoupes des Gafiers.
La police a aufli veillé à ce que les chiffonniers, en
lavant leurs chiffons & en les emmagafinant, n’in-
fefraffent ni l’air ni les eaux, en reléguant leurs ma-
gafins hors du centre des villes, & en éloignant leurs
lavages des endroits des rivières où les habitans vont
puifer les eaux qu’ils boivent.
CHIFFRE, 1. m. (Aritkm.) caraftere dont on fe
fert pour défigner les nombres. Les différens peuples
fe font fervis de différens chiffres; on peut en voir le
détail au mot C a r a c t è r e . Les feuls en ufage au*
jourd’hui, du moins dans l’Europe & dans une grande
partie de la Terre, font les chiffres arabes au nombre
de d ix , dont le zéro (ô) fait le dixième. Le zéro
s’eft appellé pendant quelque tems du nom de chiffre,
cyphra; enforte que ce nom lui étoit particulier. Aujourd’hui
on donne le nom de chiffre à tous les caractères
fervant à exprimer les nombres ; & quelques
auteurs refufent même le nom de chiffre au zéro, parce
qu’il n’exprime point de nombre, mais fert feulement
à en changer la valeur.
On doit regarder l’invention des chiffres comme
une des plus utiles, & qui fait le plus d’honneur à
l’efprit humain. Cette invention eft digne d’être mife
à côté de celle des lettres dè l’alphabet. Rien n’eft
plus admirable que d’exprimer avec un petit nombre
de carafteres toutes fortes de nombres & toutes fortes
de mots. Au refte on aurait pu prendre plus ou
moins de dix chiffres; & ce n’eft pas précifément dans
cette idée que confifte le mérite de l’invention, quoique
le nombre de dix chiffres foit affez commode*
Voye%_ Binaire & Échelles a r ith m é t iq u e s . Le
mérite de l’invention confifte dans l’idée qu’on a eue
de varier la valeur d’un chiffre en le mettant à différentes
places ; & d’inventer un caraciere %éro qui fe
trouvant devant un chiffre, en augmentât la valeur
d’une dixaine. Voyei Nombre , Ar ithm é t iq u e ,
Numération, On trouve dans ce dernier article la