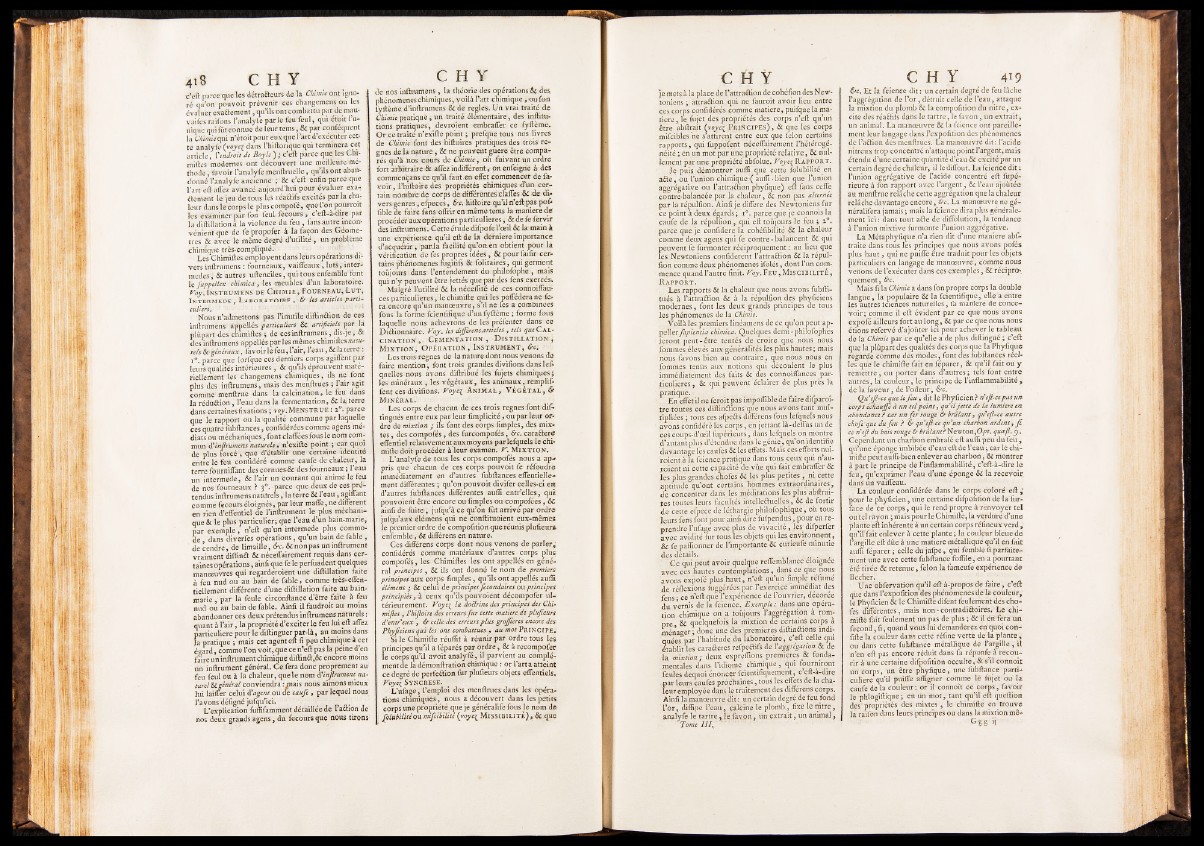
4 i 8 C H Y
c’eft parce que les détrafreursde la Chimie ont igno- j
ré qu’on pouvoit prévenir ces ôhangemens ou les
évaluer exaflement, qu’ils ont combattu par de mau- <
vaifes raifons l’analyle par le feu feul, qui éïoit l’u- ;
nique qui fut connue de leur tems, ôc par conféquent ;
la C/ù'/m'tfqui n’étoit pour ëuxque l’art d’exécuter cet- j
te analyfe (voyei dans l’hiftorique qui terminera cet j
article, l’endroit de Boy le ) ; c’eft parce que; les Chi- ;
milles modernes ont découvert une meilleûreàhé-
thode. l'avoir l’analyfe menftruelle, qu’ils ont «ban- \
donné- l’ analyfe ancienne' ; & c’eft enfin parce-que j
l ’art* eft- allez avancé -aujourd’hui pour évaluer. ex a- ;
élément le jeu de tous les réaftifs excites par-la cha- ’
leur dans le corps le plus compofé, que l’on pourroit
les exàmirier par fon feuL fecours, ceft-à-dire pat
la diftillation à la violence du feu , fans autre inconvénient
que de fe propofer à l!a façon des Géorhe- i
très & avec le même degré d’utilité , un problème
chimique très-compliqué;; - 1 ; ?1! ' ' ’ |
Les Chimiftes employent dans leurs operations divers
inftrumens : fourneaux, vaiffeaüx1, lu é j inter*
medes ; & autres* uftenciles, qui tous enfemble' font
le fuppellex cliimica ,* les -meubles1 d’un laboratoire.
Voy'. Instrumens de* C èdimie, Fourneau;L u t ,
INTERMEDE, LABORATOIRE , 6* les articles particuliers.
'■ ' 1 \ ; ' lJ A'
Nous n’admettons pas l’inutile diftinétion de ces
inftrumens appelles particuliers & artificiels par là
plupart des chimiftes ; de cesinftrumens, dis-je:,: &
des inftrumens appell és par les mêmes chimiftes naturels
& généraux , favoir le feu, l’air, l’eau, & la terre :
i° . parce que lorfque ces derniers corps agiffent par
leurs qualités intérieures'y -& qu’ils éprouvent matériellement'
les changemens chimiques, ils ne'font
plus des inftrumens, mais des menftrues ; l’air agit
comme1 menftrue dans la calcination, le feu dans
la rédüélion, l’eau dans la fermentation, & la)terre
dans certaines fixations ; voy. Menstrue : z°. parce
que le rapport ou la qualité commune par laquelle
ces quatré fùbftances, cortfldérées comme agens médiats
ou méchaniques, font clafféesfouS le nom commun
d’ inftrumens naturelsy n’exifte' point ; car quoi
de plus forcé ; que d’établir une certaine identité
entre le feu confidéré comme caufe de chaleur, la
terre fourniffant des cornues & des fourneaux ; l’eau
un intermede* & l’air un 'courant qui anime le feu
de nos fourneaux ? 3 parce que deux de ces prétendus
inftrumens naturels, la terre & l’eau, agiffant
comme fecours éloignés, par leur malle, ne different
en rien d’effentiel de l’mftrument le plus méchani-
que & le plus particulier; que l’eau d’un bain-marie,
par exemple, n’eft qu’un intermede plus commode
, dans diverfes opérations, qu’un bain de fable,
de cendre, de limaille, &c. & non pas un infiniment
vraiment diftinél & néceffairement requis dans certaines
opérations, ainfi que fe le perfuadent quelques
manoeuvres qui regarderoient une diftillation faite
à feu nud ou au bain de fable, comme très-ëffen-
tiellement différente d’une diftillation faite au bain-
marie, par la feule circonftance d’être faite à feu
nud ou au bain de fable. Ainfi il faudroit au moins
abandonner ces deux prétendus inftrumens naturels :
quant à l’a ir , la propriété d’exciter le feu lui eft afféz
particulière pour le diftinguer par-là, au moins dans
la pratique ; mais cet agent eft fi peu chimique à cet
égard, comme l’on voit, que ce n’eft pas la peine d’en
faire un infiniment chimique diftinél,& encore moins
Un inftrument général. Ce fera donc proprement au
feu feul ou à lâ chaleur, que le nom d’injlrument naturelle.
général conviendra : mais nous aimons mieux
lui laiffer celui d’agent ou ae caufe , par lequel nous
l’ayons défigné jufqu’ici. . ' ‘ ^
L’explication fuffifamment détaillée de 1 aétion de
nos deux grands agens, du fecours que nous tirons
C H Y
de nos inftrumens , la théorie des opérations & des
phénomènes chimiques, y o ilà l’art chimique j ou fon
fyftème. d’inftrumens & de réglés. U n vrai traité de
Chimie pratique ; un traité élémentaire, des: inftitu»
tiens pratiques; .devroiènt embraffer ce fyftème.
Or ce traite n’exifte point ; prefqiiétous nos .livres
de Chimielont des hiftoires pratiques, des trois régnés
d e là n ature, & ne .peuvent guerè être compa-
rés qu’à-tios cours de Chimieoù fuivant un ordre
fort arbitraire & affez indifférent, pnenfeigrie à des
comm'en'çafts t e qu’il, faut .en-effet commencer de fav
o ir , d’hiftoire des propriétés chimiques d’un, certain
nombre de corps de différentes claffes & de divers
genres , efpeces, &c. hiftoir.e'qu’il n*eft;pas pof-
fible de faire fans offrir en même tems la mariiere dé
procéder aux opérations particulières, & de fe-feryir
des inftrumens. Cette étudedifpofq l’oeil & la main à
une expérience qu’il eft de là dëfniere importance
d’acquérir ; 'p a r ia facilité qu’on,èn obtient pour la
vérification de fes propres idé e s, & pour faifir certains
phénomènes fugitifs &-folitaires, qui germent
toujours- dans.; l’entendement du philofophei, mais
qui n’y peuvent être jettes que par des fens exercés^
Malgré l’utilité & la néceflité de ces conhoiffan-
ces particulières, le chimifte qui les poffédera ne fe*
ra. encore qu’un manoeuvre, s ’il ne les a combinées
fous la formé-feientifique' d’un fyftème ; forme fous
laquelle nous achevrons de les préfenter dans ce
Diélionnaire. Voy, les différent articles, tels que C alc
in a t io n -,.- C em ent at ion , D is t il l a t io n ;
Mix t io n ; O p ér a t io n , In strum en t , &c; -
Les trois régnés de la nature dont nous venons de
faire mention, font trois grandes divifions danslefi
quelles nous avons diftribué les fujets chimiques;
les minéraux, les v égétau x, les animaux, remplif*
fent ces divifions. Voyt{ A n im a l , V é g é t a l , &
Min éra l.
Les corps de chacun de ces trois régnés fontdif-
tingués entre eux p ar leur fimplicité, ou par leur ordre
de mixtion ; ils font des corps limples, des mixtes
, des compofés, des furcompofés, &c. caraélere
efTentiel relativement aux moyens parlefquels le chimifte
doit procéder à leur examen. ^ .M ix t io n .
L ’analyie de tous les corps compofés nous a appris
que chacun de ces corps pouvoit fe réfoudre
immédiatement en d’autres fùbftances eflentielle-
ment différentes ; qu’on pouvoit divifer celles-ci en
d’autres fùbftances différentes auffi entr’e lle s, qu i
pouvoient être encore ou fimples ou compofées, &
ainfi de fu ite , jufqu’à ce qu’on fût arrivé par ordre
jufqu’aux élémens qui ne conftituoient eux-mêmes
le premier ordre de compofition que réunis plufieurs.
enfemble, & différens en nature.
Ces différens corps dont nous venons de parler,’
confidérés comme matériaux d’autres corps plus,
compofé’§, lés Chimiftes les ont appelles en général
principes, & ils ont donné le nom de premiers
principes zxXx corps fimples, qu’ils ont appellés aufli
élémens ; & celui de principes fecondaires ou principes
principiés, à ceux qu’ils pouvoient décompofer ultérieurement.
Voyei la doctrine des principes des Chi-
mijles , Phijloirt des erreurs fur cette matière de plufieurs
d'entreux , & celle des erreurs plus grojjieres encore des
PhyJicienSqui les ont combattues , au mot Pr in cip e .
Si le Chimifte réuflit à réunir par ordre tous les
principes qu’il a féparés par ord re , & à recompofer
le corps qu’il aVoit an aly fé, il parvient au complément
de la démonftration chimique : or Parta atteint
ce degré de perfection fur plufieurs objets effentiels,
Voyc{ Syncrese.
L ’ufag e , l’emploi des menftrues dans les opérations
chimiques, nous a découvert dans les petits
corps une propriété que je généralife fous le nom d©
JolubilitéOU mifeibilité (yoye^ Mi s s ib il it é ) , & que
ij
C H Y
je mets à la place de l’attraâion de cohéfion des Newtoniens
; àttraftion qui ne fauroit avoir lieu entre
ces corps confidérés comme matière, puifque la m atière
, le fujet des propriétés des corps n’eft qu’un
être abftrait (voye^^ iu n c ip e s ) , & que les corps
mifcibles ne s’attirent entre eux que félon certains
rapports, qui fuppofent néceffairement l’hétérogénéité
; en un mot par une propriété relative, & nullement
par une propriété abfolue. Voyej R a ppo r t .
Je puis démontrer aufli que cette lolubilité en
afte , o;u l’union chimique ( aufli - bien que l’umon
aggrégative ou l’attraûion phyfique) eft fans ceffe
contre-balancée par la chaleur, & non pas alternée
par la répulfion. Ainfi je différé des Newtoniens fur
ce point à deux égards; i°. parce que je connois la
caufe de la répulfion, qui eft toujours le feu ;• 20.
parce que je confidere la cohéfibilité & la chaleur
comme deux agens qui fe contre-balancent & qui
peuvent fe furmonter réciproquement : au lieu que
les Newtoniens confiderent l’attraftion & la répulfion
comme deux phénomènes ifolés, dont l’un commence
quand l’autre finit. Vyy. Feu , Mis c ib il it e ,
R a p p o r t .
Les rapports & la. chaleur que nous avons fubfti-
tués à l’attraâion & à la répul^on des phyficiens
modernes, font les deux grands principes de tous
les phénomènes de la Chimie.
■ Voilà les premiers linéamens de ce qu’on peut ap-
peller fapientia chimica. Quelques demi - philofophes
feront peu t-ê tre tentés de croire que nous, nous
fommes élevés aux généralités les plus h autes; niais
nous favons bien au contraire , que nous nous en
fommes tenus aux notions qui découlent le plus
immédiatement d.es faits & des connoiflances particulières
, & qui peuvent éclairer de plus près la
pratique. < , A
. En effet il ne feroit pas impoffible de faire difparoi-
tre toutes ces diftin£lions que nous avons tant multipliées
; tous ces afpeéls différens fous ïefquels nous
avons confidéré les corps, en jettant là-deflus un de
ces coups-d’oeil fupérieurs, dans lefqupls on montre
d’autant plus d’étendue dans le génie, qu’on identifie
davantage lès caufes Ôc les effets. Mais ces efforts nui-
roient à la fcience pratique dans tous ceux qui n’au-
roiént ni cette capacité de vûe qui fait embraffer &
le s plus grandes chofes & les plus pe.tites , ni cette
aptitude qu’ont certains hommes extraordinaires ,
de concentrer dans les méditations lés plus àbftrai-
tes toutes leurs facultés intelle&uelles,, & de fortir
de cette efpece de léthargie philofophique, où tous
leurs fens font pour ainfi dire fùlpendus, pour en reprendre
l’ufage ayeç plus de v iv a c ité , les difperfer
avec avidité fur tous les objets qui les environnent,
& fe paflionner de l’importante & cürieufé minutie
des détails. . • 1f , . ,
C e qui peut avoir quelque reffemblance eloignee
avec ces hautes contemplations, dans ce que nous
'avons expofé plus h au t, n’eft qu’iin fimple rëfumé
de réflexions liiggérees par l’exercice immédiat des
iens ; ce n’eft que l’expérience de l’ouvrier, décorée
du vernis de la fcience.. Exemple : dans une opération
chimique on a toujours l’aggrégation à rompre
, & quelquefois la mixtion de certains corps à
ménager ; donc une des premières diftin&ions indiq
u é e s&p a r l’habitude,du laboratoire, c’eft celle qui
établit les caraaeres refpeftifs de l’aggrégation & de
la mixtion; deux expreflions premières & fondamentales
dans l’idiome chimique , qui fourniront
feules dequoi énoncer fcientifiqùement, c’eft-à-dire
par leurs caufes prôc.hainc.s, tous les effets de la chaleur
employée dans le traitement des différens corps.
Ainfi la manoeuvre dit : un certain degré de feu fond
l’o r , diflipe l’eau, calcine-le plomb,, .fixe le nitre,
analyfe le tartre, Jç.fayon, lin extrait, un animal,
fome I I I f i "
C H Y 419
&c. Et la fcience dit : un certain degré de feu lâche
l’aggrëgation de l’o r , détruit celle de l’eau, attaque
la mixtion du plomb & la compofition du nitre, excite
des réaûifs dans le tartre, le favon, un extrait,
un animal. La manoeuvre & la fcience ont pareillement
leur langage dans l’expofition des phénomènes
dé l’aftion des menftrues. La manoeuvre dit: l’acide
nitreux trop concentré n’attaque point l’argent, mais
étendu d’une certaine quantité d’eau & excité par un
'certain degré de chdteur, il le diffout. La fcience dit :
l’tinion aggrégative de l’acide concentré eft fupé-
rieufe à fon rapport avec l’argent, & l’eau ajoûtée
au menftrue relâche cette aggrégation que la chaleur
relâche davantage encore, &c. La manoeuvre ne gé-
néralifera jamais ; mais la fcience dira plus généralement
ici : dans tout a£le de diffolution, la tendance
à l’union mixtive furmonte l’union aggrégative.
La Métaphyfique n’a rien dit d’une maniéré abstraite
dans tous les principes que nous avons pofés
plus haut, qui ne puiffe être traduit pour les objets
particuliers en langage de manoeuvre, comme nous
venons de l’exécuter dans ces exemples, & récipra-,
quement, &c.
Mais fi. la Chimie a dans fon propre corps la double
langue, la populaire & la feientifique,.elle a entre
les autres fciences naturelles, fa maniéré de concevoir;
comme il eft évident par ce que nous avons
expofé àilleurs fort au long, & par ce que nous nous
étions refervé d’ajouter ici pour achever le tableau
de la Chimie par ce qu’elle a de plus diftingué ; c’eft
que la plupart des qualités des corps que la Phyfique
regarde comme des modes, font des fùbftances réelles
què' le chimifte fait en féparer, & qu’il fait ou y
remettre, ou porter'dans d’autres; tels font entre
■ autrés, la couleur., le principe de l’inflammabilité 9
de la faveur, de l’bd'eur, &c,
Quéjl-ce que le feu , dit le Phyficien ? n’efi-ce pas urt
corps échauffé à un tel point, qu’il jette de la lumière en
abondance é car un fer rouge & brûlant, qu’e(l-ce autre
ehofe'que du feu ? & qu’eft-ce qu’un charbon ardent -, Je
cèn’ejl du bois roUge & brûlant? Newton, Opt. quceft.c).
Cependant un charbon èmbrafé eft aufli peu du feu ,
qu’une éponge imbibée d’eau eft de l’eau ; car lè chimifte
peut aufli-bien enlever au charbon, & montrer
à part le principe de l’inflammabilité, c’eft-à-dire le
feu, qu’exprimer l’eau d’une éponge & la recevoir
danS un vâifleau.
. La couleur confidérée dans le corps coloré eft^
pour le phyficien, une certaine difpofition de la fur-
£ace de Ce corps, qui le rend propre à renvoyer tel
ou tel rayon ; mais pour le Chimifte, la verdure d’une
plante eft inhérente à un certain corps réfineux verd ,
• ’ù’il'fait enlever à cette plante ; la couleur bleue de
argille eft due à une matière métallique qu’il en fait
aum féparer ; celle du jafpe, qui femblé fi parfaitement
une avec cette fubftance foflile, en a pourtant
été tirée & retenue, félon la fameufe expérience de
Bêcher.. '
Une obfervation qu’il eft à-propos de faire, c’eft
qiié dans l’expofition des phénomenesde la couleur,
le Phÿficien ôc le Chimifte difent feulèmerit des cho-
fés différentes', ,mais non - Contradi£loires. Le chimifte
fait feulement un pas de plus ; & il éh'fera un
fécond, fi, quand vous lui demanderez en! quoi con-
fifte la couleur dams cette réfine verte de/la plante ,
ou dans cette fubftance métallique de i’argille , il
n’en eft pas encore réduit dans fa réponfe à recourir
à une certaine difpofition occulte, & s’il coiinoît
un ebrps, un être phyfique, une fubftance particulière
qu’il puiffe afligner comme lè fùjet ou la
caùfe de la couleur : or il connoît ce corps, favoir
le phlogiftique ; en lin mot, tant qu’ il eft qiieftion
des* propriétés des mixtes , le chimifte en trouves
la raifon dans leurs principes ou dans la mixtion mê