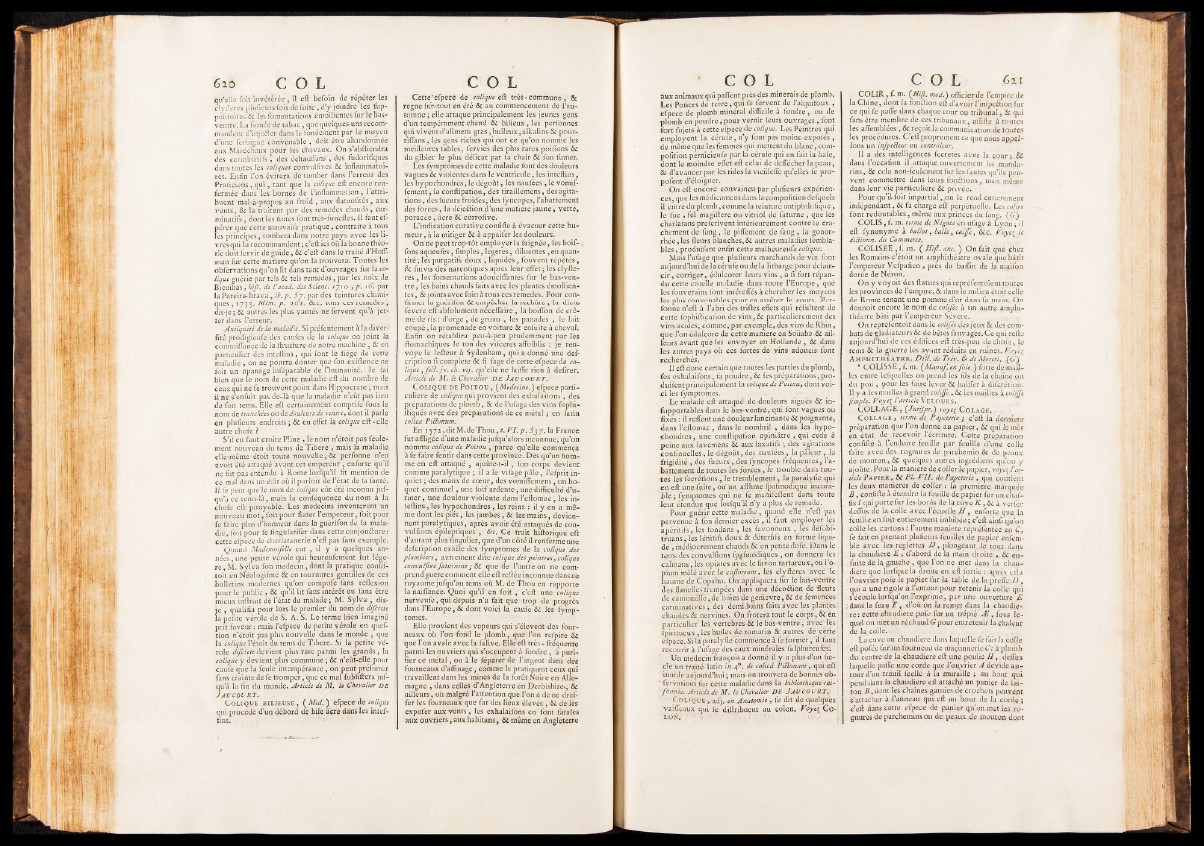
qu’elle foit invétérée , il eft befoin de répéter les
clyfteres plufieurs fois de fu ite , d’y joindre les fup-
politoires & les fomentations émollientes fur le bas-
ventre. La fumée de tab a c , que quelques:uns recommandent
d’injecter dans le fondement par le moyen
d’une feringue convenable , doit être abandonnée
aux Maréchaux pour les chevaux. On s’abftiendra
des carminatifs, des échauffans , des fudorifiques
dans toutes les coliques convuhives 6c inflammatoires.
Enfin l’on évitera de tomber dans l’erreur des
Praticiens , q u i, tant que la colique eft encore renfermée
dans les bornes de l’inflammation l’attribuent
mal-à-propos au froid , aux flatuofites, aux
vents, 6c la traitent par des remedes chauds, car-
minatifs, dont les fuites font très-funeftes. Il faut ef-
pérer que cette mauvaife pratique, contraire à tous
les principes, tombera dans notre pays avec les livres
qui la recommandent ; c’eft ici oit la bonne théorie
doit fervir de guide, 6c c’eft dans le traité d’Hoffman
fur cette matière qu’on la trouvera. T outes les
obfervations qu’on lit dans tant d’ouvrages fur la co-
lique guérie par tels 6c tels remedes, par les noix de
Bicuibas, hijl. de Vacad. desScienc. lyio , p. 16. par
la Pareira-brava, ib. p. S j. par des teintures chimiques
,1 7 3 3 . Mém. p. zCz. 6cc. tous ces remedes ,
dis-je ; 6c autres les plus vantés ne fervent qu’à jet-
ter dans l’erreur.
Antiquité de la maladie. Si préfentement à la diver-
lité prodigieufe des caufes de la colique on joint la
connoiffance de la ftruéhire de notre machine, & en
particulier des inteftins, qui font le fiége de cette
maladie , on ne pourra douter que fon exiftence ne
foit un apanage inféparable de l’humanité. Je fai
bien que le nom de cette maladie eft du nombre de
ceux qui ne fe trouvent point dans Hippocrate ; mais
il ne s’enfuit pas de-là que la maladie n’eût pas lieu
de fon tems. Elle eft certainement comprife fous le
nom de tranchées oü de douleurs de vektre, dont il parle
en plufieurs endroits ; 6c en effet la colique eft - elle
autre chofe ?
S ’il en faut croire P line, le nom n’étoit pas feulement
nouveau du tems de T iberê , mais la maladie
elle-même étoit toute nouvelle, 6c perfonne n’en
avoit été attaqué avant cet empereur , enforte qu’il
ne fut pas entendu à Rome lorfqu’il fit mention de
ce mal dans un édit oii il parloit de l’état de fa fanté.
Il fe peut que'le nom de colique eût été inconnu juf-
qu’à ce tems-là, mais la conféquence du nom à la
chofe eft pitoyable. Les médecins inventèrent un
nouveau m o t, foit pour flater l’empereur, foit pour
fe faire plus d’honneur dans la guérifon de la malad
ie , foit pour fe fingularifer dans cette conjoncture:
cette efpece de charlatanerie n’eftpas fans exemple.
Quand Mademoifelle eut , il y a quelques années
, une petite vérole qui heureufement fut légère
, M. Sy lv a fon médecin, dont la pratique confif-
toit en Néologifme 6c en tournures gentilles de ces
bulletins modernes qu’on compofe fans reflexion
pour le public , 6c qu’il lit fans intérêt ou fans être
mieux inftruit de l’état du malade ; M. Sylva , dis-
je , qualifia pour lors le premier du nom de difcrete
la petite vérole de S. A. S. L e terme bien imaginé
prit faveur : mais l’efpece de petite vérole en question
n’étoit pas plus nouvelle dans le monde , que
la colique l’étoit du tems deTibere. Si la petite vérole
difcrete devient plus rare parmi les grands , la
colique y dévient plus commune ; & n’eût-elle pour
caufe que la feulé intempérance, on peut préfumer
fans crainte de fe tromper, que ce mal fubfiftera juf-
qu’à la fin du monde. Article de M. le Chevalier d e
Ja v c q v RT.
C o lique bilieuse , ( Midi) efpece de coliqüe
qui procédé d’un débord de bile âcre dans les inteftins.
Cette'efpece de colique eft très-commune , &
régné fur-tout en été 6c au commencement de l’automne
; elle attaque principalement les jeunes gens
d’un tempérament chaud 6c bilieux, les perfonnes
qui vivent d’alimens g r a s , huileux, alkalins 6c pour-
riffans, les gens riches qui ont ce qu’on nomme lès
meilleures tables, fervies des plus rares poiffons 6c
du gibier le plus délicat par fa chair 6c fon fumet.
Les fymptomes de cette maladie font des douleurs
vagues & violentes dans le ventricule, les inteftins,
les hypochondres, le dégoût, les naufées , le vomif-
fement, la eonftipation, des tiraillemens, des agitations
, desfueurs froides, des fyncopes, l’abattement
des fo rce s, là déjeftion d ’une matière jaune, verte,
p o ra cé e , âcre & corrofive.
L ’indication curative confifte à évacuer cette humeur,
à la mitiger 6c à appaifer les douleurs.
On ne peut trop-tôt employer la faignée, les boif- ,
fons aqueufes, Amples, legeres, diluentes, en quantité
; les purgatifs doux , liquides, fouvent répétés ,
6c fuivis des narcotiques après leur effet ; les clyfte-
res , les fomentations adouciffantes fur le bas-ventre
, les bains chauds faits avec les plantes émollientes
, & joints avec foin à tous ces remedes. Pour confirmer
la guérifon 6c empêcher la rechûte, la diete
févere eft abfolument néceffaire , la boiffon de crème
de ris : d’orge , de gruau , les panades , le lait
coupé ,1a promenade en voiture & enfuite à cheval.
Enfin on rétablira peu-à-peu prudemment par les
ftomachiques le ton des vifeeres affoiblis : je renv
o yé le le&eur à Sydenham , qui a donné une def-
criptiôn fi complété 6c fi fage de cette efpece de colique
^fecl.jv. ch. vij. qu’elle ne laiffe rien à defirer.
Article de M. le Chevalier DE J AV COURT.
C o lique de Po ito u , (Mededne. ) efpece particulière
de colique qui provient des exhalaifons , des
préparations de plomb, & de l’ufage des v ins fophi-
ftiqués avec des préparations de ce métal ; en latin
colica Piclonum.
En 1572, dit M. de T h o u , t. VI. p. 5$ j. la France
fut affligée d’une maladie jufqu’alors inconnue, qu’on
nomma colique de Poitou , parce qu’elle commença
à fe faire fentir dans cette province. D è s qu’un homme
en eft attaqué , ajoûte-t-il, fon corps devient
comme paralytique ; il a le vifage p â le , l’efprit inquiet
; des maux de coeur, des vomiffemens, un ho-
quèt continuel, une foif ardente, une difficulté d’uriner
, une douleur violente dans l’eftomac, les inteftins
, les hypochondres , les reins : il y en a même
dont les pié s, les jamb es, & les m ains, deviennent
paralytiques, après avoir été attaqués de con-
vulfions épileptiques , &c. C e trait hiftorique eft
d’autant plus fingulier, que d’un côté il renferme une
defeription exafte des fymptomes de la colique des
plombiers, autrement dite colique des peintres, colique
convulfive faturnine ; 6c que de l’autre on ne comprend
guere comment elle eft reftée inconnue dans ce
royaume jufqu’au tems où M. de Thou en rapporte
la naiffance. Quoi qu’il en foit , c’eft une colique
nerveufe, qui depuis n’a fait que trop de progrès
dans l’E u rope, & dont voici la caufe 6c les fymptomes.
Elle provient des vapeurs qui s’élèvent des fourneaux
où l’on-forid le plomb, que l ’on refpire 6c
que l’on avale avec la falive. Elle eft très - fréquente
parmi les ouvriers qui s’occupent à fondre, à purifier
ce m étal, ou à le féparer de l’argent dans des
fourneaux d’affinage, comme le pratiquent ceux qui
travaillent dans les mines de la forêt Noire en Allemagne
, dans celles d’Angleterre en Derbishire«, 6c
ailleurs, où malgré l’attention que Fon a de ne drëf-
fer les fourneaux que fur des lieux élevés , 6c de les
expofer aux v en ts , les exhalaifons en font fatales
aux ouvriers, aux habitans, & même en Angleterre
aux animaux qui paffent près des minerais de plomb.
Les Potiers de te rre , qui fe fervent de l’alquifoux ,
efpece de plomb minéral difficile à fondre , ou de
plomb en poudre, pour vernir leurs ouvrages , font
fort fujets à cette efpece de colique. Les Peintres qui
employent la cérufe, n’y font pas moins expoles ,
de même que les femmes qui mettent du blanc, com-
pofition pernicieufe par la cérufe qui en fait la bafe,
dont le moindre effet eft celui de deflecher la p eau,
& d’avancer par les rides la vieilleffe qu’elles fe pro-
pofent d’éloigner.
On eft encore convaincu, par plufieurs expériences,
que les médicamens dans lacompofition defquels
il entre du plomb, comme la teinture antiphthifique,
le fuc , fel magiftere ou vitriol de faturne , que les
charlatans preferivent intérieurement contre le crachement
de fan g, le piffement de fa n g , la gonorrhée
, les fleurs blanches, 6c autres maladies fembla-
b le s , produifent enfin cette malheureufe colique.
Mais l’ufage que plufieurs marchands de vin font
aujourd’hui de la cérufe ou de la litharge pour éclaircir
, corriger, édulcorer leurs vins , a fi fort répandu
cette cruelle maladie dans toute l’Eu rope, que
les fouverains font intéreffés à chercher les moyens
les plus convenables pour en arrêter le cours. Perfonne
n’eft à l’abri des triftes effets qui réfultent de
cette fophiftiçation de v ins, 6c particulièrement des
vins acides, comme, par exemple, des vins de Rhin,
que l’on édulcore de cette maniéré en Soüabe 6c ailleurs
avant que les envoyer en Hollande , 6c dans
les autres pays où ces fortes de vins adoucis font
recherchés.
Il eft donc certain que toutes les parties du plomb,
fes exhalaifons, fa poudre, & fes préparations, produifent
principalement la colique de Poitou, dont voic
i les fymptomes.
L e malade eft attaqué de douleurs aiguës 6c in-
fupportables dans le bas-ventre, qui font vagues ou
fixes : il relient une douleur lancinante 6c poignante,
dans l’eftomac, dans le nombril , dans le s hypo-
chondrës, une eonftipation opiniâtre , qui cede à
peine aux lavemens & aux laxatifs ; des agitations
continuelles, le d égoût,des naufées, la pâleur , la
frigidité , des fu eu rs, des fyncopes fréquentes, l’a battement
de toutes les fo r c e s , le trouble dans toutes
les lecrétions, le tremblement, la paralyfie qui
en eft une fuite, ou un afthme fpafmodique incurable
; fymptomes qui ne fe manifeftent dans toute
leur étendue que lorfqu’il n’y a plus de remede.
Pour guérir cette maladie , quand elle n’eft pas
par venue à fo n dernier e x c è s , il faut employer les
apéritifs , le s fondans , les favonneux , lés défobf-
truans, les lénitifs doux & déterfifs en forme liquide
, médiocrement chauds 6c en petite dofe. Dans le
tems des convulfions fp^fmodiques , on donnera les
caïmans, les opiates avec le favon tartareux, o u T o - ,
piummêlé avec le cafloreum, les clyfteres' avec le ,
baume de Copahu. On-appliquera fur le b'as.-ventre
des flanelles trempées cfans une déco&ion d'e-fleurs
de camomille ,de baies de genievre, & de femençes
carminativès des demi-bains faits âvec les plàirttës ;
chaudes 6c nervines. On frofera tout le corps, & én
particulier' les vertébrés 6c le bas-ventre, avec lé s .
fpiritueux, les huiles de-romarin & autres dé cette
efpece. Si 1à paralyfie commence à fe former, il'faut ;
recourir à l’ufage des eàux minérales fulphurèufes;
Un médecin françois a donné il y a plus d’un fie-;
cle un traité latin i/z.40. de colicâ Piclonum, qui eft
inutile aujourd’hui ; mais on trouvera de bonnes ©b-
' fervations fur cette maladie dans la bibliothèque rai-'
fonniè. Article de M. le Chèvalier DE J AV COURT,
' O b liQ U E , adj. en Anatomie , fe dit de quelqués
. v aiffeaux qui fe diftribuent au colon, Voye^ C o-
' lon1, 0 r*
C O L IR , f. m. (Hijl. mod.\ officier de l’empire de
la Chine, dont la fonction eft d’avoir l’infpeûion fur
ce qui fe paffe dans chaque cour ou tribunal, & qui
fans être membre de ces tribunaux, affifte à toutés
les affemblées , 6c reçoit la communication de tontes
les procédures. C ’eft proprement ce que nous appelions
un infpecleur ou contrôleur.
Il a des intelligences fecretes avec la c o u r ;
dans l’occafion il attaque ouvertement les mandarins,
ôc cela non-feulement fur les fautes qu’ils peuvent
commettre dans leurs fondions , mais même
dans leur vie particulière 6c privée.
Pour qu’il foit impartial, ,on le rend entièrement
indépendant, 6c fa charge eft perpétuelle. Les colins
font redoutables, même aux princes du fang. ( G)
C O L IS , f. m. terme de Négoce en ufage à L y on ; il
eft fynon.yme à ballot, balle, caiffe, 6cc. Voyez le
diclionn. du Commerce.
COLISÉE , f. m. ( Hijl. anç. ) On fait que phez
les Romains c’étoit un amphithéâtre ovale que bâtit
l’empereur Vefpafien , près du baffin de la m^ifqn
dorée de Néron.
On y v oyoit des ftatues qui repréfentoient toutes
les provinces de l’empire, & dans le milieu étoit celle
de Rome tenant une pomme d’or dans fa main. Qn
donnoit encore le nom de colij'èe à un autre amphithéâtre
bâti par l’empereur Sévere.
On repréfentoit dans le colifée des jeu x & d<es combats
de'gladiateurs 6c de bêtes fauvages. Ce qui refte
aujourd’hui de ces édifices eft très-peu de chofe, je
tems & la guerre les ayant réduits en ruines. Voyé£
Amphithéâtre. Dicl. de Trév. £ de Moreri, (G)
* C O L IS SE , f. m. (Ma/ii/f. en foie.') for,te de m ailles
entre lefquelles on prend les fils de la chaîne .ou
du p o il , pour les faire lever & baiffer à diferétion.
Il y a les mailles à grand colijfe , 6c les mailles k çolijfc
(impie. Voye^ l’article V e l o u r s .
C O L L A G E , (Jurifprf voyei ÇoLAGE. .
C o l l a g e , terme de Papeterie; c’eft la dernière
préparation que l’on donné au papier, 6c qui le met
en é tat de recevoir l’écriture. Cette préparation
confifte à. l’enduire feuille par feuille d’une colle
faite avec dçs: rognures de parchemin & de peaux
de mouton, & quelque? autres ingrédiens qu’on y
ajoûte. Pour la maniéré de coller le papier, voye^ Carticle
pAPiEft, 6c PI. VII. de Papeterie, qui contient
les deux manières de coller : la première marquée
B , confifte à étendre la feuille de papier fur un chaf-
fis I qui porte fur les bords de la cuve K , 6c à verfer
deflùs de la colle avec l’écuelle H , enforte que la
feuille, en foit entièrement imbibée ; c ’eft aiifti ou’on
colle les cartons : l’antre manière reptéfentée .en Ç,
1e fait en prenant plufieurs feuilles de papier enïem-
ble avec les.reglettes D , plongeant le tout.da.rjs
la chaudiere.fi , .d’abord de la main droite , 6c en-
fuite d e I4 gauche , que fo n ne met dans la chaudière
que lorfque la droite .en, eft fortie : après cela
: l’ouvrier pofe le papier fnr l,a table de iapreffe D ,
qui a une rigole à l’entour, pou* retenir la colle qui
s’écoule lorlqu’o n l’exprime, par une ouverture p
; dans le feaq F , d’où on la. remet dans la chaudie-
: re : cette jchaydiere pofe fur un trépié -Æ , fpus lequel
on met un réchaud G po ur entretenir la chaleur
de la colle.
La cuve ou chaudière dans laquelle fe fait la colle
eft poféè fimiin fourneaii de maçonnerie C:- Aplomb
du centre de la chaudière eft une poulie H , defius
laquelle paffe une corde que l'ouvrier A deyide au tour
d’un treuil fcellé à la muraille ; au bout qui
pend dans la.chaudière eft attaché un panier de. laiton
B ,[dont les chaînes garnies.de erpehets peuvent
s’attacher à d’anneau qui eft au bout de la, corde ;
c’eft dans cette efpece dé papier q.u’on met le s rognures
de parchemins ou de. peaux de mouton dont