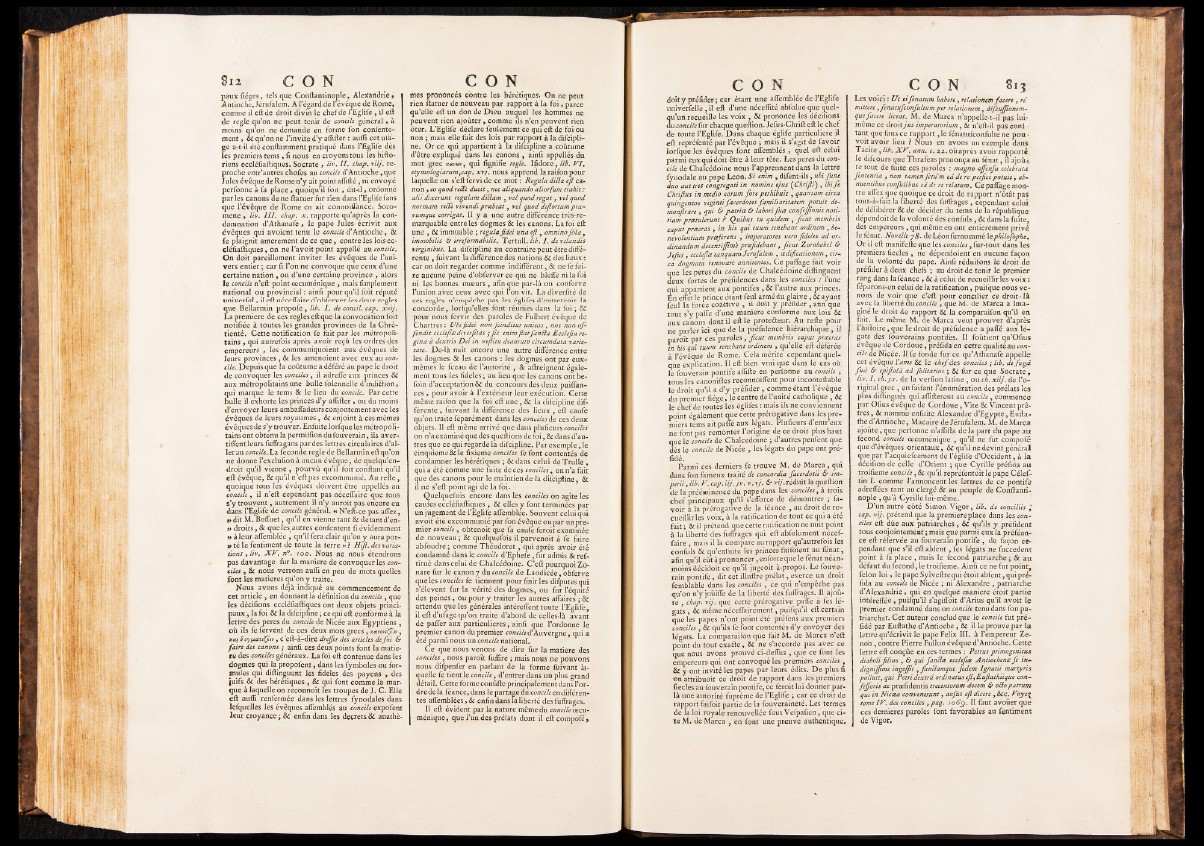
p aux lièges, tels que Conftantinople, Alexandrie »
Antioche, Jérufalem. A l’égard de l’évêque de Rome,
comme il eft de droit divin le chef de l’Eglife , il eft
de réglé qu’on ne peut tenir de concile général, à
moins qu’on ne demande en forme fon confente-
ment, 8c qu’on ne l’invite d’y aflifter : auffi cet uia-
ge a-t-il été conftamment pratiqué dans l’Eglife dès
les premiers tems , fi nous en croyons tous les hifto-
riens eccléfiafiiques. Socrate > liv. II. chap. viij. reproche
entr’autres chofes au concile d’Antioche, que
Jules évêque de Rome n’y ait point affilié, ni envoyé
perfonne à fa place, quoiqu’il fo i t , dit-il, ordonné
parles canons de ne ftatuer fur rien dans l’Eglife fans
que l’évêque de Rome en ait connoiflance. Sozo-
mene , liv. I I I . chap. x. rapporte qu’après la condamnation
d’Athanafe, le pape Jules écrivit aux
évêques qui a voient tenu le concile d’Antioche, &
fe plaignit amerement de ce que, contre les lois eccléfiafiiques
, on ne l ’avoit point appellé au concile.
On doit pareillement inviter les évêques de l’univers
entier ; car fi l’on ne convoque que ceux d’une j
certaine nation, ou d’une certaine province , alors
le concile n’efi point oecuménique , mais Amplement
national ou provincial : ainfi pour qu’il foit réputé
univerfel, il eft néceflaire d’oblerver les deux réglés
que Bellarmin propofe, lib. I . de concil. cap. xvij.
La première de ces réglés eft que la convocation foit
notifiée à toutes les grandes provinces de la Chrétienté.
Cette notification fe Fait par les métropolitains
, qui autrefois après avoir reçu les ordres des
empereurs , les communiquoient aux évêques de
leurs provinces, & les amenoient avec eux au concile.
Depuis que la coutume a déféré au pape le droit
de convoquer les conciles, il adreffe aux princes 8c
aux métropolitains une bulle l'olennelle d’indiftion,
qui marque le tems & le lieu du concile. Par cette
bulle il exhorte les princes d’y aflifter , ou du moins
d’envoyer leurs ambaffadeursconjontementavec les
évêques de leurs royaumes, & enjoint à ces mêmes
évêques de s’y trouver. Enfuite lorfque les métropolitains
ont obtenu la permiffion dufouverain, ils aver-
tiflent leurs fuffraganspardes lettres circulaires d’aller
au concile. La fécondé réglé de Bellarmin eft qu’on
ne donne l’exclufion à aucun évêque, de quelqu’en-
droit qu’il vienne , pourvu qu’il foit confiant qu’il
eft évêque, & qu’il n ’eft pas excommunié. Au refte,
quoique tous les évêques doivent être appellés au
concile , il n’eft cependant pas nécefiaire que tous
s’y trouvent, autrement il n’y auroit pas encore eu
dans l’Eglife de concile général. « N’eft-ce pas allez,
»> dit M. Bofluet, qu’il en vienne tant 8c detantd’en-
» droits, & que les, autres confentent fi évidemment
» à leur afiemblée , qu’il fera clair qu’on y aura por-
v té le fentiment de toute la terre » ? Hifi. des variations
, liv. X K . n°. 100. Nous ne nous étendrons
pas davantage fur la maniéré de convoquer les conciles
, & nous verrons auffi en peu de mots quelles
font les matières qu’on y traite.
Nous avons déjà indiqué au commencement de
cet article , en donnant la définition du concile, que
les décifions eccléfiaftiques ont deux objets principaux
, la foi & la difeipline ; ce qui eft conforme à la
lettre des peres du concile de Nicée aux Egyptiens ,
où ils fe fervent de ces deux mots grecs, v.axm'Çn,
xetf <f oypucnÇiv , c ’eft-à-dire drejfer des articles de foi &
faire des canons ; ainfi ces deux points font la matière
des conciles généraux. La foi eft contenue dans les
dogmes qui la propofent, dans les fymboles ou formules
qui diftinguent les fideles des payens , des
juifs 8c des hérétiques , & qui font comme la marque
à laquelle on reconnoît les troupes de J. C. Elle
eft auffi renfermée dans les lettres fynodales dans
lefquelles les évêques aflemblés au concile expofent
leur croyance ; 6c enfin dans les decrets 6c anathèmes
prononcés contre les hérétiques. On ne peut
rien ftatuer de nouveau par rapport à la fo i, parce
qu’elle eft un don de Dieu auquel les hommes ne
peuvent rien ajoûter, comme ils n’en peuvent rien
ôter. L’Eglife déclare feulement ce qui eft de foi ou
non ; mais elle fait des lois par rapport à la difeipline.
Or ce qui appartient à la difeipline a coûtume
d’être expliqué dans les canons , ainfi appellés du
mot grec kavwv , qui fignifie réglé. Ifidore, lib. K l.
etymologiarum^cap. xvj. nous apprend la raifon pour
laquelle on s’eft fervi de ce mot : Régula dicta efi canon
y eo quod rectè ducit, nec aliquando aliorfum trahit :
alii dixerunt régulant dictant, vel quod regat, vel quod
normam rectè vivendi prabeat, vel quod difiortum pra-
vumque corrigat. Il y a une autre différence très-remarquable
entre les dogmes & les canons. La foi eft
une , 8c immuable ; régula fidei una eft, omnino fola,
immobilis & irreformabilis. Tertull. lib. I. de velandis
virginibus. La difeipline au contraire peut être différente
, fuivant la différence des nations 6c des lieux :
car on doit regarder comme indifférent, & ne fe faire
aucune peine d’obferver ce qui ne blefle ni la foi
ni les bonnes moeurs, afin que par-là on conferve
l’union avec ceux avec qui l’on vit. La diverfité de
ces réglés n’empêche pas les églifes d’entretenir la
concorde, lorfqu’elles font réunies dans la foi ; 6c
pour nous fervir des paroles de Fulbert évêque de
Chartres : Ubi fidei non feinditur uni tas , nos non of-
fondit ecclejia diverfîtas ; Jîc enimfiat fancta Ecclejia re-
gina à dextris Dei in vefiitu deaurato circumdata varie-
tate. De-là naît encore une autre différence entre
les dogmes & les canons : les dogmes ont par eux-
mêmes le fceau de l’autorité , & aftreignent également
tous les fideles ; au lieu que les canons ont be-
foin d’acceptation 6c du concours des deux puifian-
ces, pour avoir à l’extérieur leur exécution. Cette
même raifon que la foi eft une, 6c la difeipline différente
, fuivant la différence des lieux , eft caufe
qu’on traite féparément dans les conciles de ces deux
objets. Il eft même arrivé que dans plufieurs conciles
on n’a examiné que des queflions de fo i, 6c dans d’autres
que ce qui regarde la difeipline. Par exemple, le
cinquième 6c le fixieme conciles fe font contentés de
condamner les hérétiques ; 6c dans celui de T rulle,
qui a été comme une fuite de ces conciles, on n’a fait
que des canons pour le maintien de la difcipfline, 8c
il ne s’eft point agi de la foi.
Quelquefois encore dans les conciles ôn agite les
caufes eccléfiaftiques , 6c elles y font terminées par
un jugement de l’Eglife affemblee. Souvent celui qui
avoit été excommunié par fon évêque ou par un premier
concile , obtenoit que fa caufe feroit examinée
de nouveau; 6c quelquefois il parvenoit à fe faire
abfoudre ; comme Théodoret, qui après avoir été
condamné dans le concile d’Ephelë, fut admis 6c ref-
titué dans celui de Chalcédoine. C ’eft pourquoi Zo-
nare fur le canon 7 du concile de Laodicée, obferve
que les conciles fe tiennent pour finir les difputes qui
s’élèvent fur la vérité des dogmes, ou fur l’équité
des peines, ou pour y traiter les autres affaires ; 6c
attendu que les générales intéreflent toute l’Eglife,
il eft d’ufage qu’on traite d’abord de celles-là avant
de paffer aux particulières, ainfi que l’ordonne le
premier canon du premier concile d’Auvergne, qui a
été parmi nous un concile national.
Ce que nous venons de dire fur la matière des
conciles , nous paroît fuffire ; mais nous ne pouvons
nous difpenfer en parlant de la forme fuivant laquelle
fe tient le concile, d’entrer dans un plus grand
détail. Cette forme confifte principalement dans l’ordre
de la féance, dans le partage du concile en différentes
afîemblécs, 8c enfin dans la liberté des fuffrages.
Il eft évident par la nature même du concile oecu-
ménique, que l’un des prélats dont il eft çompofé,
doit y préfider ; car étant une afiemblée de l’Eglife
univerfelle, il eft d’une néceffité abfolue que quelqu’un
recueille les voix , 6c prononce les décifions
du concile fur chaque queftion. Jefus-Chrift eft le chef
de toute l’Eglife. Dans chaque églife particulière U
eft repréfenté par l’évêque ; mais il s’agit de favoir
lorfque les évêques font aflemblés , quel eft celui
parmi eux qui doit être à leur tête. Les peres du con-
die de Chalcédoine nous l’apprennent dans la lettre
fynodale au pape Leon. Si enim , difent-ils, ubi funt
duo aut très congregati in nornine ejus ( Chrifii) , ibife
Chrifius in medio eorum fore ptrhibuit, quantam circa
quingentos viginti facerdotes familiaritatem potuit de-
monfirare , qui & patriot & labori Jua confeffionis noti-
tiam prcetulerunt ? Quibus tu quidem , Jîcut membris
caput praéras , in his qui tuum tenebant ordinem\, be-
nevolentiam preeferens , imper afores vero fideles ad or-
dinandum decentifjîmè prafidebant, Jîcut Zorobabel &
Jefus y ecclejia tanquam Jerufalem , cedificationem, cir->
ca dogmata renovare anrùtentes. Ce paflage fait voir
que les peres du concile de Chalcédoine diftinguent
deux fortes de préfidences dans les conciles : l’une
qui appartient aux pontifes , 8c l’autre aux princes. ;
En effet le prince étant feul armé du g laiv e, 6c ayant ;
feul la force coàâive , il doit y préfider , afin que
tout s’y pafle d’une maniéré conforme aux lois 8c
aux canons dont il eft le prote&eur. Au refte pour
ne parler ici que de la préfidence hiérarchique , il
paroît par ces paroles, Jîcut membris caput pr aéras
in his qui tuum tenebant ordïnem , qu’elle eft déférée
à l’évêque de Rome. Cela mérite cependant quelque
explication. Il eft bien vrai que dans le cas où
le fouverain pontife affifte en perfonne au concile ,
tous les canoniftes reconnoiflent pour inconteftable
le droit qu’il a d’y préfider , comme étant l’évêque
du premier fiége, le centre de l’unité catholique , 6c
le chef de toutes les églifes : mais ils ne conviennent
point également que cette prérogative dans les premiers
tems ait pafle aux légats. Plufieurs d’entr’eux
ne font pas remonter l’origine de ce droit plus haut
que le concile de Chalcédoine ; d’autres penfent que
dès le concile de Nicée , les légats du pape ont pré-
fidé.
Parmi ces derniers fe trouve M. de Marca, qui
dans fon fameux traité de concordia Jacerdotii & im-
perii, lib. K. cap. iij.jv . v. vj. & v ÿ . réduit la queftion
de la prééminence du pape dans les conciles, à trois
chef principaux qu’il s’efforce de démontrer ; favoir
à la prérogative de la féance , au droit de recueillir
les voix, à la ratification de tout ce qui a été
fait ; 8c il prétend que cette ratification ne nuit point
à la liberté des fuffrages qui eft abfolument nécef-
faire , mais il la compare au rapport qu’autrefois les
confuls 6c qu’eni'uite les princes faifoient au fénat,
afin qu’il eût à prononcer, enfôrteque le fénat néanmoins
décidoit ce qu’il jugeoit à-propos. Le fouverain
pontife, dit cet illuftre prélat, exerce un droit
femblable dans les conciles , ce qui n’empêche pas
qu’on n’y joiiifîe de la liberté des fuffrages. Il ajoû-
te , chap. vij. que cette prérogative pafle à fes légats
, & même néceflairement, puifqu’il eft certain
que les papes n’ont point été préfens aux premiers
conciles , 6c qu’ils fe font contentés d’y envoyer des
légats. La comparaifon que fait M. de Marca n’eft
point du tout exafte, 6c ne s’accorde pas avec ce
que nous avons prouvé ci-deflus , que ce font les
empereurs qui ont convoqué les premiers conciles ,
6c y ont invité les papes par leurs édits. De plus fi
on attribuoit ce droit de rapport dans les premiers
fiecles au fouverain pontife, ce feroit lui donner par-
là une autorité fuprème de l’Eglife ; car ce droit de
rapport faifoit partie de la fouveraineté. Les termes
de la loi royale renouvellée fous Velpafien, que cite
M. de Marca , en font une preuve authentique.
Les voici : Ut eifenatum habere, relationtm facere, re
mittere ,fenatufconfultum per relationtm, difcujjionem-
qw facere liceat. M. de Marca n’appelle-t-il pas lui-
meme ce droit ju s imperatorium, 6c n’eft-il pas conl •
tant que fans ce rapport, le fénatufconfulte ne pou j
voit avoir lieu ? Nous en avons un exemple dans
Tacite , lib. X K , ann. c. 22. où après avoir rapporté
le difeours que Thrafeas prononça au fénat, il ajoû j
te tout de fuite ces paroles : magne ajfenfu celebrata
fententia , non tamen fetum eâ de re perfici potuit y ab-
nuentibus conjulibus eâ de re relatum. Ce paflage montre
aflez que quoique ce droit de rapport n’ôtât pas
tout-à-fait la liberté des fuffrages , cependant celui
de délibérer 6c de décider du tems de la république
dépendoit de la volonté des confuls, 6c dans la fuite,
des empereurs , qui même en ont entièrement privé
le fénat. NovelleyS. deLéonfurnommé lephilofophe.
Or il eft manifefte que les conciles, fur-tout dans les
premiers fiecles , ne dépendoient en aucune façon
de la volonté du pape. Ainfi réduifons le droit de
préfider à deux chefs ; au droit de tenir le premier
rang dans la féance, 6c à celui de recueillir les v o ix:
féparons-en celui de la ratification, puilque nous v enons
de voir que c’eft pour concilier ce droit-là
avec la liberté du concile , que M. de Marca a imaginé
le droit de rapport 6c la comparaifon qu’il en
fait. Le même M. de Marca veut prouver d’après
l’hiftoire, que le droit de préfidence a pafle aux légats
des fouverains pontifes. Il foûtient qu’Ofius
évêque de Cordoue , préfidaen cette qualité au concile
de Nicée. Il fe fonde fur ce qu’Athanafe appelle
cet évêque Vame 8c le chef des conciles ; lib. de fugâ
fuâ & epifiolâ ad folitarios ; 8c fur ce que Socrate ,
liv. I. ch. j x . de la verfion latine , ou ch. x iij. de l’original
grec , en faifant l’énumération des prélats les
plus diftingués qui affifterent au concile, commence
par Ofius évêque de Cordoue, Vite 6c Vincent prêtres
, & nomme enfuite Alexandre d’Egypte, Eufta-
the d’Antioche, Macaire de Jérufalem. M. de Marca
ajoûte,que perfonne n’aflifta delà part du pape au
fécond concile oecuménique , qu’il ne fut compofé
que d’évêques orientaux, 6c qu’il ne devint générai
que par l’acquiefcement de l’églile d’Occident, à la
décifion de celle d’Orient ; que Cyrille préfida au
troifieme concile, 6c qu’il repréfentoit le pape Célef-
tin I. comme l’annoncent les lettres de ce pontife
adreffées tant au clergé 6c au peuple de Conftantinople
,qu ’à Cyrille lui-même.
D ’ un autre côté Simon Vigor, lib. de conciliis y
cap. vij. prétend que la première place dans les conciles
eft dûe aux patriarches, 6c qu’ils y préfident
tous conjointement ; mais que parmi eux la préféan-
ce eft réfervée au fouverain pontife , de façon cependant
que s’il eft abfent, fes légats ne fuccedent
point à fa place , mais le fécond patriarche ; & au
défaut du fécond,le troifieme. Ainfi ce ne fut point,
félon lu i, le pape Sylveftrequi étoit abfent, qui préfida
au concile de Nicée ; ni Alexandre , patriarche
d’Alexandrie , qui en quelque maniéré étoit partie
intéreffée, puifqu’il s’agifloit d’Arius qu’il avoit le
premier condamné dans un concile tenu dans fon pa-
triarchat. Cet auteur conclud que le concile fut pré-
fidé par Euftathe d’Antioche , 6c il le prouve par la
lettre qu’écrivit le pape Félix III. à l’empereur Ze-
no'n, contre Pierre Fullon évêque d’Antioche. C ette
lettre eft conçue en ces termes : Petrus primogenitus
diaboli filius , & qui fancta ecclejia Antiochena fe in-
dignijjîme ingejjit, fanciamque fedem Ignatii martyns
polluit, qui Pétri dextrâ ordinatus efiyEufiathiique con-
fejforis ac præfidentis trecentorum decem & o3opatrunt
qui in Nicoea convenerunt, aufus efidicere , 8cc. Koye^
tome IK. des conciles, pag. io&c). Il faut avoiier que
ces dernieres paroles font favorables au fentiment
de Vigor,