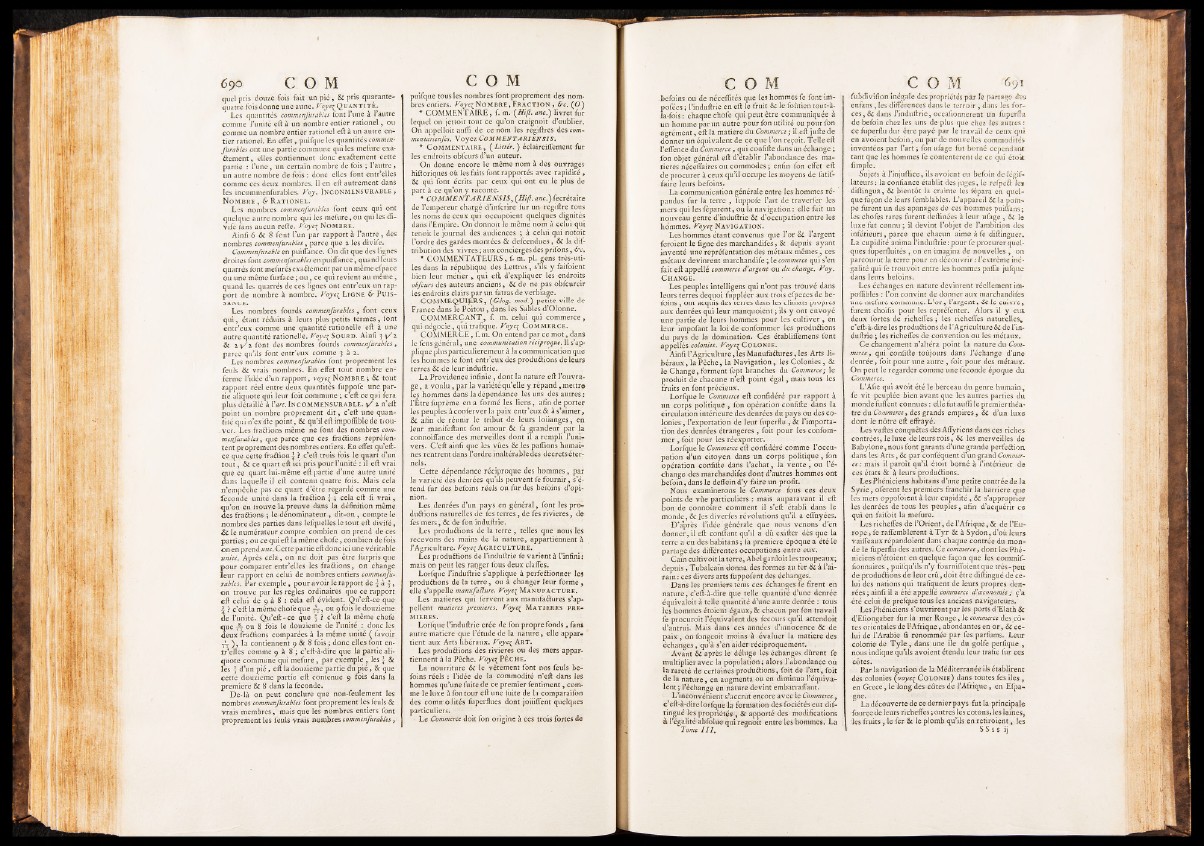
quel pris douze fois fait un p ié , 8c pris quarante-
quatre fois donne une aune. Voyt{ Q u an t it é .
Les quantités commenfurables font l’une à l’autre
comme l’unité eft à un nombre entier rationel, ou
comme un nombre entier rationel eft à un autre entier
rationel. En effet, puifquë les quantités commenfurables
ont .une partie commune qui les mefure exactement
, elles contiennent donc exactement cette
partie : l’une, un certain nombre de fois ; l ’autre,
lin autre nombre de fois : donc elles font entr’elles
comme ces deux nombres. Il en eft autrement dans
les incommenfurables. Voy. Inconmensurable ,
Nombre , & Rat io n e l .
Les nombres commenfurables font ceux qui ont
quelque autre nombre qui les mefure, ou qui les di-
vifé iàns aucun refte. Voye{ Nombre.
Ainfi 6 8c 8 font l’un par rapport à l’autre , des
nombres commenfurables, parce que i les divife.
Commenfurable en puiffance. On dit que des lignes
droites font commenfurables en puiffance, quand leurs
quarrés font mefurés exactement par un memeefpace
ou une même furface ; ou , ce qui revient au même,
quand les quarrés de ces lignes ont entr’eux un rapport
de nombre à nombre. Voyeç Ligne & Puissan
ce.
Les nombres fourds commenfurables, font ceux
qui, étant réduits à leurs plus petits termes, font
entr’eux comme une quantité rationelle eft à une
autre quantité rationelle. Voye^ Sourd. Ainfî 3 \/x
& 2 1/2 font des nombres, fourds commenfurables 3
parce qu’ils font entr’eux comme 3 à 2.
Les nombres commenfurables font proprement les
feuls 8c vrais nombres. En effet tout nombre enferme
l’idée d’un rapport, vcye£Nombre ; 8c tout
rapport réel entre deux quantités fuppofe une partie
aliquote qui leur foit commune ; c’eft ce qui fera
plus détaillé à l'art. Incommensurable, yf 2 n’eft
point un nombre proprement d it , c’eft une quantité
qui n’exifte point, & qu’ileftimpofliblede trou-
,ver. Les fraérions même ne font des nombres commenfurables
, que parce que ces fr a étions repréfen-
tent proprement des nombres entiers. En effet qu’eft-
ce que cette fraûion \ } c’ eft trois fois le quart d’un
tout, & ce quart eft ici pris pour l’unité : il eft vrai
que ce quart lui-même eft partie d’une autre unité
dans laquelle il eft contenu quatre fois. Mais cela
n’empêche pas ce quart d’être regardé comme une
fécondé unité dans la fraÇtion £ ; cela eft fi v ra i,
qu’on en trouve la preuve dans la définition même
des fraérions ; le. dénominateur, dit-on , compte le
nombre des parties dans lefquelles le tout eft divifé,
& le numérateur compte combien on prend de ces
parties ; ou ce qui eft la même chofe, combien de fois
on en prend une. Cette partie eft donc ici une véritable
unité. Après cela , on ne doit pas être furpris que
pour comparer entr’elles les fraftions, on change
leur rapport en celui de nombres entiers commenfu-
rables. Par exemple, pour avoir le rapport de } à f ,
on trouve par les réglés ordinaires que ce rapport
eft celui de 9 à 8 : cela eft évident. Qu’eft-ce que
\ ? c’eft la meme chofe que ou 9 fois le douzième
de l’unité. Qu’eft-ce que f ? c’eft la même chofe
que ou 8 fois le douzième de l’unité : donc les
deux fraftions comparées à la même unité ( (avoir
JL. ) , la contiennent 9 8c 8 fois ; donc elles font en-
ir ’elles comme 9 à 8 ; c’eft-à-dire que la partie aliquote
commune qui mefure, par exemple, les \ &
les y d’un pié , eft la douzième partie du p ie, & que
cette douzième partie eft Contenue 9 fois dans la
première 8c 8 dans la fécondé.
De-là on peut conclure que non-feulement les
nombres commenfurables font proprement les feuls &
vrais membres , mais que les nombres entiers font
proprement les feuls vrais nombres commenfurables
puifque tous les nombres font proprement des nombres
entiers. Voye^Nombre, Fraction , &c. (O )
* COMMENTAIRE, f. m. ( Hiß. anc.) livret fur
lequel on jettoit tout ce qu’on craignoit d’oublier.
On appelloit aufli de ce nom les regiftres des com-
mentarienfes. Voyez Co m m e n t ar i e n s i s .
* C ommentaire, ( Littér. ) éclairciffement finies
endroits obfcurs d’un auteur.
On donne encore le même nom à des ouvrages
hiftoriques où les faits font rapportés avec rapidité ,
8c qui font écrits par ceux qui ont eu le plus de
part à ce qu’on y raconte.
* CO MME NTA RIE NS IS, {Hiß. anc.') fecrétaire
de l’empereur chargé d’infcrire fur un regiftre tous
les noms de ceux qui occupoient quelques dignités
dans l’Empire. On donnoit le même nom à celui qui
tenoit le journal des audiences ; à celui qui notoit
l’ordre des gardes montées & defcendues, 8c la distribution
des v iv re s; aux concierges des prifons, &c.
* COMMENTATEURS, f. m. pl. gens très-utiles
dans la république des L e ttre s, s’ils y faifoient
bien leur métier y qui e ft d’expliquer les endroits
obfcurs des auteurs anciens, & de ne pas obfcurcir
les endroits clairs par un fatras de verbiage.
COMMEQUIJLRS, (Géog. mod.) petite ville de
France dans le Poitou, dans les Sables d’Olonne.
COM MER ÇAN T, f. m. celui qui commerce,
qui négocie, qui trafique. Voye[ Commerce.
COM MER CE, f. m. On entend par ce m ot, dans
le fens général, une communication réciproque. Il s’applique
plus particulièrement à la communication que
les hommes le font entr’eux des produirions de leurs
terres 8c de leur induftrie.
La Providence infinie, dont la nature eft l’ouvrag
e , a v o u lu , par la variété qu’elle y répand , mettre
les hommes dans la dépendance les uns des autres :
l’Être ïiiprème en a formé les liens, afin de porter
les peuples àconferver la paix entr’eux & à s’aimer,
8c afin de réunir le tribut de leurs loiianges, en
leur manifeftant fon amour 8c fa grandeur par la
connoiffance des merveilles dont il a rempli l’univers.
C ’eft ainfi que les vûes 8d les paflions humaines
rentrent dans l’ordre inaltérable des decrets éternels.
Cette dépendance réciproque des hommes, parla
variété des denrées qu’ils peuvent fe fournir, s’étend
fur des befoins réels ou fur des befoins d’opinion.
Les denrées d’un pays en général, font les productions
naturelles de les terres, de fes rivières, de
fes m ers, 8c de fon induftrie.
Les productions de la terre , telles que nous les
recevons des mains de la nature, appartiénnent à
l’Agriculture. Voye{ Agriculture.
Les productions de l’indultrie fe varient à l’infini :
mais on peut les ranger fous deux claffes.
Lorfque l’induftrie s’applique à perfectionner les
productions de la terre, ou à changer leur forme,
elle s ’appelle manufacture. Voye[ Manufacture.
Les matières qui fervent aux manufactures s ’appellent
matières premières. Voye[ MATIERES PREMIERES.
Lorfque l’induftrie crée de fon propre fonds, fans
autre matière que l’étude de la nature, elle appartient
aux Arts libéraux. Voye^ Art.
Les productions des rivières ou de? mers appartiennent
à la Pêche. Voye^ Pê c h e .
L a nourriture 8c le vêtement font nos feuls befoins
réels : l’idée de la commodité n’eft dans les
hommes qu’une fuite de ce premier fentiment, comme
le luxe à fon tour eft une fuite de la comparaifon
des commodités fuperflues dont joüiffent quelques
particuliers..
L e Commerce doit fon origine à ces trois fortes de
.befoins ou de néceflités que les hommes fe font im-
pofées ; l’induftrie en eft le fruit 8c le foûtien tout-à-
la-fois : chaque chofe qui peut être communiquée à
un homme par un autre pour fon utilité ou pour fon
agrément, eft la matière du Commerce; il.eft jufte de
donner un équivalent de ce que l’on reçoit. Telle eft
l’eflence du Commerce, qui confifte dans un échange ;
fon objet général eft d’établir l’abondance des matières
néceffaires ou commodes ; enfin fon effet eft
de procurer à ceux qu’il occupe les moyens de fatif-
faire leurs befoins.
L a communication générale entre les hommes répandus
fur la terre , fuppofe l’art de traverfer les
mers qui les féparent, ou la navigation : elle fait un
nouveau genre d’induftrie 8c d’occupation entre les
hommes. Voye[ Navigation.
Les hommes étant convenus que l’or 8c l’argent
feroient le ligne des marchandifes, & depuis ayant
inventé une repréfentation des métaux mêmes, ces
métaux devinrent marchandife ; le commerce qui s’en
fait eft appellé commerce d'argent ou du change. Voy.
C hange.
Les peuples intelligens qui n’ont pas trouvé dans
leurs terres dequoi fuppléer aux trois efpeces de befoins
, ont acquis des terres dans les climats propres
aux denrées qui leur manquoiént ; ils y ont envoyé
une partie de leurs hommes pour les cultiver , en
leur impofant la loi de confommer les produirions
du pays de la domination. Ces établifi'emens font
appellés colonies. Voye^ Colonie.
Ainfi l’Agriculture, les M anufactures, les Arts lib
éraux, la Pêche, la Navig ation , les C o lonie s, &
le Change, forment fept branches du Commerce; le
produit de chacune n’eft point é g a l , mais tous les
fruits en font précieux.
Lorfque le Commerce eft confidéré par rapport à
un corps politique , fon opération confifte dans la
circulation intérieure des denrées du pays ou des colonies
, l’exportation de leur fuperflu , & l’importation
des denrées étrangères , foit pour les confommer
, foit pour les réexporter.
Lorfque le Commerce eft confidéré comme l’occupation
d’un citoyen dans un corps politique, fon
opération confifte dans l’a ch a t, la v e n te , ou l’échange
des marchandifes dont d’autres hommes ont
befoin, dans le deffein d’y faire un profit.
Nous examinerons le Commerce fous ces deux
points de vûe particuliers : mais auparavant il eft
bon de connoître comment il s’eft établi dans le
monde, & les diverfes révolutions qu’il a effuyées.
D ’a’près l’idée générale que nous'1 venons d ’en
donner, il eft confiant qu’il a dû exifter dès que la
terre a eu des habitans ; fa première époque a été le
partage des différentes occupations entre eux.
Caïn cultivoit la terre, Abel gardoit les troupeaux;
depuis, Tubalcaïn donna des formes au fer 8c à l’airain
: ces divers arts fuppofent des échanges.
Dans les premiers tèms ces échanges fe firent en
nature, c’eft-à-dire que telle quantité d’une denrée
équivaloit à telle quantité d’une autre denrée : tous
les hommes étoient égaux, & chacun par fon travail
fe procuroit l’équivalent des fecours qu’il attendoit
d’autrui. Mais dans ces années d’innocence 8c de
p a ix , on fongeoit moins -à évaluer la matière des
échanges, qu’à s ’en aider réciproquement.
Avant 8c après le déluge les échanges dûrent fe
multiplier avec la population; alors l’abondance ou
la rareté de certaines productions, foit de l’a r t , foit
de la nature, en augmenta ou en diminua l’équiva>-
lent; ^échange en nature devint embarraffant.
L ’inconvénient s-’ac-crut encore avec le Commerce,
c’eft-à-dire lorfque la formation des fociétés eut dif-
tingué les propriétés-1, 8c apporté' des modifications
à l’égalité abfolue qui regnoit entre les hommes. La
Tome I I I .
fubdivifion inégale des propriétés par le partage d'es
enfans, les différences dans le terroir , dans les forc
es, 8c dans l’induftrie, occafionnerent lin fuperflu
de befoin chez les uns de plus que chez les autres :
ce fuperflu dur être p ayé par le travail de ceux qui
en avoient befoin, ou par de nouvelles commodités
inventées par l’a r t ; fon ufage fut borné cependant
tant que les hommes fe contentèrent de ce qui étoii
fimple.
Sujets à l’injuftice, ils avoient eu befoin de législateurs
: la confiance établit des juges, le refpeil le#
diftingua, 8c bientôt la crainte les Gépara en quelque
façon de leurs femblables. L’appareil 8c la poni»
pe furent un des apanages de ces hommes puiflans;
les chofes rares furent deftinées à leur ufage , 8c le
luxe fut connu ; il devint l’objet de l’ambitipn des
inférieurs, parce que chacun aime à fe diftinguer.
La cupidité anima l’induftrie: pour fe procurer quelques
fuperfluités , on en imagina de nouvelles , on
parcourut la terre pour en découvrir : l’extrême inégalité
qui fe trouvoit entre les hommes paffa jufque
dans leurs befoins.
Les échanges en nature devinrent réellement im-
poflibles : l’on convint de donner aux marchandifes
une mefure commune. L ’o r , l’argen t, 8c le cuivre,
furent choifis pour les repréfenter. Alors il y eut
deux fortes de richeffes ; les richeffes naturelles,,
c’eft-à-dire les produirions de l ’Agriculture 8c de l’induftrie
; les richeffes de convention ou les métaux.
Ce changement n’altéra point la nature du Commerce
, qui confifte toujours dans l’échange d’une
denrée, foit pour une autre , foit pour des métaux.
On peut le regarder comme une fécondé époque du
Commerce.
L ’Afie qui avoit été le berceau du genre humain,
fe vit peuplée bien avant que les autres parties du
monde fuffent connues : elle fut aufli le premier théâtre
du Commerce, des grands empires, 8c d’un luxe
dont le nôtre eft effrayé.
Les vaftes conquêtes des Aflyriens dans ces riches
contrées, le luxe de leurs ro is, 8c les merveilles de
Babylone,. nous font garants d’une grande perfection
dans les A rts, 8c par conféquent d’un grand Commerce
: mais il paroît qu’il étoit borné à l’intérieur de
•ces états & à leurs productions.
Les Phéniciens habitans d’une petite contrée de la
S y rie , oferent les premiers franchir la barrière que
les mers oppofoient à leur cupidité , 8c s’approprier
les denrées de .tous les peuples, afin d’acquérir ce
qui en faifoit la mefure.
' Les richeffes de l’Orient, de l’Afrique, & de l’Europe
, le raffemblerent à T y r 8c à Sydon, d’oii leurs
vaiffeaux répandoient dans chaque contrée du monde
le fuperflu des autres. C e commerce , dont les Phéniciens
n’étoient en quelque façon que les commifi-
fionnaires, puifqu’ils n’y fourniffoient que très-peu
de productions de leur c rû , doit être diftingué de celui
des nations qui trafiquent de leurs propres denrées
; ainfi il a été appellé commerce d’oeconomie ; ç’a
été celui de prefque tous les anciens navigateurs.
Les Phéniciens s’ouvrirent par les ports d ’Elath 8c
d’Efiongaber fur la mer Rou g e , le commerce des côtes
orientales de PAfrique, abondantes en o r , 8c celui
de l’Arabie fi renommée par fes parfums. Leur
colonie de T y le y dans une île du golfe perfique ,
nous indique qu’ils avoient étendu leur trafic fur ces
côtes.
Par la navigation de la Méditerranée ils établirent
des colonies (yoye^ C olonie) dans toutes fes î l e s ,
en Grece, le long des côtes de l’Afrique, en Efpa-
gne.
La découverte de ce dernier pays fut la principale
fource de leurs richeffes ; outres les cotons, les laines,
'tes fruits, le fer 8c le plomb qu’ils en retiroient, les
S S s s ij