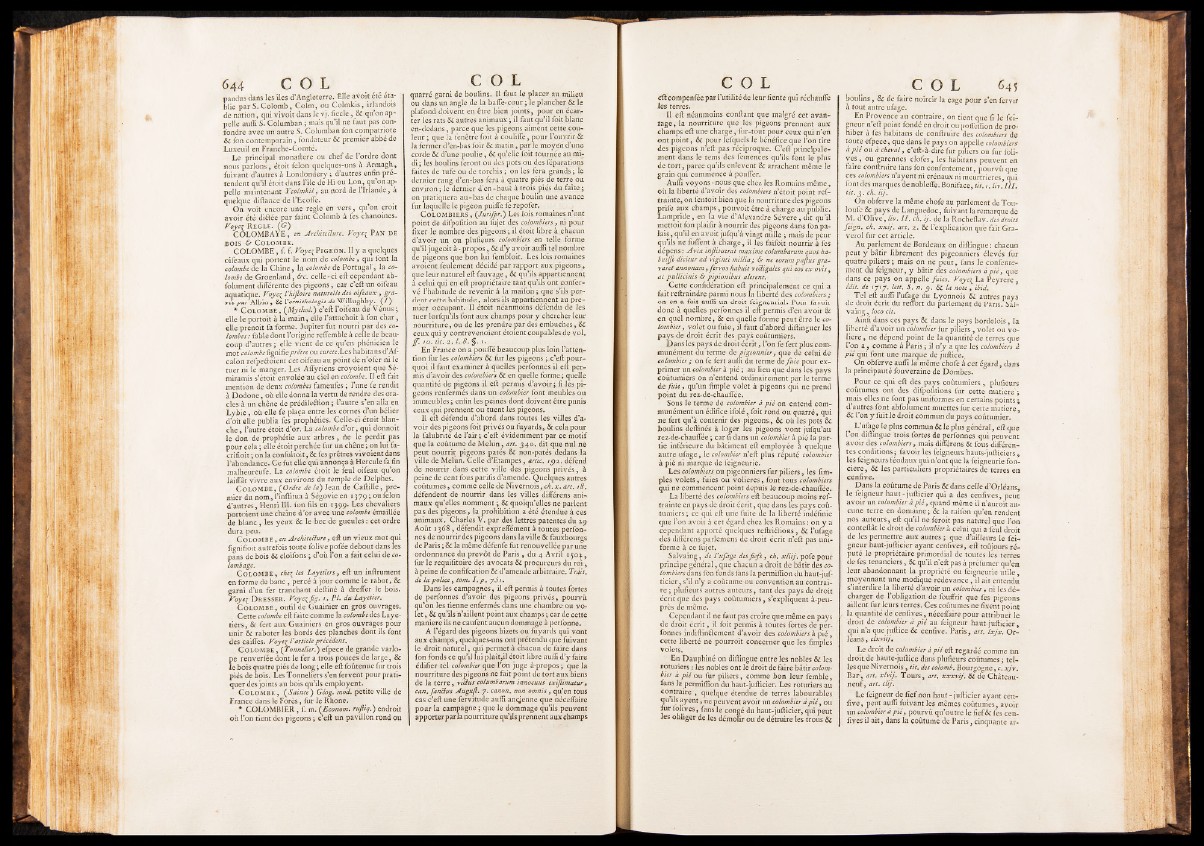
A
pandus dans les îles d’Angleterre. Elle avoit été établie
par S. C olomb, C olm, ou Colmkis, irlandois
de nation, qui vivoit dans le vj. fiecle, 6c qu’on appelle
auffi S. Columban ; mais qu’il ne faut pas confondre
avec un autre S. Columban fon compatriote
& fon contemporain, fondateur 6c premier abbe de
Luxeuil en Franche-Comté.
Le principal monaftere ou chef de l’ordre dont
nous parlons, étoit félon quelques-uns à Armagh,
fuivant d’autres à Londondery ; d’autres enfin prétendent
qu’il étoit dans l’île de Hi ou Lon , qu’on appelle
maintenant Ycolmkil, au nord de l’Irlande, a
quelque diftance de l’Ecoffe. ?
On voit encore une réglé en v e rs , qu’on croit
avoir été di&ée par faint Colomb à fes chanoines.
Yoyc{ Réglé. (G)
COLOMBAYE, en Architecture. Voyc{ Pan DE
bo is & C o lom b e .
COLOMB E, f. f. VoyeiPig eo n . Il y a quelques
oifeaux qui portent le nom de colombe, qui font la
colombe de la Chine, la colombe de Portugal', la colombe
de Groenland, &c. celle-ci éft cependant ab-
folument différente des pigeons, car c’eft un oifeau
aquatique. Voye^ l'hifioire naturelle des oifeaux, gravie
par Albin, 6c l’ornithologie de W illughby. ( / )
* C o lom b e , (Mythol.) c’eft l’oifeau de Vénus ;
elle le portoit à la main, elle l’attachoit à fon char,
elle prenoit fa forme. Jupiter fut nourri par des colombes:
fable dont l’origine reffemble à celle de beaucoup
d’autres ; elle vient de ce qu’en phénicien le
mot colombe fignifieprêtre ou curete.Les habitans d’Af-
calon refpeâoient cet oifeau au point de n’ofer ni le
tuer ni le manger. Les Affyriens croyoient que Sé-
miramis s’étoit envolée'au ciel en colombe. Il eft fait
mention de deux colombes fameufes ; l’une fe rendit
à Dod one, où elle donna la vertu de rendre des oracles
à un chêne de prédilection ; l’autre s ’en alla en
L y b ie , où elle fe plaça entre les cornes d’un bélier
d’où elle publia fes prophéties. Celle-ci étoit blanche
, l’autre étoit d’or. La colombe d’o r , qui donnoit
le don de prophétie aux a rb re s, ûe le perdit pas
pour cela ; elle étoit perchée fur un chêne ; on lui fa-
crifioit ; on la confultoit, & fes prêtres vivoient dans
l ’abondance. Ce fut elle qui annonça à Hercule fa fin
malheureufe. La colombe étoit le feul oifeau qu’on
laiffât v ivre aux environs' du temple de Delphes.
C o lom b e , (Ordre de là) Jean de Caftille, premier
du nom, l’inftitua à Ségovie en 1379 ; ou félon
d’autres, Henri III. fon fils en 1399. Les chevaliers
portoient une chaîne d ’or avec une colombe émaillée
de b lan c , les yeux 6c le bec de gueules : cet ordre
dura peu.
C o lom be , en Architecture , eft un vieux mot qui
fignifioit autrefois toute folive pofée debout dans les
pans de bois 6c cloifons ; d’où l’on a fait celui de colombage.
C o lom b e , chei les Layetiers, eft un infiniment
en forme de banc , percé à jour comme le rabot, 6c
garni d’un fer tranchant deftiné à dreffer le bois.
Yoye{ D resser. Yoye{fig. I. PI. duLayetier.
C o lom b e , outil de Guainier en gros ouvrages.
. Cette colombe eft faite comme la colombe des L ay etiers,
& fert aux Guainiers en gros ouvrages pour
unir 6c raboter les bords des planches dont ils font
des caiffes. Voyeç l'article précédent.
C o lom b e , ("Tonnelier.) efpece de grande varlope
renverfée dont le fer a trois pouces de large , 6c
le bois quatre piés de long ; elle eft foûtenue fur trois
piés de bois. Les Tonneliers s’en fervent pour pratiquer
des joints au bois qu’ils employent.
C o lom b e , ( Sainte) Géog. mod. petite ville' de
France dans le F orés, fur le Rhône.
* COLOMBIER, f. m. ( Econom. rufiiq.) endroit
où Ton tient des pigeons ; c’eft un pavillon rond ou
quarré garni de boulins. Il faut le placer au milieu
ou dans un angle de la baffe-cour ; le plancher & le
plafond doivent en être bien joints, pour en écarter
les rats 6c autres animaux ; il faut qu’il foit blanc
en-dedans, parce que les pigeons aiment cette couleur
; que la fenêtre foit à couliffe, pour l’ouyrir &
la fermer d’en-bas foir & matin, par'le moyen d’une
corde 6c d’une poulie, 6c qu’elle foit tournée au midi
; les boulins feront ou des pots ou des féparations
faites de tufe ou de torchis ; on les fera grands ; le
dernier rang d’en-bas fera à quatre piés de terre ou
environ ; le dernier d’en-haut à trois piés du faîte ;
on pratiquera au-bas de chaque boulin une avance
fur laquelle le pigeon puiffe fe repofer.
C olombiers , ( Jurifpr.) Les lois romaines n’ont
point de difpofition au fujet des colombiers., pi pour
fixer le nombre des pigeons ; il étoit libre à .chacun
d’avoir im ou plufieurs colombiers en telle, forme
qu’il jugeoit à - propos, 6c d’y avoir auffi tel nombre
de pigeons que bon lui fembloit. Les lois romaines
avoient feulement décidé par rapport aux pigeons.,
que leur naturel eft fauvage, 6c qu’ils appartiennent
à celui qui en eft propriétaire tant qu’ils ont çonfer-
vé l’habitude de revenir à la maifon ; que s’ils perdent
cette habitude, alors ils appartiennent au premier
occupant. Il étoit néanmoins défendu de les
tuer lorfqu’ils font aux champs pour y chercher leur
nourriture, ou de les prendre par des embûches, 6c
ceux qui y contrevenoient étoient coupables de vol,
ff. 10. tit. z ,l..8. § . /.
En France on a pouffé beaucoup plus loin l’attention
fur les colombiers 6c fur les pigeons c’eft pourquoi
il faut examiner à quelles perfonnes il eft permis
d’avoir des colombiers 6c en quelle forme ; quelle
quantité de pigeons, il eft permis d’avoir ; fi.les pigeons
renfermés dans un-colombier font meubles ou
immeubles ; enfin les peinés dont doivent être punis
ceux qui prennent ou tuent les. pigeons.
Il eft défendu d’abord dans toutes les villes d’avoir
des pigeons foit privés ou fuyards , & cela,pour
la falubrité de l’air ; c’eft évidemment par ce motif
que la coûtume de Melun, art. 340. dit que nul ne
peut nourrir pigeons pâtés 6c non-patés dedans la
ville de Melun. Celle d’Etampes, artic. ic)z. défend
de nourrir dans cette ville des pigeons privés, à
peine de cent fous parifis d’amende. Quelques autres
coutumes, comme celle de Nivernois, ch. x. art. 18,
défendent de nourrir dans les villes différens ani-.
maux qu’elles nomment ; & quoiqu’elles ne parlent
pas des pigeons, la prohibition a été étendue à ces
animaux. Charles Y. par des lettres patentes du 29
Août 1368, défendit expreffément à toutes perfonnes
de nourrir des pigeons dans la ville & fauxbourgs
de Paris ; 6c la même défenfe fut renouvellée par une
ordonnance du prévôt de Paris , du 4 Avril 1502,
fur le requifitoire des avocats 6c procureurs du roi,
à peine de confifcation 6c d’amende arbitraire. Trait,
de la police, tom. I. p. y 5t.
Dans les campagnes, il eft permis à toutes fortes
de perfonnes d’avoir des pigeons privés, pourvu
qü’on les tienne enfermés dans une chambre ou volet
, 6c qu’ils n’aillent point aux champs ; car de cette
maniéré ils ne caufent aucun dommage à perfonne.
A l’égard des pigeons bizets ou fuyards qui vont
aux champs, quelques-uns ont prétendu que fuivant
le droit naturel, qui permet à chacun de faire dans
fon fonds ce qu’il lui plaît,il étoit libre auffi d’y faire
édifier tel colombier que l’on juge à-propos ; que la
nourriture des pigeons ne fait point de tort aux biens
de la terre, v ictus columbarum inno cuits exijlimatur,
can. fanctus Augufl. y . canon, non omnis, qu’en tous
cas c’eft une fervitude auffi ancienne que néceffaire
pour la campagne ; que le dommage qu’ils peuvent
I apporter parla nourriture qu’ils prennent aux champs
eft compenfée par l’utilité de leur fiente qui réchauffe
les terres.
Il eft néanmoins confiant que malgré cet avanta
g e , la nourriture que les pigeons prennent aux
champs eft une charge, -fur-tout pour ceux qui n’en
ont p oint, 6c pour lefquels le bénéfice que l’on tire
des pigeons n’eft pas réciproque. C’eft principalement
dans le teins des femences qu’ils font le plus
de to rt, parce qu’ils enlevent 6c arrachent même le
grain qui commence à pouffer.
Auffi voyons -nous que chez les Romains même,
où la liberté d’avoir des colombiers n’étoit point ref-
trainte, on fentoit bien que la nourriture des pigeons
prife aux champs, pouvoit être à charge au public.
Lampride, en la vie d’Alexandre S é v e re , dit qu’il
mettoit fon plaifir à nourrir des pigeons dans fon palais
, qu’il en avoit jufqu’à vingt mille ; mais de peur
qu’ils ne fuffent à charge, il les faifoit nourrir à fes
dépens: Avia injîituerat maxime columbarum quos ha-
buiffe dicitur ad viginti milita; & ne eorum paftus gravai
et annonam, fervos habuit vectigales qui eos ex ovis,
ac pullicinis & pipiombus alerent.
Cette confidération eft principalement ce qui a
fait reftraindre parmi nous la liberté des colombiers ;
on en a fait auffi un droit feigneurial. Pour favoir
donc à quelles perfonnes il eft permis d’en avoir &
en quel nombre, & en quelle forme peut être le colombier,
volet ou fu ie , il faut d’abord diftinguer les
pay s de droit écrit des pays coutumiers.
Dans les pays de droit écrit, l’on fe fert plus communément
du terme de pigeonnier, que de celui de
colombier ; on fe fert auffi du terme de fuie pour exprimer
un colombier à pié ; au lieu que dans les pays
coûtumiers on n’entend ordinairement par le terme
de fuie , qu’un fimple volet à pigeons qui ne prend
point du rez-de-chauffée.
Sous le terme de colombier à pié on entend communément
un édifice ifo lé , foit rond ou quarré, qui
ne fert qu’à contenir des pigeons., 6c où les pots 6c
boulins deftinés à loger les pigeons vont jufqu’au
rez-de-chauffée ; car fi dans un colombier à pié la partie
inférieure du bâtiment eft employée à quelque
autre u fag e , le colombier n’eft plus réputé colombier
à pié ni marque de feigneurie.
Les colombiers, ou pigeonniers fur piliers, les Amples
v o le ts, fuies ou v o lières, font tous colombiers
qui ne commencent point depuis le rez-de-chauffée.
La liberté des colombiers eft beaucoup moins ref-
trainte en pays de droit écrit, que dans les pays coûtumiers
; ce qui eft une fuite de la liberté indéfinie
que l’on avoit à cet égard chez les Romains : on y a
cependant apporté quelques reftri&ions, 6c l ’ufage
des différens parlemens de droit écrit n’eft pas uniforme
à ce fujet.
S alv aing , de l'.ufage des fiefs , ch. xliij. pofe pour
principe général, que chacun a droit de bâtir des colombiers
dans fon fonds fans la permiffion du haut-juf-
ticier, s’il n’y a coûtume ou convention au contraire
; plufieurs autres auteurs, tant des pays de droit
écrit que des pays coûtumiers, s’expliquent à-peu-
près de même.
Cependant il ne faut pas croire que même en pays
de droit é c r it, il foit permis à toutes fortes de perfonnes
indiflindement d’avoir des colombiers à p ié ,
cette liberté ne pourroit concerner que les fimples
volets. -
En Dauphiné on diftingue entre les nobles 6c les
roturiers : les nobles ont le droit de faire bâtir colombier
à pié ou fur piliers, comme bon leur femble,
fans la permiffion du haut-jufticier. Les roturiers au
contraire , quelque étendue de terres labourables
qu us ayent, ne peuvent avoir un colombier à pié, ou
lur folives, fans le congé du haut-jufticier, qui peut
les obliger de les démolir ou de détruire les trous 6c
boulins, 6c de faire noircir la cage pour s ’en fervir
à tout autre ufage.
En Provence au contraire, on tient que fi le fei-
gneur n’eft point fondé en droit ou poffeffion de prohiber
à fes habitans de conftruire des colombiers de
toute efpece, que dans le pays on appelle colombiers
à pié ou à cheval, c’eft-à-dire fur piliers ou fur folives
, ou garennes c lofes, les habitans peuvent en
faire conftruire fans fon confentement, pourvû que
ces colombiers n’ayent ni crénaux ni meurtrières, qui
font des marques de nobleffe. Boniface, tit. 1. liv. III.
tit. 3. ch. ïij.
On obferve la même chofe au parlement de Tou-
loufe & pays de Languedoc, fuivant la remarque de
M. d’O live , liv. II. ch. ij. de la Rocheflav. des droits
feign. ch. xxij. àrt. z. & l’explication que fait Gra-
verol fur cet article.
Au parlement de Bordeaux on diftingue : chacun
peut y bâtir librement dés pigeonniers élevés fur
quatre piliers ; mais on ne p eu t, fans le confentement
du feigneur, y bâtir des colombiers à pié, que
dans ce pays on appelle fuies, k'oyei L a Peyrere ,
édit, de ryiy. lett. S.n. g. 6c la note, ibid.
T e l eft auffi l’ufage du Lyonnois 6c autres pays
de droit écrit du reffort du parlement de Paris. Salv
aing , loco cit.
. Ainfidans ces pays 6c dans le pays bordelois, la
liberté d’avoir un colombier fur piliers, volet ou v o lière
, ne dépend point de la quantité de terres que
l’on a , comme à Paris ; il n’y a que les colombiers à
pié qui font une marque de juftice..
On obferve auffi la même chofe à cet é gard, dans
la principauté fouveraine de Dombes.
Pour ce qui eft des pays coûtumiers , plufieurs
coutumes ont des difpofitions fur cette matière"';
mais elles ne font pas uniformes en Certains points ;
d’autres font abfolument muettes fur cette matière,
6c l’on y fuit le droit commun du p ays coutumier.
L ’ufage le plus commun & le plus général, eft que
l’on diftingue trois fortes de perfonnes qui peuvent
avoir des colombiers, mais différens & fous différentes
conditions; favoir les feigneurs hauts-jufticiers,
les feigneurs féodaux qui n’ont que la feigneurie foncière
, 6c les particuliers propriétaires de terres en
cenfive.
Dans la coûtume de Paris & dans celle d’Orléans,
le feigneur haut-jufticier qui a des cenfives, peut
avoir un colombier à pié, quand même il n’auroit aucune
terre en domaine; 6c la raifon qu’en rendent
nos auteurs, eft qu’il ne feroit pas naturel que l’on
conteftât le droit de colombier à celui qui a feul droit
de les permettre aux autres ; que d’ailleurs le feigneur
haut-jufticier ayant cenfives, eft toûjours réputé
le propriétaire primordial de toutes les terres
de fes tenanciers, 6c qu’il n’eft pas à préfumer qu’en
leur abandonnant la propriété ou feigneurie u tile,
moyennant une modique redevance, il ait entendu
s’interdire la liberté d’avoir un colombier, ni les décharger
de l’obligation de fouffrir que fes pigeons
aillent fur leurs terres. Ces coûtumesne fixent point
. la quantité de cenfives, néceffaire pour attribuef le
droit de colombier à pié au feigneur haut-jufticier,
qui n’a que juftice 6c cenfive. Paris, art. Ixjx. Orléans
, clxviij.
Le droit de colombier à pié eft regardé comme un
droit de haute-juftice dans plufieurs coûtumes ; telles
que Nivernois, tit. des colomb. Bourgogne, c. xjv.
B a r , art. xlvij. T o u rs, art. xxxvij. 6c de Château-
neu f, art. clij.
L.e feigneur de fief non haut - jufticier ayant cenfiv
e , peut auffi fuivant les mêmes coûtumes, avoir
un colombier à pié, pourvû qu’outre le fief & fes cenfives
il a it, dans la coûtume de Paris, cinquante ar