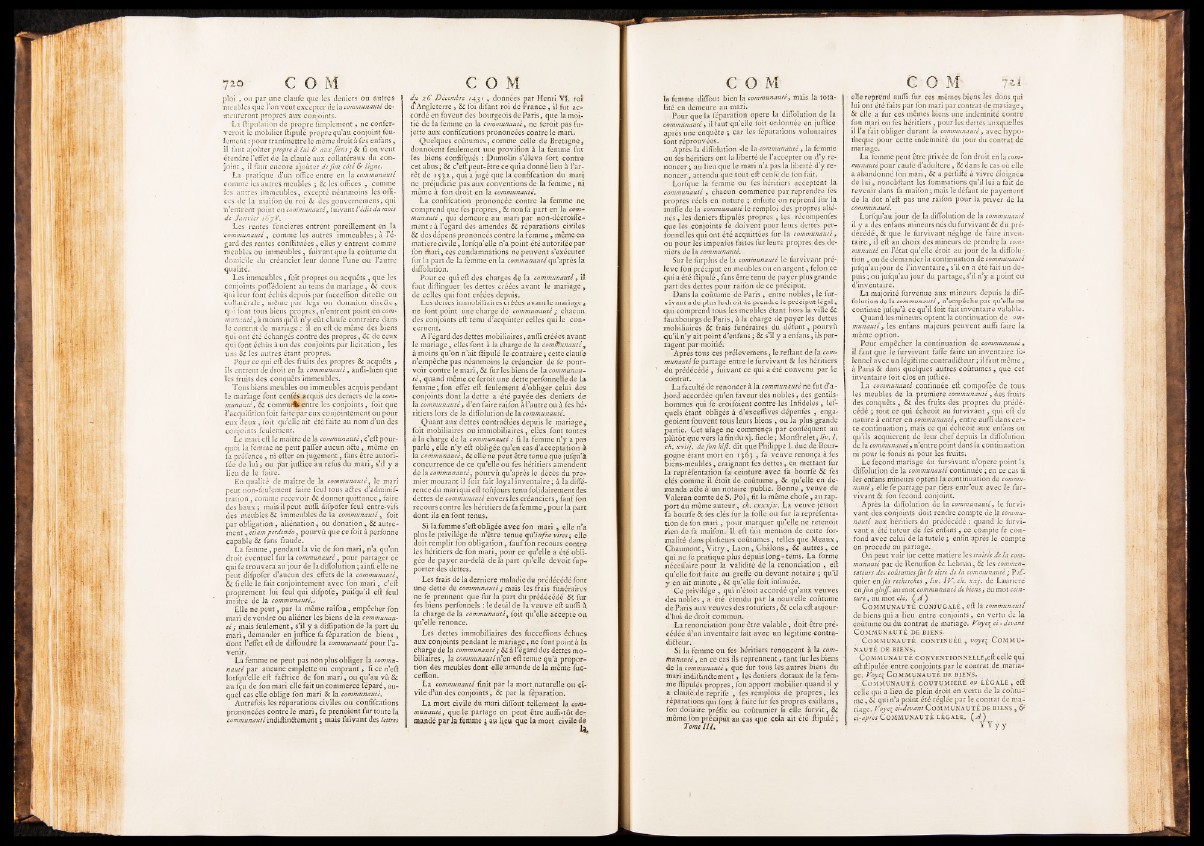
ploi , ou par une claufe que les deniers ou autre s
■ meubles que l’on veut excepter de la communauté demeureront
propres aux conjoints.
'La flipulation de propre fimplement, ne confer-
veroit le mobilier ftipulé propre qu’au conjoint feulement
: pOiir tranfmëttre le même droit à Tes enfans,
il faut ajoûter propre à lui & aux jitns ; & fi on veut
étendre l’effet de la claufe aux collatéraux du conjoint
, il fa vit encore ajoûter de fon côté & ligne.
La pratique d’un office entre en la communauté
comme les autres meubles ; & les offices , comme
les autres immeubles, excepté néanmoins les offices
de la maifon du roi & dès gouvernemens, qui
li’erttrent point en communauté, iuivant l ’édit du mois
de Janvier i6 y 8 .
Les rentes foncières entrent pareillement en la
‘communauté , comme les autres immeubles; à l’égard
des rentes conftituées , eiies y entrent comme
meubles bu immeubles, fuivant que la coutume du
domicile du créancier leur donné l’une ou l’autre
qualité.
Les immeubles, foit propres ôu acquêts , que les
Conjoints poffédoient au temS du mariage, & ceux
qui leur font échus depuis par fucceffion direfte ou
collatérale, même par legs ou donation directe,
qui font toils biens propres, n’entrent point en communauté
, à moins qu’il n’y eût claufe contraire dans
le contrat de mariage : il en eft de même des biens
qui ont été échangés contre dès propres, & de ceux
qui font échûs à un des conjoints par licitation, les
uns Sc les autres étant propres.
Pour ce qui eft des fruits des propres & acquêts ,
ils entrent de droit en la communauté, auffi-bien que
les fruits des conquêts immeubles.
Tous biens meubles ou immeubles acquis pendant
le mariage font cenfésnacquis des deniers de la communauté
, & commué entre les conjoints, foit que
l ’acquifition foit faite par eux conjointement ou pour
■ eux deux, foit qu’elle ait été faite au nom d’un des
conjoints feulement.
Le mari eft le maître de là communauté, c’eft pourquoi
la femme ne peut paffer aucun a£te, même en
fa préfence, ni efter en jugement, fans être autori-
fée de lu i, ou j5ar juftice au refus du mari, s’il y a
lieu de le faire.
En qualité de maître de la communauté, le mari
peut non-feulement faire feul tous aétes d’adminif-
tration, comme recevoir & donner quittance, faire
des baux ; mais il peut auffi difpofer feul entre-vifs
des meubles ÔC immeubles de la communauté, foit
par obligation , aliénation, ou donation, & autrement
, etiam perdendo, pourvû que ce foit à perfonne
capable & fans fraude.
La femme, pendant la vie de fon mari, n’a qu’un
droit éventuel fur la communauté, pour partager ce
qui fe trouvera au jour de la diffolution ; ainfi elle ne
peut difpofer d’aucun des effets de la communauté,
& fi elle le fait conjointement avec fon mari, c’eft
proprement lui feul qui difpofe, puifqu’il eft feul
maître de la communauté..
Elle ne peut, par la même raifoa, empêcher fon
mari de vendre ou aliéner les biens de la communauté
; mais feulement, s’il y a diffipationde la part du
mari, demander en juftice fa féparation de biens ,
dont l’effet eft de diffoudre la communauté pour l’a-
Venir.
La femme ne peut pas non plus obliger la communauté
par aucune emplette ou emprunt, fi ce n’eft
Ibrfqu’elle eft faftricé de fon mari, ou qu’au vû &
au fçu de fon mari elle fait un commerce féparé, auquel
cas elle oblige fon mari & la communauté.
Autrefois les réparations civiles ou confifcations
prononcées contre le mari, fé prenoient fur toute la
communauté indiftinêlement ; mais fuivant des lettres
du zG Décembre 1431 , données par Henri VL roi
d'Angleterre, & foi difant roi de France , il fut ac*
cordé en faveur des bourgeois de Paris, que la moitié
de la femme en la communfiuté, ne leroit pas fu*
jette aux confifcations prononcées contre le mari.
Quelques coûtumes, comme celle de Bretagne
donnoient feulement une provifion à la femme fur
les biens confifqués : Dumolin s’éleva fort contre
cet abus ; & c’eft peut-être ce qui a donné lieu à l’arrêt
de 1532-, qui a jugé que la confifcation du mari
ne préjudicie pas aux conventions de la femme, ni
même à fon droit en la communauté.
La confifcation prononcée contre la-femme ne,
comprend que fes propres, & non fa part en la com-*
munauté , qui demeure au mari par non-décroiffe-
ment : à l’égard des amendes & réparations civiles-
& des dépens prononcés contre la femme, même en.
matierecivile, lorfqu’elle n’a point été autorifée par
fon diari, ces condamnations ne peuvent s’exécuter
fur la part de la femme en la communauté qu’après la
diffolution.
Pour çe qui eft des charges de la 'communauté , il
faut diftinguer les dettes créées avant le mariage ,
de celles qui font créées depuis.
Les dettes immobiliaires créées avant le mariage f
ne font point une charge de communauté ; chacun,
des conjoints eft tenu d’acquitter celles qui le concernent.
A l’égard des dettes «nobiliaires, auffi créées avant
le mariage, elles font à la charge de la communauté ,
à moins qu’on n’ait ftipulé le contraire ; cette claufe
n’empêche pas néanmoins le créancier de fe pourvoir
contre le mari, & fur lesbiens de la communauté,
quand même ce feroit une dette perfonnelle de 1»
femme ; fon effet eft feulement d’obliger celui de9
conjoints dont la dette a été payée des deniers de
la communauté , d’en faire raifon à l’autre ou à fes hé»
' ritiers lors de la diffolution de la communauté.
Quant aux dettes contrariées depuis le mariage*
foit mobiliaires ou immobiliaires, elles font toutes
à la charge de la communauté : fi la femme n’y a pas
parlé , elle n’y eft obligée qu’en cas d’acceptation à
la communauté, & elle ne peut être tenue que jufqu’à
concurrence de ce qu’elle ou fes héritiers amendent
delà communauté, pourvû qu’après le décès du premier
mourant il foit fait loyal inventaire ; à la différence
du mari qui eft toûjours tenu folidairement des
dettes de communauté envers les créanciers, fauf fon
recours contre les héritiers de fa femme, pour la part
dont ils en font tenus.
Si la femme s’eft obligée avec fon mari , elle n’a
plus le privilège de n’être tenue qu 'infra vires; elle
doit remplir fon obligation, fauf fon recours contre
les héritiers de fon mari, pour ce qu’elle a été obligée
de payer au-delà de la part qu’elle devoit fup-
porter des dettes.
Les frais de la derniere maladie du prédéçédé font
une dette de communauté ; mais les frais funéraires
ne fe prennent que fur la part du prédécédé fur
fes biens perfonnels : le deuil de la veuve eft auffi à
la charge de la communauté, foit qu’elle accepte ou
qu’elle renonce.
Les dettes immobiliaires des fucceffions échues
aux conjoints pendant le mariage, ne font point à la
charge de la communauté; & à l’égard des dettes mobiliaires
, la communauté n’en eft tenue qu’à proportion
des meubles dont elle amende de la même fuç-
ceffion.
La communauté finit par la mort.naturelle ou -cir
vile d’un des conjoints, & par la féparation.
La mort civile du mari diffout tellement la communauté,
que le partage en peut être auffi-tôt demandé
par la femme ; au lieu que la mort civile de
u ,
la femme diffout bien la communauté, mais là totalité.
en demeure au mari.
Pour que la féparation opéré la diffolution de la
communauté, il faut qu elle foit ordonnée en juftice
après une enquête ; car les féparations volontaires
font réprouvées.
Après la diffolution -de la communauté, la femme
ou fes héritiers ont la liberté de l’accepter ou d’y renoncer
; au lieu que le mari n’a pas la liberté d’y renoncer,.,
attendu que tout eft cenfé. de fon fait.
Lorfque la femme ou fes héritiers acceptent la
communauté , chacun commence par reprendre fes
propres réels en nature ; ënfuite on reprend fur la
maffe de.la communauté le remploi des propres aliénés
, les deniers ftipulés propres,, les rëcompenfes
que les conjoints fe doivent pour leurs dettes per-
lonnelles qui ont été acquittées fur la communauté *
ou pour les impenfes faites fur leurs propres des deniers
de la communauté; .
Sur le furplus de la communauté le, furvivant prélevé
fon préciput en meubles ou en argent, félon ce
qui a été ftipulé, fans être tenu de payer plus grande
part des dettes pour raifon de ce préciput;
Dans la coûtume de Paris , entre nobles* le fur-
vivant a de plus le droit de prendre le préciput légal,
qui comprend tous les meubles étant hors la ville êc
fauxbourgs de Paris, à la charge de payer lés dettes
mobiliaires & frais funéraires du défunt, pourvû
qu’il n’y ait point d’enfans ; & s’il y a enfans, ils partagent
par moitié;
Après tous ces préleveriiens ; le reftant de la communauté
fe partage entre le furvivant & les héritiers
du prédéçédé , fuivant ce qui a été convenu par le
contrat.
Lafaculté de rehoncer à là communauté ne fut d’a bord
accordée qu’en faveur des nobles * des gentilshommes
qui fe croifoient contre les Infidèles , lef-
quels étant obligés à d’exceffives dépenfes , enga-
geoient fouvent tous leurs biens , ou la plus grande
partie. Cet ufage ne commença par conféquent au
plût ôt que vers la fin du xj. fieclë; Monftrelet $liv. I.
ch. xviij. de fon hift. dit que Philippe I. duc de Bourgogne
étant mort en 1363 * fa veuve renonça à fes
biens-meubles, craignant fes dettes, en mettant fur
la repréfentation fa ceinture avec la bourfe & fes
clés comme il étoit de coûtume , & qu’elle en demanda
a été à un notaire public. Bonne , veuve de
Valeran comte de S. P o l, fit la même chofe, au rapport
du même auteur, ch. Cxxxjx. La veuve jettoit
fa bourfe & fes clés fur la fofle ou fur la repréfenta-
tiôn de fon mari, pour.-marquer qu’elle ne retenoit
rien de fa maifon.-Il eft fait mention de cette formalité
dans'plufieurs coûtumes, telles,qiie Meaux,
Chaumont, V itry , Laon, Châlons, & autres, ce
qui ne fe pratique plus depuis long-tems. La forme
néceffaire pour la validité de la renonciation * eft
qu’elle foit'faite au greffe ôu devant notaire ; qu’il
y en ait minute, & qù’elle foit infinuée.
Ce privilège , qui n’étoit accordé qu’aux veuves
des nobles , a été étendu par la nouvelle coûtume
de Paris aux veuves des roturiers, & cela eft aujourd’hui
de droit commun.
La renonciation pour être valable * doit être précédée
d’un inventaire fait avec un légitime contra-
diélëur.
Si la femme ou fes héritiers renoncent à la communauté
, en ce cas ils reprennent, tant fur les biens
de la communauté, que fur tous les autres biens du
mari indiftinêlement, les deniers .dotaux de la femme
ftipulés propres, fon apport mobilier quand il y
a claufe.de reprife , fes remplois de propres, les
féparations. qui font à faire fur fes propres exiftans,
fon doiiaire préfix ou coûtumier fi elle furvit, &
même, fon préciput au ças que cela ait été ftipulé ;
Tome ///,
elle reprend auffi fur ces mêmes biens les dons qui
lui ont été faits par fon mari par contrat de mariage,
& elle a fur ces mêmes biens une indemnité contré
fon mari ou fes héritiers, pouf les dettés auxquelles
il l’a fait obliger durant la communauté, avec hypotheque
pour cette indemnité du jour du contrat de
mariage. i
La femmë peut être privée de fon droit eh la communauté
pour caufe d’adultere, & dans le cas oii elle
a abandonné fon mari, & a perfifté à vivre éloigné®
de lui ., nônobftant les fommations qu’il lui a fait de
revenir dans fa maifon ; mais lè défaut de payement
de la dot n’eft pas une raifon pour la priver de la
communauté.
Lorfqu’au .jour de la diffolution de la communauté
il y a des enfans mineurs nés du furvivant & du prédécédé
, & que le furvivant néglige de faire inventaire
, il eft au choix des mineurs de prendre la communauté
en l’état qu’elle, étoit au jour de la diffolu-,
tion, ou de demander la continuation de communauté
jûfqu’au jour de l’inventaire, s’il en a été fait un depuis
; ou jufqu’au jour du partage, s’il n’y a point cii
d’inventaire.
La majorité furvenue aux mineurs depuis la diffolution
de la communauté, n’empêche pas qu’elle né
continue jufqu’à ce qu’il foit fait inventaire valable.
Quand les mineurs optent la continuation de 'om-
munauté, les enfans ffiajeiirs peuvent auffi faire la
même option.
Pour empêcher la continuation de communauté,
il faut que le furvivant faffe faire un inventaire fo-
lennel avec un légitime contradicteur ; il faut même,
à Paris & dans quelques autres coûtumes , que cet
inventaire foit clos en juftice. x
La communauté continuée eft compofée de tous
les meubles de la première communauté, des fruits
des conquêts , & des fruits des propres du prédécédé
; tout ce qui écheoit au furvivant, qui eft de
nature à entrer en communauté, entre auffi dans cette
continuation ; mais ce qui écheoit aux enfans ou
qu’ils acquièrent de leur chef depuis la diffolution
de là communauté, n’entre point dans la continuation
ni pour le fonds ni pour les fruits;
Le fécond mariage du furvivant n’opère point la
diffolution de la communauté continuée ; en ce cas fi
les enfans mineurs optent la continuation de communauté
, elle fe partage par tiers entr’eux avec le fur-
vivant & fon fécond conjoint.
Après la diffolution de la communauté, le furvivant
des conjoints doit rendre compte de la communauté
aux héritiers du prédécédé : quand le furvivant
a été tuteur de fés enfarts, ce compte fe confond
avec celui de la tutele ; enfin après le compté
on procédé au partage;
On peut voir fur cette matière les traites de la communauté
par de Renuffon & Lebrun ; & les commentateurs
des coutumes furie titre de la communauté ; Paf-
quier en fes recherches , liv. IV . ch. xx j. de Laurieré
eh fon glojf. au mot communauté de biens , àu mot ceinture
, au mot clé. { A }
Communauté conjugale, eft la communauté
de biens qui a lieu entre conjoints, en vertu de la
coûtume ou du contrat de mariage. Voye^ ci - devant
Communauté de biens.
■ Communauté continuée , voye^ Communauté
DE BIEÏîS. >v<
Communauté conventionnelle,eft celle qui
eft ftipulée entre conjoints par le contrat de-maria-?
ge; Voye% Communauté de biens.
Communauté côùtumiere ou légale , eft
celle qui a lieu de plein droit en vertu de là coutume
, & qui n’a point été réglée par le contrat de mariage.
Voye{ ci-devant COMMUNAUTÉ DE BIENS , &
ci-aprés COMMUN AU T É LÉGALE, CA ) Y v y y
I
1
::f!
v|
| a