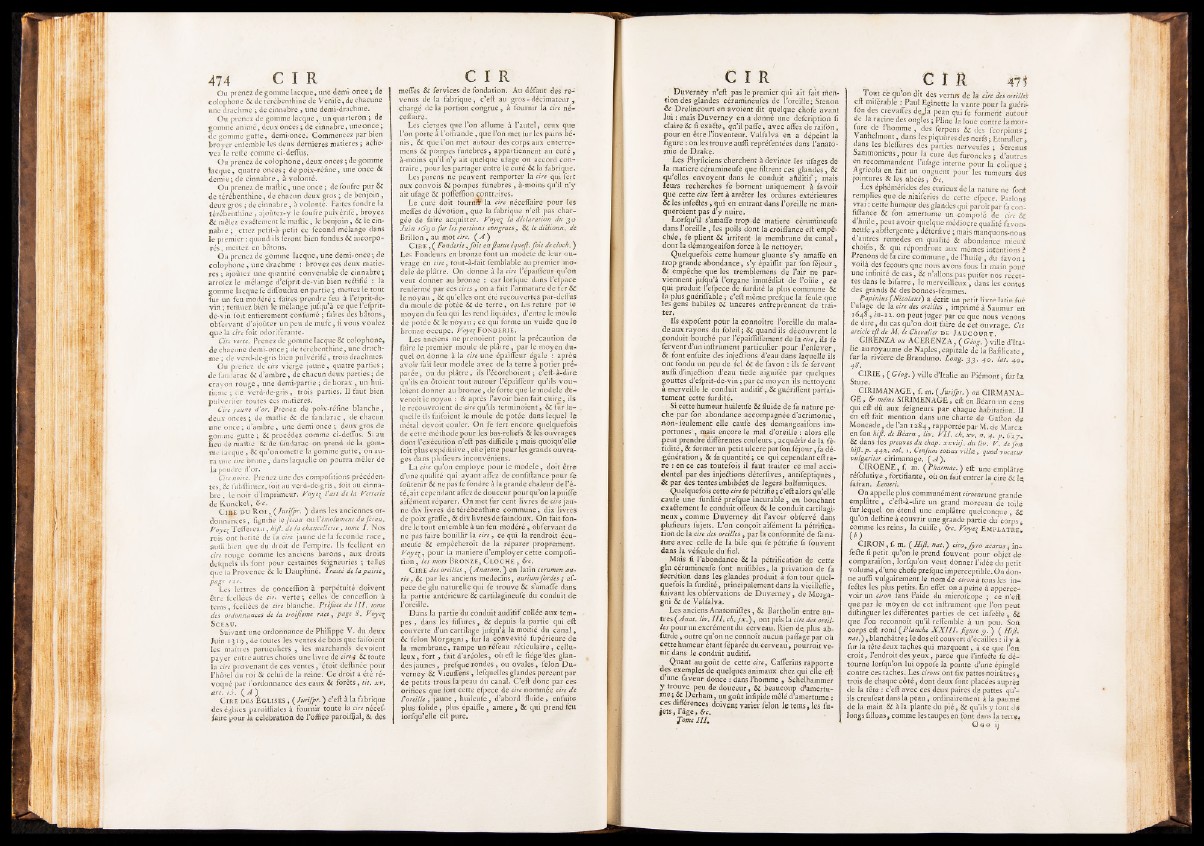
474 C I R
Ou prenez de gomme lacque, une demi-once ; de
colophone & de térébenthine de Venife, de chacune
une drachme ; de cinnabre , une demi-drachme.
Ou prenez de gomme lacque , un quarteron ; de
gomme animé, deux onces ; de cinnabre, une once ;
de gomme gutte, demi-once. Commencez par bien
broyer enfemble les deux dernieres matières ; achevez
le refte comme ci-deffus.
Ou prenez de colophone, deux onces ; de gomme
lacque, quatre onces; de poix-réfine, une once &
demie; de cinnabre, à volonté.
Ou prenez de maftic, une once ; de foufre pur &
de térébenthine, de chacun deux gros ; de benjoin ,
deux gros ; de cinnabre, à volonté. Faites fondre la
térébenthine , ajoûtez-y le foufre pulvérifé, broyez
Sc mêlez exattement le maftic, le benjoin , & le cinnabre
; ettez petit-à-petit ce fécond mélange dans
le premier : quand ils feront bien fondus & incorporés
, mettez en bâtons.
Ou prenez de gomme lacque, une demi-once; de
colophone, une drachme : broyez ces deux matières
; ajoutez une quantité convenable de cinnabre ;
arrofez le mélange d’efprit-de-vin bien re&ifié : la
gomme lacque fe diffoudra en partie ; mettez le tout
fur un feu modéré; faites prendre feu à l’efprit-de-
vin ; remuez bien le mélange jufqu’ à ce que l’efprit-
de-vin toit entièrement confumé ; faites des bâtons,
obfervant d’ajouter un peu de mufe, li vous voulez
que la cire foit odoriférante.
Cire verte. Prêtiez de gomme lacque & colophone,
de chacune demi-once ; de térébenthine, une drachme
; de verd-de-gris bien pulvérifé, trois drachmes.
Ou prenez de cire vierge jaune, quatre parties ;
de fantfarac &c d’ambre, de chacun deux parties ; de
crayon rouge, une demi-partie ; de borax , un huitième
; de verd-de-gris, trois parties. Il faut bien
pulvériier toutes ces matières.
Cire jaune d'or. Prenez de poix-réfirie blanche,
deux onces ; de maftic & de fandaraç , de chacun
une once ; d’ambre, une demi-once ; deux gros de
gomme gutte ; & procédez comme ci-deffus. Si au
lieu de maftic & de l'andarac on prend de la gomme
lacque , & qu’on omette la'gomme gutte, ôn aura
une cire brune, dans laquelle on pourra mêler de
la poudre d’or.
Cire noire. Prenez une des compofitions précédentes,
& fubftituez, foit au verd-de-gris, foit au cinnabre
, le noir d'imprimeur. Voyeç Cart de la Firrerie
de Kunckel, &c.
C i$e DU R o i , ( Jurifpr. j dans les anciennes ordonnances
fignifie le fceau ou l’émolument duJceau.
y 0yt{ Teffei eau , hifi. de la chancellerie, tome I. Nos
rois ont hérité de la cire jaune de la fécondé race,
auffi bien que du droit de l’empire. Ils fcellent en
cire rouge comme les anciens barons , aux droits
defquels ils font pour certaines feigneuries ; telles
que la Provence & le Dauphiné. Traité de la pairie,
page 121. ' . .
Les lettres de conceflion à perpétuité doivent
être fcellées de cm verte ; celles de conceflion à
tems, fcellées de cire blanche. Préface du I II. tome
des ordonnances de la troijîeme race, page 8. Voyeç
Sce au .
Suivant une ordonnance de Philippe V. dii-deux
Juin 1319, de toutes les ventes de bois que faifoient
les maîtres particuliers , les marchands dévoient
payer entre autres choies une livre de cireç & toute
la cire provenant de ces ventes, étoit deftinée pour
l’hôtel du roi & celui de la reine. Ce droit a été révoqué
par l’ordonnance des eaux & forêts, tit. xv.
art. 16. ( A ) ‘ .
C ire des Églises , ( Jurifpr. ) c’eft à la fabrique
des égliies paroilfiales à fournir toute la cire nécef-
faire pour la célébration dé l’office paroiffial, St des
C I R
meffes & fervices de fondation. Au défaut des revenus
de la fabrique, c’èft au gros - décimateur ,
chargé de la portion congrue, à fournir la cire né-
ceflaire.
Les cierges que l’on allume à l’autel, ceux que
l ’on porte a l ’offrande, que l’on met fur les pains bénis,
& que l’on met autour des corps aux enterre-
mens &L pompes funèbres, appartiennent au curé ,
à-moins qu’il n’y ait quelque ufage ou accord contraire
, pour les partager entre le curé ôc la fabrique.
Les parens ne peuvent remporter la cire qui fert
aux convois & pompes funèbres , à-moins qu’il n’y
ait ufage & poffeflion contraires.
Le curé doit fournir la cire néceffaire pour les
meffes de dévotion, que la fabrique n’eft pas chargée
de faire acquitter. Voye£ la déclaration du 30
Juin tCÿo fur les portions congrues , & le diclionn. de
Brillon , au mot cire.' ( A )
ClRE, ( Fonderie ,fo it en jlatue équejl.foit de cloch. )
Les Fondeurs en bronze font un modèle de leur ouvrage
en cire, tout-à-fait femblable au premier modèle
de plâtre. On donne à la cire l’épaiffeur qu’on
veut donner au bronze : car lorfque dans l’elpace
renfermé par ces cires , on a fait l’armature de fer &
le noyau , & qu’elles ont été recouvertes par-deffus
du moule de potée &c de terre , on les retire par le
moyen du feu qui les rend liquides, d’entre le moule
de potée & le noyau ; ce qui forme un vuide que le
bronze occupe. Foye^ Fonderie.
Les anciens ne prenoient point la précaution de
faire le premier moule de plâtre, par le moyen duquel
on donne à la cire une épaiffeur égale : après
avoir fait leur modèle avec de la terre à potier préparée
, ou du plâtre, ils l’écorchoient ; c’eft- à-dire
qu’ils en ôtoient tout autour l’épaiffeur qu’ils vou-
loient donner au bronze, de forte que le modèle dfe-
venoitle noyau : & après l’avoir bien fait cuire, ils
le recouvraient de « « qu’ils terminoient, &c fur laquelle
ils faifoient le moule de potée dans lequel le
métal devoit couler. On f e fert encore quelquefois
de cette méthode pour les bas-reliefs & les ouvrages
dont l’exécution n’eft pas difficile ; mais quoiqu’elle
foit plus expéditive, elle jette pour les grands ouvrages
dans plufieurs inconvéniens.
La cire qu’on employé pour le modèle, doit être
d’une qualité qui ayant affez de confiftance pour fe
foûtenir & ne pas fe fondre à la grande chaleur de l’été,
ait cependant affez de douceur pour qu’on la puiffe
aifément réparer. On met fur cent livres de cire jaur
ne dix livres de térébenthine commune, dix livres
de poix graffe, & dix livres de faindoux. On fait fondre
le tout ehtemblé à un feu modéré , obfervant de
ne pas faire bouillir la cire , ce qui la rendrait écu-
meule & empêcherait de la réparer proprement.
Voye{ , pour la maniéré d’employer cette compofi-
tion, les mots Bro n ze, C lo ch e , &c.
ClRE des oreilles , ( Anatom. ) en latin cerumen au-
ris, & par les anciens médecins, aurium fardes,* efpece
de glu naturelle qui fe trouve & s’araaffe dans
la partie antérieure & cartilagineufe du conduit de
l’oreille.
Dans la partie du conduit auditif collée aux tempes
, dans les fiffures, & depuis la partie qui eft
couverte d’un cartilage jufqu’à la moitié du canal,
& félon Morgagni, fur la convexité fupérieure de
la membrane, rampe un réfeau réticulaire, celluleux,
fo r t , fait d’aréoles, oii eft le fiége*des glandes
jaunes , prefque rondes, ou ovales, félon Du-
verney & Vieuffens , lefquelles glandes percent par
de petits trous la peau du canal. C ’eft donc par ces
orifices que fort cette efpece de cire nommée cire de
Voreille, jaune, huileufe, d’abord fluide, enl’uite
plus folide, plus épaiffe, amere, & qui prend feu
lorfqu’elle eft pure.
C I R
Duverney n’eft pas le premier qui ait fait mention
des glandes cérumineüfes de l ’oreille; Stenon
& DrelincOurt en âvoiént dit quelque chofe avant
lui : mais Duverney en a donné une defcription fi
claire & fi exa&e, qu’il paffe, avec affez de raifôn,
pour en être l ’inventeur. Valfalvà en a dépeint la
figure : on les trouve aufïï repréfentées dans l’anatô-
?nie de Drake.
Les Phyficiens cherchent à deviner les ufagés dè
la matière cérumineufe que filtrent ces glandes, &
qu’elles envoyent dans le conduit aftditif ; mais
leurs recherches fe bornent uniquement à favôir
que cette cire fert à arrêter les ordures extérieures
& les infe&es, qui en entrant dans l’oreille ne manqueraient
pas d’y nuire-.
Lorfqu’il s’amaffe trop dé matière cérumineufe
dans l ’oreille , les poils dont la croiffance eft empêchée
, fe plient & irritent la membrane du canal,
dont la démangeaifon force à le nettoyer.
Quelquefois cette humeur gluante s’y amaffe en
trop grande abondance, s’y épaiffit paf fon féjour,
& empêche que les tremblemens de l’air ne parviennent
jufqu’à l’organe immédiat de l’oiiie , ce
qui produit l’efpece de furdité la plus commune &
la plus guériffable ; c’eft même prefque la feule que
les gens habiles & finceres entreprennent de traiter*
Ils expofent pour la connoître l’oreille du malade
aux rayons du foleil ; & quand ils découvrent le
.conduit bouché par l’épaifiiffement de la cire, ils fe
fervent d’un inftrument particulier pour l’enlever,
& font enfuite des injeâions d’eau dans laquelle ils
ont fondu un peu de fel & de favon : ils fe fervent
auffi d’injeflion d’eau tiede aiguifée par quelques
gouttes d’efprit-de-vin ; par ce moyen ils nettoyent
à merveille le conduit auditif, & guériffent parlai- '
tement cette furdité*
Si cette humeur huileufe & fluide de fa nature péché
par fon abondance accompagnée d’acrimonie,
non-feulement elle caufe des demangeaifons importunes',
iq|is encore le mal d’oreille : alors elle
peut prendre différentes couleurs, acquérir de la fétidité
, & former un petit ulcéré par fon féjour, fa dégénération;
& fa quantité; ce qui cependant eft rare
: en ce cas toutefois il faut traiter ce mal accidentel
par des injeétions déterfives, antifeptiques ,
& par des tentes imbibées de légers balfamiques.
Quelquefois cette cire fe pétrifie ; c’eft alors qu’elle
caufe une furdité prefque incurable, en bouchant
exactement le cOtiduit offeux & le conduit cartilagineu
x, comme Duverney dit l’avoir obfervé dans
plufieurs fujets. L’on conçoit aifément la pétrification
de la cire des oreilles, par la conformité de fa nature
avec celle de la bile qui fe pétrifie li fouvent
dans la véficule du fiel.
Mais fi l ’abondance & la pétrification de cette
glu cérumineufe font nuifibles, la privation de fa
Sécrétion dans les glandes produit à fon tour quelquefois
la furdité, principalement dans la vieillçffe,
iuivant les obfervatioris de Duverney, de Morgagni
& de Valfalva.
Les anciens Anatomiftes, & Bartholin entre autres
( Anat. liv. I I I . c h . jx . j , ont pris la cire des oreilles
pour un excrément du cerveau. Rien de. plus ab-
furde, outre qu’on ne connoît aucun paffage par où
cette humeur étant féparée du cerveau, pourrait venir
dans le conduit auditif.
Quant au goût de cette « « , Caflerius rapporte
des exemples de quelques animaux chez qui elle eft
d’une faveur douce : dans l’homme , Schelhammer
y trouve peu de douceur, & beaucoup d’amertu-
me ’ ,^ .P er^am > un goût infipide mêlé d’amertume :
ces différences doivent varier félon le tems, les fu-
gets, la g e , &c.
J'orne I I ! .
C I R 47*
ce rç11’0” dit des vertus de ïa cire des orcillc's
eft miferable : Paul Eginette la vante pour la guéri:-
lôn des Crevaffes d é jà peâu qui fe forment autouf
de la racine des ongles ; Pline la loué contre la mor-
B p | l’homme, des ferpens & des feorpions ;
Vanhelmont, dans les piquûres des nerfs ; Etmuller ;
dans les bleffures des parties nerveufes ; Serenus
oammonicus, pour la cure des furoncles ; d’autres
en recommandent 1 ufage interne pour la colique ;
Agricola en fait un onguent pouf les tumeurs des
jointures & les abcès ; &c.
Les éphémérides des curieux de la nature né font
remplies que de niaiferies de cette efpece. Parlons
vrai : cette humeur des glandes qui paraît par fa confiftance
& fon amertume un compofé de cire &
d huile, peut avoir quelque médiocre qualité favon-
neüfe, abftergente > detérfivé ; mais manquons-nous
d autres remedes en qualité & abondance mieux
choifis, & qui répondront aux mêmes intentions ?
Prenons dé la cire commune, de l’huile , du favon ;
voilà des fecoufs que nous avons fous la main pour
une infinite de cas, & n’allons pas puifer nos recettes
dans le bifafre, le m erveilleux, dans les contes
des grands & des bonnés-femmes.
P a p in iu s (Nico laù s ) a écrit un petit livré latin fur
l ’ufage de la cire des oreilles , imprimé à Saumur en
1648, i n - ïa. on peut juger par ce que nous venons
de dire, du cas qu’on doit faire de cet Ouvrage-. Cet
article efi d e M . le Chevalier DE JAUCOURT.
CIRENZA ou ACERENZA, ( Géog. ) ville d’Ita-i
lie au royaume de Naples, capitale de la Bafilicate *
fur la riviere deBranduno. L o n g . 3 3 . 4 0 . U t . 4 0 ,
4 8 .
CIRIE, ( Géog. ) ville d’Italie au Piémont , fur la
Sture.
CIRIMANAGE, f. m. ( J u r ifp r .) où CIRMANA-
G E , & même SIRIMENAGE, eft en Béarn un cens
qui eft dû aux feigneurs par chaque habitation. II
en eft fait mention dans une charte de Gafton de
Moncade, de l’an 1284, rapportée par M. de Marca
en fon h ifi. de B éarn , liv . F I I . ch. x v . n . 4 . p. (> 2 j:
& dans fes preuves du chap. x x v i i j . du liv . V . de fo rt
k i f i .p . 4 4 2 . co l. i . Cenfum totius v i l la , qu od vo ca tu r
vulgariter cirimanage. ( A ) .
' CIROENE, f. m. (P h a rm a c .) eft une éniplâtré
réfolutive, fortifiante, où on fait entrer la cire &c lé,
fafran. Lemeri.
On appelle plus communément cirô’ene une grande
emplâtre , c’efhà-dire un grand morceau de toile
fur lequel on étend une .emplâtre quelconque , &
qu’on deftine à couvrir une grande partie du corps ,
comme les reins, la cuiffe, & c . F o y t { Em p lâ t r e *
( 6)
CIRON, f* m. ( Hiß. nat-.) ciro,jyrà acarus, in-
fe&e fi petit qu’on le prend fouvent pour objet de
comparaifon, Iorfqu’on veut donner l’idée du petit
volume, d’une choie prefque imperceptible. On donne
auffi vulgairement.le nom de cironà tous les in-
feâes les plus petits. En effet on a peine à apperce-
voir un ciron fans Paide du microfeope ; ce n’eft
que par le moyen de cet inftrument que l’on peuÉ
diftinguer les différentes parties de cet infeéfe , &
que l’on reconnoît qu’il reffemble à un pou. Son
corps éft rond ( Planche X X I I I . figure j). ) ( Hifh
nat. ) , blanchâtre ; le dos eft couvert d’écailies : il y â
fur la tête deux taches qui marquent, à ce que l’on
croit, l’endroit des y e u x , parce que l’infefte fe détourne
lorfqu’on lui oppofe la pointe d’une épinglé
contre ces taches. Les cirons ont fix pattes noirâtres,
trois de chaque côté, dont deux font placées auprès
de la tête : c’eft avec çes deux paires de pattes qu’ils
creufent dans la peau, ordinairement à la paumé
de la main & à la plante du pié, & qu’ils y font dé
longs filions, comme lés taupes en font dans la terre*
0 0 o ij