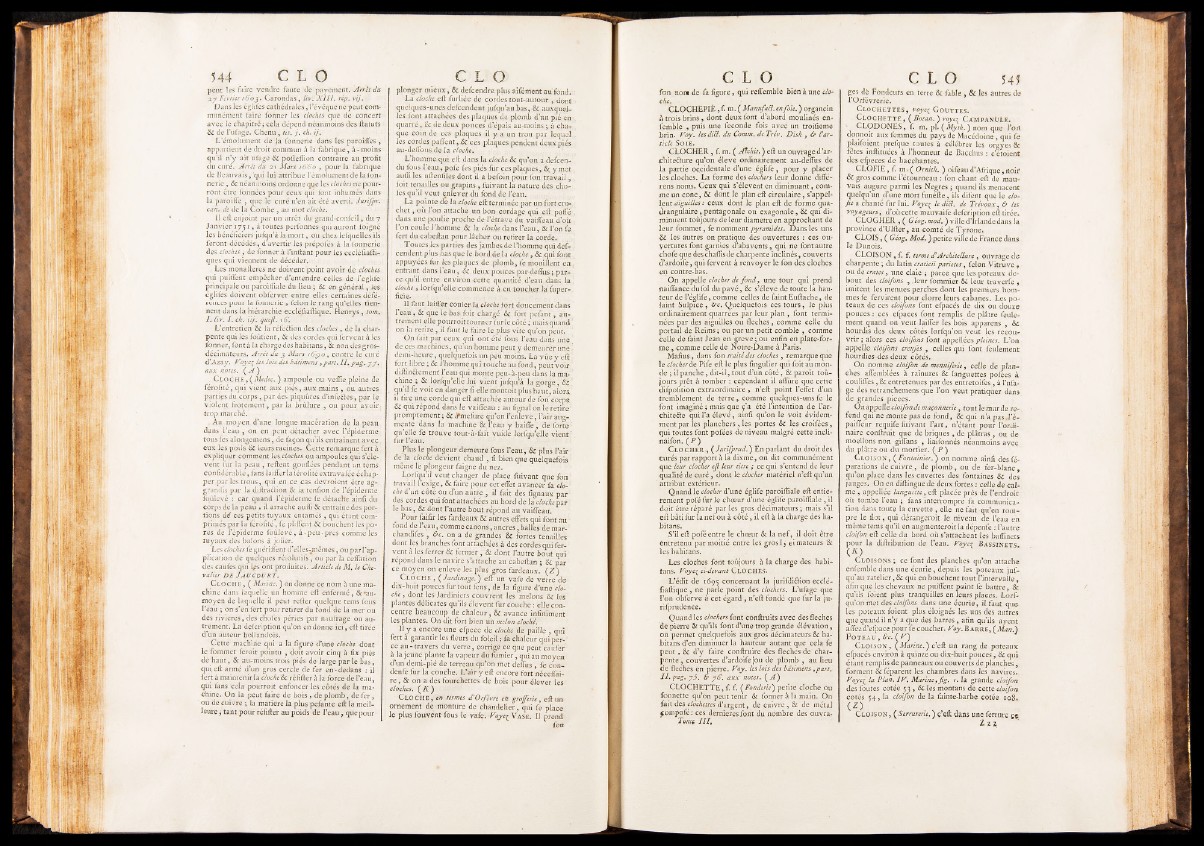
peut les faire vendre faute de payement. Arrêt du
z y Fcvrisr i6~o 3. Carondas, livvXIIl. rép. vij.-
D ans les églifes cathédrales, l’évêque ne peut communément
taire fonner les clodus que de concert
avec le chapitré ; cela dépend néanmoins des ftatuts
& de l’ufage. Chenu, tic. j . ch. ij.
L ’émolument de la fonnerie dans les paroiffes,
appartient de droit commun à la fabrique, à-moins
qu’il n’y ait ufage 6c poffeflion contraire au profit
du curé.; Arrêt du z i Mars i 660 > pour la fabrique
de Beauvais, qui lui attribue l’émolument de la fon-
nerie , 6c néanmoins ordonne que les cloches ne pourront
être tonnées pour ceux qui font inhumés dans
la paroifle , que le curé n’en ait été averti. Jurifpr.
can. de de la Combe , au mot cloche.
Il eft enjoint par un arrêt du: grand-confeil\ du 7
Janvier 1751, à toutes perfonnes qui auront loigné
les bénéficiers jufqu’à la mort, ou chez: le (que lies ils
feront décédés, d’avertir les prépofés à la fonnerie
des cloches, de fonner à l’inftant pour les eccléfiafti-r
ques qui viennent de décéder.
; Les monàfteres ne doivent'point avoir d& cloches
qui puiffent empêcher d’entendre celles dé l’eghfe
principale ou paroifliale du Uemj 6c en général,, l e s .
églifes doivent obferver entre elles certaines, déférences
pour la fonnerie, félon le rang qu’elles tiennent
dans la hiérarchie eccléfiaftique. Henrys, tom. ■
I . liv. I. ch. lij. quefl. 16'. - ) ■ .
L’entretien 6c la réfeélion d es cloches, de la charpente
qui lés. foûtient, & des cordes qui fervent à les
l’onner, fontà la charge des habitans, & non desgros-
décimateurs. Arrêt du 3 Mars i6g.o, contre le curé
d’Azay. V l e s lois des bdtimens , part. II. pag. yy. ■
aux notes. t ÇA )
. C l o c h e , (Medec. ) ampoule ou veffie pleine de
férolité, qui vient aux piés, .aux mains , ou, autres
parties du corps ,, par des piquûres d’infeûes, par le
violent frôlement, par la brûlure , ou pour avoir i
trop marché.
. Au moyen d’une longue macération de la peau
dans l ’eau , on en peut détacher avec l’épiderme-
tous fes alongemens, de façon qu’ils entraînent a v e c ,
eux les poils 6c Leurs racines. Cette remarque fert à
expliquer comment les cloches ou ampoules qui s’élèvent
lur la peau , relient gonflées pendant un tems
confidérable, fans Iaiffer lalérofitéextravafée échapper
par les trous, qui ,en ce cas devroient être ag-;
grandis par la diftraélion &d^tenfion de l’épiderme
fo.ûlevé : car quand l’épiderme fe détache ainfi du
corps de la peau , il arrache aufli & entraîne des portions
dd ces petits tuyaux entamés , qui étant comprimés
par la férofité, fe pliffën't 6c bouchent les pores
de l’épiderme foulevé, à-peu-près comme les
tuyaux des balons à joiier.
Les cloches fe guériflent d’elles-ÿnêmes, ou par l’application
de quelques réiolutifs, ou par la ceffation
des caufes qui l^s ont produites. Article de M. le Chevalier
DE J AV COURT.
C lo ch e , ( Marine. ) on donne ce nom à une ma- i
chine dans laquelle un homme êlt enfermé, &*au-
moyen de laquelle il peut relier quelque tems fous
l’eau ; on s’en fert pour retirer du fond de la mer ou
des rivières, des choies péries par naufrage ou autrement.
La defeription qu’on en donne ic i, ell tirée
d’un auteur hollandois.
Cette machine qui a la figure d’une cloche dont
le fommet feroit pointu , doit avoir cinq à lix piés
de haut, & au-moins trois piés de large par le bas,
qui ell armé d’un gros cercle.de fer en-dedans : il
fert à maintenir la cloche 6c réfiller à la-force de l’eau,
qiti fans cela pourroit enfoncer les côtés de la machine.
On la. peut faire de bois , de plomb, de fer,
ou de cuivre ; la matière la plus pefante ell la meilleure
, tant pour réfiller au poids de l’eau, que pour
plonger mieux, & defcendreplus aifément au fond.
La cloche ell furliée de cordestout-autour , dont
quelques-unes defeendent jufqu’au bas, 6c auxquelles
font attachées des plaques, d.e plomb d’un pié en
quarré, 6c de deux pouces d’épais au-moins ; à cha-r
que coin de ces plaques il y a un trou par 'lequel
les cordes paflent , 3c ces plaques pendent deux piés
au-deffous de la cloche.
L’homme qui ell dans la cloche 6c qu’on a defeen-
du fous l’eau, pofe fes piés fiir c es plaques, & y met
aufli les uftenfiles dont il a befoin pour fon tra vail,
foit tenailles ou grapins., fuivant la nature des choies
qu’il veut enlever du fond de l’eau. __
La pointe de la cloche ell terminée par un fort crochet
, où l’on attache un bon cordage qui ell pafle
•dans une poulie proche de l’étrave du vaiffeau d’oji
l’on coule l ’homme 6c la cloche dans l’eau,, & l’on fi?
fert du cabeftan pour lâcher ou retirer la corde.
Tou tes,les parties des jambes de l’homme qui descendent
plus bas que le bord de la cloçhe , 6c qui font
appuyeçs fur les plaques de plomb, fe mouillent en
entrant dans l’eau, 6c deux pouces par-deffus; parce
qu’il entre environ cette quantité, d’eau dans la
cloçhe .î lorfqu’elle commence à en toucher laSuperficie...
Il faut Iaiffer couler la clochefort doucement dans
l’eau', & que le bas foit chargé 6c fort pefant, autrement
elle pourroit tourner furie côté ; mais quand
on la retire, il faut le faire le plus vîte qu’on peut.
On fait par ceux qui ont été fous l’eau dans une
de ces machines, qii’un homme peut y demeurer une
demi-heure, quelquefois un peu moins. La vûe ÿ eft
fort libre ; 6c l’homme qui touche au fond, peut voir
diftinûement l’eau qui monte peu-à-peu dans la machine
; & lorfqu’elle lui vient jufqu’à la gorge, &
■ vo^ en Ranger fi elle montoit plus haut, alors,
ii tire une corde qui eft attachée autour de fon corps,
6c qui répond dans le vaiffeau : au fignal on le retire
promptement ; 6c üftnefure qù’on l’enlevé , l’air augmente
dans la machine & l’eau y baiffe , de forte-
qu’elle fe trouve tout-à-fait vuide lorfqu’elle vient
fur l’eau.
Plus le plongeur demeure fous l’eau, & plus l’air
de^la cloche dévient chaud , fi bien que quelquefois
même lê plongeur faigne du nez.
Lorfqti’il veut changer de place fuivant que fon
travail l’exige, & faire pour cet effet avancer fa cloche
d’un coté ou d’un autre , il fait des fignaux par
des cordes qui font attachées au bord de la cloche par
le bas, 6c dont l ’autre bout répond au vaiffeau.
Pour faifir les fardeaux & autres effets qui font au
fond de l’eau, comme canons, ancres, ballës de mar-
chandifès , &c. on a de grandes 6c fortes tenailles
dont les branches font attachées à des cordes qui fervent
à les ferrer 6c fermer , & dont l’autre bout qui
répond dans le navire s’attache au cabeftan ; 6c par
ce moyen on enleve les plus gros fardeaux. ( Z )
C lo ch e , ( Jardinage. ) eft un vafe de verre de
dix-huit pouces fur tout fens, de la figure d’une cloche,
dont les Jardiniers couvrent les melons 6c les
plantes délicates qu’ils élevent fur couche : elle concentre
beaucoup de chaleur, 6c avance infiniment
les plantes. On dit fort bien un melon cloché.
Il y a encore une efpece de cloche de paille , qui
fert à garantir les fleurs du foleil : fa chaleur qui perce
au-travers du verre, corrige ce que peut caiifer
à la jeitne plante la vapeur du nimier, qui au moyen
d’un demi-pié de terreau qu’on met deffus , fe con-
denfe fur la couche. L’air y éft encore fort néceflai-
r e , & on a des fourchettes de bois pour élever les
cloches. ( K )
C l o c h e , en termes d'Orfèvre eh grofferie, eft un
ornement de monture de chandelier, qui fe place
le plus fouventfous le vafe. Voyc^ V ase. Il prend
fon
fon nom de fa figure, qui reffemble bien à une cio*
the. ... •
CLOCHÈPIÉ, fi m. ( Manufact. enfoie. ) organcin
à trois brins , dont deux font d’abord moulinés ensemble
, puis une feGonde fois avec un troifieme
brin. Voy. lesdicl. du Comfn. de Trév. Dish , & C article
Soie.
CLOCH ER, fi m. ( Ahhit. ) eft un ouvrage d’ar-
«hiteélure qu’on éleve ordinairement au-deffus de
la partie occidentale d’une églife, pour y placer
les cloches. La formé des clochers leur donne diffé-
rens noms. Ceux qui s’élèvent en diminuant, comme
un code, 6c dont le plan eft circulaire, s’appellent
aiguilles : ceux dont le plan eft de forme qua-
drangulaire, pentagonale ou exagonale, 6c qui diminuent
toujours de leur diamètre en approchant de
leur fommet, fe nomment pyramides. Dans les uns
6c les autres on pratique des ouvertures : ces ouvertures
font garnies d’abavents, qui ne font autre
chofe que deschaflisde charpente inclinés, couverts
d’ardoife, qui fervent à renvoyer le fon des cloches
en contre-bas.
On appelle clocher de fond, une tour qui prend
naiffance du fol du pavé, & s’élève de toute la hauteur
de l’églife, comme celles de faint Euftache, de
faint Sulpice, &c. Quelquefois ces tours, le plus
ordinairement quarrées par leur plan , font terminées
par des aiguilles ou fléchés, comme celle du
portail de Reims ; ou par un petit comble , comme
celle de faint Jean en greve ; ou enfin en plate-for*
m e , comme celle de Notre-Dame à Paris.
Mafius, dans fon traité des cloches, remarque que
le clocher de Pife eft le plus fingulier qui foit au monde
; il panche, dit-il, tout d’un côté, & paroît toujours
prêt à tomber : cependant il affûre que cette
difpofition extraordinaire, n’eft point l’effet d’un
tremblement de terre, comme quelques-uns fe le
font imaginé ; mais que ç’a été l’intention de l’ar-
chiteéle qui l’a élev e, ainfi qu’on le voit évidemment
parles planchers ,le s portes 6c les croifées,
qui toutes font pofées de niveau malgré cette incli-
nàifon. ( P )
C lo ch e r , ( Jurifprud. ) Én parlant du droit des
Curés par rapport à la dixme, on dit communément
que leur clocher ejl leur titre ; ce qui s’entend de leur
qualité de curé, dont le clocher matériel n’eft qu’un
attribut extérieur.
Quand le clocher d’uné églife paroifliale eft entièrement
pofé fur le choeur d’une églife paroifliale , il
doit être réparé par les gros décimateurs ; mais s’il
eft bâti fur la nef ou à cô té, il eft à la charge des habitans.
S’il eft pofé entre le choeur & la nef, il doit être
entretenu par moitié entre les grosl» eimateurs &
les habitans.
Les cloches font tôûjours à la charge des habi*
tans. Voyt^ ci-devant C lo che s .
L’édit de 1695 concernant la jurifdiâion ecèlé-
fiaftique , ne parle point des clochers. L’ufage que
l’on ôbferve à cet égard , n’eft fondé que fur la ju-
rifprudence.
Quand les clochers font conftritits aveë des fléchés
de pierre & qu’ils font d’une trop grande élévation,
on permet quelquefois aux gros décimateurs & habitans
d’en diminuer la hauteur autant que cela fe
p eu t, 6c d’y faire conftruire des fléchés de charpente
, couvertes d’ardoife [ou de plomb , au lieu
de fléchés en pierre. Voy. les lois des bdtimens ,part.
I I . pagsfjb. & 7<f. aux notes. ( ^ )
CLOCHETTE, f. f. ÇFonderie) petite cloché ou
fonnette qu’on peut tenir & fonner à la main. On
fait des clochettes d’argent, de cuivre, & de métal
Compofé : ces dernieres font du nombre des ouvra-
Tomt, III\
ges dè Fondeufs en terre 6c fable j & les autres de
l’Orfèvrerie.
C lo ch e t t e s , voye^ G out tes.
C lo ch e t t e , ( Botan. ) voye^ C a^mpanüLé.
' CLODONES, f. m. pl. ( Mytk. ) nom que l’oit
donnoit aux femmes du pays de Macédoine, qui fe
plaifoient prefque toutes à célébrer les orgyes &
fêtes inftituées à l’honneur de Bacehus : c’étoient
des efpeces de bacchantes.
CLOFIE, f. m ,{ Ornith. ) oifeau d’Afrique, noif
& gros comme l’étourneau : fen chant eft de mauvais,
augure parmi les Negres ; quand ils menacent
quelqu’un d’une mort funéfte, ils difent que le clo-
fie a chanté fur lui. Voye^ le dicl. de Trévoux, & les
voyageurs, d’où cette mauvaife defeription eft tirée.
CLOGHER , ( Gèog.mod. ) ville d’Irlande dans la
province d’Ulfter, au comté de Tyrone»
CLOIS, ( Géog. Mod. ) petite ville de France dans
le Dunois.
CLOISON, f. f. terme d?Architecture , ouvrage de
charpente ; du latin craticii parûtes, félon Vitruve ,
ou de craies, une claie ; parce que les poteaux debout
des cloifons , .leur fommier 6c leur traverfe ,
imitent les menues perches dont les premiers hommes
fe fervirent pour clorre leurs cabanes. Les poteaux
de ces cloifons font efpacés de dix ou douze
pouces : ces efpaces font remplis de plâtre feulement
quand on veut Iaiffer les bois apparens , 6c
hourdis des deux côtés lorfqu’on veut les recouvrir
; alors ces doifons font appellées pleines. L ’on
appelle cloifons creufes , celles qui font feulement
hourdies des deux côtés.
On nomme cloifon de merlitiferie, celle de planches
affemblées à rainures 6c languettes pofees à
couliffes.,& entretenues par des entretoifes, à l’ufa-
ge des retranchemens que l’on veut pratiquer dans,
de grandes pièces.
On appelle cloifon de maçonnerie, tout le mur de refend
qui ne monte pas de fond, & qui n ’a pas.l’é-
paifféur requife fuivant l’art, n’étant pour l ’ordinaire
conftruit que de briques , de plâtras , ou de
moellons non giffans , liaifonnés néanmoins avec
du plâtre ou du mortier. ( P )
C loison , ( Fontainier. ) qn nomme ainfi des fé-
paradons de cuivre., de plomb, ou de fer-blanc,
qu’on place dans les cuvettes des fontaines 6c des
jauges. On en diftingue de deux fortes ; celle de cal-*
me , appellée languette, eft placée près de l’endroit
où tombe l’eau ; fans interrompre fa communica-
tioq dans toute la cuvette , elle ne fait qu’en rompre
le flot, qui dérangeroit le niveau de l’eau en
même tems qu’il en augmenteroitla dépenfe : l’autre
cloifon eft celle du bord où s’attachent les baflinets
pour la diftribution de l’eau. Voyez Bassinets.
■ ■ H ' ■ I ■ ■
C loisons ; ce font des planches qu’on attache
enfemble dans une écurie, depuis les poteaux jufqu’au
râtelier ,6c qui en bouchent tout l’intervalle,
afin que les chevaux ne puiffent point fe battre, &,
qu’ils foient plus tranqijilles en leurs places. Lorfqu’on
met des cloifons dans une écurie, il. faut que
les poteaux foient plus éloignés les uns des autres
que quand il n’y a que des barres, afin qu’ils ayent
affezd’efpace pour fe coucher. Voy. Barre, (Man.)
Po teau , &c. ( V )
C loison , (Marine.') c’eft un rang de poteaux
efpacés environ à quinze ou dix-huit pouces, & qui
étant remplis de panneaux ou couverts de planches ,
forment & féparent les chambres dans les navires...
Voye^ la Plan. IV. Marine, fig. 1. la grande cloifon
des foutes cotée 53 , & les montans de cette cloifon
cotés 54, la cloifon de la fainte-barbe cotée 108.
1
C lo iso n , (Serrurerie.') c’eft dans une ferrure çç
Z z i