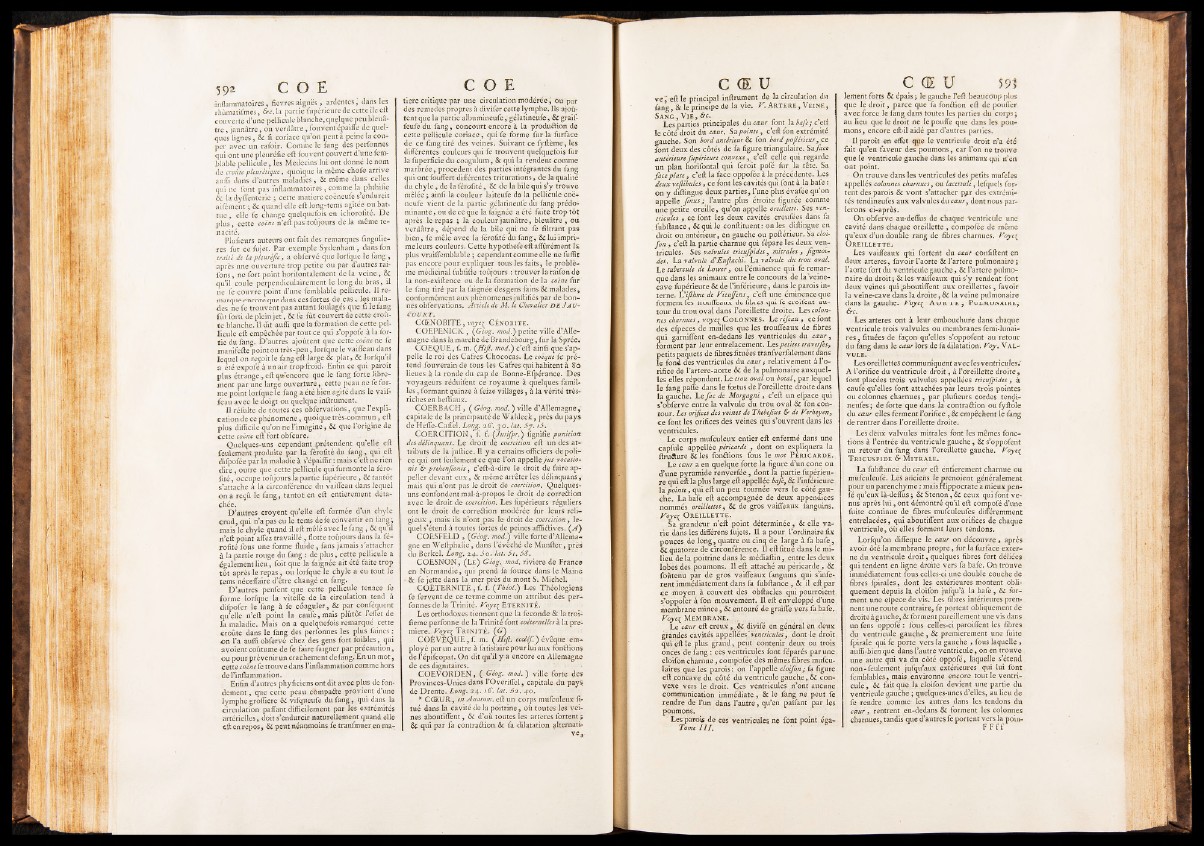
59a C O E
inflammatoires, fievres aiguës, ardentes, dans les
rhùmatifmes, Gc. la partie fuperieure de cette île eft
couverte d’une pellicule blanche, quelque peu bleuâtre
, jaunâtre, ou verdâtre, fouvent epaiffe de quelques
lignes, & fi coriace qu’on peut à peine la couper
avec un rafoir. Comme le fang des perfonnes
•qui ont une pleuréfie eft fou vent couvert d une fem-
blable pellicule, les Médecins lui ont donné le nom
de croûte pleurétique, quoique la même chofe arrive
auffi dans d’autres maladies, & même dans celles
qui ne font pas inflammatoires , comme la phthifie
& la dyffenterie ; cette matière coëneufe s’endurcit
aii'ément ; & quand elle eft long-tems agitee ou battue
., elle fe change quelquefois en ichorofité. De
.plus, cette co'ène n’eft pas toujours de la même ténacité.
Plufieurs auteurs ont fait des remarques fingulie-
res fur ce fujet. Par exemple Sydenham , dans fon
traité de la pleuréjîe, a obfervé que lorfque le fang ,
après une ouverture trop petite ou par d’autres rai-
fons, ne fort point horifontalement de la veine, &
qu’il coule perpendiculairement le long du bras , il
ne fe couvre point d’une femblable pellicule. Il rer
marque encore que dans ces fortes de cas, les malades
ne fe trouvent pas autant foulagés que fi le fang
fut forti de plein je t , & fe fût couvert de cette croûte
blanche. Il dit auffi que la formation de cette pellicule
eft empêchée par tout ce qui s’oppofe à la for-
tie du fang. D ’autres ajoûtent que cette co'ène ne fe
manifefte point ou très-peu, lorfque le vaiffeau dans
lequel on reçoit le fang eft large & plat, & lorfqu’il
a été expofé à un air trop froid. Enfin ce qui paraît
plus étrange , eft qu-’encore que le fang forte librement
par une large ouverture, cette peau ne fe forme
point lorfque le fang a été bien agité dans le vaiffeau
avec le doigt ou quelque infiniment.
Il réfulte de toutes ces obfervations, que l’explication
de ce phénomène, quoique très-commun, eft
plus difficile qu’on ne l’imagine, & que l’origine de
cette co'ène eft fort obfcure.
Quelques-uns cependant prétendent qu’elle eft
feulement produite par la férofité du fang, qui eft
difpofée par la maladie à s’épaifïir : mais c ’eft ne rien
dire, outre que cette pellicule quifurmonte la férofité,
occupe toujours la partie fupérieure, & tantôt
s’attache à la circonférence du vaiffeau dans lequel
on a reçu le fang, tantôt en eft entièrement détachée.
D ’autres croyent qu’elle eft formée d’un chyle
crud, qui n’a pas eu le tems defe convertir en fang ;
mais le chyle quand il eft mêlé avec le fang, & qu’il
n’eft point affez travaillé, flotte toujours dans la férofité
fous une forme fluide, fans jamais s’attacher
à la partie rouge du fang : de plus, cette pellicule a
également lieu, foit que la daignée ait été faite trop
tôt après le repas, ou lorfque le chyle a eü tout lé
tems néeeffaire d’être changé en fang.
D ’autres penfent que cette pellicule tenace fe
forme lorfque la vîtefle de la circulation tend à
difpofer le fang à fe coaguler, & par conséquent
qu’elle n’eft point la caufe, mais plutôt l’effet de
la maladie. Mais on a quelqûefois remarqué cette
croûte dans le fang des perfonnes les plus faines :
on l’a auffi obferve chez des gens fort faibles, qui
avoient coûtume de fe faire faigner par précaution,
ou pour prévenir un crachement de fang. En un mot,
cette co 'ène fe trouve dans l’inflammation comme hors
de l’inflammation.
Enfin d’autres phyficiens ont dit avec plus de fondement
, que cette peau Cômpatte provient d’une
lymphe groffiere &c vifqueufe du fang, qui dans la
circulation paffant difficilement par les extrémités
artérielles, doit s’endurcir naturellement quand elle
eft en repos, & peut néanmoins fe tranfmuer.en ma-
C O E
tiere critique par une circulation modérée \ ou par
des remedes propres à divifer cette lymphe. Ils ajoûtent
que la partie albumineufe, gélatineufe, & graif-
feufe du fang, concourt encore à la production de
cette pellicule coriace , quife forme fur la furface
de ce fang tiré des veines. Suivant ce fyftème, les
différentes couleurs qui fe trouvent quelquefois fur
la fuperficie du coagulum, & qui la rendent comme
marbrée, procèdent des parties intégrantes du fang
qui ont foufferit différentes triturations, de la qualité
du ch yle, de la férofité, & de la bile qui s’y trouve
mêlée ; ainfi la couleur laiteufe de la pellicule coë*
neufe vient de la partie gélatineufe du fang prédominante
, ou de ce que la faignée a été faite trop tôt
après le repas ; la couleur jaunâtre, bleuâtre , oit
verdâtre, dépend de la bile qui ne fe filtrant pas
bien, fe mêle avec la férofité du fang, & lui imprime
leurs couleurs. Cette hypothefe eft affûrément la
plus vraiffemblable ; cependant comme elle ne fuffit
pas encore pour expliquer tous les faits, le problème
médicinal fubfifte toujours : trouver la raifon de
la non-exiftence ou de là formation de la co'ène fur
le fang tiré par la faignée des gens fains & malades,
conformément aux phénomènes juftifiés par de bonnes
obfervations. Article de M. le Chevalier d e Ja u -
C’O U R T .
CCENOBITE, voyez C én obite.
COEPENICK , (Géog, mod.) petite ville d’Allemagne
dans la marche de Brandebourg, fur la Sprée.
COEQUE, f. m. (Hijl. mod.) c’eft ainfi que s’appelle
le roi des Cafres Chococas. Le coëque fe prétend
fouverain de tous les Cafres qui habitent à 8ô
lieues à la ronde du cap de Bonne-Efpérance. Des
voyageurs réduifent ce royaume à quelques familles
, formant quinze à feize villages, à la vérité très-
riches en beftiaux.
COERBACH , ( Géog. mod. ) ville d’Allemagne,'
capitale de la principauté de W aldeck, près du pays
de Heffe-Caffel. Long. ttC. g o . lut. 5y. i5.-\
COERCITION, f. f. (Jurifpr.) lignifie punition
des délinquans. Le droit de coercition eft un des attributs
de la juftice. Il y a certains officiers de police
qui ont feulement ce que l’on appelle jus vocatio-
7iis & prehenjionis, c’eft-à-dire le droit de faire ap-
peller devant eux, & même arrêter les délinquans ,
mais qui n’ont pas le droit de coercition. Quelques-
uns confondent mal-à-propos le droit de correction
avec le droit de coercition. Les fupérieurs réguliers
ont le droit de correction modérée fur leurs religieux
, mais ils n’ont pas le droit de coercition, lequel
s’étend à toutes fortes de peines afflictives. ( A )
COESFELD , (Géog. mod.') ville forte d’Allemagne
en Weftphalie, dans l’évêché de Munfter, prè9
du Berkel. Long. 24. 5o. lut. 5 i. 58.
COESNON, (Le) Géog. mod. riviere de France
en Normandie, qui prend fa-fource dans le Maine
• & fe jette dans la mer près du mont S. Michel.
COÉTERNITÉ, f. f. (Théolj) Les Théologiens
1 fe fervent de ce terme comme un attribut dés per-?
fonnes de la Trinité. Voyez Éte rn it é .
Les orthodoxes tiennent que la fécondé & la troi-
fieme perfonne de la Trinité font coéternelles à la première.
.Voyez T r in it é . (6 )
CO É V ÊQU E , f. m) ( Hifi. ecclèf. ) évêque employé
par un autre à fatisfaire pour lui aux fondions
de l’épifcopat. On dit qu’il y a encore en Allemagne
de ces dignitaires.
COEVORDEN, ( Géog. mod. ) ville forte des
Provinces-Unies dans l’Overiffel, capitale du pays
de Drente. Long. 2:4. 16. lat. 62. 40.
* COEUR, en Anatom. eft un corps mufculeux fi-
tué dans la cavité delà poitrine, où toutes les vei-
nés aboutiffent, & d’où toutes les arteres fortent ;
& qui par fa contraction. & fa dilatation ^Iternati-
H
COE U
ve > èft le principal infiniment de la circulation du
fang, & le principe de la vie. V , A rtere , V ein e,
-Sa n g , V ie , &c.
Les parties principales du coeur font la bafe; c’eit
le côté droit du coeur. Sa pointe, c’eft fon extrémité
gauche. Son bord antérieur & fon bord pojlérieur, ce
font deux des côtés de fa figure triangulaire. Saface
anterieure fupérieure convexe, > e’eft celle qui regarde
un plan horifontal qui ferait pofé fur la tête. Sa
face plate, c’eft la face oppofée à la précédente. Les
deux vefiibules, ce font les cavités qui font à la bafe :
on y diftingue deux parties, l’une plus évafée qu’on
appelle Jinus ; l’autre plus étroite figurée comme
une petite oreille, qu’on appelle oreillette. Ses ventricules
, ce font les deux cavités ereufées dans fa
fubftance, & qui ie conftituent : on les diftingue en
droit ou antérieur, en gauche ou poftérieur. Sa cloi-
fo n , c’eft la partie charnue qui fépare les deux ventricules.
Ses valvules tricufpides, mitraies , Jigmoi-
des. La valvule d'Euftachi. La valvule du trou oval.
Le tubercule de Lower, ou l’éminence qui fe remarque
dans les animaux entre le concours de la'veine-
cave fupérieure & de l’inférieure -, dans le parois interne.
lJifihme de Vieujfens, c’eft une éminence que
forment les troufleaux de fibres qui fe croifent autour
du trou oval dans l’oreillette droite. Les colonnes
charnues, voyez COLONNES. Le réfeau , ce font
des efpeces de mailles que les troufleaux de fibres
qui garniffent en-dedans les ventricules du coeur,
forment par leur entrelacement. Les petites tràverfes,
petits paquets de fibres fituées tranfverfalement d’ans
le fond des ventricules du coeur * relativement à l’orifice
de l’artere-aorte & de la pulmonaire auxquelles
elles répondent. Le trou oval ou boial, par lequel
le fang paffe dans le foetus de l’oreillette droite dans
la gauche. Le fac de Morgagni * c’eft un efpace qui
s’obferve entre la valvule du trou oval & fon.con-
tour. Les orifices des veines de Thebejius & de Verheyen,
ce font les orifices des veines qui s’ouvrent dans les
ventricules.
Le corps mufculeux entier eft enfermé dans une
capfule appellée péricarde , dont on expliquera la
ftruéture & les fondions fous le mot Péricard e.
Le coeur a en quelque forte la figure d’un cône ou
d’une pyramide renverfée, dont la partie fupérieure
qui eft la plus large eft appellée bafe, & l’inférieure
\z pointe , qui eft un peu tournée vers le côté gauche.
La bafe eft accompagnée de deux appendices
nommés oreillettes, & de gros vaifleaux fanguins.
. Voyez O reil le t te ,
Sa grandeur n’eft .point déterminée, & elle varie
dans les. différens lujets. Il a pour l’ordinaire fix
pouces de long, quatre ou cinq de large à fa bafe,
& quatorze de circonférence. Il eftfitué dans le milieu
de la poitrine dans le médiaftin, entre les deux
lobés des poumons. Il eft attaché au péricarde, &
fôûtenu par de gros Vaifleaux fanguins qui s’infe*
rent immédiatement dans fa fubftance , & il eft par
c e moyen à couvert des obftacles qui pourraient
s’oppoler à fon mouvement. Il eft enveloppé d’une
membrane mince, & entouré de graille vers fa bafe. ,
Voyez Membrane.
Le coeur eft creux , t & divifé en général en deux
grandes cavités appellées’ventricules,. dont le droit,
qui eft le plus grand, peut contenir deux ou trois
onces de fang : ces ventricules font féparés par une ,
cloifon charnue, compôfée ,des mêmes fibres mufcu-,
laires que les parois: on l’appelle cloifon; fa figure
eft concave du côté du ventricule gauche, Sc convexe
vers le droit. Ces ventricules n’ont aucune
communication immédiate, & le fang ne peut fe
rendre de l’un dans l’autre, qu’en palfant par les
poumons.
Les paroi« de ces ventricules ne font point éga-
Tome I I I .
C I U 59?
lement forts & épais ; le gauche l’eft beaucoup plus
que le droit, parce que fa fonflion eft de poufl'er
avec force le fang dans toutes les parties du corps ;
au lieu que le droit ne le pouffe que dans les poumons
, encore eft-il aidé par d’autres parties.
Il paraît en effet que le ventricule droit n’a été
fait qu’en faveur des poumons, car l’on ne trouve
que le ventricule gauche dans les animaux qui n’en
ont point.
On trouve dans les ventricules des petits mufcles
appellés colonnes charnues, ou lacertuli, lefquels fartent
des parois & vont s’attacher ppr des extrémités
tendineufes aux valvules du coeur, dont nous parlerons
ci-après.
On obferve au-deflus de chaque Vëntricüle une
cavité dans chaque oreillette , compofée de même
qu’eux d’un double rang de fibres charnues. Voyez
O reillet te*
Les vaifleaux qui fartent du coetir confiftent en
deux arteres, favoir l’aorte & l’artere pulmonaire ;
l’aorte fort du ventricule gauche , & l’artere pulmonaire
du droit ; & les vaifleaux qui s’y rendent font
deux veines qui iaboutiffent aux oreillettes , favoir
la veine-cave dans la droite, & la veine pulmonaire
dans la gauche. Voyez A o r t e ^ Pulmonaire*
&c.
Les arteres ont à leur embouchure dans chaque
ventricule trois valvules ou membranes femi-lunai-
re s , fituées de façon qu’elles s’oppofent au retour
du fang dans le coeur lors de fa dilatation. Voy. V a l vu
le.
Les oreillettes communiquent avec les ventricules^'
A l’orifice du ventricule droit, à l’oreillette droite,
font placées trais valvules appellées tricufpides , à
caufe qu’elles font .attachées par leurs trois pointes
ou colonnes charnues, par plufieurs cordes tendi-<
neufes ; de forte que dans la contraction ou fyftole
du coeur elles ferment l’orifice, & empêchent le fang
de rentrer dans l’oreillette droite.
Les déiix valvules mitrales font les mêmes fonctions
à l’entrée du ventricule gauche, & s’oppofent
au retour du fang dans l’oreillette gauche. Voyez
T ricuspide & Mit r a l e .
La lubftahce du coeur eft entièrement charnue ou
mufculéüfë. Lè$ anciens le prenoient généralement
pour un parenchyme : mais Hippocrate a mieux pen-
fé qu’eux là-deffus ; & Stenon, & ceux qui font venus
après lu i, ont démontré qu’il eft compofé d’une
fuite continue de fibres mufculeufes différemment
entrelacees, qui aboutiffent aux orifices de chaque
ventricule, où elles forment leurs tendons.
Lorfqu’on diffeque le. coeur on découvre , après
avoir ôté la membrane propre, fur la furface externe
du ventricule droit, quelques fibres fort déliées
qui tendent en ligne droite vers fa bafe. On trouve
immédiatement fous celles-ci une double couche de
fibres fpirales, dont les extérieures montent obliquement
depuis la cloifon jufqu’à la bafe, & forment
une elpece de vis. Les fibres intérieures prennent
une route contraire, fe portent obliquement de
droite àgauche, & forment pareillement une vis dans
un fens oppofé : fous celles-ci paroiffent les fibre9
du ventricule .gauche, & premièrement une fuite
fpirale qui fe porte vers la gauche , fous laquelle ,
auffi-bien que dans l’aiitre ventricule, on en trouve
une autre qui va du côté oppofé, laquelle s’étend
non - feulement jufqu’aux extérieures qui lui font
femblables, mais environne encore tout le ventricule
, & fait que la cloifon devient une partie du
ventricule gauche ; quelques-unes d’elles, au lieu de
fe rendre comme les autres dans les tendons du
ctpur, rentrent en-dedans & forment les colonnes
charnues, tandis que d’autres fe portent vers la poin-
F F f f