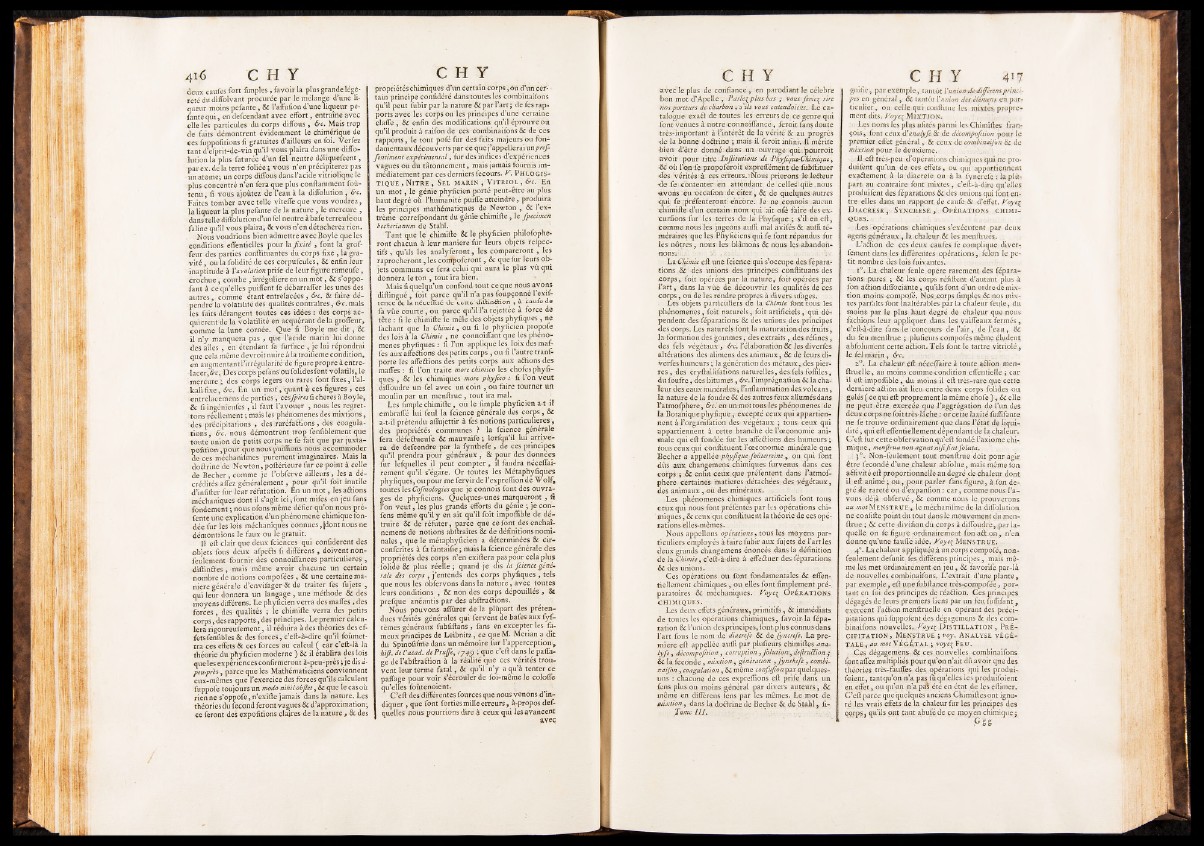
deux caufes fort Amples, favoir la plus grande légèreté
du diffolvant procurée par le mélange d’une ligueur
moins pefante, 6c Paffiifion d’une liqueur pelante
qui, en defcendant avec effort, entraîne avec ;
elle les particules du corps diffous , &c. Mais trop
de faits démontrent évidemment le chimérique de
ces fuppofitions fi gratuites d’ailleurs en foi. Verfez
tant d’efprit-de-vin qu’il vous plaira dans une diffo-
lution la plus faturée d’un fel neutre déliquefcent,
par ex. de la terre foliée ; vous n’en précipiterez pas
un atome; un corps diffous dans l’acide vitriolique le
plus-concentré n’en fera que plus conftamment foû-
tenu, fi vous ajoutez de l’eau à la diffolution ,& c .
Faites tomber avec telle vîteffe que vous voudrez,
la liqueur la plus pefante de la nature, le mercure ,
dans telle diffolution d’un fel neutre à bafe terreufeou
faline qufil vous plaira, & vôiis n’en détacherez rien.
Nous voudrions bien admettre avec Boyle que les
conditions effentielles pour la fixité , font la grof-
feur des parties conftituantes du corps fixe , la gravité
, ou la folidité de ces côrpufcules, 6c enfin leur
inaptitude à V-avolation prif'e de leur figure rameufe ,
crochue, courbe , irrégùliere en un m ot, & s’oppo-
fant à ce qu’elles puiffent fe débarraffer les unes des
autres, comme étant entrelacées, &c. & faire dépendre
la volatilité des qualités contraires, &c. mais
les faits dérangent toutes ces idées : des corps acquièrent
de la volatilité en acquérant delà grofleur,
comme la lune cornée. Que fi Boyle me d i t , 6c
il n’y manquera pas , que l’acide marin lui donne
des aîles , en étendant fa furface , je lui répondrai
que cela même devroit nuire à la troifieme condition,
en augmentant l’irrégularité de figure propre à entrelacer,
&c, D es corps pefàns'ou folidesfont volatils, le
mercure;; des corps légers bu rares font fixes, l’àl-
kali fixe, &c. En un mot? , quant à ces figures , ces
entrelaceméns de partiés-V éés^frMficherës'à Boÿïe,
& fi ingénieufes , il faut l’avouer , nous les regrettons
réellement ; mais les phénomènes des mixtions,
des précipitations , des iràréfa&ions, des coagula- '
tions y&c. nous démontrenttrop fenfiblément que
toute union de petits corps ne fe fait que par juxta-
pofition ,pour que nous puiflions nous accommoder
de ces méchanilmes purement'imaginaires. Mais la
doûrine de Newton, poftérieure fur ce point à celle
de Becher, comme je l’obferve ailleurs, les a décrédités
affez généralement, pour qu’il foit inutile
d’infifter fur leur réfutation. En un m ot, les aûions
méchaniques dont il s’agit ici , font mifes en jeu fans
fondement ; nous ofons même défier qu’on nous préfente
une explication d’un phénomène chimique fondée
fur ies lois méchaniques connues, |dont nous ne
démontrions le faux ou le gratuit.
Il eft clair que deux fciences qui confiderent des
objets fous deux afpe&s fi différens , doivent non-
feulement fournir des connoiffances particulières ,
diftinâes, -mais même avoir chacune un certain
nonibre de notions compofées , & une certaine maniéré
générale d’envifager & de traiter fes fujets ,
qui leur donnera un langage , une méthode 6c des
moyens différens. Le phyficien verra des maffes, des
forces, des qualités ; le chimifte verra des petits
corps, des rapports, des principes. Le premier calculera
rigoureul'ement, il réduira à des théories des ef-
fetsfenfibles & des forces, e’eft-à-dire qu’il foûmet-
tra ces effets & ces forces au calcul ( car c’eft-là la
théorie .du phyficien moderne ) 6c il établira des lois
que les expériences confirmeront à-peu-près ; je dis à-
peu-pris, parce que les Mathématiciens conviennent
eux-mêmes que l’exercice des forces qu’ils calculent
fuppofe toujours un modo nihilobfiet, & que le cas où
rien ne s’oppofe,n’exifte jamais dans la nature. Les
théories du fécond feront vagues 6c d’approximation;
ce feront des expofitions claires de la nature , & des
propriétés chimiques d’un certain corps ;ôü d’un cer-1
tain principe confidéré dans toutes lés combinaifons
qu’il peut fubir par la nature 6c par l’art ; de fes rapports
avec les corps ou les-principes d’une certaine
claffe , 6c enfin des modifications qu’il éprouve ou
qu’il produit à raifon de ces combinaifons & de cès
rapports, le tout pofé fur des faits majeurs ou fondamentaux
découverts par ce que j’appelleraixmpref-
fentiment expérimental, fur des indices d’expériences
vagues ou du tâtonnement, mais jamais fournis immédiatement
par ces derniers feçours. V , Ph lo g is -
t iq u e , Ni t r e , Sel m a rin ; V i t r io l , &c. En
un m o t, le génie phyficien porté peut-être au plus
haut degré où l’humanité puiffe atteindre, produira
les principes mathématiques de Newton , 6c l’ex-
trème correfpondant du génie chimifte, le fpecimen
becherianum de Stahl.
Tant que le chimifte & le phyficien philofophe-
ront chacun à leur maniéré fur leurs objets refpec-
tifs , qu’ils les analyferont, les compareront , les
raprocheront, les coirfpoferont, & que fur leurs objets
communs ce fera celui qui aura le plus vu qui
donnera le ton , tout ira bien.
Mais fi quelqu’un confond tout ce que nous avons
diftingué, foit parce qu’il n’a pas foupçonné l’exif-
tence &lanécefîité de cette diftinâion , à caufede
fa vûe courte, ou parce qu’il l’a rejettée à force de
tête : fi le chimifte fe mêle des objets phyfiques , ne
fachant que la Chimie, ou fi le phyficien propofe
des lois à la Chimie , ne connoiffant que les phénomènes
phyfiques : fi l’un applique les loix des maffes
aux affe&ions des petits corps , ou fi l’autre tranf-
porte les affe&ions des petits corps aux aftions des
maffes : fi l’on traite more chimico les chofes phyfiques
, 6c les chimiques more phyfico : fi l’on veut
diffoudre un fel avec un coin , ou faire tourner un
moulin par un menftrue , tout ira mal. ■
Les fimple chimifte, ou le fimple phyficien a-t il
embraffé lui feul la fcience générale des corps, 6c
a-t-il prétendu affujettir à fes notions particulières ,
des propriétés communes ? la fcience generale I fera défe&ueufe 6c mauvaife ; lorfqu’il lui arrivera
de defcendre par la fynthefe , de ces principes
qu’il prendra pour généraux , & pour des données
fur lefquelles il peut compter, il faudra néceffai-
rement qu’il s’égare. Or toutes les Métaphyfiques
phyfiques, ou pour me fervir de l’exprefllon de W olf,
toutes les Cofmologies que je connois font des ouvrages
de phyficiens. Quelques-unes marqueront, fi
l’on v eu t , les plus grands efforts du génie ; je con-
fens même qu’il y en ait qu’il foit impoflible de détruire
6c de réfuter, parce que ce font des enchaî-
nemens de notions abftraites 6c de définitions nominales
, que le métaphyficien a déterminées & cir-
confcrites à fa fantaifie ; mais la fcience générale des
propriétés des corps n’en exiftera pas pour cela plus
folide 6c plus réelle ; quand je dis la fcience générale
des corps , j’entends des corps phyfiques , tels
que nous les obfervons dans la nature, avec toutes
leurs conditions , 6c non des corps dépouillés , &
prefque anéantis par des abftraôions.
Nous pouvons affûrer de la plùpart des prétendues
vérités générales qui fervent de bafes aux fyf-
tèmes généraux fubfiftans, fans en excepter les fameux
principes de Leibnitz, ce que M. Merian a dit
du Spinofifrie dans un mémoire fur l’apperception-,
hiß. deVacad. de Prüfe, 1749 ; que c’eft daps le paffa-
ge de l’abftraftion à la réalité que ces vérités trouvent
leur terme fa ta l, & qu’il n’y a qu’à tenter ce
paflage pour voir s’écrouler de foi-même le coloffe
qu’elles foûtenoient.
C ’eft des différentes fourcesque nous venons d’indiquer
, que font forties mille erreurs, à-propos def-
quelles nous pourrions dire è ceux qui les avancent
avec;
avec le plus de confiance.,? :en parodiant le célébré
bon mot d’Apelle y Parle{ plus bas ; vous-ferie^ rire
nos port'eurs de cHarbon 's’ils vous entendoient:. Le catalogue1
exaét de toutes les erreurs de; ce genre qui
font venues à notre connoiffancé., feroitfanf doute
très-important à'l’intérêt de la vérité1 .& .au progrès
de la bonne dodrine ; maïs il feroit infini. .11 mérite
■ bien1 d ’être donné: dans .un ouvrageiquk.'pburroit
avoir pour \titie .Infiitutions de PhyfiqiuuClümique,
■ & où l’onfe.pEopofeiroitexpreftementde fubftituer
des vérités : à ces erreurs. î Nous prierons dededeur
d e fe.icontenterr en attèndant de. cellesf'qtiè.nous
•avons èu »ccalàan idé citer, & de quelques.autres
q ui fe :jfréfenteront: encore. Je.negconnois .aucun
chimifte: d’un certain nom "qui ait ofé faire d es ex-
cunfions fur les terres de ■ la Phyfique. ; s’il eh eft,
rommeinous les: jugeons.auffi. mal avifési& aùfîi téméraires'queles
Phyficiens qui fe font répandus fur
lès nôtres, nous: les-blâmons & nous lçs? abandon-
nonsiûij : 1 . V: ( • •• • .j ,j .•
Lz.Ckimie eft: unefcieiïce qui s’occupe des. féparaf
rions ,& des unions; des .principes conftituans des
corps, foit opérées:par;là nature,' foit opérées par
l’art, dans la vue de découvrir les qualités de ces
corps, ou de les rendre propres, à ;divers ufages. . ,
Les objets particuliers de la Chimie font tous les
phénomènes, foit naturels ; foit1 artificiels qui dé-?
pendent des féparatiOns & des unions des. principes
des Corps. Les naturels font la maturation des fruits,
la formation des gommes, des extraits, tdes réfines,
des fels végétaux , l’élaboration'& les diverfes
altérations des alimens des animaux, & de leurs di-
Verfes humeurs ; la génération des métaux.,.des pierres
, des cryftallifations.naturelles, des.fels foffiles,
du foufre, des^bitumès, &c. l’imprégnation & la chaleur
des eaux minérales.; l’inflammation desivolcans,
la nature de la foudre & des autres feux allumés dans
l’atmofphere, &c '. en un mot tous lès phénomènes.'de
la Botanique phÿfiquè ,: excepté ceux qui appartiennent
à l’organifation des végétaux ; tous, ceux qui
appartiennent à cette-branche de l’oeconomie animale
qui eft fondée fur.les. affeftions des' humeurs ;
tous ceux qui cônftituent l’oeconomie minérale que
Becher a appellée phyfique:fouteireine, ou qui font
dûs aux changemens chimiques furvenus dans ces
corps:; .& enfin ceux que préfentent dans l’atmof-
phere. certaines matières détachées' des végétaux,
dés animaux, où des minéraux. _
Les phénomènes chimiques artificiels font tous
ceux qui nous font préféntés par les opérations chimiques
, & ceux qui cônftituent la théorie de ces opérations
elles -mêmes .;
Nous appelions opérations, tous les moyens particuliers
employés à faire fubir aux fujets de l’art les
deux grands changemens énoncés dans la définition
de la Chimie, c’eft-àdire à effectuer des-féparatiOns
& des unions.' .
Ces opérations ou font fondamentales & eften-
tiellement chimiques, ou elles font Amplement pré-,
paratoires &: méchaniques. Voye^ Opérations
ch im iq u e s . - -
Les deux effets généraux, primitifs, & immédiats
de toutes les opérations chimiques , fayojr la fépa-
ration & l’union des principes, font plus connus dans,
l’art fous le nom -de diacrefe & de Jyncrefe. La première
eft appellée aufli par plufxeurs chimiftes ana-
Lyfe, décompofition, corruption , folutiondejlruclion
& la. feco'nde, mixtion-. , génération , fynthefe , combi-
naifon x coagulation, SC même confufion par quelques-
uns : chacune de ces expreflions eft prife dans un
{bas plus ou moinsi général par divers auteurs , &
même en différens fens par les mêmes. Le mot de
mixtion,, dans la doftrine de Becher & de S tahl, li-
Tomc I II,
gnifiê, .par exemple., tantôt l’uniondc différens principes
en généra l, 6c tantôt l’union des, élemens. en particulier,
ou celle qui-conftitue les mixtes, proprement
dits; Voye^ MIXTION.
' ! ■ L e s noms les plijs ufités parmi les Chimiftes fran-
çois , font ceux d’analyfe. & de décompofition pour le
premier .effet général, & c.eux de combinaifon 6c de
mixiiori pour le deuxieme..
.. ILeft très-peu d’opérations chimiques qui ne pro-
duifent qu’un de ces effets, ou qui appartiennent
exjtéfcement: à la diacrefe- ou à la fyncrefe/: la.plêh
pa rt au contraire font mixtes, c’eft-à-dire qu’elles
pEoduifent des féparations 6c des unions qui font entre
elles dans un rapport de caufe, & d’effet. Voye^
Di'AeRiÉSE, Syn c r e s e , . O pérations ch im iq
ues. i,- ,
- L e s Opérations chiihiqiies s’exécutent par deux
agehs généraux , la. chaleur 6c les mehftrués,.
L’aélion de ces deux caufes; fe complique diver-
fement ,d.ahs <les différentes opérations , félon le petit,
nombre des loi's fuiyantes.
L a . chaleur feule opère rarement des fépara-
tiohsi.puresl ; 6c les: corps r.éfiftent d’autant plus à
fon aftion diflbciahte., .qu’ils font d’un Qr;dre de mixtion
moins compofé. Nos,corps fim[des. ôc nos mixtes
parfaits font inaltérables par la chaleur feule-, du
moins par le plus haut degré de chaleur que nous
fâchions leur appliquer dans les VailTeaux fermés,
e?.eft-à-dire fans le iconcours de l’a i r , ’de l’e a u , 6c
du feu menftrue ; plufieurs compofés même éludent
abfolument cette aérion.Tels font le tartre vitriolé,
le fel marin, &c.
i°. L a chaleur éft néeeftaire à toute aélion men-
ftruelle, au moins comme condition effentielle ; car
il eft impoflible, du moins:il eft très-rare que; cette
derniere aâ ion ait lieu, entre deux corps folides ou
gelés (ce. qui eft. proprement la même.chofe ) , 6c elle
ne pçut.être exercée que J ’aggrégation de l’un des
deux coirps ne foit très-lâche : or cette laxité fufKfante
ne.fe trouve ordinairement que dans l’état de liquidité
, qui eft effentiellement dépendant de la,chaleur.
G’eft lur cette obfervation.qu’eft fondé l’axiome chimique
i menfirua non agunt nifiifint foluta .
4 3°.; Non-feulement tout menftrue doit pour, agir
être fécondé d’une chaleur abfolue, mais même Ion
activité eft proportionnelle au degré de chaleur dont
il- eft animé ; o u , ,po,ur.-parler fansfigure, à.fon degré
de rareté ou. d’expanfion : c a r , comme nous l’avons
déjà obfervé, 6c comme nous le, prouverons
au mot MENSTRUE:jile mé,chanifme d e là diffolution
ne c.onfifte point du tout dans le mouvement du men-
ftr.ue ; & cette divifion,dû corps à d iffo u d re p a r la quelle.
on fe figure ordinairement fon aéLon , n’en
d.onnes qu’une muffé idée.^ Koye^ Me n st r u e ;
- 4°. L a chaleur appliquées un corps compofé, non-
feulement defunit fes_différens principës ,, mais même
les, met 'ordinairement en je u , 6c favorife par-là
de nouvelles combinaifons. L ’extrait d’ime plante ,
par exemple, eft unefubftance très-compofée, portant
en foi des principes deréaélion. Ces principes
dégagés de leurs premiers liens par un feu fuffifant,
exercent l’aftion me;nftruelle en opérant des précipitations
qui fuppofent de;s dégagemens & des combinaifons
n o u v e l l e s , . D i s t i l l a t io n , Pr é c
i p i t a t io n ,. P e ^ s t r u é A n a l y s e v é g é t
a l e ja u mot -Y-ÉGIIt a l ?çye{ F e u .
.. Ces dégagemens- & ces nouvelles, combinaifons
font,affez multipliés pour qu’on n’ait dû-avoir que des
théories très-fauftes. des opérations ;qui les produi-
fpient, tant qu’on n’a pas lu qu’elles les produifoient
qn effet, ou qu’on n’a pas été en état de les eftimer.
C ’eft parce que quelques anciens Chimiftes ont ignoré;
les vrais effets de la. chaleur fur les principes des
cprps, qu’ils ont tant abujfé de ce moyen chimique j