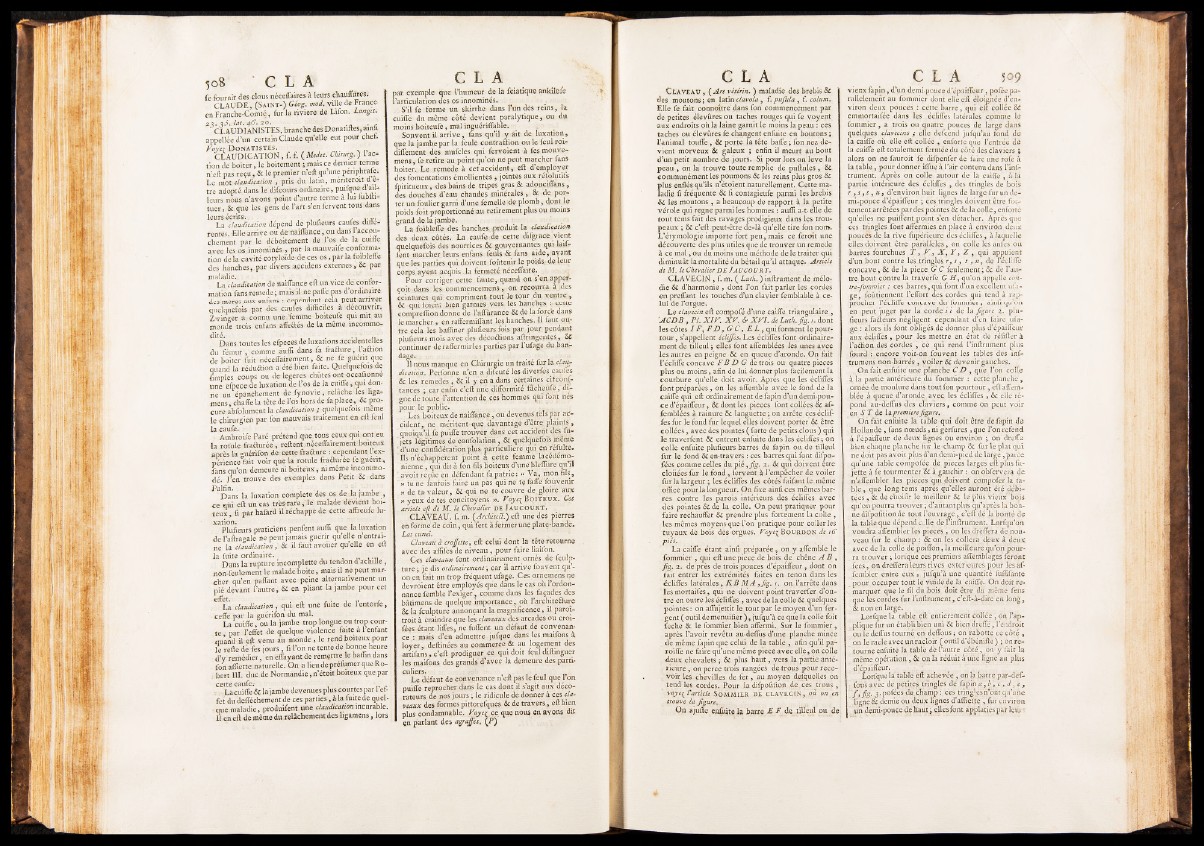
Ce fournir des clous néceffaires à leurs chauffdresr
. CLAUDE, ( S a i n t - ) Giog. moi. ville de France
en, Fr^ndie--Comiç, fur la riviere de Lifon. Longit.
%%. i j . lat. 4&. 20. ....... é
CLAUDIANISTES, branche des D.onatiftes,amii
appellée ’d’un certain Claude qu’elle eut pour chef.
Voyez D o NATISTES.
CLAUDICATION, f. f. (.Medec. Chirurg. ) l ac*
tion de boiter, le boitement ; mais ce dernier terme
n’eft pas reçu, & le premier n’eft qu’une périphrale.
Le mot claudication , pris du latin, meriteroit d titre
adopté.dans le.difcoürs ordinaire, puifqueri’aik
leurs nous n’avons point d’autre terme à lui fubfti-
tuer , &. què les gens de l’arts’en fervent tousidans
leurs éc rits;.. .
La claudication dépend de plufieurs cauies ditte-
rentes. Elle arrive ou dè' naiflance, ou dans 1 accouchement
par . le déboitement de i ’os de la. cuiffe
avec les,os innominés,, par la mauvaife conformation
dé la cavité cotyloïde de ces o s , par la fojbieffe
des .hanches v par divers .apcidens externes » & par
malàidie^ a/: . ’ " ■ '.....
La iclaudication de riaiffance eft un vice de: confôrmation
fans femedu.;.mais [il nepùfie.pas d’ordinaire
desmores.aux enfans : cependant cela peurarriver
quelquefois .par des cauies düiicilcs à découvrir.
Ziringer. a-.-connu une .femme boiteufe qui mit au
monde trois'enfans .affitftés. de la même incominor
^Dans toutes les efpecasdé luxations accidentelles
du fémur comme .aiitlî dans fa fiaélure, 1 action
de boiter litiit néceffairément I & nétfe sguerit. que ;
quand la réduflion a é iéü en faite. Quelquefois de
fimptes coups ou. de-legeres iChûtes ont becafisnne :
ttner éfoeceide luxation,de l’os, de la cuiffe ,.qui don.
ne un épâncbement de. fynoyîe , relâche' les liga-
mens, chaffèla têtedel’às.borsds’faplace, & procure
abfolument lacclfW&fMWqi quelquefois même ,
le chirurgien par. fou mauvais traitement en eft feul .
la caufe. ' -• -•*' 1 .
• Ambroife Paré prétend ,que tous ceux qui ont eu
la rotule fra&urée » relientmèceffairement.boiteux
après la «mérifon de cette frafture : cependant; l’ex-
perience fait voir que la'rotule fraaurée de.'guént-,
■ fans qu’on demeure ni boiteux , ni meme incommodé.
J’en trouve des exemples, dans Petit & dans
Dans la luxation complété des os de ia jambe ,
ce qui eft un cas trè£rar e ,' le malade devient boi- ;
teu x, fi par hafard il'réchappe de cette affreufe ;lu-
Plufieurs praticiens penfent auffi que la luxation
de l’aftragale ne peut jamais guérir qu’elle n’entraîne
la claudication, & il faut avoiier qu’elle en eft
la fuite ordinaire.
Dans la rupture incomplette du tendon d achille,
non-feulement le malade boite, mais il ne peut marcher
qu’en paffant avec peine alternativement un
pié devant l’autre en pliant la jambe pour cet
La claudication, qui eft une fuite de 1 entorfe,
ceffé par la guérifon du mal.
La cuiffe, ou la jambe trop longue ou trop courte
par l’effet de quelque violence faite à l’enfant
quand .il eff venu au monde, le rend boiteux pour
le refte de fes jours, fi l’on ne tente de bonne heure
d’y remédier, en èffayant dé remettre le baffm dans
fon afliette. naturelle. On a lieu de prefumer que Ro-
bert 111. duc.de Normandie, n’étoit boiteux que par
cette caufer " fp •„ . .
Là cuiffe & la jambe devenues plus courtes par 1 effet
du defféchement de ces parties, à la fuite de quelque
maladie, produifent une claudication incurable.
Il en eft de même du relâchement des ligamens, lors
>ar exemple que l’humeur de la feiatique ankil&fé
’articulation des os innominés.
S’il fe forme un skirrhe dans l’un des reins, la
cuiffe du même côté devient paralytique,.ou du
moins boiteufe, mal inguériffàble.
Souvent il arrive, fans qu?il y ait . de luxation,
que la jambe par la feule contra&ion ou le feul roi-
diffement des mufclès qui fervoient-àfes.mouve-
mens , fe retire au point qu’on ne peut marcher fans
boiter.., Le. remede à cet accident-, eft d’employer
des fomentations émollientes , jointes aux refoliitifs
fpiritueux, ,des bains de tripes gras & adouciffajis ,
des douchés d’èau chaudes minérales, & de porter
un foulier garni d’une femelle fie plomb, dpnt.le
poids foit proportionné au retirement plus ou moin$
grand delà jambe. '.y - . / '
La foibleffe des hanches .produit la claudication
des deux, côtés. La caufe de cette difgrace vient
quelquefois des nourrices & gouvernantes qui laif-
fent marcher leurs enfans feûls & fans aide, ayant
qije les parties qui doivent ,-fofitenir le poids de leü|r
corps.ay.ent acquis ,1a fermeté, néceffaire.
Pour corriger cette fautequand on s’etiapper-
çoit dans : les commencemens, on recourra àjdes
ceintures qui compriment tout le tour du ventre ,
&c qui foient bien garnies.vers les hanches. cette
çomprefîion donne de l’aflurançe & de la forcé dans
le marcher, en raffermiffant les hanches. Il faut outre
cela les baffiner plufieurs. fois par. jour, pendant
plufieurs mois avec des décodions aftring,entes.,: ôc
continuer de raffermir les parties par l’ufage duban-
dage*rj :r: d ; # i , ' ' ' ' °
Il nojis manque en Chirurgie un traité fur la claudication.
Perfonne n’en a difeuté les diverfes caufes
& les remedes , & il y en a dans certaines eifeonf.
tances ; car enfin c’eft une difformité .fâchëùfe, digne
de toute-l’attention de ,c.es hommes quffônf nés
pour! le public. :
Les. boiteux de naiffance, ou devenus tels pa f accident,
rie méritent-que davantage d’êtr£ plaints ,
quoiqu’il,fe puiffe trouver dans cet accident des_fu-
j.ets légitimes de confqlation, & quelquefois meftie
'd ’une cônfidératioriplus particulierè'qui entéftilte.
Ils- n’échappefent point à cette femme lacedémo-
riienne , qui dit à fon fils boiteux d’une'bléflure qu’il
: avoir reçue en défendant fa patrie : « V a , mon fils ,
tu ne faufôis fai’ré un pas' qui ne' fç faffe' fôùVenir
» de. ta- valeur, .& qui ne-te-couvre de, gloire, airx
» yeux de tes concitoyens ». Vôye[ Bo it eu x . Cet
article eft de M. le Chevalier DE JAUCOÜRT.
CLAViEAU. f. m. (A r ch ite cl.) eft une des pierres
èn formé de coin, qui fert à fermer Une plate-bandè.
L a t cunei.
Claveau à crojjette, eft celui dont la tête retourne
avec des afîifes de niveau, pour faire liaifon.
Ces c laveaux font ordinairement ornés de fculp-
ture ; je dis ordinairement j car il arrive fouvent qu’on
en fait un trop fréquent ufage. Ces ornemens ne
devrôient être employés que dans le cas ôîi l’ordonnance
femble l’exiger, comme dans les façades des
bâtimens de quelque importance, où l’architefture
Si la fculpture annonçant la magnificence, il paroî-
troit à craindre que les claveaux des arcades ou croi-
fées étant liffes, ne fuffent un défaut de convenance.:
mais d’en admettre jufque dans les maifons à
loyer, deftinées. au commerce & au logement des
artifans, c’eft prodiguer, ce qui doit feul diftinguer
les maifons des grands d’avec la demeure des particuliers.
; ; .-cri •
Le défaut de convenance n’eft pas le leul que l on
puifle reprocher dans le cas dont il s agit aux décorateurs
de nos jours ; le ridicule de donner à ces cla~
veaux des formes pittorefques & de travers., eft bien
plus condamnable. Vpye^ co que nous en ayons dit
en parlant des agrafes, (P)
C L A V E A U , \A r t véeérin. ) maladie des brebis Sc
des moutons; en latinclavola, f.pufula , f. colum.
Elle fe fait connoître dans fon commencement par
de petites élevûres ou taches rouges qui fe voyent
aux endroits oit la laine garnit le moins la peau : ces
taches ou élevûres fe changent enfuite en boutons ;
l’animal touffe, & porte la tête baffe ; fon nez devient
morveux & galeux ; enfin il meurt au bout
d’un petit nombre de jours. Si pour lors on leve la
peau , on la trouve toute remplie de pullules , &
communément les poumons & les reins plus gros &
plus enflés qu’ils n’étoient naturellement. Cette maladie
fi fréquente & fi contagieiife parmi les brebis
& les moutons , a beaucoup de rapport à la petite
vérole qui régné parmi les hommes : auflx a-t- elle de
tout tems fait des ravages prodigieux dans les troupeaux
; & c’eft peut-être de-là qu’elle tire fon nom.
L ’étymologie importe fort peu, mais ce ferait une
découverte des plus utiles que de trouver un remede
à ce mal, ou du moins une méthode de le traiter qui
diminuât la mortalité du bétail qu’il attaque. Article
de M. le Chevalier DE J AU COU RT.
CLAVE CIN , f. m. ( Luth. ) inftrument de mélodie
& d’harmonie , dont l’on fait parler les -cordes
en preffant les touches d’un clavier femblable à celui
de l’orgue.
Le clavecin eft compofé d’une caiffe triangulaire ,
A C D B y PI. X I r . x y . & X V I . de Luth. fig. I. dont
les côtes I F , F D , G C , Ë L , qui forment le pçurT
tour, s’appellent éclijjis. Les écliffes font ordinairement
de tilleul ; elles font affemblées les unes avec
les autres en peigne & en queue d’aronde. On fait
l’écliffe concave F B D G de trois ou quatre pièces
plus ou moins, afin de lui donner plus facilement la
courbure qu’elle doit avoir. Après que les écliffes ’
font préparées, on les affemble avec le fond de la
caiffe qui eft ordinairement de fapin d’un demi-pouce
d’épaiffeur, & dont les pièces font collées & affemblées
à rainure & languette ; on arrête ces écliffes
fur le fond fur lequel elles doivent porter & être
collées, avec des pointes ( forte de petits clous ) qui
le traverfent & entrent enfuite dans les écliffes ; on
colle enfuite plufieurs barres de fapin ou de tilleul
fur le fond & en-travers : ces barres qui font difpo-
lees comme celles du pié y fig. z . & qui doivent être
cloiiées fur le fond, fervent à l ’empêcher de voiler
fur la largeur ; les écliffes des côtés faifant le même
office pour la longueur. On fixe ainfices mêmes barres
contre les parois intérieurs des écliffes avec 1
des pointes & de la colle. On peut pratiquer pour
faire rechauffer & prendre plus fortement la colle ,
les mêmes moyens que l’on pratique pour coller les
tuyaux de bois dès orgues. Voye^ Bourdqn de iG i
pies- I HH
La caiffe étant ainfi préparée, on y affemble le
fommier , qui eftunepiece de bois de chêne A B ,
fig. z . de près de trois pouces d’épaiffeur, dont on
fait entrer les. extrémités faites en tenon dans les ,
écliffes latérales, K B M A ,fig. /. orvl’atrête dans
les mortaifes, qui ne doivent point traverfer d’outre
en outre les écliffes , avec de la colle & quelques
pointes : on affujettit le tout par le moyen a’un fer*
gent ( outil de menuifier ) , jUfqu’à ce que la colle foit
leche & le fommier bien affermi. Sur le fommier ,
après l’avoir revêtu au-deffus d’une planche mince
de même fapin que celui de la table , afin qu’il pa-
roiffe ne faire qu’une même pièce avec elle, on colle
deux chevalets ; & plus haut , .v.ers la partie anté-.
rieure ,. on perce trois rangées de trous pour rece- ■
voir les chevilles, de fer , au.moyen desquelles on
tend les cordes. Pour ,1a difpofition .de,ces trous ,
Voye^_ l'article SOMMIER DE CLAVECIN, ou on en‘
trouve la figure..
On ajufte enfuite la barre E F de .tilleul pu de
vieux fapin, d’un demi-pouce d’épaiffeur, pofée parallèlement
au fommier dont elle éft éloignée.d’environ
deux pouces : cette barre, qui eft collée
emmortaifée dans les écliffes latérales comme le
fommier, a trois ou quatre pouces de large dans
quelques clavecins y elle defeend jufqu’au fond de
la caiffe où elle eft collée , enforte que l’entrée dé
la caiffe eft totalement fermée du côté des daviers ;
alors on ne fauroit fe difpenfer de faire une rofe à
la table, pour donner iffue à l’air contenu dans l’inf-
trument. Après on colle autour de là caiffe , à là
partie intérieure des écliffes , des tringles de bois
r y s y t , u y d’environ huit lignes de large fur un demi
pouce d’épaiffeur ; cès tringles doivent être fortement
arrêtées par des pointes & de la co^le, enfortè
qu’elles ne puiffent.point s’en détacher. Après que
ces tringles font affermies en place à environ deux
poucës de la rive fupérieure des écliffes , à laquelle
elles doivent être parallèles, on colle les anfes ou
barres fourchues T } V , X , Y y Z , qui appuient
d’un bout contre les.tringies r, s , t , Uy de l’écliffe
concave, & de la piece. G C feulement ; & de l’autre.
bout contre la trayerfe G H , qu’on appelle con-
trerfommier : ces barres, qui font d’un excellent ula-
g e , foûtiennent l’effort.des cordes qui tend à rapprocher
l’écliffe concave du' fommier, ainfi qu’on
en peut juger par la corde i i de la figure 2. plufieurs
faftéurs négligent cèpendant d’en faire ufage
: alors ils font obligés de donner plus d’épaiffeur
aux écliffes , pour les mettre en état de réfifter à
l’adion.des cordes , çè qui rend l’inftrument plus
fpurd'': encore voit-on .fouvent les tables des inf-
trumens non barrés y. voiler & devenir gauches. f:
, Ôn fait enfuite une planche C D , que l’on colle
à la partie antérieure du fommier : cette planché,
ornée de moulure dans tout fon pourtour, éft affem-
blée à queue d’aronde.. avec les écliffes , & elle répond
au-deffus des claviers, comme on peut voir
en i" T de la première figure.
On fait enfuite la table qui dpit être de fapin de
Hollande , fans noeuds , ni gèrfures ,que l’on refend
à l’épaiffeur de deux lignes ou environ ; on dreffs
bien chaque planche fiir le-champ & fur le plat qui
ne doit pas avoir plus d’un demi-pied de large, parce
qu’une table coinpofée de pièces larges ell plus fii-
jette à fe tourmentgr,'& à.gauchir : on obfervera de
n’affembler les pièces qui doivent çpmpofer la table
, que long-tems après qu’elles auront été débitées
, & dechoifir le meilleur & le pliis vieux bois
qu’on pourra trouver f d’aiitant plus qu’ aptjès la bonne
difpofition de tout l’ouvrage, c’ èft dé la bonté cle
la table que dépend celle de. l’inftrument. Lorfqu’on
voudra affembîer les pièces , on lès dreffera de nouveau
fur le champ : & on. les collera d£ux à deux
avec de la colle de poifîbn, la meilleure qu’on pourra
trouver ; lorfque ces. premiers affemblagës feront
fec.s, on dreffera leurs rives extérieures pour lesàf-
fembler entre eu x , jufqti’à une quantité fuffifante
pour occuper tout le vuide de la caiffe. On doit re-
marquer que le fil du bois doit être du même fens
que les cordes fur l’inftrumertt, c’eft-à-dire en long,
& non en large.
Lorfque la table eft entièrement collée , On l’applique
fur un établi bien uni & bien drèffé, l’endroit
J ou lëdeffus tourne en deffous ; on rabotte ce côté ,
" on le racle avec un.raçloir ( outil d’ébénifte ) ; on retourne
enfuite la table de l’autre cô té, ôn y fait la
même opération, & on la réduit à une ligne au pliis
.d ’épaiffeur.
Lorfque là tablé èft achevée , on là barre par-def-
■ fous avec de petites tringles de fapin a , b c yd , e ,
f». fio- 3 • P°fées de. champ : ces tringles i f ont qu’u ne
ligne & demie ou deux lignes d’affiette , fur environ
un demi-pouce de haut ; elles font àpplaties par leiu -