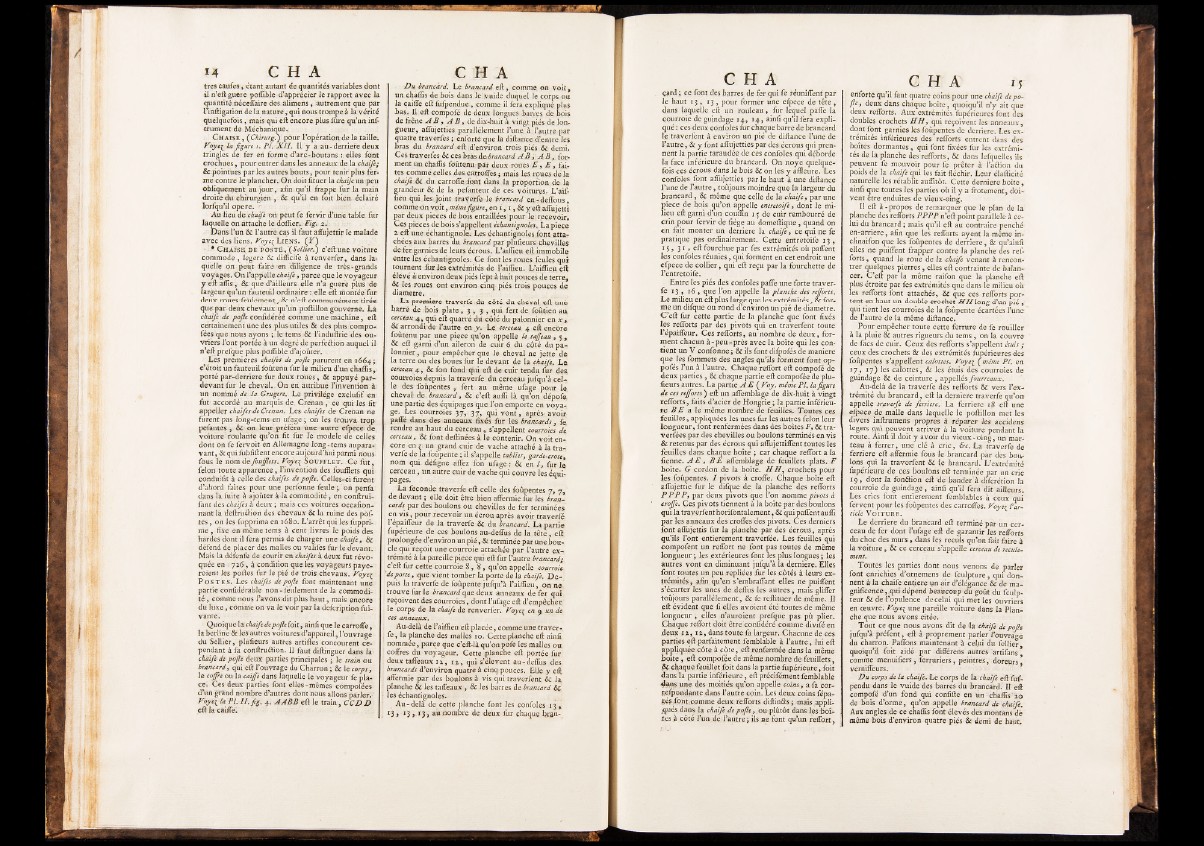
très caufes, étant autant de quantités variables dont
il n’eft guere poflible d’apprécier le rapport avec la
quantité,néceflaire des alimens, autrement que par
l’inftigation de la nature, qui nous trompe à la vérité
quelquefois, mais qui eft encore plus fure qu’un infiniment
de Méchanique.,
C h aise , ( Chirurg.) pour l ’opération de la taille.
Foye^ la figure i. PI. X f l . IL y a au-derrière deux
tringles de fer en forme d’arc-boutans :: elles font
crochues, pour entrer dans les anneaux delà chaife;
& .pointues parles autres bouts, pour tenir’plus ferme
contre le plancher. On doit fituer la chaije:un peu
obliquement au jour, afin qu’il frappe fur la main
droite du chirurgien , & qu’il en foit bien, éclairé
lorfqu’il opéré. 0
Au lieu de chaife ori' peut fe fervir d’une table fur
laquelle on attache le doffierr Fig. xi:
Dans l ’un & l’autre cas il faut affujettir le malade
avec des liens. Foye[ L iens. (T")
* Ç h a fs d e p os t È, ^ ( ellier. ) c’eftune voiture
commode , legere ôc difficife à renverfer, dans laquelle
On peut fairô en diligence de très-grarids
voyages. On l’appelle cAai/ê, parce que le voyageur
y « f t aflis & êjc que d’ailleurs elle n’a guère plus de
largeur qu’-un fauteuil ordinaire : elle eft montée fur
deux roues f e u lem e n t ; ,n ’eft communément tirée
que par deux chevauxqu’un portillon gouverne. La
ckaiji de pofie confidéréé comme, une machine, eft
certainement Une des plus utiles & des plus compo-
fées’que nous ayons le tems ôtT’induftrie des ouvriers
l’ont portée à un degré de perfection auquel il
n’ert prefqiie plus poflible 'd?ajourer.
Les premières chaifes de pofie parurent en 1664;
c’étoit un fauteuil foûtenù fur le milieu d’un chaflis,
porté par-derriere fur deiix roues , & appuyé par-
devant fur le cheval. On en attribue l’invention à;
un nonimé de -la Grugere. Le privilège exclufif 'en'
fut accordé au marquis de, Creinan, ce qui'les fit
appeller ckaifes de Crenan. Les chaifes de Grenan ne
furent pas long-tems en ufage ; on les trquva. trop
pefantes , & on leur préféra une autre efpece' de
voiture roulante qu’on fit fur le modèle de celles
dont on fe fervoit en Allemagne long-tems aupara-'
vant, & qui fubfiftent encore aujourd’hui parmi n'ous'
fôus le nom dëfouffiets. Foyeç Souf f let. . C e fu t ,
félon toute apparence, l’invention des foufflets qui
conduifit à celle des chaifes de pofie. Celles-ci furent
d’abord faites pour une perfonne feule; on penfa
dans la fuite à ajouter à la commodité, en conftrui-
fant des chaifes à deux ; mais ces voitures occafion-
nant là dêftrüCtion des chevaux & la ruine des pof-
tes , on les fupprima en 1680. L’arrêt qui les fuppri-
nie , fixe en même teins à cerit livres le poids des
hardes dont il fera permis de charger une chaife, &
défend de placer des malles ou valifes fur le devant.
Mais la défenfe de courir en chaifes à deux fut révoquée
en 17 16 , à condition que les voyageurs payem
en t tes portes fur le pié de trois chevaux. Foyeç
P o s t e s . Les chaifes de pofie font maintenant une
partie confidérable non - feulement de la commodité
, comme nous l’avons'-dit plus haut, mais encore
du lu x e, comme on va le voir par la defeription fui-
vânte.
Quoique la chaife de pofie foit, ainfi que le carroffe,
la berline & lés autres voitures d’appareil, l ’ouvrage
du Sellier, plufieurs autres artirtes concourent cependant
à fa conftru&ion. Il faut dirtinguer dans la
chkife de pofie deux parties principales ; le train Ou
brancard, qui eft l’ouvrage du Charron; & le corps,
le coffre ou Ici coiffe dans laquelle le voyageur fe place.
Cés deux parties font elles-mêmes compofées
d’un gr^and nombre d’autres dont 'noùs allons parlera
Voyt{ la P l.H .fig . 4. A A B B eft le train, C C D D
eft la caifle.
■ Du brancard. Le brancard e ft , comme on v o it ,
un efyaffis de bois dans le'.vuide duquel le corps ou
la caifle eft fufpendue , comme il fera expliqué plus
bas. I l ’eft compofé de deux longues barres, de bois
4e frêne A B , A B , de dix-huit à vingt pies de jonr
gueur, aflujetties parallèlement l’uné. à l’aqtre pat
quatre traverfes ; enforté que la diftance d’entre les
bras du brancard eft id’enyirori trois: pies & demi,
Ces traverfes & ces bras de. brancard 4 B , A B forment
un chaflis foûtenù ipa'r deux roues E , E , fair
tes comme celles des. ca^roffes ; mais les.-roues de la
ckaifi àc du carrofle/iont dans la proportion., de la
grandeur &c de la pefanteur de ces voitures, L’aif-
fieu qui lesqoint tra-f erfe. le brancard en - deflous,
comme on v o it, meme figure, en 1 , 1 , & y eftaflujetti
par deux pièces de bois entaillées pour le ; recevoir.
Ces pièces de bois s’appellent êçhantignoleLa piece
2- eft une éèhantignole. Les échantignole§fo|it attachées
aux barres du brancard par plufieurs chevilles
de fer garnies de leurs écrous. L ’aiflieu eft immobile
entre les échantignoles. Ce font les roues; feules qui
tournent fur les extrémités de l’aiffieu. L ’aiflieu eft
élevé à environ deux piés fept à huit pouces de terre,
& les roues ont environ cinq piés trois pouces de
: diamètre.
L a première traverfe ;du côté du cheval eft une
barré de bois plate, 3 , 3 , qui fer.t de fo^rien au
cerceau 4 , qui eft quarré du côté du palonnier en
& arrondi'de l’autre en y . Le. cerceau 4 eft encore
foûtenù par une piece qu’on appelle le taffeau, 5 ,
& eft garni d’un aileron de cuir 6 du côté du palonnier,
pour empêcher que le cheval ne jette de
la terre ou des boues fur le devant de la chaife.. Le
cerceau 4 , & fon fond: qui eft de cuir tendu fur des;
côutroiesdepuis la traverfe du cerceau juiqu’à celle
des foûpentes fert au même ufage pour le,
cheval de. brancard, & c’eft aufli là qu’on dépofe,
une partie des équipages que l’on emporte en voyage.
Les courroies 37,. 37, qui v o n t, après- avoir
parte dans des anneaux fixés fur les brancards, fe
rendre au haut du cerceau, s’appellent courroies de.
cerceau, &c font deftinées à le contenir. On voit encore
en c lin grand cuir de vache attaché à la traverfe
de la foûpente f i l s’appelle tablier, garde-croie,
nom qui. défigne àffez fon ufage : & en l , fur le
cerceau, un autre cuir de vache qui couvre les équipages.
La fécondé traverfe eft celle des foûpentes 7 , 7 ,
de devant ; elle doit être bien affermie fur les brancards
par des boulons ou chevilles de fer terminées
en v is , pour .recevoir un écrou après avoir traverfe
l’épaiffeur de la traverfe & du brancard. La partie
fupérieure de ces boulons au-deffus de la tête , eft
prolongée d’environ un pié, & terminée par une boucle
qui reçoit une courroie attachée par l’autre extrémité
à la pareille piece qui eft fur l ’autre brancard;
c’eft fur cette courroie 8 , 8 , qu’on appelle courroie
'déporte, que vient tomber la porte de la chaife. D e - ,
puis la traverfe de foûpente jufqu’à l’aiflieu, on ne
trouve fur le brancard que deux anneaux de fer qui
reçoivent des courroies, dont l’ufage eft d’empêçhec
le corps de la chaife de renverfer. Foye^ en 9 un de
ces anneaux.
Au-delà de l ’ailïïeu eft placée, comme une traver-,
fe , la planche des malles io. Cette planche eft ainft
nommée, parce que c’eft-là qu’on pofe les malles ou
coffres du voyageur. Cette planche eft portée fur;
deuxtaffeaux i z , 12 , qui s’élèvent au-deffus des
brancards d’environ quatre à cinq pouces. EUe y eft
affermie par des boulons à vis qui traverfent & la
planche & les taffeaux , & les barres de brancard &ç
les échantignoles.
Au-delà de cette planche font les confoles 13 ,
13 > 13 >13 , ah nombre de deux fur chaque brançard
; ce font des barres de fer qui fe réunifient par
le haut 13 , 13 , pour former une efpece de tê te ,
dans laquelle eft un rouleau, fur lequel paffe la
courroie de guindage 14, 14 , ainfi qu’il fera expliqué
: ces deux confoles fur chaque barre de brancard
le traverfent à environ un pié de diftance l’une de
l’autre, & y font aflujetties par des écrous qui prennent
la partie taraudée de ces confoles qui déborde
la face inférieure du brancard. On noyé quelquefois
ces écrous dans le bois & on les y affleure. Les
confoles font affujettiçs par le haut à une diftance
l ’une de l’autre, toujours moindre que la largeur du
brancard, & même que celle de la chaife, par une
jpiece de bois qu’on appelle entretoife, dont le milieu
eft garni d’un couffin 15 de cuir rembourré de
crin pour fervir de liège au domeftique, quand on
en fait monter un derrière la chaife, ce qui ne fe
pratique pas ordinairement. Cette entretoife 13 ,
1 5 , 31 » eft fourchue par fes extrémités oit partent
les confoles réunies, qui forment en cet endroit une
efpece de collier, qui eft reçu par la fourchette de
l’entretoife.
Entre les piés des confoles parte une forte traver-
fè 13 , 16 , que l’on appelle la planche des rejforts.
Le milieu en eft plus large que les extrémités, & forme
un difque ou rond d’environ un pié de diamètre.
C ’eft fur cette partie de la planche que font fixés
les refforts par des pivots qui en traverfent toute
l’épaiffeur. Ces refforts, au nombre de deux, forment
chacun à-peu-près avec la boîte qui les contient
un V confonne ; & ils font difpofés de maniéré
que les fommets des angles qu’ils forment font op-
pofés l’un à l ’autre. Chaque reffort eft compofé de
deux parties, .& chaque partie eft compofée de plufieurs
autres. La partie A E ( Foy. même PI. la figure
de ces refforts ) eft un affemblage de dix-huit à vingt
refforts, faits d’acier de Hongrie ; la partie inférieù-
re B E a le même nombre de feuilles. Toutes ces
feuilles, appliquées les unes fur les autres félon leur
longueur, font renfermées dans des boîtes F , ôc tra-
verfées par des chevilles ou boulons terminés en vis
& retenus par des écrous qui affujettiffent toutes les
feuilles dans chaque boîte ; car chaque reffort a la
fienne. A E , B E affemblage de feuillets plats, i 7
boîte. G cor.don de la boîte. H H , crochets pour
les foûpentes. I pivots à croffe. Chaque boîte eft
affujettie fur le difque de la planche des refforts
P P P P , par deux pivots que l’on nomme pivots à
croffe. Çes pivots tiennent à la boîte par des boulons
qui la trayerfent horifontalement, & qui partent aufli
par les anneaux des croffes des pivots. Ces derniers
font affujetjis fur la planche par des écrous, après
qu’ils l’ont entièrement traverfée. Les feuilles qui
compofent un reffort ne font pas toutes de même
longueur ; les extérieures font les plus longues ; les
autres vont en diminuant jufqu’à la derniere. Elles
font toutes un peu repliées fur les .côtés à leurs extrémités,
afin qu’en s ’embraffant elles ne puiffent
s’écarter les unes de defliis les autres, mais gliffer
toûjours parallèlement, & fe reftituer de même. Il
eft évident que fi elles avoient été toutes de même
longueur ; elles n’auroient prefque pas pû plier.
Chaque reffort doit être'confidéré comme divifé en
deux 1 z , 12, dans toute fa largeur. Chacune de ces
parties eft parfaitement fomblable à l’autre, lui eft
appliquée çôte à côte, eft renfermée dans la même
b o î t e e f t compofée de même iiombre de feuillets,
chaque, feuillet .foit dans la partie fupérieure, foit
dans la partie inférieure, eft pr.écifément femblable
d^ns une dés moitiés qu’on appelle coins, a fa cor-
rjefpçndanfo dans l’autre coin. Les deux coins fépa-
ÿé^/pntiOQmme deux refforts diftinâs ; mais .appliqués,
dana la chaife de pofie , ou plûtô.t dans les boî-
tes à côté l’un de l’autre ; ils ne font qu’un reffort ,
enforte qu’il faut quatre coins pour une chaife depo-
fic , deux dans chaque boîte, quoiqu’il n’y ait que
deux refforts. Aux extrémités fupérieures font des
doubles crochets H H , qui reçoivent les anneaux,
dont font garnies les foûpentes de derrière. Les extrémités
inférieures des refforts entrent dans des
boîtes dormantes, qui font fixées fur les extrémités
de la planche des refforts, & dans lesquelles ils
peuvent fe mouvoir pour fe prêter à l’ariion du
poids de la chaife qui les fait fléchir. Leur élafticité
naturelle les rétablit auffitôt. Cette derniere boîte,
ainfi que toutes les parties oh il y a frotement, doivent
etre enduites de vieux-oing.
Il eft à-propos de remarquer que le plan de la
planche des refforts P P P P n’eft point parallèle à celui
du brancard ; mais qu’il eft au contraire penché
en-arriere, afin que les refforts ayent la même in-
clinaifon que les foûpentes de derrière, & qu’ainfi
elles ne puiffent frapper contre la planche des refforts
, quand la roue de la chaife venant à rencontrer
quelques pierres , elles eft contrainte de balancer.
C ’eft par la même raifon que la planche eft
plus étroite par fes extrémités que dans le milieu oh
les refforts font attachés, & que ces refforts portent
en-haut un double crochet H H long d’un p ié ,
qui tient les courroies de la foûpente écartées l’une
de l’autre de la même diftance.
Pour empêcher toute cette ferrure de fe rouiller
à la pluie & autres rigueurs du tems, on la couvre
de facs de cuir. Ceux des refforts s’appellent étuis ;
ceux des crochets & des extrémités fupérieures des
foûpentes s ’appellent calottes. Foyeç ( même PI. en
1 7 , 17) les calottes, & les étuis des courroies de
guindage & de ceinture , appelles fourreaux.
Àu-aelà de la traverfe des refforts & vers l’extrémité
du brancard, eft la derniere traverfe qu’on
appelle traverfe de ferriere. La ferriere 1,8 eft une
efpece de malle dans laquelle le portillon met les
divers ïnftrumens propres à réparer les accidens
légers qui peuvent arriver à la voiture pendant la
route. Ainfi il doit y avoir du vieux- oing, un marteau
à ferrer, une clé à cr ic , &c. La traverfe de
ferriere eft affermie fous le brancard par des boiv-
lons qui la traverfent & le brancard. L ’extrémité
fupérieure de ces boulons eft terminée par un cric
19 , dont la fonâion eft de bander à discrétion la
courroie de guindage, ainfi qu’il fera dit ailleurs.
Les crics font entièrement femblables à ceux qui
fervent pour les foûpentes des carroffes. Foye^ larticle
V o itu r e .
Le derrière du brancard eft terminé par un cerceau
de fer dont l’ufage eft de garantir les refforts
du choc des murs , dans les reculs qu’on fait faire à
la voiture, & ce cerceau s’appelle cerceau de recule-
ment.
Toutes les parties dont nous venons de parler
font enrichies d’ornemens de fculpture, .qui donnent
à la chaife entier« un air d’élégance & de magnificence,
(qui dépend beaucoup dû goût du fculp-
teur & de l’opulence de celui qui met les ouvriers
en oeuvre. Foye^ une pareille voiture dans la Planche
que nous avons citée.
Tout .ce que nous avons dit de 'la chaife de pofie
jufqu’à préfent, eft à proprement parier l’ouvrage
du charron. Partons maintenant à celui du fellier
quoiqu’il -foit aidé par différens autres artifans
comme menuifiers, ferruriers, peintres, doreurs,
verniffeurs.
Du corps de la chaife. Le corps de la chaife eft fuf-
pendu dans le vuide des barres du brancard. Il eft
compofé d’un fond qui confifte en un chaflis zo
de bois d’orme, qu’on appelle brancard de chaife.
Aux angles .de ce chaflis font élevés des montans dè
même bois d’environ quatre piés & demi de haut.