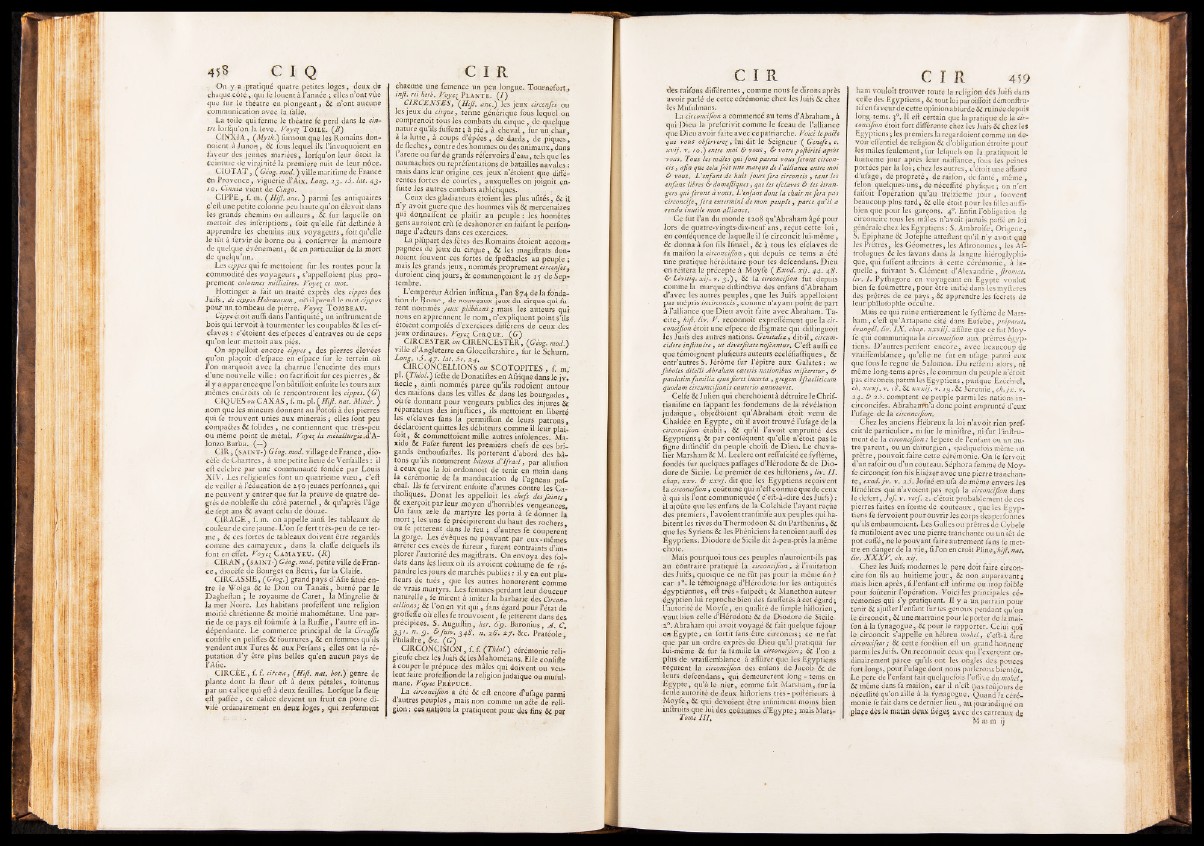
458 C I Q
On y a pratiqué quatre petites loges, deux de
•chaque côté ,?qui fe louent à l’année ; elles n’ont vue
que fur le théâtre en plongeant, & n’ont aucune
communication avec la lalle.
La toile qui ferme le théâtre fe perd dans le cintre
lorlqu’on la leve. Voy&{ T o il e . (2?)
CINXIA, {Myth.) furnom que les Romains don-
noient à JunoH, 6c fous lequel ils l’invoquoient en
faveur des jeunes mariées, lorfqu’on leur ôtoit la
Ceinture de virginité la première nuit de leur noce.
CIOTA T , Ç Géog. mod. ) ville maritime de France
Cn Provence, viguerie d’Aix. Long. 23. iS. lut. 43.
jq. Cinxia vient de Cingo.
CIPPE, f. m. (Hifi. anc. ) parmi les antiquaires
.c’eft une petite colonne peu haute.qu’on élevoit dans
les grands chemins ou ailleurs , ôc fur laquelle on
mettoit des inferiptions, foit qu’elle fût deftinée à
apprendre les chemins aux voyageurs, foit qu’elle
le lut à lêrvir de borne ou à conferver la mémoire
de quelque événement, ôc en particulier de la mort
de quelqu’un.
Les cippes qui fe mettoient fur les routes pour la
commodité des voyageurs, s'appelaient plus proprement
colonnes militaires. Voye^ ce mot.
Hottinger a fait un traité exprès des cippes des
Juifs, de dp pis Hebrteorum, oüil prend le mot cippus
pour un.tombeau de pierre. Voye^ T om b e au .
Cippe éioit auffi dans l’antiquité, un infiniment de
bois qui fervoit à tourmenter les coupables ôc les efi*
claves : c’étoient des efpeces d’entraves ou de ceps
qu’on leur mettoit aux piés.
On appelloit encore cippes, des pierres élevées
qu’on plaçoit d’efpace en efpace fur le terrein oit
l ’on marquoit avec la charrue l’enceinte des murs
4 ’une nouvelle ville : on facrifioit fur ces pierres, ÔC
il y a apparence que l’on bâtiffoit enfuite les tours aux
.mêmes endroits oii fe rericontroient les cippes. (G)
C 1QUES ou C A X A S , f. m. pl. ( Hiß. nat. Miner. )
jnom que les mineurs donnent au Potofi à des pierres
qui fe trouvent unies aux minerais ; elles font peu
compares ôc folides , ne contiennent que très-peu
ou même point de métal. Voye{ la métallurgie .d’A-
lonzo Barba. (—)
C IR , (s a in t -) Géog. mod. village de France, dio-
çèfe de Chartres, à une petite lieue de Verfailles : il
eft célébré par une communauté fondée par Louis
XIV. Les religieufes font un quatrième voeu , ç’eft
de veiller à l’éducation'de 250 jeunes perfonnes, qui
ne peuvent y entrer que fur la preuve de quatre degrés
de nobleffe du coté paternel, & qu’après l’âge
4e lept ans ôc avant celui de douze.
CIRAGE, f. m. on appelle ainfi les tableaux de
couleur de cire jaune. L’on fe fert très-peu de ce terme
, ôc ces fortes de tableaux doivent être regardés
comme des camayeux , dans la dalle defquels ils
font en effet. Voyeç C am a y e u . (R)
CIRAN, ( saint-) Géog. mod. petite ville de France
, diocèfe de Bourges en Berri, fur la Claife.
CIRC ASSIE, (Géog.) grand pays d’Afie litué entre
le Wolga ôc le Don ou Tanaïs, borné par le
Daghellan ; le royaume de Caret, la Mingrelie &
la mer Noire. Les habitans profeffent une religion
moitié chrétienne ôc moitié mahométane. Une partie
de ce pays elt foûmife à la Rulfie , l ’autre eft indépendante.
Le commerce principal de la Circajfie
çonfifte en peliffes ôc fourrures, ôc en femmes qu’ils
yendent aux Turcs ôc aux Perfans ; elles ont la réputation
d’y être plus belles qu’en aucun pays de
l’Àlie.
CIRC ÉE, f. f. citcoea, {Hiß. nat. bot.') genre de
plante dont la fleur elt à deux pétales, ibûtenus
par un calice qui elt à deux feuilles. Lorfque la fleur
elt paflèe, ce calice devient un fruit en poire di-
vifé ordinairement en deux loges, qui renferment
C I R
chacune une femence un peu longue. Tourne for tj,
injl. rei herb. Voye{ PLANTE. (/ )
CIRCENSES, (H f i,, anc.) les jeux circenfes ou
les jeux du cirque, terme générique fous lequel.on
comprenoit tous les combats du cirque, de quelque
nature qu’ils fuffent ; à pié, à cheval, fur un char,
à la,lutte, à coups d’épées, de dards, de piques,
de fléchés, contre des hommes ou des animaux, dans
l’arene ou fur de grands réfervoirs d’eau, tels que les
naumachies ou repréfentations de batailles navales :
mais dans leur origine ces jeux n’étoient que différentes
fortes de courfes, auxquelles on joignit en-
fuite (es autres combats .athlétiques.
Ceux des gladiateurs étoient (es plus ufités, ôc il
ri’y avoit guere que des hommes vils ôc mercenaires
qui doqnaffent ce plailir au peuple : les honnêtes
gens auraient cru fe deshonorer en faifant le perforn
nage d’a&eurs dans ces exercices.
La plupart des fêtes des. Romains étoient accom-*
pagnées de jeux du cirque x ôc les magiftrats don-?
noient fouvent ces fortes.de fpeftacles au peuple ;
mais les grands.jeux, nommésproprement c,ircenfest
duroient cinq jours, & commençaient le 15 de Septembre.
L’empereur Adrien inflitua, Pan 874 de là fondation
de Rome., de nouveaux .jeux du cirque qui furent
nommés jeux plébéiens ; mais les auteurs qui
nous en apprennent le nom, n’expliquent point s’ils
étoient compofés d’exercices, differens de ceux des
jeux ordinaires. Voye[ C irque. (G)
CIRCESTER ou CIRENCESTER, {Géog. mod.)
ville d’Angleterre en Gloceftershire, fur le Schurn,
Long. t5. 47. Lu. 5 t. 24.
C 1RCONCELLIONS ou SCQTOPITES , f. m,
pi. ( ThéoL'.) fette deDonatiftes en Afrique dans le jv,
fiecle , ainfi nommés parce qu’ils rodoient autour
des maifons dans les. villes ôc dans les bourgades ,
où fe donnant pour vengeurs publics des injures &
réparateurs des injuftices, ils mettoient en liberté
les efclaves fans la permiflion de leurs patrons,
déclaroient quittes les débiteurs comme il leur plai-
foit, & commettoient mille autres infolences. Ma-
xide ôc Fafer furent les premiers chefs de ces brigands
énthoufiaftes. Ils portèrent d’abord des bâtons
qu’ils nommèrent bâtons d'Ifrael, par allufion
à ceux que la loi ordonnoit de tenir en main dans
la cérémonie de la manducation de l’agneau paf-
chal. Ils fe fervirent enfuite d’armes contre les Catholiques.
Donat les appelloit les chefs desfaints,
&exerçoit par leur moyen d’horribles vengeances,
Un faux zele de martyre les porta à fe donner la
mort ; les uns fe précipitèrent du haut des rochers
ou fe jetterent dans le feu ; d’autres fe coupèrent
la gorge. Les évêques ne pouvant par eux-mêmes
arrêter ces excès de fureur, furent contraints d’implorer
l’autorité des magiflrats. On envoya des fol-
dats dans les lieux où ils avoient coûtume de fe répandre
les jours de marchés publics : il .y en eut plu-
fieurs de tués, que les autres honorèrent comme
de vrais martyrs. Les femmes perdant leur douceur
naturelle, fe mirent à imiter la barbarie des Circon-
celltons; & l’on en vit qui, fans égard pour l’état de
groffeffe où elles fe trouvoient, fe jetterent dans des
précipices. S. Auguftin, fier. 6 9 . Baronius, A . Cm
33 /. n. c). &fuiv. 3 48. n. 26. 2 7. &c, Pratéole,
Pinlaftre, &c. (G)
i CIRCONCISION, f. f. ( Theol.) cérémonie reli-
gieufe chez les Juifs ôc les Mahométans. Elle çonfifte
à couper le prépuce des mâles qui doivent ou veulent
faire profeflionde la religion judaïque ou mulùl-
mane. Voyee Prépuce.
I La circoncifion a été & eft encore cfufage parmi
d’autres peuples , mais non comme un aéle de religion
; çes Jjatjqn$ la pratiquent pour des fins ôc par
C I R
fies raifons différentes, comme nous le dirons après
avoir parlé de cette cérémonie chez les Juifs ôc chez
les Mufulmans.
La circoncifion a commencé au teins d’Abraham, à
qui Dieu la preferivit comme le fceau de l’alliance
que Dieu avoir faite avec ce patriarche. Voici le pacte
•que vous obferverei, lui dit le Seigneur ( Genefe, c.
xvij. v. 10.) entre moi & vous, & votre poflérité après
vous. Tous les mâles qui font parmi vous feront circoncis
, afin que cela foit une marque de l'alliance entre moi
& vous. L'enfant de huit jours fera circoncis , tant les
enfans libres & domefiiques, que les efclaves & les étrangers
qui feront à vous. L'enfant dont la chair ne fera pas
circoncife , fera exterminé de mon peuple , parce qu'il a
rendu inutile mon alliance.
Ce fut l’an du monde 1208 qu’Abraham âgé pour
lors de quatre-vingts-dix-neuf ans, reçut cëtte lo i,
en conféquence de laquelle il fe circoncit lui-même,
& donna à fon fils Ifmaël, & à tous les efclaves de
fa maifon la circoncifion, qui depuis ce tems a été
une pratique héréditaire pour fes defeendans. D ieu
en réitéra le précepte à Moyfe ( Exod. xij. 44. 48.
& Lévitiq. xij. v. 3 . ) , & la circoncifion fut depuis
comme la marque diftinâive des enfans d’Abraham
d ’avec les autres peuples, que les Juifs appelloient
par mépris incirconcis, comme n’ayant point de part
à l’alliance que D ieu avoit faite avec Abraham. Tacite
, hiß. liv. V. reconnoît expreffément que la circoncifion
étoit une efpece de fligmate qui diftinguoit
les Juifs des autres nations. Genitalia, dit-il, circum-
cidere infiituêre , ut diverfitate nofeantur. C ’efl auffi ce
que témoignent plufieurs auteurs eccléfiafliques, &
entr’autres S. Jérôme fur l’épître aux Galates : ne
foboles dilecli Abraham cateris natiofibus mifeeretur , &
■ paulatim familia ejus fieret incerta , gregem Ifraeliticum
quodam circumc fionis cauterio annotavit,
Celfe & Julien qui cherchoientà détruire le Chrif-
tianifme en fappant les fondemens de la révélation
judaïque , objeéloient qu’Abraham étoit venu de
Chaldée en Egypte , où il avoit trouvé l’ufage de la
<irconcifion établi, & qu’il l’a voit emprunté des
Egyptiens ; & par conféquent qu’elle n’étoit pas le
ligne diftinélif du peuple choifi de Dieu. Le chevalier
Marsham & M. Leclerc ont reffufeité ce fyftème,
fondés fur quelques paffages d’Hérodote & de Dio-
dore de Sicile. Le premier de ces hiftoriens, liv. II.
chap. xxv. & xxvj. dit que les Egyptiens reçoivent
la circoncifion, coûtume qui n’eft connue que de ceux
è qui ils l’ont communiquée ( c’eft-à-dire des Juifs) :
il ajoûte que les enfans de la Colchide l’ayant reçûe
•des premiers, l’avoient tranfmife aux peuples qui habitent
les rives du Thermodoon & du Partheni'us, &
que les Syriens & les Phéniciens la tenoient auffi des
Egyptiens. Diodore de Sicile dit à-peu-près la même
chofe.
Mais pourquoi tous ces peuples n’auroient-ils pas
au contraire pratiqué la circoncifion, à l’imitation
des Juifs ^ quoique ce ne fût pas pour la même fin ?
car i° . le téfnoignage d’Hérodote* fur les antiquités
.égyptiennes j eft très - fufpeél ; & Manethon auteur
égyptien lui reproche bien des fauffetés à cet égard ;
l’autorité de Moyfe, .en qualité de fimple hiflorien,
•vaut bien celle d’Hérodote ôc de Diodore dé Sicile.
2°. Abraham qui avoit voyagé & fait quelque féjour
en Egypte, en fortit fans être circoncis; ce ne fut
que par un ordre exprès de Dieu qu’il pratiqua fur
lui-même & fur fa famille la circoncifion; Ôc l’on a
plus de vraiffemblance à affûrer que les Egyptiens
reçurent, la circoncifion des enfans de Jacob ÔC de
leurs defeendans, qui demeurèrent long - tems en
Egypte, qu’à le nier, comme fait Marsham, fur la
• feule autorité de deux hiftoriens très - poftérieurs à
Moyfe, & qui dévoient être infiniment moins,bien
inftruits que lui des coûtumes d’Egypte ; mais Mars-
Tome I II. àJr - ................ ,
C ï R 459
hani vOuIôit trouver toute la religion dés Juifs dans
celle des Egyptiens, & tout lui paroiffoit démonftra*
tifen faveur de cette opinionabfurde & ruinée depuis
long-tems. 30. Il eft certain que la pratique de la rir-
concifion étoit fort différente chez les Juifs & chez les
Egyptiens ; les premiers la regardoient comme un de*
voir eflentiel de religion & d’obligation étroite pom*
les mâles feulement, fur lefquels on la pratiquoit le
huitième jour après leur naiffance, fous les peines
portées par la lo i; chez les autres, c’étoit une affaire
d’ufage, de propreté, de raifon, de fanté, même ,
félon quelques-uns, de néceflité phyfique; on n’en
faifoit l’opération qu’au treizième jour , fouvent
beaucoup plus tard, & elle étoit pour les filles aufli-
bien que pour les garçons. 40. Enfin l’obligation de
circoncire tous les .mâles n’avoit jamais paffé en loi
générale chez les Egyptiens : S. Ambroife, Origene ,
S. Epiphane 6c Jofephe attellent qu’il n’y avoit que
les Pretres, les Géomètres, les Aftronomes ; les Astrologues
& les favans dans la langue hiéroglyphique,
qui fuffent aftreints à cette cérémonie , à laquelle
, fuivant S. Clément d’Alexandrie ,firomat.
liv. I. Pythagore en voyageant en Egypte voulut
bien fe. foûmettre, pour être initié dans les myfteres
des prêtres de ce pays , 6c apprendre les fecrets de
leur philofophie occulte.
Mais ce qui ruine entièrement le fyftème de Marsham;;;
c’eft qu’Artapane cité dans Eufebe, préparât,
évangél. liv. IX . chap. xxviij. allure que ce fut Moyfe
qui communiqua la circoncifion aux prêtres égyp*
tiens. D ’autres penfent encore, avec beaucoup de
vraiffemblance, qu’elle ne fut en ufage parmi eux
que fous le régné de Salomon. Du relié ni alors , ni
même long-tems après, le commun du peuple n’étoit
pas circoncis.parmi les Egyptiens, puifque Ezécniel,
ch. x x x j. v. 18.6c xxxij. v. i,ÿ.. 6c Jéreinie, çh.jx. v.
24. & 26. comptent ce peuple parmi les nations in-
circoncifes. Abrahanfti’a donc point emprunté d’eux
l’ufage, de ia circoncifion.
Chez les anciens Hébreux la loi n’avoit rien pref-
crit'de particulier, ni fur le miniftre, ni fur l’inftru-
ment de la circoncifion : le'pere de l’enfant ou un autre
parent, ou un chirurgien, quelquefois même un
prêtre, pouvoit faire cette cérémonie. On fe fervoit
d’un rafoir ou d’un couteau. Séphora femme de Moyfe
circoncit fon fils Eliézer avec une pierre tranchante,
exod.jv. v. 26. Jofué en ufa de même envers les
Ifraélites qui n’avoient pas reçû la circoncifion dans
le defert, Jof. v. verf. 2. .c’étoit probablement de ces
pierres faites en forme de couteaux, que les Egyptiens
fe fervoient pour ouvrir les corps des perfonnes
qu’ils embaumoient.. Les Galles ou prêtres de Cybele
lé mutiloient avec une pierre tranchante ou Un têt de
pot caffé, ne le pouvant faire autrement fans fe mettre
en danger de la v ie , fi l’on en croit Pline, h f i . nat*
liv. X X X V . ch. xij.
Chez les Juifs modernes le pere doit faire, circoncire
fon fils au huitième jour, 6c non auparavant ;
mais bien après, fi l’enfant eft infirme ou trop faible
pour, foûtenir l’opération. Voici les principales cérémonies
qui s’y pratiquent. II y a un,parrain pour
tenir Ôc ajufter l’enfant lur fes genoux pendant qu’on
le circoncit, & une marraine pour le porter de là maifon
à la fynagogue,- 6c pour le rapporter. Celui qui
lè circoncit s’appelle en hébreu mohel, ç’eft-à dire
circoncifeur; 6c cette fonâion eft un. grand honneur
parmi,les Juifs. On.reconnoît ceux qui l’exerçant or-
.dinairement parce qu’ils ont les ongles des pouces
;fort.longs, pour l’ufage dont nous parlerons bientôt*
Le pere de l’enfant fait quelquefois l’off ree du mohel,
ôc même dans fa maifon , car il n’eft lias toujours de
.néceflité qu’on aille à la fynagogue. Quand la cérémonie
fe fait dans ce dernier lieu , au jour indiqué on
place dès le matin deux fiéges 'avec des carreaux de
M ni m |