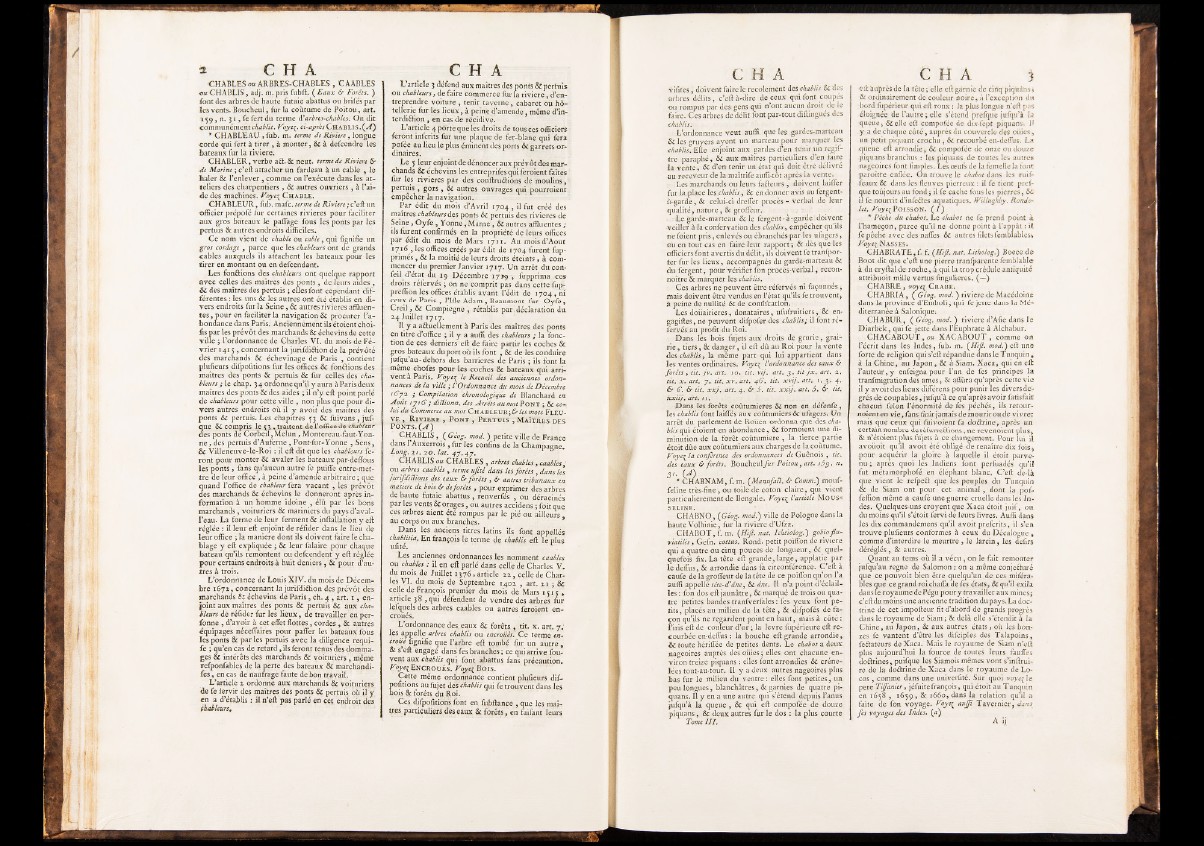
CH A BLES ou ARBRES-CHABLES , CAABLES
ou CHABLIS, adj. m. pris fubft. ( Eaux & Forêts. )
font des arbres de haute futaie abattus ou brifés par
les vents. Boucheul, fur la coutume de Poitou, art.
i <o , n. 3 1 , fe fert du terme d' arbrts-chables. On dit
^communémentchablit. Voyt{. ci-aprïsC h a b l is . {A )
* CHABLEAU ,fu b. m. terme de Riviere, longue
corde qui fert à tirer , à monter, & à defcendre les
bateaux fur la riviere.
CH ABLER, verbe aéh & neuf, terme de Riviere &
de Marine ; c’eft attacher un fardeau à un cable , le
haler & l’enlever, comme on l’exécute dans les at-
teliers des charpentiers , & autres ouvriers , à l’aide
des machines. Voye£ C hable.
CHABLEUR, fub. mafe. terme de Riviere; c’eft un
•officier .prépofé fur certaines rivières pour faciliter
au x gros bateaux le paffage fous les ponts par les
pertuis & autres endroits difficiles.
Ce nom vient de chable ou cable, qui lignifie un
gros cordage , parce que les chableurs ont de grands
cables auxquels ils attachent les bateaux pour les
tirer en montant ou en defeendant.
Les fondions des chableurs ont quelque rapport
a v e c celles des maîtres des ponts , de leurs aides ,
& des maîtres des pertuis ; elles font cependant différentes
: les uns & les autres ont été établis en divers
endroits fur la Seine, & autres rivières affluen-
te s , pour en faciliter la navigation & procurer l’abondance
dans Paris. Anciennement ils étoient choi-
lis par les prévôt des marchands & échevinsde cette
ville ; l’ordonnance de Charles VI. du mois de Février
14 15 , concernant la jurifdiâion de la prévôté
des marchands 8c échevinage de Paris , contient
plufieurs difpofitions fur les offices 8c fondions des
maîtres des ponts & pertuis 8c fur celles des chableurs
; le chap. 3 4 ordonne qu’il y aura à Paris deux
maîtres des ponts 8c des aides ; il n’y eft point parlé
de chableurs pour cette ville , non plus que pour divers
autres endroits où il y avoit des maîtres des
ponts & pertuis. Les chapitres 53 & fuivans , juf-
ue 8c compris le $3 , traitent de l’office de chableur'
es ponts de Corbetl, Melun, Montereau-faut-Yon-
n e , des pertuis d’Auferne, Pont-fur-Yonne , Sens,
& Villeneuve-le-Roi : il eft dit que les chableurs feront
pour monter 8c avaler les bateaux par-deffous
les ponts > fans qu’aucun autre fe puifle entre-met-
tre de leur office , à peine d’amende arbitraire ; que
quand l’office de chableur fera vacant , les prévôt
des marchands 8c échevins le donneront après information
à un homme idoine , élu par lés bons
marchands, voituriers & mariniers du pays d’aval-
l’eau. La forme de leur ferment 8c inftallation y eft
réglée : il leur eft enjoint de réfider dans le lieu de
leur office ; la maniéré dont ils doivent faire le cha-
blage y eft expliquée ; 8c leur falaire pour chaque
bateau qu’ils remontent ou defeendent y eft réglée
pour certains endroits à huit deniers, & pour d’autres
à trois.
L’ordonnance de Louis XIV. du mois de Décembre
16 7 1 , concernant la jurifdiôion des prévôt des
marchands 8c échevins de Paris, ch. 4 , art. 1 , enjoint
aux maîtres des ponts 8c pertuis 8c aux chableurs
de réfider fur les lieux, de travailler en per-
fonne , d’avoir à cet effet flottes, cordes , & autres
équipages néceffaires pour palier les bateaux fous
les ponts & par les pertuis avec la diligence requi-
fe ; qu’en cas de retard, ils feront tenus dès dommages
& intérêts des marchands 8c voituriers, même
refponfables de la perte des bateaux & marchandi-
fes , en cas de naufrage faute de bon travail.
L ’article 2 ordonne aux marchands 8c voituriers
de fe fervir des maîtres des ponts 8c pertuis où il y
en a d’établis : il n’eft pas parlé en cet endroit des
fhâbleurs,
L’article 3 défend aux maîtres des ponts & pertuis
ou chableurs , de faire commerce fur la r iviere, d’entreprendre
voiture , tenir taverne, cabaret ou hôtellerie
fur les lieux, à peine d’amende, même d’in-
terdiftion , en cas de récidive.
L’article 4 porte que les droits de tous ces officiers
feront inferits fur une plaque de fer-blanc qui fera
pofée au lieu le plus éminent des ports 8c garrets ordinaires.
Le y leur enjoint de dénoncer aux prévôt des marchands
8c échevins les entreprifes qui feroient faites
fur les rivières par des conftruéHons de moulins,
pertuis , gors , 8c autres ouvrages qui pourroient
empêcher la navigation.
Par édit du mois d’Avril 1704 , il fut créé des
maîtres chableurs des ponts 8c pertuis des rivières de
Seine, O y fe , Yonne, Marne, 8c autres affluentes
ils furent confirmés en Ja propriété de leurs offices
par édit du mois de Mars 17 1 1 . Au mois d’Août
1716 , les offices créés par édit de 1704 furent fup-
primés, & la moitié de leurs droits éteints, à commencer
du premier Janvier 1717. Un arrêt du con-
feil d’état du 19 Décembre 171*9 , fupprima ces
droits réfervés ; on ne comprit pas dans cette fup-
preflion les offices établis avant l’édit de 170 4,01
ceux de Paris , l’Ifle-Adam, Beaumont-fur- O y fe ,
C re il, & Compiegne , rétablis par]déclaration du
24 Juillet 1717.
Il y a actuellement à Paris des maîtres des ponts
en titre d’office ; il y a auffi des chableurs ; la fonction
de ces derniers eft de faire partir les coches &
gros bateaux du port où ils font , 8c de les conduire
jufqu’au- dehors des barrières de Paris ; ils font la
même chofes pour les coches 8c bateaux qui arrivent
à Paris. P"?yeç le Recueil des anciennes ordonnances
de la ville ; l'Ordonnance du mois de Décembre
1672 ; Compilation chronologique de Blanchard en
Août iy i G ; diclionn. des Arrêts au mot Pont ; 8c ce
lui du Commerce au mot CHABLEUR j.6* les mots FLEUVE
, Riviere , Po n t , Pertuis , Maîtres des
Po n t s . (A )
CHABLIS, ( Géog. mod. ) petite ville de France
dans l’Auxerrois , fur les confins de la Champagne.
Long. z i . 20. lat. 4 7 .4 7 .
CHABLIS ou CHABLES , arbres chables ., caables
ou àrbres caables , terme ujité dans les forêts , dans les
jurifdiclions des eaux & forets , & autres tribunaux en
matière de bois & de f prêts , pour exprimer des arbres
de haute futaie abattus, renverfés , ou déracinés,
par les vents & orages, çu autres accidens ; foitque
ces arbres aient été rompus par le pie ou ailleurs
au corps ou aux branches.
Dans les anciens titres latins ils font appellés
chablitia. En françois le terme de chablis eft le plus
ufité.
Les anciennes ordonnances les nomment caables
ou chables il en eft parlé dans celle de Charles V .
du mois de Juillet 1376, article 2 2 , celle de Charles
VI. du mois de Septembre 1402 , art. 21 ; &
celle de François premier du mois de Mars 1 5 1 5 ,
article 3 8 , qui défendent de vendre des arbres fur
lefquels des arbres caables o.u autres feroient en-
çrqiiés.
L’ordonnance des. eaux 8c forêts,, tit. x. art. 7.'
^ S.?PPe^® arbres chablis 011 encroiiês. Çe terme ert-
croüé lignifie c[ue l’arbre eft tombe fur un autre ,
& s eft engage dans fes branchés ; ce qui arrive fou-
Vent aux chablis qui font abattus fans précaution.
F°ye^ Enc rou é s . Foyti Bois.
Cette même ordonnance contient plufieurs dif-
pofitiôns aufujet des chablis qui fe trouvent dans les
bqis & forêts dufloi.
Ces difpofitions font en fiibftançe , que les maîtres
particuliers des eaux & forêts, en faifant leurs
Vififes, doivent faire le recolement des chablis & des
•arbres délits, c’eft à-dire de ceux qui font coupes
ou rompus par des gens qui n’ont aucun droit de le
faire. Ces arbres de délit font par-tout diftingués des
chablis r
L ’ordonnance veut aufli que les gardes-marteau
& les gruyers ayent un marteau pour marquer les
chablis. ,Elle enjoint aux gardes d’en tenir.un regif-
tre paraphé, & aux maîtres particuliers d’en faire
la vente, & d’en tenir un état qui doit être délivre
au receveur de la maîtrife aufli-tôt après la vente.
Les marchands ou leurs faveurs , doivent laiffer
fur la.place les.chablis, & en donnèr avis au fergent-
à-garde, & celui-ci dreffer procès - verbal de leur
qualité, nature, & grofleur.
- : Le. garde-marteau & le fergertt - a-garde, doivent
•veiller à:1a confervation des chablisempêcher qu’ils
ne foient pris, enlevés ou ébranchés par les ufagers *
ou en tout cas en faire leur rapport ; & dès que les
officiers font avertis du délit, ils doivent fe tranfpor-
ter fur les lieux, accompagnés du gardè-marteau &
du fergent, pour vérifier fon procès-verbal, recon-
noître & marquer les chablis. :
Ces arbres ne peuvent être réfervés ni façonnes *
mais doivent être vendus en l’état qu’ils fe trouvent,
à peine de nullité & de confiscation.
Les douairières, donataires, ufufruitiers, & en-
gagiftes, ne peuvent difpofer des chablis; il foiit ré-
lervés. au profit du Roi.
Dans les bois fujets aux droits de grurie * grai-
r ie , tiers, & danger, il eft dû au Roi pour la vente
des chablis, la même part qui lui appartient dans
les ventes ordinaires; Poye^ Vordonnance des eaux &
forêts , tit. jv. art. 1 o. tit. vij. art. 3. tit j x . art. $$
tit. x. art. y. tit. xv. art. 4G. tit. xvij. a r t 1. y . 4.
& C. & tit. x x j. art. 4. & tit. x x ij. art. 6. & tit,;
Scxiij. art. / /.
Dans les forêts coûtumiefes & non en défenfe,
les chablis font laifles aux coûtumiers & ufagers. Un
arrêt du parlement de Rouen ordonna que des chablis
qui étoient en abondance, & formoient une diminution
de la forêt coûtumiere , la tierce partie
étoit dûe aux coûtumiers aux charges de la coutume.
F'oye^ la conférence des ordonnances de Guênois , tiu
des eaux & forêts. Boucheul fur Poitou, art. iS(). n.
3/. (^ )
* CHABNAM, f. m. ( Manufacl. & Comm.) mouf-
feline très-fine ', ou toile de coton claire, qui vient
particulièrement de Bengale. Voye^ l'article Mous*
SELINE.
CHABNO, {Géog. mod.) ville de Pologne dans la
haute Volhinie, fur la riviere d’Ufza.
CH A BO T, f. m. {Hiß. nat. Ichtiolog.) gobioflu-
viatilis , Gefn. cottus. Rond, petit poiffon de riviere
qui a quatre ou cinq pouces de longueur, & quelquefois
fix. La tête eft grande, large, applatie par
le deffus, & arrondie dans fa circonférence. C ’eft à
caufe de là groffeur de la tête dé ce poiffon qu’on l’a
auffi appelle tête-d’âne, & dne. Il n’a point d’eclailr
les : fon dos eft jaunâtre, & marqué de trois ou quatre
petites bandes tranfverfales : fes yeux font petits,
placés au milieu de la tête , & aifpofés de façon
qu’ils ne regardent point en haut, mais à côté :
l ’iris eft de couleur d’or ; la levre fupérieure eft recourbée
en-deffus : la bouche eft grande arrondie,
& toute hériffée de petites dents. Le chabot a deux,
nageoires auprès des oiües ; elles ont chacune environ
treize piquans : elles font arrondies & créne-,
lées tout-au-tour. Il y a deux autres nageoires plus
bas fur le milieu du ventre : elles font petites, un
peu longues, blanchâtres, & garnies de quatre piquans.
Il y en a une autre qui s’étend depuis l’anus
jufqu’à la queue, & qui eft compofée de douze
piquans, & deux autres fur le dos : la plus courte
Tome I II,
eft huprès de la tête ; elle eft gârnie de éirtq piqtiàns,
.& ordinairement de couleur noire, à l’exception du
bord fupérieur qui eft roux : la plus longue n’eft pas
éloignée, de l’autre; elle s’étend prefque jufqu’à la
queue* & elle eft compofée de dix-fept piquans. Il
-y a de chaque cô té , auprès du couvercle des oiiies,
un petit piquant crochu, &c recourbé en-deffus. La
queue eft arrondie, & compofée de onze ou douze
-piquans branchus : les piquans de toutes les autres
:nageoires font fimples. Les oeufs de la femelle la font
paroître enflée. On trouve le chabot dans les ruif-
feaux & dans les fleuves pierreux : il fe tient prefque
toûjoürs au fond ; il fe cache fous les pierres, ôc
il fe nourrit d’infeûes aquatiques. Willughby. Rondelet.
Foye^ Poisson. ( / )
* Pêche du chabot. Le chabot ne fe prend point à
l’hameçon, parce qu’il ne donne point à l’appât : il
fe pêche avec des naffes & autres filets femblablesi
.Vbyeç Nassesi. .
CHABRATE, f. f. (Hifl. nat. Litholog.) Boece dé
Boot dit que c’eft une pierre tranfparente femblable
à du cryfta.l de roche, à qui la trop crédule antiquité
attribuoit mille vertus fingulieres. (—)
ÇHABRE, voye{ C rabe;
CHABRIA, ( Géog. mod. ) riviere de Macédoine
dans la province d’Emboli, qui fe jette dans la Méditerranée
à Saloniquc.
CHABUR, ( Géog. mod. ) riviere d’Afie dans le
Diarbek, qui fe jette dans l’Euphrate à Alchabur.
CH ACABOU T, ou XACABOUT , comme on
l’écrit dans les Indes, fub. m. {Hifl. mod.) eft une
forte de religion qui s’eft répandue dans le Tunquin,
à la Chine, au Japon, & à Siam. Xaca* qui en eft
l’auteüf, y enfeigna pouf l’un de fes principes la
tranfmigfatiorides âmes* & affûra qu’après cette vie
il y avoit des lieux différens pour punir les divers der
grés de coupables, jufqu’à ce qu’après avoir fâtisfait
chacun félon l’énormité de fes péchés, ils retour-
noient en vie, fansfinir jamais de mourir ou de vivre:
mais que ceux qui fuivoient fa doélrine, après un
certain nombre de réfurre&ions, ne revenoient plus*
& n’étoient plus füjets à ce changement. Pour lui il
avoiioit qu’il avoit été obligé de renaître dix fois *
pour acquérir la gloire à laquelle il étoit parvenu
; apres quoi les Indiens font perfuadés qu’il
fut métamorphofé en éléphant blanc; C ’eft de-là
que vient le refpeét que les peuples du Tunquin
8c de Siam ont pour cet animal, dont la pof-
feflion même a caufé une guerre cruelle dans les Indes.
Quelques-uns croyent que Xaca étoit juif, ou
du moins qu’il s’étoit fervi de leurs livres. Aufli dans
les dix commandemens qu’il avoit preferits, il s’en
trouve plufieurs conformes à ceux du Décalogue ,
comme d’interdire le meurtre, le larcin, les defirs
déréglés, & autres.
Quant au tems où il a v é cu , on le fait remonter
jufqu’au régné de Salomon : on a même conjetturé
que ce pouvoit bien être quelqu’un de ces miféra-
bles que ce grand roi chaffa de fes états, & qu’il exila
dans le royaumedePégu pour y travailler aux mines;
c’eft du moins une ancienne tradition du pays. La doctrine
de cet impofteur fit d’abord de grands progrès
dans le royaume de Siam ; & delà elle s ’étendit à la
Chine, au Japon, & aux autres états , où les bonzes
fe vantent d’être les difciples des Talapoins,
feûateurs de Xaca. Mais le royaume de Siam n’eft
plus aujourd’hui la fource de toutes leurs fàuffes
doftrines, puifque les Siamois mêmes vont s’inftrui-
re de la doftrine de Xaca dans le royaume de Lo-
cos , comme dans une univerfité. Sur quoi voyeç le
pere Tiffanier, jéfuitefrançois, qui étoit au Tunquin
en 1658 , 1659, & 1660, dans la relation qu’il a
faite de fon voyage. Foye^ auffi Tavernier, dans
fes voyages des Indes, (a)