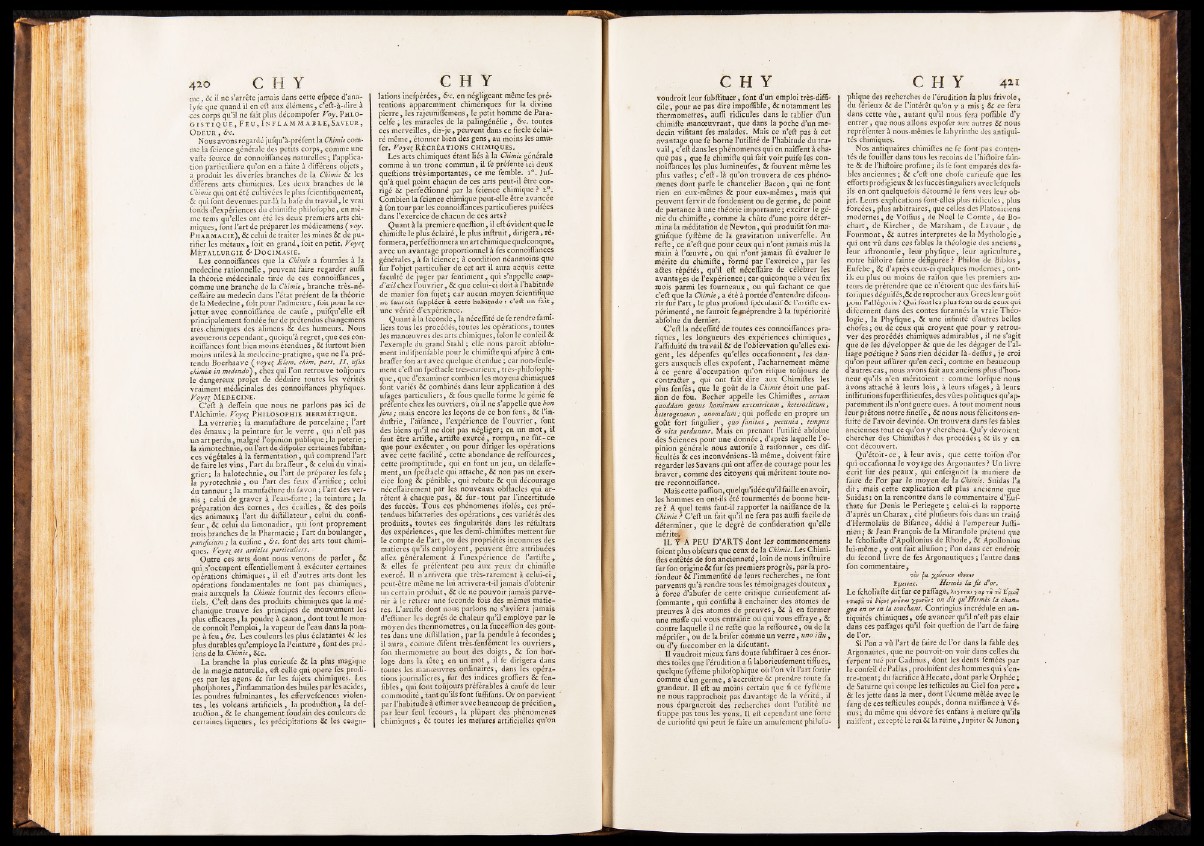
m e , & il ne s’arrête jamais dans cette efpece d’arià-
lyfe que quand il en eft aux élémens, c’eft-à-dire à
ces corps qu’il ne fait plus décompofer Voy. Phlo-
& i s t i q u e , F e u , I n f l a m m a b l e , Saveur ,
O deur , &c.
Nous avons regardé jufqu’à-préfent la Chimie comme
la fcience générale des petits corps, comme une
vafte fourcc de connoiffances naturelles ; l’application
particulière qu’on en a faite à différens objets,
a produit les diverfes branches de la Chimie & les
différens arts chimiques. Les deux branches de la
Chimie qui ont été cultivées le plus feientifiquement,
& qui font devenues par-là la bafe du travail, le vrai
fonds d’expériences du chimifte philofophe, en même
tems qu’elles ont été les deux premiers arts chimiques;
font l’art de préparer les médicamens ( voy.
P h a rm a cie) , 8c celui de traiter les mines 8c de purifier
les métaux, foit en grand, foit en petit. Voye{
Mé t al lu rg ie & D o c im a s ie .
Les connoiffances que la Chimie a fournies à la
medecine rationnelle, peuvent faire regarder auffi
la théorie médecinale tirée de ces connoiffances,
comme une branche de la Chimie , branche très-né-
ceffaire au médecin dans l’état préfent de la théorie
de la Medecine, foit pour l’admettre, foit pour la re-
jetter avec connoiffance de caufe , puifqu’elle eft
principalement fondée fur de prétendus changemens
très-chimiques des alimens 8c des humeurs. Nous
avouerons cependant, quoiqu’à regret, que ces con-
noiftànces font bien moins étendues, 8c furtout bien
moins utiles à la medecine-pratique, que ne l’a prétendu
Boerhaave ( voye^ Elem. chim. part. I I . ufus
chimie in medendo) , chez qui l’on retrouve toûjours
le dangereux projet de déduire toutes les vérités
vraiment médicinales des connoiffances phyliques.
Voye{ MED E CIN E .
C ’eft à deffein que nous ne parlons pas ici de
l’Àlchimie. Voye^ Ph iloso ph ie h erm é t iq u e .
La verrerie ; la manufa&ure de porcelaine ; l’art
dés émaux ; la peinture fur le verre , qui n’eft pas
un art perdu, malgré l’opinion publique ; la poterie ;
la zimotechnie, ou l’art de difpofer certaines fubftan-
ces végétales à la fermentation, qui comprend l’art
de faire les v ins, l’art du braffeur, & celui du vinaigrier;
la halotechnie, ou l’art de préparer les fels ;
la pyrotechnie, ou l’art des feux d’artifice ; celui
du tanneur ; la manufacture du favoii ; l’art des vernis
; celui de graver à l’eau-forte ; la teinture ; la
préparation des cornes, des écailles, 8e des poils
des animaux; l’art du diftillateur, celui du confi-
feur, 8c celui du limonadier, qui font proprement
trois branches de la Pharmacie ; l’art du boulanger,
panificitim ; la cuifinc, &c. font des arts tout chimiques.
Foyei ces articles particuliers. •/-' .
Outré ces arts dont nous venons de parler, &
qui.s’occupent effentiellement à exécuter certaines
opérations chimiques, il eft d’autres arts dont les
opérations fondamentales ne font pas chimiques,
mais auxquels la Chimie fournit des fecours effen-
tiels. C’eft dans des produits chimiques que la mé-
chanique trouve fes principes de mouvement les
plus efficaces, la poudre à canon, dont tout le monde
connoît l’emploi, la vapeur de l’eau dans la pompe
à feu, &c. Les couleurs les plus éclatantes 8c les
plus durables qu’employe la Peinture, font des pré-
fens de la Chimie, 8ec.
La branche la plus curieufe 8c la plus magique
de la magie naturelle, eft celle qui opéré fes prodiges
par les agens 8c fur les fujets chimiques. Les
phofphores, l’inflammation des huiles par lës acides,
les poudres fulminantes, les effervefcences violentes
, les volcans artificiels, la produ&ion, la def-
truftion, & le changement foudain des couleurs de
certaines liqueurs, les précipitations 8c les ceagulations
inefpérées, 6*c. en négligeant même les prétentions
apparemment chimériques fur la divine
pierre, les rajeuhiffemens, le petit homme de Para-
celfe ; les miracles de la palingénéfie , 6*c. toutes
ces merveilles, dis-je, peuvent dans ce fiecle éclairé
même, étonner bien des gens, au moins les amu-
fer. Voye{ Récréations chimiques.
Les arts chimiques étant liés à la Chimie générale
comme à un tronc commun, il fe préfente ici deux
queftions très-importantes, ce me femble. i° . Juf-
qu’à quel point chacun de ces arts peut-il être corrigé
Ôe perfe&ionné par la fcience chimique ? z®.
Combien la fcience chimique peut-elle être avancée
à fon tour par les connoiffances particulières puifées
dans l’exercice de chacun de ces arts ?
Quant à la première queftion, il eft évident que le
chimifte le plus éclairé, le plus inftruit, dirigera, ré?
formera, perfectionnera un art chimique quelconque,
avec un avantage proportionnel à fes connoiffances
générales, à fa fcience ; à condition néanmoins que
fur l’objet particulier de cet art il aura acquis cette
faculté de juger par fentiment, qui s’appelle coup-
d'oeil chez l’ouvrier, 8c que celui-ci doit à l’habitude
de manier fon fujet; car aucun moyen fciëntifique
ne fauroit fuppléer à cette habitude : c’eft un fait,
une vérité d’expérience.
Quant à la fécondé, la néceffité de fe rendre familiers
tous les procédés, toutes les opérations, toutes
les manoeuvres des arts chimiques, félon le confeil &
l’exemplè du grand Stahl ; elle nous pàroît abfolu-
ment indifpenfable pour le chimifte qui afpire à em-
braffer fon art avec quelque étendue ; car non-feulement
c’ eft un fpe&acle très-curieux, très-philofophi-
que, que d’examiner combien les moyens chimiques
font variés 6c combinés dans leur application à des
ufages particuliers, 8c fous quelle forme le génie fe
préfente chez les ouvriers, où il ne s’appelle que bon
fens; mais encore les leçons de ce bon fens, 6c l’in-
duftrie, l’aifance, l’expérience de l’ouvrier, font
des biens qu’il ne doit pas négliger ; en un mot, il
faut être artifte, artifte exercé, rompu, ne fû t-ce
que pour exécuter, ou pour diriger les opérations
avec cette facilité, cette abondance de reffources ,
cette promptitude, qui en font un jeu, un délaffe-
ment, un fpeftacle qui attache, 6c non pas un exercice
long 6C pénible, qui rebute 6c qui décourage
néceffairement par les nouveaux obftacles qui arrêtent
à chaque pas, 6c fur-tout par l’incertitude
des fuccès. Tous ces phénomènes ifolés, ces prétendues
bifarreries des opérations, ces variétés des
produits, toutes ces fingularités. dans les réfultats
des expériences, que les demi-chimiftes mettent fur
le compte de l’ art, oit des propriétés inconnues des
matières qu’ils emplôyent, peuvent être attribuées
affez généralement à l’inexpérience de l’artifte,
& elles fé préfentent peu aux yeux du chimifte
exercé. Il n’arrivera que très-rarement à celui-ci,
peut-être même ne lui arrivera-t-il jamais d’obtenir
un certain produit, 6c de ne pouvoir jamais parvenir
à le retirer une fécondé fois des mêmes matières.
L’artifte dont nous parlons ne s’avifera jamais
d’eftimer les degrés de chaleur qu’il employé par le
moyen des thermomètres, où la fucçeffion des gouttes
dans une diftillation, par la pendule à fécondés ;
il aura, comme difent très-fenfement les ouvriers ,
fon thermomètre au bout des doigts, 6c fon horloge
dans la tête ; en un mot, il fe dirigera dans
toutes les manoeuvres ordinaires-, dans les opérations
journalières, fur des indices groffiers 6c fen-
fiblcs, qui font toûjours préférables à caufe de leur
commodité, tant qu’ ils font fuffifans. Or on parvient
par l’habitude à eftimer avec beaucoup de précifion,
par leur feul fecours, la pîûpart des phénomènes
chimiques ; 6c toutes les mefure* artificielles qit’on
voudroit leur fubftituer, font d’un emploi très-difficile,
poùr ne pas dire impoffible, 6c notamment les
thermomètres, auffi ridicules dans le tablier d’un
chimifte manoeuvrant, que dans la poche d’un médecin
vilitant fes malades. Mais ce n’eft pas à cet
avantage que fe borne l’utilité de l’habitude du travail
, c’eft dans les phénomènes qui en naiffent à cha-
qué pas , que le chimifte qui fait voir puife les con-
rioiffances les plus lumineufes, & fouvent même les
plus vaftes ; c’eft - là qu’on trouvera de ces phénomènes
dont parle le chancelier Bacon, qui ne font
rien en eux-mêmes 6c pour eux-mêmes, mais qui
peuvent fervir de fondement ou de germe, de point
de partance à une théorie importante ; exciter le génie
du chimifte, comme la chûte d’une poire détermina
la méditation de Newton, qui produilit fon magnifique
fyftème de la gravitation univerfelle. Au
refte, ce n’eft que pour ceux qui n’ont jamais mis la
main à l’oeuvre, OU qùi n’ont jamais fû évaluer le
mérite du chimifte, formé par l’exercice, par les
aûes répétés, qu’il eft nécefîaire de célébrer les
avantages de l’expérience; car quiconque a vécu fix
mois parmi les fourneaux, ou qui fachant ce que
c’eft que la Chimie , a été à portée d’entendre difeou-
rir fur l’art, le plus profond fpéculatif ôc l’artifte expérimenté
, ne fauroit fe#néprendre à la lùpériorité
abfolue du dernier.
C ’eft la néceffité de toutes ces connoiffances pratiques,
les longueurs des expériences chimiques,
l ’affiduité du travail 6c de l’obfervation qu’elles exigent
, les dépenfes qu’elles occafionnent, les dangers
auxquels elles expofent, l’acharnement même
à ce genre d’occupation qu’on rifque toûjours de
c'ôntrafter , qui ont fait dire aux Chimiftes les
plus fenfés, que le goût de la Chimie étoit une paf-
flon dé fou. Becher appelle les Chimiftes, certum
quoddam genus kominürli excentricum , heteroclitum,
heterogeneurn, anomaiüm; qui poffede en propre un
goût fort iinguiief , qùo fanitâs, pecunia, tempus
& vita perduntur. Mais en prenant l’utilité abfolue
dès Sciences pour une donnée, d’après laquelle l’opinion
générale nous autorife à raifonner, ces difficultés
8c ces inconvéniens-là même, doivent faire
regarder les Savans qui ont affez de courage pour les
braver, comme dés citoyens qui méritent toute notre
reconrtoiffance.
Mais cette paffion, quelqu’idée qu’il faille en avoir,
lés hommes en ont-ils été tourmentés de bonne heure
? A quel tems faut-il rapporter la naiffance de la
Chimie ? C’eft un fait qu’il ne fera pas auffi facile de
déterminer, que le degré de confideration qu’elle
méritej|
IL Ÿ A PEU D’ARTS dont les cornmencemens
foient plus obfcurs que ceux de la Chimie. Les Çhimi-
ftés entêtés de fort ancienneté, loin de nous inftruire
fur fon origine 8c fur fes premiers progrès, par la profondeur
8c l’immérifîte dé leurs recherches, ne font
parvenus qu’à rendre tous lès témoignages douteux,
à force d’abufer dé cette critique curieufement af-
fommànte, qui confifté à' enchaîner des atomes de
preuves à des atomes dé preuves, 8c à en former
une maffe qui vous entraîne ou qui vous effraye, &
contre laquelle il ne refte que la reffource, ou de la
méprifer, ou de la brifer comme un verre, uno i3u ,
ou d’y fuccomber en là difeutant.
' Il vaudroit mieux fans doute fubftituer à ces énormes
tollés que l’érudition a fi laborieufement tiffues,
quelque fyftème philofôphique où l’on vit l’art fortir
comme d’un germe, s ’accroître 6c prendre toute fa
grandeur. Il eft au moins certain que fi ce fyftème
ne nous rapprochoit pas davantage de la vérité, il
nous épargneroit des recherches dont l’utilité ne
frappe pas tous les yeux. Il eft cependant une forte
de curiofité qui peut fe faire un ainufement philofophique
des recherches de l’érudition la plus frivole ,
du férieux 8c de l’intérêt qu’on y a mis ; 8c ce fera
dans cette vû e , autant qu’il nous fera poffible d’y
entrer, que nous allons expofer aux autres 8c nous
repréfenter à nous-mêmes le labyrinthe des antiquités
chimiques.
Nos antiquaires chimiftes ne fe font pas contentés
de fouiller dans tous les recoins de l’hiftoire fain-
te 8c de l’hiftoire profane ; ils fe font emparés des fables
anciennes ; 6c c’eft une chofe curieufe que les
efforts prodigieux 8c les fuccès finguliers avec lefquels
ils en ont quelquefois détourné le fens vers leur objet.
Leurs explications font-elles plus ridicules, plus
forcées, plus arbitraires’, que celles dés Platoniciens
modernes, de Voffius, de Noël le Comte, de Bo-
chart, dé Kircher, de Marsham, de Lavaur, de
Fourmont, 6c autres interprètes de la Mythologie >
qui ont vû dans ces fables la théologie des anciens ,
leur aftronomie, leur phyfique, leur agriculture,
notre hiftoire fainte défigurée ? Philon de Biblos,
Eufebe, 6c d’après ceux-ci quelques modernes, ont-
ils eu plus ou moins de raifon que les premiers auteurs
de prétendre que ce n’étoient que des faits hif-
foïiqttes déguifés,ôc de reprocher aux Grecs leur goût
pour l’allégorie? Q ui font les plus fous ou de ceux qui
difeernent dans des contes lurannés la vraie Théologie,
la Phyfique, 8c une infinité d’autres belles
chofes ; ou de ceux qui croyent que pour y retrouver
des procédés chimiques admirables, il ne s’agit
que de les développer 8c que de les dégager de l’alliage
poétique ? Sans rien décider là-deffus, je croi
qu’on peut affurer qu’en ce c i, comme en beaucoup
d’autres cas, nous avons fait aux anciens plus d’honneur
qu’ils n’en méritoient : comme lorfque nous
avons attaché à leurs lo is , à leurs ufages, à leurs
inffitùtions fuperftitieufes, des vîtes politiques qu’ap-
paremment ils n’ont guere eues. A tout moment nous
leur prêtons notre fineffe, 8c nous nous félicitons en-
fiiite de Pavoir devinée. On trouvera dans les fables
anciennes tout ce qu’on y cherchera. Qu’y dévoient
chercher des Chimiftes ? des procédés ; 8c ils y en
ont découvert.
Qu’éto it-ce , à leur avis, que cette toi fon d’or
qui occafionna le voyage des Argonautes ? Un livre
écrit fur des peaux, qui enfeignoit la mahiere de
faire de l’or par le moyen de la Chimie. Suidas l’a
dit; niais cette explication eft plus ancienne que
Sûidas : on la rencontre dans le commentaire d’Euft
tlïate fur Denis le Periegete ; celui-ci la rapporte
d’après urt Charax, cité plufieurs fois dans un traité
d’Hétmôlaüs de Bifance, dédié à l’empereur Jufti-
nien ; 8c Jean François de la Mirandole prétend que
le fchôliafte d’Apollonius de Rhode, 8c Apollonius
lui-même, y ont fait allufion ; l’un dans cet endroit
du fécond livre de fes Argonautiques ; l’autre dans
fon commentaire,
toy pce X'pveuov tutiKty
Epfxuctç. Hermis la fit d’or.
Le fchôliafte dit fur ce paffage, xvytTcu ?*p t« t» E’ppS
matfih to S'ipoç p.vweu xpuoSy : on dit qui Hermès la changea
en or en là touchant. Conringius incrédule en antiquités
chimiques, ofe avancer qu’il n’eft pas clair
dans ces paffâges qu’il foit queftion de l’art de faire
de l’or..
Si Pon a vû l’art de faire de l’or dans la fable des
Argonaütes, que ne pouvoit-on voir dans celles du
ferpent tué par Cadmus, dont les dents femées par
le confeil de Pallas, produifent des hommes qui s’entre
tuent; dit facrifice àHecate, dont parle Orphée;
de Saturne qui coupe les tefticules au Ciel fon p ere,
8c les jette dans la mer, dont l ’écume mêlée avec le
fang de ces tefticules coupés, donna naiffance à Vénus;
du même qui dévore fes enfans à mefure qu’ils
naiftbnt, excepté le roi & la reine, Jupiter 6c Junon;