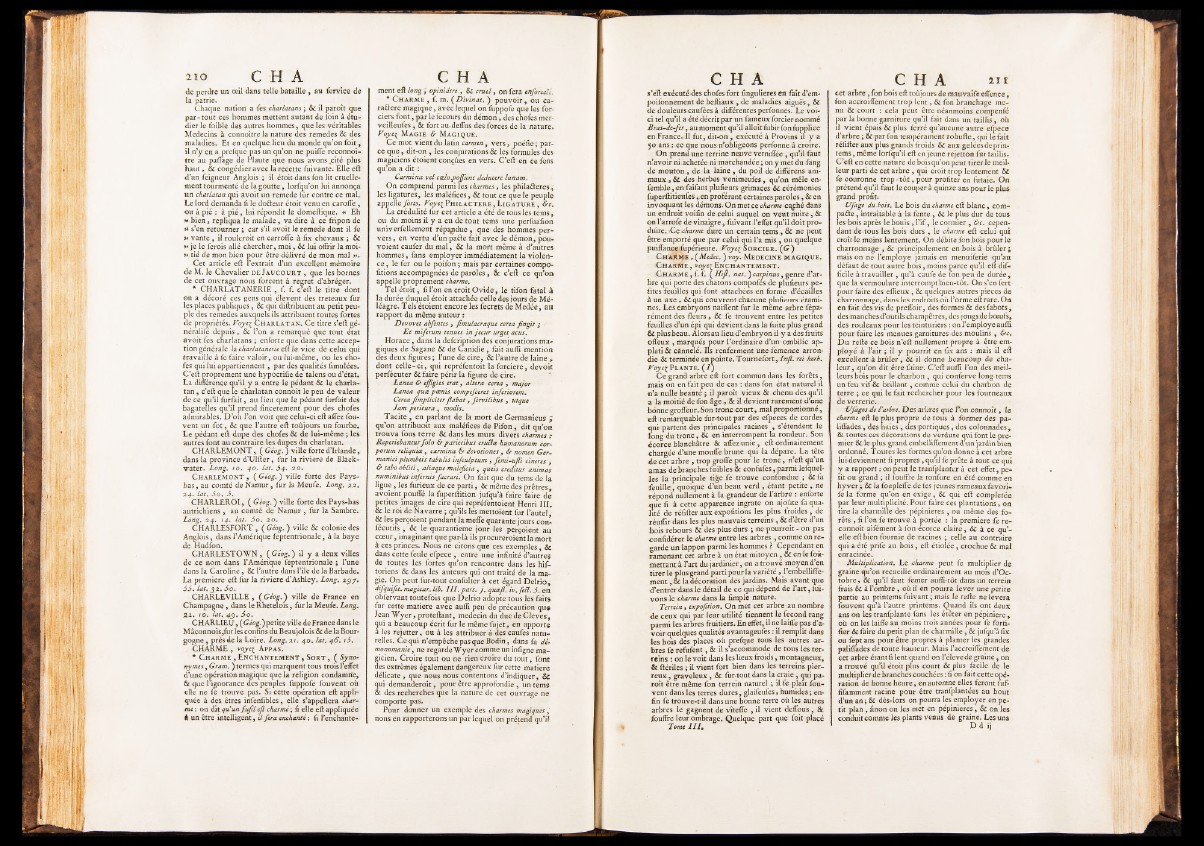
de perdre un oeil dans telle bataille , au fervice de
la patrie.
Chaque nation a les charlatans ; & il paroît que
par-tout ces hommes mettent autant de foin à étudier
le foible des autres hommes, que les véritables
Médecins à eonnoître la nature des remedes ôc des
maladies. Et en quelque lieu du monde qu’on fbit,
il n’y en a prefque pas un qu’on ne puiffe reconnoî-
tre au paffage de Plaute que nous avons ,cité plus
haut, ôc congédier avec la recette fuivante. Elle eft
d’un feigneur Anglois ; il étoit dans fon lit cruellement
tourmenté de la goutte, lorfqu’on lui annonça
un charlatan qui avoit un remede fur contre ce mal.
Le lord demanda fi le dotteur étoit venu en caroffe ,
ou à pié : à p ié , lui répondit le domeftique. « Eh
» bien, répliqua le malade, va dire à ce fripon de
s’en retourner ; car s’il avoit le remede dont il fe
» vante, il rouleroit en carroffe à fix chevaux ; ôc
» je le ferois allé chercher, m oi, ôc lui offrir la moi-
» tié de mon bien pour être délivré de mon mal ».
Cet article eft l’extrait d’un excellent mémoire
de M. le Chevalier de Ja u c o u r t , que les bornes
de cet ouvrage nous forcent à regret d’abréger.
* CHARLATANERIE , f. f. c?eft le titre dont
on a décoré ces gens qui élevent des tréteaux fur
les places publiques, ôc qui diftribuent au petit peuple
des remedes auxquels ils attribuent toutes fortes
de propriétés. Voyt^ C h a r la t an . Ce titre s’eft gé-
néralifé depuis, ôc l’on a remarqué que tout état
avoit fes charlatans ; enforte que dans cette acception
générale la charlatanerie eft le vice de celui qui
travaille à fe faire valoir, ou lui-même, ou les chofes
qui lui appartiennent, par des qualités fimulées.
C ’eft proprement une hypocrifie de talens ou d’état.
La différence qu’il y a entre le pédant 5c le charlatan
, c’eft que le charlatan connoît le peu de valeur
de ce qu’il furfait, au lieu que le pédant furfait des
bagatelles qu’il prend fincerement pour des chofes
admirables. D ’où l ’on voit que celui-ci eft affez fou-
vent un fo t , ôc que l’autre eft toûjours un fourbe.
Le pédant eft dupe des chofes ôc de lui-même ; les
autres font au contraire les dupes du charlatan.
CH ARLEMONT, ( Géog. ) ville forte d’Irlande,
dans la province d’Ulfter, fur la riviere de Blaek-
water. Long. 10. 40. lat. 64. 20.
C harlemon t , ( Géog. ) ville forte des Pays-
bas, au comté deNamur, fur la Meufe. Long. 22.
24. lat. So. S.
CHARLEROI, ( Géog.') ville forte des Pays-bas
autrichiens , au comté de Namur, fur la Sambre.
Long. 24. 14. lat. 60. 20.
CHARLESFORT , ( Géog. ) ville ôc colonie des
Anglois, dans l’Amérique feptentrionale, à la baye
de Hudfon.
CHARLESTOWN , ( Géog. ) il y a deux villes
de ce nom dans l’Amérique feptentrionale ; l’une
dans la Caroline, ôc l’autre dans l’île de la Barbade.
La première eft fur la riviere d’Ashley. Long. 297.
6.S. lat. $2. So.
CHARLEVILLE , ( Géog. ) ville de France en
Champagne, dans le Rhetelois, fur la Meufe. Long.
22. 10. lat. 49. S o.
CH ARLIEU, (Géog.) petite ville de France dans le
Mâconnois,fur les confins du Beaujoloisôcde la Bourgogne
, près de la Loire. Long. 21. 40. lat. 46. iS.
CHARME, voye{ A p pas.
* C harme , Enchantemen t , So r t , ( Synonymes
, Gram. ) termes qui marquent tous trois l’effet
d’une opération magique que la religion condamrfe,
& que l ’ignorance des peuples fuppofe fouvent où
elle ne fe trouve pas. Si cette opération eft appliquée
à des êtres infenfibles, elle s’appellera charme
: on dit qu'un fujil ejl charmé ; fi elle eft appliquée
à un être intelligent, U fera enchanté : fi l’enchantement
eft long , opiniâtre , & cruel, on fera tnforcelé.
* C harme , f. m. ( Divinat. ) pouvoir, ou ca-
rattere magique, avec lequel on fuppofe que les for-
ciers font, par le fecours du démon, des chofes mer-
veilleufes, & fort au-deffus des forces de la nature.
Voyc^ Mag ie & Ma g iq u e .
Ce mot vient du latin carmen, v ers , poéfie; parce
que, dit-on, les conjurations & les formules des
magiciens étoient conçues en vers. C ’eft en ce fens
qu’on a dit :
Carmina vtl ccdo.pojfunt deducere lunam.
On comprend parmi les charmes, les philatteres,
les ligatures, les maléfices, ôc tout ce que le peuple
appelle forts. V oyt{ Ph il ac ter e , L ig a tu r e , &c.
La crédulité fur cet article a été de tous les tems ,
ou du moins il y a eu de tout tems une perfuafion
univerfellement répandue, que des hommes pervers
, en vertu d’un patte fait avec le démon, pou-
voient caufer du mal, & la mort même à d’autres
hommes, fans employer immédiatement la violence
, le fer ou le poifon ; mais par certaines compo-
fitions accompagnées de paroles, & c’eft ce qu’on
appelle proprement charme.
Tel étoit, fi l’on en croit O v id e, le tifon fatal à
la durée duquel étoit attachée celle des jours de Mé-
léagre. Tels étoient encore les fecrets de Medée, an
rapport du même auteur :
Devovet abfentes , Jimulacraque cerea fingit ; ■
E t miferum tenues in jecur urget acus.
Horace, dans la defeription des conjurations magiques
de Sagane & de Canidie, fait auflî mention
des deux figures ; l’une de cire, ôc l’autre de laine ,
dont c e lle - c i, qui repréfentoit laforc iere , devoit
perfécuter ôc faire périr la figure de cire. '
Lanea & effigies erat, altéra cerea , major
Lanea quoi poenis compefceret inferiorem.
Cerea Jîmpliciter flabat, fervilibus , utquc
Jam peritura, modis.
Tacite , en parlant de la mort de Germanicus ^
qu’on attribuoit aux maléfices de Pifon, dit qu’on
trouva fous terre ôc dans les murs divers charmes ;
Reperiebantur folo & parietibus eruclce humanorum cor-
porum reliquice, carmina & devotiones , & nomen Ger-
manici plumbeis tabulis infculptum , femi-ufli cineres ,
& taboobliti, aliaque maleficia , queis creditur animas
numinibus infernis facrari. On fait que du tems de la
ligue, les furieux de ce parti, & même des prêtres,
a voient pouffé la fuperftition jufqu’à faire faire de
petites images de cire qui repréfentoient Henri III.
& le roi de Navarre ; qu’ils les mettoient fur l ’autel,
& les perçoient pendant la meffe quarante jours con-
fécutifs , & le quarantième jour les perçoient au
coeur, imaginant que par-là ils procureroient la mort
à ces princes. Nous ne citons que ces exemples, &
dans cette feule efpece , entre une infinité d’autres
de toutes les fortes qu’on rencontre dans les historiens
ôc dans les auteurs qui ont traité de la magie.
On peut fur-tout confulter à cet égard Delrio,
difquijit. magicar. lib. I I I . part. j . quoejl. iv.fecl. 5. en
obfervant toutefois que Delrio adopte tous les faits
fur cette matière avec aufli peu de précaution que
Jean "Wyer, proteftant, médecin du duc de Cleves,
qui a beaucoup écrit fur le même fujet, en apporte
à les rejetter, ou à les attribuer à des caufes naturelles.
Ce qui n’empêche pas que Bodin, dans fa de*
monomanie, ne regarde "Wyer comme un infigne magicien.
Croire tout ou ne rien croire du tout, font
des extrêmes également dangereux fur cette matière
délicate, que nous nous contentons d’indiquer, &
qui demanderoit, pour être approfondie , un tems
& des recherches que la nature de cet ouvrage ne
comporte pas.
Pour donner un exemple des charmes magiques
nous en rapporterons un par lequel on prétend qu’il
s’eft exécùté-des chofes fort fingulieres en fait d’em-
poifonnement de beftiaux, de maladies aiguës, 5c
de douleurs caufées à différentes perfonnes. Le voici
tel qu’il a été décrit par un fameux forcier nommé
B ras-de-fer,. au moment qu’il alloit fubir fon fupplice
en France.il fut, dit-on., exécuté à Provins il y a
50 ans : ce que nousn’obligeons perfonne:à croire.
On prend une terrine neuve verniffée , qu’il faut
n?avoir ni achetée ni marchandée ; on y met du fang
de mouton., de la laine, du poil de différens animaux.,
5c des herbes venimeufes, qu’on mêle en-
femble, en faifant plufieurs grimaces ôc cérémonies
fuperftitieufes,,en proférant certaines paroles, ôc en
invoquant les démons. On met ce charme cqché dans
un endroit voifin de celui auquel on veut nuire, 5c
on l’arrofe de vinaigre, fuivant l’effet qu’il doit produire.
'C e .charme dure un certain tems, ôc ne peut
être emporté que par celui qui l’a mis , ou quelque
puiffannejfupérieure. Voye^ So r c ier . (G )
C harme , (Medec. )voy. Medecine m a g iq u e .
(C'HarM e , v.cyci En ch an t em en t .
;Ghàrme ,( Hijl. nat. ) carpinus, genre d’arbre
qui porte des chatons compofés de plufieurs p etites
feuilles qui font attachées en forme d’écailles
à un axe , & qui couvrent chacune plufieurs étamines.
Les embryons naiffent fur le même arbre fépa-
rément des fleurs., 5c fe trouvent entre les petites
feuilles d’un épi qui devient dans la fuite plus grand
& plus beau. Alors au lieu d’embryon il y a des fruits
offeux , marqués pour l ’ordinaire d’un ombilic ap-
plati 5c cannelé. Ils renferment une femence arrondie
5c terminée en pointe. Tournefort, Infl. rei herb.
Voyei Plante. ( / )
C e grand arbre eft fort commun dans les forêts,
mais on en fait peu de cas : dans fon état naturel il
n’a nulle beanté ; il paroît vieux 5c chenu dès qu’il
a la moitié de fon âge ., 5c il devient rarement .d’une
bonne groffeur. Son tronc court , mal proportionné,,
eft remarquable fur-tout par des efpeces de cordes
qui partent des principales racines , s’étendent le
long du tronc, ôc en interrompent la rondeur. Son
écorce blanchâtre 5c affez unie, eft ordinairement
chargée d’une moufle brune qui -la dépare. La tête
de cet arbre , trop groffe pour le tronc, n’eft qu’un
amas de branches foibles 5c confufes, parmi lefquel-
les la principale ti|e fe trouve confondue ; ôcfa
feuille., quoique d’un beau verd , étant petite , ne
répond nullement à la grandeur de l’arbre : enforte
que fi à cette apparence ingrate on ajoute fa qualité
de réfifter aux expofitions les plus froides, de
réuflir dans les plus mauvais terreins , ôc d’être d’un
bois rebours ôc des plus durs ; ne pourroit - on pas
confidérer le charme entre les arbres , comme on regarde
un lappon parmi les hommes ? Cependant en
ramenant cet arbre à un état m itoyen, ôc en le fou-
mettant à l’art du jardinier, on a trouvé moyen d’en
tirer le plus grand parti pour la variété , l’embelliffe-
ment, ôc la décoration des jardins. Mais avant que
d ’entrer dans le détail de ce qui dépend de l’art , lui-
vons le charme dans la fimple nature.
Terrein, expojîtion. On met cet arbre au nombre
de ceux qui par leur utilité tiennent le fécond rang
parmi les arbres fruitiers. En effet, il ne laiffe pas d’avoir
quelques qualités avantageufes : il remplit dans
les bois des places où prefque tous les autres arbres
fe refufent, 5c il s’accommode de tous les ter-
reins : on le voit dans les lieux froids, montagneux,
5c ftériles ; il vient fort bien dans les terreins pierreux
, graveleux, ôc fur-tout dans la c raie, qui paroît
être même fon terrein naturel ; il fe plaît fou-
vent dans les terres dures, glaifeufes, humides; enfin
fe trouve-t-il dans une bonne terre où les autres
arbres le gagnent de vîteffe , il vient deffous , ôc
fouffre leur ombrage. Quelque part que foit placé
Tome I I I ,
cet arbre, fon bois.eft toûjours de mauvaife effence,
fon accroiffement trop len t, ôc fon branchage menu
ôc court : cela peut être néanmoins compenfc
par la bonne garniture qu’il fait dans un taillis, où
il vient épais Ôc plus ferré qu’aucune autre efpece
d’arbre ; ôc par fon tempérament robufte, qui le fait
réfifter aux plus grands froids ôc aux gelées de prin-
tems, même lorfqu’iLeft en jeune rejetton fur taillis.
C ’eft en .cette nature de bois qu’on peut tirer le meilleur
.parti de cet arbre , qui croît trop lentement Ôc
fe couronne -trop - t ô t , pour profiter en futaie. On
prétend qu’i l faut le couper à quinze ans pour le plus
grand profit.
V f âge dubois. Le bois du charme eft blanc, com-
patte, intraitable à la fente , ôc le plus dur de tous
les bois après le bonis, l’i f , le cormier, &c. cependant
de -tous les bois durs , le charme eft celui qui
croît le.moins lentement. On débite fon bois pour le
charronnage , ôc principalement en bois à brûler ;
mais on ne l’employe jamais en menuiferie qu’au
défaut de tout autre bois, moins parce qu’il eft difficile
à travailler , qu’à caufe de fon peu de durée ,
que la vermoulure interrompt bien-tôt. On s’en fort
pour faire des eflieux , ôc quelques autres pièces de
charronnage, dans les endroits où l’orme eft rare. On
en fait des vis de preffoir, des formes & desfabots ,
des manches d’outils champêtres, des jougs de boeufs,
des rouleaux pour les teinturiers : on l’employe aufli
pour faire les menues garnitures des moulins , &c.
Du refte ce bois n’eft nullement propre à être employé
à l’air ; il y pourrit en fix ans : mais il eft
excellent à brûler , ôc il donne beaucoup de chaleur,
qu’on dit être faine. C ’.eft aufli l ’un des meilleurs
bois pour le charbon , qui conferve long-tems
un feu v if ôc brillant, comme celui du charbon de
terre ; ce qui le fait rechercher pour les fourneaux
de verrerie.
TTfages de L'arbre. D es arbres que l ’on connoît, le
charme eft le plus propre de tous à former des pa-
■ liffades , des haies , des portiques, des colonnades*
& toutes ces décorations de verdure qui font le premier
ÔC’le plus grand embelliffeinetït d’ un jardin bien
ordonné. Toutes les formes qu’on donne à cet arbre
lui deviennent fi propres , .qu’il fe prête à tout ce qui
y a rapport : on peut le tranfplanter à cet effet, petit
pu grand ; il fouffr.e la tonfure en été comme en
hy ver ; ôc Ia foupleffe de fes jeunes rameaux favori-
•fe la forme qu’on en ex ig e, ôc qui eft complétée
par leur multiplicité. Pour faire ces plantations, on
tire la charmille des pépinières , ou même des forêts
, fi l’on fe trouve à portée : la première fe re-
connoît aifément à fon ecorce claire, ôc à ce qu’elle
eft bien fournie de racines ; celle au contraire
qui a été prife au bois, eft étiolée, crochue ôc mal
enracinée.
Multiplication. Le charme peut fe multiplier de
graine qu’on recueille ordinairement au mois d’Oc-
tobre , ôc qu’il faut femer auflî-tôt dans un terrein
frais ôc à l’ombre , où il en pourra lever une petite
partie au printems fuivant ; mais le refte ne lèvera
fouvent qu’à l’autre printems. Quand ils ont deux
ans on les tranfplante fans les étêter en pépinière ,
où on les laiffe au moins trois années pour fe fortifier
ôc faire du petit plan de charmille, ôc jufqu’à fix
ou feptans pour être propres à planter les grandes
paliffades de toute hauteur. Mais l’accroiffement de
cet attire étant fi lent quand on l’éleve de graine, on
a trouvé qu’il étoit plus court ôc plus facile de le
multiplier de branches couchées : fi on fait cette opération
de bonne heure, en automne elles feront fuf-
fifamment racine pour être tranfplantées au bout
d’un an ; ôc dès-lors on pourra les employer en petit
plan, finon on les met en pépinières, ôc on les
conduit comme les plants venus de graine. Les uns
D d ij