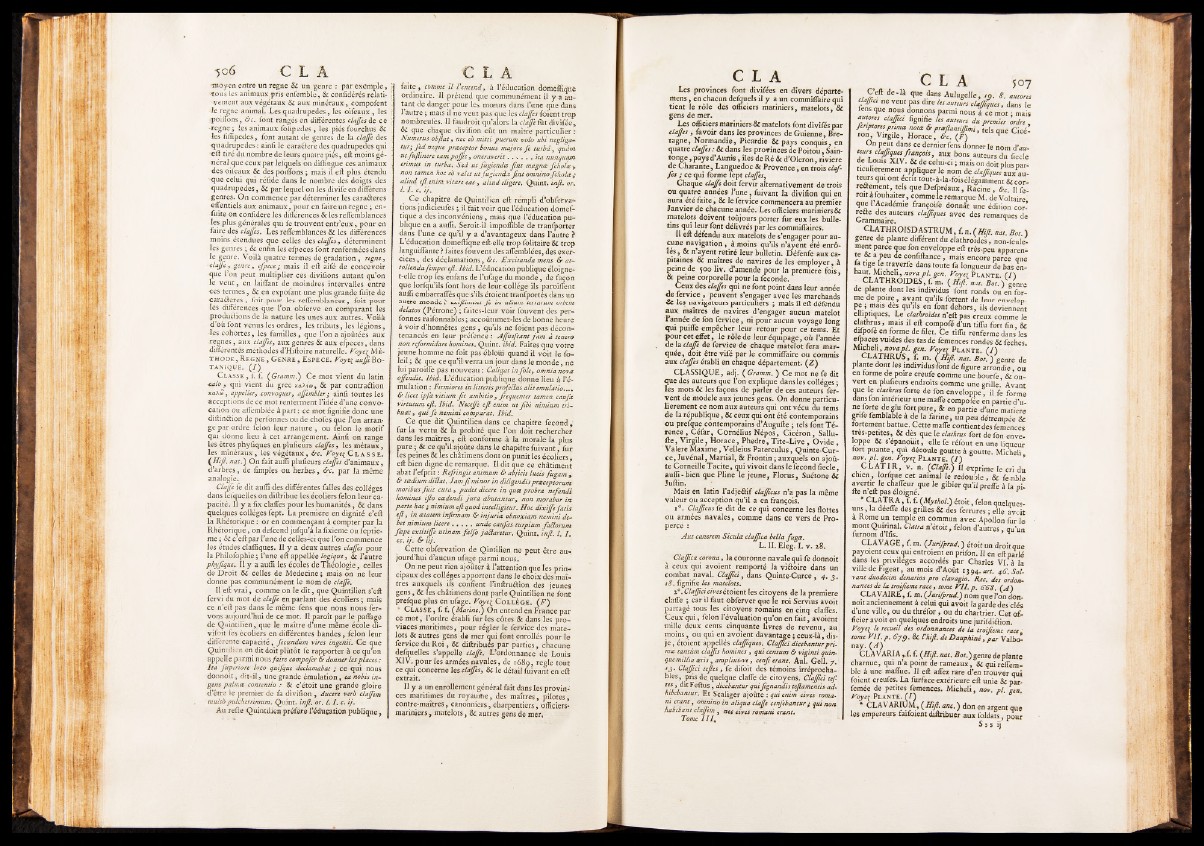
■ i l il
m g r
» f l ;
i l
i p i
i l ;
i m Ht
ü i
moyen entre un regne & un ’genre par exemple,
tous les animaux^pris enfemble, & confidérés relativement
aux végétaux & aux minéraux-, compofent
le regne animal. Les quadrupèdes, les oifeaux , les
spoliions, &c. font rangés en différentes claßes de ce
-regne ; les animaux folipedes , les piés fourchus &
les fiffipedes, font autant de genres de la clajfe des
quadrupèdes : ainfi le caraftere des quadrupèdes qui
eft tiré du nombre de leurs quatre piés, eft moins général
que ceux par lelquels on diftingue ces animaux
des oileaux & des poiffons ; mais il eft plus étendu
-que celui qui réiide dans le nombre des doigts des
quadrupèdes, & par lequel on les divife en différens
genres. On commence par déterminer les carafteres
effentiels aux animaux, pour en faire un regne ; en-
fuite on confidere les différences & les reffemblances
les plus générales qui fe trouvent entr’eu x, pour en
faire des claßes. Les reffemblances & les différences
moins étendues que celles des claßes., déterminent
les genres ; & enfin les efpeces font renfermées dans
le genre. Voilà quatre termes de gradation, regne.,
■ tlajfc, genre, efpece; mais il eft aifé de concevoir
que Ton peut multiplier ces divifions autant qu’on
le v eu t, en laiffant de moindres intervalles entre
•ces termes, & en expofant une plus grande fuite de
carafteres , foit pour les reffemblances, foit pour
les différences que l’on obferve en comparant les
productions de la nature les unes aux autres. Voilà
d ’où font venus les ordres, les tributs, les légiôns,
-les cohortes, les familles, que l’on a ajoutées aux
•régnés, aux claßes, aux genres & aux efpeces, dans
différentes méthodes d’Hiftoire naturelle, f^oye^ Meth
o d e , Reg n e , G enre , Esp ece. Voyez aufiîBo tan
iq u e . (ƒ )
C lasse , f. f. ( Gramm..) Ce mot vient du latin
<al°, qui vient du grec & par contraction
xaXa, appeliez, convoquer, aßembler ; ainfi toutes les '
acceptions de ce mot renferment l’idée d’iine convocation
ou affemblée à part : ce mot fignifie donc une
diftinftion de perfonnes ou de chofes que l’on arrange
par ordre félon leur nature, ou félon le motif
qui donne lieu à cet arrangement. Ainfi on range
les êtres phyfiques en plufieurs claßes, les métaux,
les minéraux, les végétaux, &c. Voye{ C l a s s e .
{Hifi. nat.) On fait aufli plufieurs claßes d’animaux,
d’arbres, de fimples ou herbes, &c. par la même
analogie;
Claße fe dit aufli des différentes falles des collèges
dans lel'quelles on diftribue les.écoliers félon leur capacité.
Il y a fix claffes pour les humanités, & dans
quelques collèges fept. La première en dignité c’eft
la Rhétorique : or en commençant à compter par la
Rhétorique, on defcend jufqu’à la fixieme ou feptie-
me ; & c ’eft par l’une de celles-ci que l’on commence
les études claffiques. Il y a deux autres claßes pour
la Philofophie ; l’une eft appellée logique, & l’autre
phyfique. Il y a aufli les écoles de Théologie, celles
de Droit & celles de Medecine ; mais on ne leur
donne pas communément le nom de claße.
Il eft v ra i, comme on le d it, que Quintilien s’eft
fervi du mot de claße en parlant des écoliers ; mais
ce n’eft pas dans le même fens que nous nous fer-
vons aujourd’hui de ce mot. Il paroît par le paffage
de Quintilien, que le maître d’une même école di-
vifoit fes écoliers en différentes bandes, félon leur
differente capacité, fecundùm vires ingenii. Ce que
Quintilien en dit doit plutôt fe rapporter à ce qu’on
appelle parmi nous faire compofer & donner les places:
Ita fupcriore loço quifque declamabat ; ce qui nous
donnôit, dit-il, une grande émulation, eanobis ingens
palmoe contentio : & c’étoit une grande gloire
d’être le premier de fa divifion , ducere verb claßem
multb pulcherrimum. Quint, infi. or. 1 .1. c. ij.
Au refte Quintilien préféré l’éduçation publique,
fa ite , comme i l l'entend, à l’éducation dottieffiqttè
ordinaire. Il prétend que communément il y a air-
tant de danger pour les moeurs dans l’une que dans
I autre ; mais il ne veut pas que les clajfes foient trop
nombreufes. Il faudroit qu’alors la claffe fut divifée,
& que chaque divifion eût un maître particulier :
Nurnerus obfiat, nec eb mitti puerum yolo ubi negliga*
tur» fed ncque proeceptor bonus majore fe turbâ, quatre
ut. fuflj.nere eam. pojjît , oneraverit. . . . . . ita nunquaiil
erirnus in turba. Std ut fugiendçe f n t magna fchola >
non tamen hoc eb valet ut fugiendçe fint omnino fchola ;
aliud e f enim vitarc eas , aliud eligere. Quint, infi. or*
1 .1 . c, i j .
Ce chapitre de Quintilien eft rempli d’ob fer vantions
judicieufes ; il fait voir que l’éducation domestique
a des inconvéniehs, mais que l’éducation pu blique
en a aufli. Seroit-il impoflible de tranfporter
dans l’une ce qu’il y a d’avantageux dans l ’autre ?
L’éducation domeftique eft-elle trop folitaire & trop
languiffante ? faites fouvent des affemblées, des exercices,
des déclamations, &c. Excitanda mens & at-
tollendafemper ejl. Ibid. L’éducation publique éloigne-
t-elle trop les enfans de l’ufage du m onde, de façon
que lorfqu’ils font hors de leur collège ils paroiffent
aufli embarraffés que s’ils étoient tranfportés dans un
autre monde } exifiment fe in alium terrarum orberti
delatos (Pétrone) ; faites-leur voir fouvent des perfonnes
raifonnables ; accoûtumez-les de bonne heure
à voir d’honnêtes gens, qu’ils ne foient pas décontenancés
en leur préfence : AJfuefcant jam à tenero
non reformidare homines. Quint, ibid. Faites que votre
jeune homme ne foit pas ébloiii quand il voit le fo~
leil ; & que ce qu’il verra un jour dans le monde, ne
lui paroiffe pas nouveau : Caligat in foie, omnia nova
affendit. Ibid. L’éducation publique donne lieu à l’émulation
: Firmiores inlitterisprofeclus alitemuldtio....
& licet ipfa vitium f i t ambitio , fréquenter tamen caufa
virtutum ejl. Ibid. Necejfe ejl enirn ut fibi nimiurn tribun:
, qui fe hemini cotnparat. Ibid.
Ce que dit Quintilien dans ce chapitre fécond
fur la vertu & la probité que l’on doit rechercher
dans les maîtres, eft conforme à la morale la plus
pure ; & ce qu’il- ajoûte dans le chapitre fuivant, fur
les peines & les châtimens dont on punit les écoliers ,
eft bien digne de remarque. Il dit que ce châtiment
abat l ’efprit : Refringit animum & abjicit lucis fugam ,
& tædium diclat. Jam f i minor in diligendis proeceptorurte-
moribus fuit cura, pudet dicere in quceprobra nefandi
homines ifio coedendi jura abutantur, non morabor in
parte hac ; nimiurn ejl quod intelligitur. Hoc dixiffefatis
ejl, in atatern injirmam & injuria obnoyiam nernini débet
nimiurn licere.......... un de caufas turpium faclorunt
fiepe extitijfe utinam falfo jaclaretur. Quint, inft. I. ƒ.
ce. ij. & iij.
Cette obfervation de Qintilien ne peut être aujourd’hui
d’aucun ufage parmi nous.
# On ne peut rien ajoûter à l’attention que les principaux
des collèges apportent dans le choix des maîtres
auxquels ils confient i’inftruôion des jeunes
gens, & les châtimens dont parle Quintilien ne font
prefque plus en ufage. Voye^ C o l lè g e . ( F )
C lasse , f. f. (Marine.) On entend en France par
ce mot, l’ordre établi fur les côtes & dans les provinces
maritimes, pour régler le fervice des matelots
& autres gens de mer qui font enrollés pour le
fervice du R o i, & diftribues par parties, chacune
defquelles s’appelle clajfe. L’ordonnance de Louis
XIV. pour les armées navales, de 1689, regle tout
ce qui concerne les clajfes, & le détail fuivant en eft
extrait.
II y a un enrollement général fait dans les provinces
maritimes du royaume, des maîtres, pilotes,
contre-maîtres, canonniers, charpentiers, officiers-
mariniers , matelots, & autres gens de mer,
Les provinces font divifées en divers départe-
mens, en chacun defquels il y a un commiffaire qui
tient le rôle des officiers mariniers, matelots, &
gens de mer.
Les officiers mariniers & matelots font divifés par
clajfes , fa voir dans les provinces de Guienne, Bretagne,
Normandie, Picardie & pays conquis, en
quatre clajfes : & dans les provinces de Poitou, Sain-
tonge, pays d’Aunis, îles de Ré & d’Oleron, riviere j
de Charante, Languedoc & Provence, en trois claf-
fes ; ce qui forme fept clajfes,
Chaque clajfe doit fervir alternativement de trois
ou quatre années l’une, fuivant la divifion qui en
aura été faite, & le fervice commencera au prenuer
Janvier de chacune année. Les officiers mariniers &
matelots doivent toujours porter fur eux les bulletins
qui leur font délivrés par les commiffaires.
Il eft défendu aux matelots de s’engager pour aucune
navigation, à moins qu’ils n’ayent été enrô-
les, & n ayent retiré leur bulletin. Défenfe aux capitaines
& maîtres de navires de les employer, à
peine de 500 liv. d’amende pour la première fois,
& peine corporelle pour la fécondé.
Ceux des clajfes qui ne font point dans leur année
de fervice , peuvent s’engager avec les marchands
& les navigateurs particuliers ; mais il eft défendu
aux, maîtres de navires d’engager aucun matelot
l’année de fbn fervice, ni pour aucun voyage long
qui puiffe empêcher leur retour pour ce tems. Et
pour cet effet, le rôle de leur équipage, où l’année
de la clajfe de fervice de chaque matelot fera marquée,
doit être vifé par le commiffaire ou commis
aux clajfes établi en chaque département. (Z)
CLASSIQUE, adj. ( Gramm. ) Ce mot ne fe dit
que des auteurs que l’on explique dans les collèges ;
les mots & les façons de parler de ces auteurs fervent
de modèle aux jeunes gens. On donne particulièrement
ce nom aux auteurs qui ont vécu du tems
de la république, & ceux qui ont été contemporains
ou prefque contemporains d’Augufte ; tels font Té-
rence,Céfar, Cornélius Népos, Cicéron, Sallu-
fte, Virgile, Horace, Phedre, Tite-Live, Ovide ,
Valere Maxime, Velleius Paterculus, Quinte-Cur-
ce, Juvénal, Martial, & Frontin ; auxquels on ajoûte
Corneille Tacite, qui vivoit dans le fécond fiecle,
aufli-bien que Pline le jeune, Florus, Suétone &
Juftin.
Mais en latin l’adjeâif clafficus n’a pas la même
valeur ou acception qu’il a en françois.
i°. Clafficus fe dit de ce qui concerne les flottes
ou années navales, comme dans ce vers de Properce
:
Aut canerem Siculoe clajfica bella fuga.
L. II. Eleg. I. v. z8.
Clajfica corona, la couronne navale qui fe donnoit
à ceux qui avoient remporté la viôoire dans un
combat naval. Clajfici, dans Quinte-Curce, 4. 3 .
18. fignifie les matelots.
i°. Clajfici cives étoient les citoyens de la première
claffe ; car il faut obferver que le roi Servius avoit
partagé tous les citoyens romains en cinq claffes.
Ceux qui, félon l’évaluation qu’on en fait, avoient
mille deux cents cinquante livres de revenu, au
moins, ou qui en avoient davantage ; ceux-là, dis-
je , étoient appellés clajfiques. Clajfici dicebanturprima
tantum clajfis homines, qui centum & viginti quin-
que millia aris, amplius-ve, cenfi eraru. Aul. Gell. y. '
‘ 3 ’ Clajfici tejles, fe difoit des témoins irréprochables,
pris de, quelque claffç de citoyens. Clajfici tef
tes , dit Feftus, dicebantur qui fignandis tejlamentis ad-
hibebantur. Et Scaliger ajoûte : qui enim cives romani
erant, omnino in aliqua clajje cenfebantur ; qui non
habebant claffem, nec cives romani erant.
Tome I I I ,
,/ ü l d e' Ià t>Ue dans Aull,gelle, ,s . g. autores
claßa n e v eu tfz s Aua Us auteurs clatäucs, dans le
tens que nous donnons parmi nous à ce mot : mais
autores clajjiu lignifie Us auteurs iu premier ordre ,
Jcyores pnmteuat* & pm/Iantifmi , tels que Cicé-
ron, Virgile, Horace, &c. (F")
P“ * da" s H dernier iens donner le nom d’au-
teurs claßiques françois, aux bons auteurs du fiecle
de Louis XIV. & de celui-ci ; mais on doit plus particulièrement
appliquer le nom de <da^ÎKe/aux auteurs
qui ont écrit tout-à-la-fois élégamment & cor-
rettement, tels que D efpréaux, Racine, &c. Il fe -
roit à fouhaiter, comme le remarque M. de Voltaire
que 1 Académie françoife donnât une édition cor’
refte des auteurs clajfiques avec des remarques de
Grammaire.
CLATHROISDASTRUM, f. n. (Hiß. nat. Bot J
genre de plante différent du clathroides, non-feulement
parce que fon enveloppe eft très-peu apparente
& a peu de confiftance, mais encore parce que
la tige le trayerfe dans toute fa longueur de bas en-
haut. Micheli, nova pl. gen. Fovez P l a n t f ( 1\
C L A TH R O ID E sVm . ( 4 n « ) genre
de plante dont les individus font ronds ou en for-
me de poire, avant qu’ils fortent de leur envelop-
pe ; mais dès qu’ils en font dehors, ils deviennent
elliptiques. Le elathroides n’eft pas creux comme le
clathrus , mais il eft compofé d’un tiflu fort fin &c
dilpofe en forme de filet. Ce tiffu renferme dans les
elpaces vuides des tas de femences rondes & feches.
Micheli, nova pi. gen. Foyer Pla n t e ( I l
m W ” ■ { W **r. B o > f genre de
plante dont les mdividns font de figure arrondie on
en forme de poire creufe comme une bourfe, & ’ou-
vert en plufieurs endroits comme une grille. Avant
que le clathrus forte de fon enveloppe, il fe forme
dans fon intérieur une malle compofée en partie d’u-
ne forte de glu fort pure, & en partie d’une matière
grue lemblable à de la farine, un peu détrempée &
fortement battue. Cette maffe contient des femences
tres-petites, & dès que le clathrus fiart de fon enveloppe
& s’épanouit, elle fe réfout en une liqueur
tort puante, qui découle goutte à goutte. Micheli
nov. pl. gen. Foyt{ PLANTE, (ƒ)
C L A T IR , v. n. (Claffe) U exprime le cri du
chien, torique cet animal le redouble, & fomble
avertir le chafleur que le gibier qu’il preffe à la pi-
lte n elt pas éloigné. r
* ^ f' f' { fjy ,hoL) étoit, félon quelquesuns,
la déeffe des grilles & des ferrures ; elle avoir
à Rome un temple en commun avec Apollon fur le
mont Quirinal. Clatra n’étoit, félon d’autres qu’un
furnom d’Ifis. *
CLAVAGE, f. m. (Jurifprud, ) étoit un droit que
payoïent ceux cpi entroient en prifon. II en eft parlé
dans les privilèges accordés par Charles VI. à la
ville de Figeât, au mois d’Août 1394. art. 4(3. Solvant
duodecim denarios pro clavagio. Rec. des ordonnances
de la troijieme race, tome VII.p. 6'G8. (A )
CLAVAIRE, f. m. (Jurifprud.) nom que l'on donnoit
anciennement à celui qui avoit la garde des clés
d’une ville, ou du thréfor, ou du chartrier. Ce t o f ficier
avoit en quelques endroits une jurifdiûion.
Voyc[ le recueil des ordonnances de la troijieme race '
tome VII. p. Cyg. & Chifi. de Dauphiné, par Valb<£
nay- ( -0
CLAVARIA ,.f. f. (Hiß. nat. Bot.)genre déplanté
charnue, qui n’a point de rameaux, & qui reflem-
ble à une maflue. Il eft affez rare d’en trouver qui
foient creufes. La furface extérieure eft unie & par-
femée de petites femences. Micheli, nov. pl. gtn
Voye^ Plante. ( I j
* CLAVARIUM, ( Hiß. anc. ) don en argent que
les empereurs faifbient diftribuer aux foldats pour
S s s ij