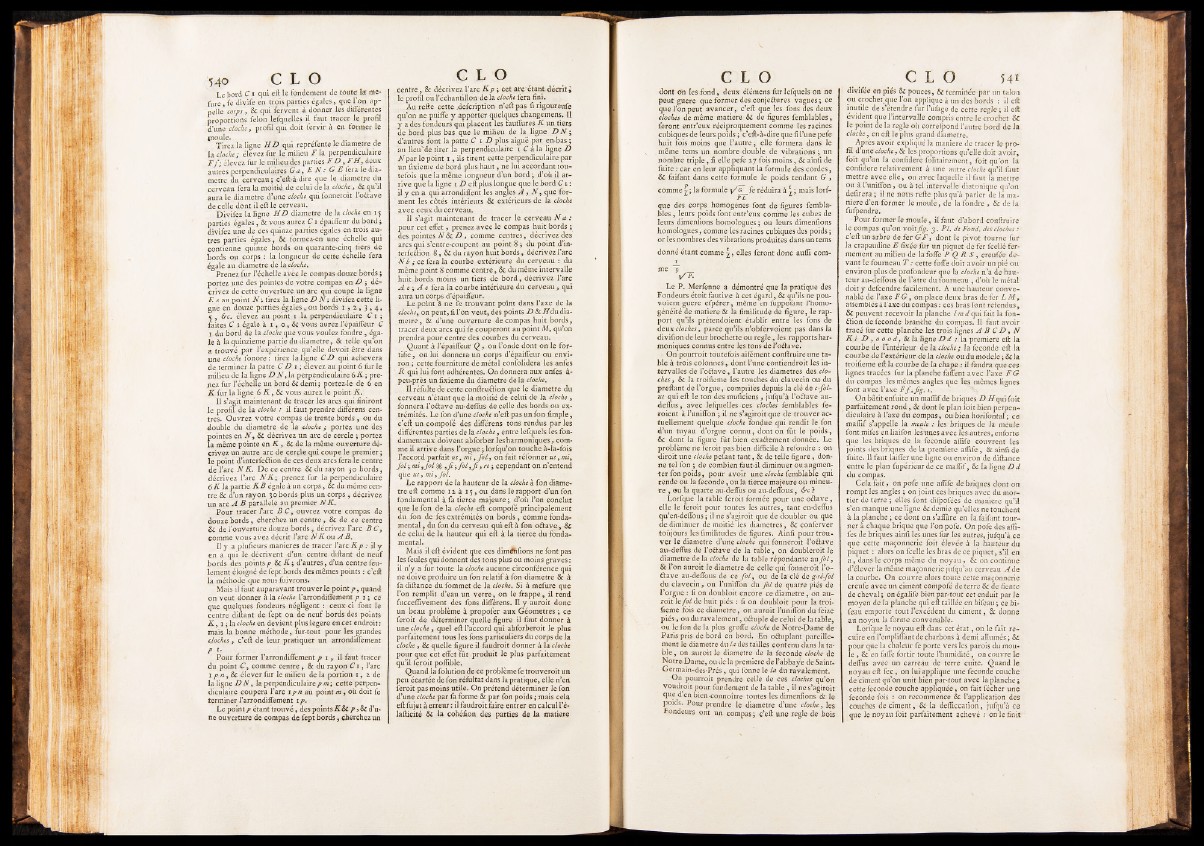
l l ' - f e
ïü H ik i É f i i l
Le bord C i qui eft le fondement de toute lac me-
fure, fe divife en trois parties égales, que l’on appelle
corps, 8c qui fervent à donner les différentes'
proportions félon lefquelles il faut tracer le profil
d’une cloche, profil qui doit fervir à en former le
moule. > « ’i- ' ; ^
Tirez la ligne H D qui repréfente le diamètre de
la cloche ; élevez fur le milieu F la perpendiculaire
F f ; élevez fur le milieu des parties F D , F H , deux
autres perpendiculaires G a , E N : G E fera le diamètre
du cerveau ; ,c’eft-à-dire que le diamètre du
cerveau fera la moitié de celui de la cloche, & qu’il
aura le diamètre d’une cloche qui fonneroit l’ottave
de celle dont il eft le cerveau.
Divifez la ligne H D diamètre de la cloche en 1 5
parties égales, & vous aurez C 1 épaiffeur du bord ;
divifez une de ces. quinze parties égales en trois autres
parties égales, 8c formez-en une échelle qui
contienne quinze bords ou quarante-cinq tiers de
bords ou corps : la longueur de cette échelle fera
égale au diamètre de la cloche,.
Prenez fur l’échelle avec le compas douze.bords ;
portez une des pointes de votre compas en D ; décrivez
de cette ouverture, un arc qui coupe la ligne
E e au point N ; tirez la ligne D N ; divifez cette ligne
en douze parties égales,rou bords 1 , 2 , 3 , 4 ,
5 , &c. élevez au point 1 la. perpendiculaire C i ;
faites C 1 égale à 1 , o , 8c vous aurez l’épaiffeur C
1 du bord de la cloche que vous voulez fondre, égale
à la quinzième partie du diamètre, & telle qu’on
a trouvé par l’expérience qu’elle devoit être dans
une cloche fonore : tirez la ligne C D qui achèvera
de terminer la patte C D 1 ; elevez au point 6 fur le
milieu de la ligne D AT, la perpendiculaire 6 K ; prenez
fur l’échelle un bord 8c demi ; portez-le de 6 en
K fur la ligne 6 K , 8 c vous aurez le point K.
Il s’agit maintenant de tracer les arcs qui finiront
le profil de la cloche : il faut, prendre différens centres.
Ouvrez votre compas de trente bords, ou du
double du diamètre de la cloche ; portez une des
pointes en N , 8c décrivez un arc de cercle ; portez
la même pointe en K , 8c de la même ouverture décrivez
un autre arc de cercle qui coupe le premier ;
le point d’interfe&ion de ces deux arcs fera le centre
de l’arc N K. De ce centre & du rayon 30 bords,
décrivez l’arc N K ; prenez fur la perpendiculaire
6 K la partie K B égale à un corps, & du même centre
8c d’un rayon 30 bords plus un corps , décrivez
un arc A B parallèle au premier N K .
Pour tracer l’arc B C , ouvrez votre compas de
douze bords, cherchez un centre, 8c de ce centre
& de l’ouverture douze bords, décrivezTare B C ,
comme vous avez décrit l’arc N K ou A B.
Il y a plufieurs maniérés de tracer l’arc K p : il y
en a qui le décrivent d’un centre diftant de neuf
bords des pointsp 8c K ; d’autres, d’un centre feulement
éloigné de fept bords des mêmes points : c’eft
la méthode que nous fuivrons.
Mais il faut auparavant trouver le point p , quand
on veut donner à la cloche l’arrondiffement p 1 ; ce
que quelques fondeurs négligent : ceux ci font le
centre diftant de fept ou de neuf bords des points
K , 1 ; la cloche en devient plus legere en cet endroit :
mais la bonne méthode, fur-tout pour les grandes
cloches, c’eft de leur pratiquer un arrondiffement
p i .
Pour former l’arrondiffement p 1 , il faut tracer
du point C , comme centre, & du rayon C 1 , l’arc
1 p n ,8c élever fur le milieu de la portion 1 , 2 de
la ligne D N , la perpendiculairepm; cette perpendiculaire
coupera l’arc ip n au point m , oh doit fe
terminer l’arrondiffement 1 p.
Le point p étant trouvé, des points K 8c p ,8c d’une
ouverture de compas de fept bords, cherchez un
centre, & décrivez l’arc K p ; cet arc étant décrit '9
le profil ou 1’échantillon.de la cloche fera fini.
Au refte cette .defeription n’eft pas fi rigoureufe
qu’on ne puiffe y apporter quelques changemens. 11
y a des fondeurs qui placent les fauffures K un tiers
de bord plus bas que le milieu de la ligne D N ;
d’autres font la patte C 1 D plus aiguë par en-bas;
au lieuvde tirer la perpendiculaire 1 C à la ligne D
N par le point 1 , ils tirent cette perpendiculaire par
un fixieme de bord plus haut, ne lui accordant toutefois
que la même longueur d’un bord ; d’où il arrive
que la ligne 1D eft plus longue que le bord C 1 :
il y en a qui arrondiffent les angles A , N , que forment
les côtés intérieurs 8c extérieurs de la cloche
avec ceux du cerveau.
Il s’agit maintenant de tracer le cerveau N a :
pour cet effet, prenez avec le compas huit bords ;
des pointes N8c D , comme centres, décrivez des
arcs qui s’entre-coupent au point 8 ; du point d’in-
terfeûion 8 , 8c du rayon huit bords, décrivez l’arc
N b ; ce fera la courbe extérieure du cerveau : du
même point 8 comme centre, 8c du même intervalle
huit bords moins un tiers de bord, décrivez l’arc
A e ; A e fera la courbe intérieure du cerveau , qui
aura un corps d’épaiffeur.
Le point 8 ne fe trouvant point dans l’axe de la
cloche,, on peut, fi l’on veut, des points D & H du diamètre,
& d’une ouverture de compas huit bords.,
tracer deux arcs qui fe couperont au point M, qu’on
prendra pour centre des courbes du cerveau.
Quant à l ’épaiffeur Q , ou l’onde dont on le fortifie
, on lui donnera un corps d’épaiffeur ou environ
; cette fourniture de métal confolidera les anfes
' R qui lui font adhérentes. On donnera aux anfes à-
peu-près un fixieme du diamètre de la cloche.
Il réfulte de cette conftruâion que le diamètre du
cerveau n’étant que la moitié de celui de la cloche ,
fonnera l’oâa-ve au-deffus de celle des bords ou extrémités.
Le fon d’une cloche n’eft pas un fon fimple ,
c’eft un compofé des différens tons rendus par les
différentes parties de la cloche, entre lefquels les fondamentaux
doivent abforbèr les harmoniques, comme
il arrive dans l’orgue ; lorfqu’on touche à-la-fois
l’accord parfait ut, m i, fo l, on fait réfonner ut, mi,
fo l ; mi ,fo l % ,Jî; fo l, f i , re ; cependant on n’entend
qüe ut, m i, Jol.
Le rapport de la hauteur de la cloche à fon diamètre
eft comme 12 à 1 5 , ou dans le rapport d’un fon
fondamental à fa tierce majeure; d’où l’on conclut
que le fon de la cloche eft compofé principalement
du fon de fesextrémités ou bords, comme fondamental
, du fon du cerveau qui eft à fon oêtave-, 8c
de celui de la hauteur qui eft à la tierce du fondamental.
Mais il eft évident que ces diméhfîons ne font pas
les feules qui donnent des tons plus ou moins graves :
il n’y a fur toute la cloche aucune circonférence qui
ne doive produire un fon relatif à fon diamètre & à
fa diftance du fommet de la cloche. Si à mefure que
l’on remplit d’eau un verre, on le frappe, il rend
fucceffivement des fons différens. Il y auroit donc
un beau problème à propofer aux Géomètres ; ce
feroit de déterminer quelle figure il faut donner à
une cloche , quel eft l’accord qui abforberoit le plus
parfaitement tous les fons particuliers du corps de la
cloche, 8c quelle figure il faudroit donner à la cloche
pour que cet effet fût produit le plus parfaitement
qu’il feroit poflible.
Quand la folution de ce problème fe trouveroit un
peu écartée de fon réfultat dans la pratique, elle n’en
leroit pas moins utile. On prétend déterminer le fon
d’une cloche par fa forme & par fon poids ; mais cela
eft fujet à erreur : il faudroit faire entrer en calcul l’é-
lafticité 8c la cohéfion des parties de la matière
dont on les fond, deux élémens fur lefquels on ne
peut guère que former des conjectures vagues ; ce
que l’on peut avancer, c’eft que les fons des deux
cloches de même matière 8c de figures femblables,
feront entr’eux réciproquement comme les racines
cubiques de leurs poids ; c’eft-à-dire que fi l’une pefe
huit fois moins que l’autre; elle formera dans le
même tems un nombre double de vibrations ; un
nombre triple, fi elle pefe 27 fois moins, 8c ainfi de
fuite : car en leur appliquant la formule des cordes,
8c faifant dans cette formule le poids tendant G ,
comme 7 ; la formule 1/G fe réduira à \ ; mais lorf-
• Fl l
que des corps homogènes font de figures femblables
, leurs poids font entr’eux comme les cubes de
leurs dimenfions homologues ; ou leurs dimenfions
homologues, comme les racines cubiques des poids ;
or les nombres des vibrations produites dans un tems
donné étant comme \ » elles feront donc aufli comme
__ \fp.
Le P. Merfenne a démontré que la pratique des
Fondeurs étoit fautive à cet égard, & qu’ils ne pou-
voient guere efpérer, même en fuppofant l’homogénéité
de matière & la fimilitude de figure, le rapport
qu’ils prétendoient établir entre les fons de
deux cloches,. parce qu’ils n’obfervoient pas dans la
divifion de leur brochette ou réglé, les rapports harmoniques
connus entre les tons de l’oCtave.
On pourroit toutefois aifément conftruire une table
à trois colonnes ,, dont l’une contiendroit les intervalles
de l’o â a v e , l’autre les diamètres des,c/o-
ches, 8c la troifieme les touches du clavecin ou du
preftant de l’orgue, comprife.s depuis la clé de c-fol-
ut qui eft le ton des muficiens , jufqu’à l’oâa-ve au-
deffus, avec lefquelles ces cloches femblables fe-
roient à l’uniffon ;'il ne s’agiroit que de trouver actuellement
quelque cloche fondue qui rendît le fon
d’un tuyau d’orgue connu, dont on fût le poids,
& dont la figure fût bien exactement donnée. Le
problème ne leroit pas bien difficile à refoudre : on
diroit une cloche pefant tant, & de telle figure, donne
tel fon ; de combien faut-il diminuer ou augmenter
fon poids, pour avoir une cloche femblable qui
rende ou la fécondé, ou la tierce majeure ou mineure
, ou la quarte aù-deffus ou au-deffous, &c }
. Lorfque la table feroit formée pour une oClave,
elle le leroit pour toutes les autres, tant en-deffus
qu’en-deffous ; il ne s’àgiroit que de doubler ou que
de diminuer de moitié les diamètres, 8c conferver
toûjours les fimilitudes de figures. Ainfi pour trouver
le diamètre d’une cloche qui fonneroit l’oCtave
au-deffus de l’o&ave de la table, on doubleroit le
diamètre de la cloche de la table répondante au fo l,
8c l’on auroit le diamètre de celle qui fonneroit l’o-
ftave au-deffous de ce fo l, ou de la clé de g-réfol
du clavecin, ou l’uniffon du fol de quatre piés de
l’orgue : fi on doubloit encore ce diamètre, on auroit
le fol de huit piés : fi on doubloit pour la troifieme
fois ce diamètre, on auroit l’uniffon du feize
piés, ou du ravalement, oCluple de celui de la table,
ou le fon de la plus greffe cloche de Notre-Dame de
Paris pris de bord en bord. En oâuplant pareillement
le diamètre du la des tailles contenu dans la table
, on auroit le diamètre de la fécondé cloche de
Notre-Dame, ou de la première de l’abbaye de Saint-
Germain-des-Prés, qui fonne le la du ravalement.
On pourroit prendre celle de ces cloches qu’on
voudroit pour fondement de la table , il ne s’agiroit
que d’en bien-connoître toutes les dimenfions de le
poids. Pour prendre le diamètre d’une cloche, les
Fondeurs ont un compas ; c’eft une réglé de bois
divifée en piés 8c pouces, & terminée par un talon
ou crochet.que l’on applique à un des bords : il eft
inutile de s’étendre fur l’ufage de cette réglé ; il eft
évident que l’intervalle compris entre le crochet 8c
le point de la réglé où correfpond l’autre bord de la
cloche, en eft le plus grand diamètre.
Après avoir expliqué la maniéré de tracer le profil
d une cloche, & les proportions qu’elle doit avoir,
foit qu’on la confidere folitairement, foit qu’on la
confidere relativement à une autre cloche qu’il faut
mettre avec elle, ou avec laquelle il faut la mettre
ou à l’uniffon, Ou à t e l in te r v a l le diatonique qu’on
defirera ; il ne nous refte plus qu’à parler de la maniéré
d’en former le moule, de la fondre, 8c de la
fufpendre.
Pour former le moulé, il faut d’abord conftruire
le compas qu’on voitfig. 3. PI. de Fond, des cloches
c’eft un arbre de fer G F , dont le pivot tourne fur
la crapaudine E fixée fur un piquet de fer fcellé fermement
au milieu de la foffe P Q R S , creufée devant
le fourneau T : cette foffe doit avoir un pié ou
environ plus de profondeur que la cloche n’a de hauteur
au-deffous de l’atre du fourneau , d’où le métal
doit y defeendre facilement. A une hauteur convenable
de l’axe F G , on place deux bras de fer L M ,
affemblés à l’axe du compas : ces bras font refendus,
8c peuvent recevoir la planche Lmdqui fait la fonction
de fécondé branche du compas. Il faut avoir
tracé fur cette planche les trois lignes A B C D , N
K i D , 0 o o d , & la.ligne D d : la première eft la
courbe de l’intérieur de la cloche ; la fécondé eft la
courbe de l’extérieur de la cloche ou du modèle ; & la
troifieme eft la courbe de la chape : il faudra que ces
lignes tracées fur la planche faffent avec Taxe F G
du compas les mêmes angles que les mêmes lignes
font avec l’axe F f i fig. /.
On bâtit enfuite un maffif de briques D i f qui foit
parfaitement rond, & dont le plan foit bien perpendiculaire
à l’axe du compas, ou bien horifontal ; ce
maffif s’appelle la meule : les briques de la meule
font mifes en liaifon les ïmes avec les autres, enforte
que les briques de la fécondé affife couvrent les
joints des briques de la première affife, & ainfi de
fuite. Il faut laiffer une ligne ou environ de diftance
entre le plan fupérieur de ce maffif, 8c la ligne D d
du compas.
Cela fait, on pofe une affife de briques dont on
rompt les, angles ; on joint ces briques avec du mortier
de terre ; elles font difpofées de maniéré qu’il
s’en manque une ligne 8c demie qu’elles ne touchent
à la planche ; ce dont on s’aflure en la faifant tourner
à chaque brique que l’on pofe. On pofe des affi-
fes de briques ainfi les unes fur les autres, jufqu’à ce
que cette maçonnerie foit élevée à la hauteur du
piquet : alors on fcelle les bras de ce piquet, s’il en
a , dans le corps même du noyau , 8c on continue
d’élever la même maçonnerie jufqu’au cerveau A de
la courbe. On couvre alors toute cette maçonnerie
creufe avec un ciment compofé de terre 8c de Rente
de cheval ; on égalife bien par-tout cet enduit par le
moyen de la planche qui eft taillée en bifeau ; ce bi-
feau emporte tout l’excédent du ciment, & donne
au noyau la forme convenable.
Lorfque le noyau eft dans cet é ta t, on le fait recuire
en l’empliffant de charbons à demi allumés; 8c
pour que'la chaleur fe porte vers les parois du moul
e , & en faffe fortir toute l’humidité, on couvre le
deffus avec un carreau de terre cuite. Quand le
noyau eft fe c , on lui applique une fécondé couche
de ciment qu’on unit bien par-tout avec la planche ;
cette fécondé couche appliquée, on fait fécher une
fécondé fois : on recommence 8c l’application des
couches de ciment, 8c la defficcation, jufqu’à ce
que le noyau foit parfaitement achevé : on le finit