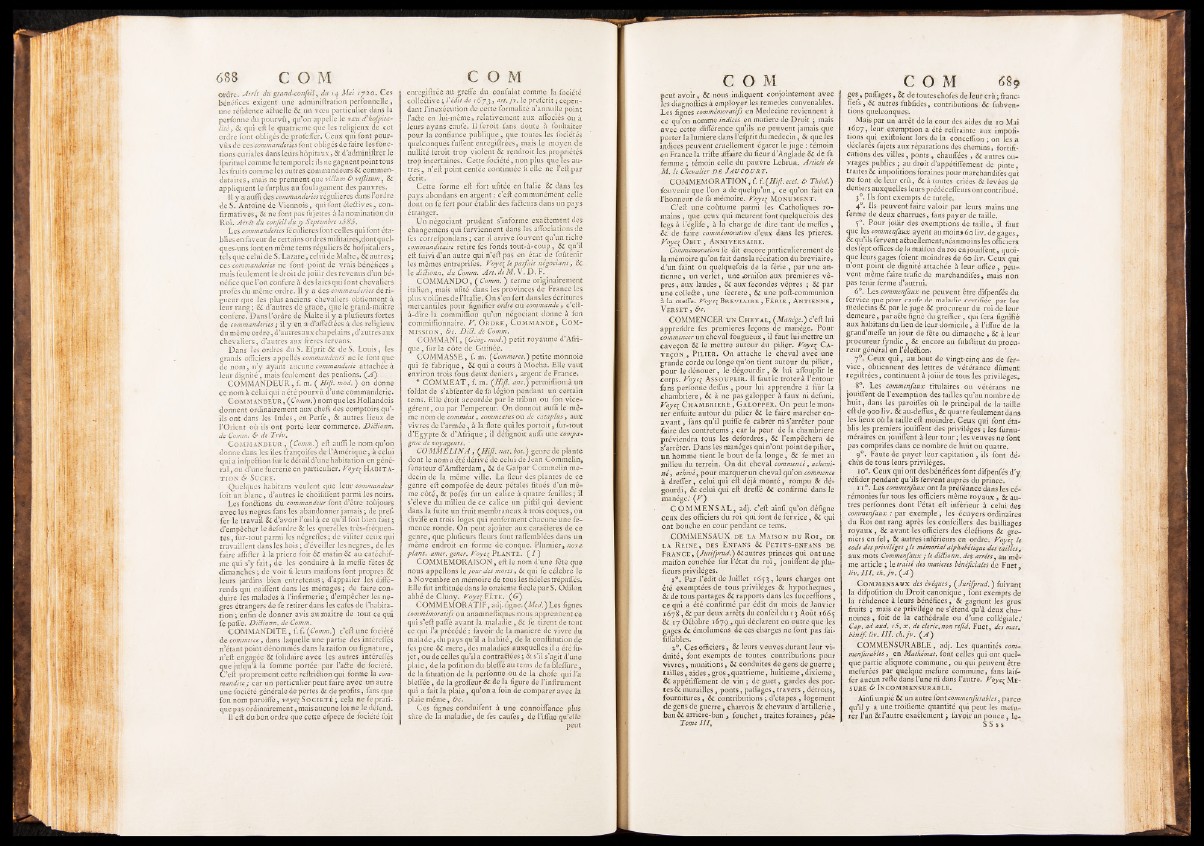
ordre. Arrêt du grand-confeil, du /4 Mal 1710. Ces
bénéfices exigent une adminiftratîon perfonnelle ,
une réfidence a&uelle & un voeu particulier dans la
perfonne du pourvu, qu’on appelle le voeu d'hofpita-
litè, & qui eft le quatrième que les religieux de cet
ordre font obligés de profeflèr. Ceux qui font pour-
vûs de ces commanderies font obligés de faire les fonctions
curiales dans leurs hôpitaux, & d’adminiftrer le
fpirituel comme le temporel : ils ne gagnent point tous
les fruits comme les autres commandeurs 8c commen-.
dataires, mais ne prennent que victum & vefiitum, 8c
appliquent le furplus au foulagepient des pauvres.
Il y a aufli des'communderi.es régulières dans l’ordre
de S. Antoine de Viennois, qui font éleftives, confirmatives,
& ne font pas fujettes à la nomination du
Roi. Arrêt du eonfeil du 9 Septembre t585.
Les commanderies féculieres font celles qui font établies
en faveur de certains ordres militaires,dont quelques
uns font en même tems réguliers 8c hofpitaliers,
tels que celui de S. Lazare, celui de Malte, 8c autres';
ces commanderies ne font point de vrais bénéfices ,
mais feulement le droit de joiiir des revenus d’un bénéfice
que l’on conféré à des laïcs qui font chevaliers
profès du même ordre. Il y a des commanderies de rigueur
que les plus anciens chevaliers obtiennent à
leur rang ; 8c d’autres de grâce, que le grand-maître
conféré. Dans l’ordre de Malte il y a plufieurs fortes
de commanderies ; il y en a d’affe&ées à des religieux
du même ordre, d’autres aux chapelains, d’autres aux
chevaliers, d’autres aux freres fervans.
Dans les ordres du S. Efprit 8c de S. Louis, les
grands officiers appelles commandeurs ne le font que
de nom, n’y ayant aucune commanderie attachée à
leur dignité, mais feulement des penfions. ( A )
COMMANDEUR, f. m. ( Hifi. mod. ) on donne
ce nom à celui qui a été pourvu d’une commanderie.
C ommandeur , (Comm.) nom que les Hollandois
donnent ordinairement aux chefs des comptoirs qu’ils
ont dans les Indes, en Perfe, & autres lieux de
l ’Orient 011 ils ont porté leur commerce. Diclionn.
de Comm. & de Trév.
Commandeur , (Comm.') eft aufli le nom qu’on
donne dans les îles françoifes de l’Amérique, à celui
qui a infpe&ion fur le détail d’une habitation en général
, ou d’une fucrérie en particulier. Voyeç Habitation
& Sucre.
Quelques habitans veulent que leur commandeur
foit un blanc, d’autres le choififfent parmi les noirs.
Les fondions du commandeur font d’être toujours
avec les negres fans les abandonner jamais; de pref-
fer le travail & d’avoir l’oeil à ce qu’il foit bien fait ;
d’empêcher le defordre & les querelles très-fréquentes
, fur-tout parmi les négreffes ; de vifiter ceux qui
travaillent dans les bois ; d’éveiller les negres, de les
faire aflifter à la priere foir 8c matin 8c au catéchif-
me qui s’y fait, de les conduire à la mefle fêtes 8c
dimanches ; de voir fi leurs maifons font propres 8c
leurs jardins bien entretenus ; d’appaifer les différends
qui naiffent dans les ménages ; de faire conduire
les malades à l’infirmerie ; d’empêcher les negres
étrangers de fe retirer dans les cafés de l’habitation
; enfin de donner avis au maître de tout ce qui
fe paffe. Diclionn. de Comm.
COMMANDITE, f. f. (Comm.) c’eft une fociété
de commerce, dans laquelle une partie des intéreffés
n’étant point dénommés dans la raifon ou fignature,
n’eft engagée 8c folidaire avec les autres intéreffés
que jufqu’à la fomme portée par l’afte de fociété.
C ’eft proprement cette reftriftion qui forme la commandite;
car un particulier peut faire avec un autre
une fociété générale de pertes & de profits, fans que
fon nom paroifle, voye{Société ; cela ne fe pratique
pas ordinairement, mais aucune loi ne le défend.
Il eft du bon ordre que cette efpece de fociété foit
enregiftrée au greffe du confulat comme la fociété
colle&ive -, l’édit de 1673, art.jv. le prelcrit ; cependant
l’inexécution de cette formalité n’annulle point
l’afte en lui-même, relativement aux affociés ou à
leurs ayans caufe. Il feroit. fans doute à fôuhaiter
pour la confiance publique, que toutes les fociétés
quelconques, fuffent enregiftrées, mais le moyen de
nullité feroit trop violent 8c rendroit les propriétés
trop incertaines. Cette fociété, non plus que les autres
, n’eft point cenfée continuée fi elle ne l’eft par'
écrit.
Cette forme eft fort ufitée en Italie 8c dans les
pays abondans en argent : c’eft communément celle
dont on fe fert pour établir des fafteurs dans un pays
étranger.
Un négociant prudent s’informe exactement des
changemens qui furviennent dans les afTociatjpns de
fes correfpondans ; car il arrive fouvent qu’un riche
commanditaire retire fes fonds tout-à-coup, 8c qu’il
eft fuivi d’un autre qui n’eft pas en état de foutenir
les mêmes entreprifes. Voyelle parfait négociant, 8c
le ditlionn. du Comm. Art. de M. V. D . F.
COMMANDO, ( Comm. ) terme originairement
italien , mais ufité dans les provinces de France lés
plus voifmes de l’Italie. On s’en fert dans les écritures
mercantiles pour fignifier ordre ou commande, c’eft-
à-dire la commiflion qu’un négociant donne à fon
commiflionnairé. V. Ordre, C ommande, C ommission,
&c. Dict. de Comm.
COMMANI, (Géog. mod.) petit royaume d’Afriq
u e , fur la côte de Guinée. ,
COMMASSE, f. m. (1Commerce.) petite monnoie
qui fe fabrique, 8c qui a cours à Mocha. Elle vaut
environ trois fous deux deniers, argent de France.
* COM MEAT , f. m. (Hifi. anc.) permiflion,à un
folclat de s’abfenter de fa légion pendant un certain
tems. Elle étoit accordée par le tribun ou fon vice-
gérent, ou par l’empereur. On donnoit aufli le-même
nom de comméat9 commeatus ou de catàplus, aux
vivres de l’armée, à la flote qui les portoit, fur-tout
d ’Egypte & d’Afrique ; il défignoit aufli une compagnie
de voyageurs. *
COMMELINA, (Hifi. nat. bot.) genre de plante
dont le nom a été dérivé de celui de Jean Commelin,
fénateur d’Amfterdam, 8c de G afpar Commelin médecin
de la même ville. La fleur des plantes de ce
genre eft compofée de deux pétales fitués d’un même
côté, & pofés fur un calice à quatre feuilles; il
s’élève du milieu de ce calice un piftil qui devient
dans la fuite un fruit membraneux à trois coques, ou
divifé en trois loges qui renferment chacune une fe-
mence ronde. On peut ajoûter aux caraâeres de ce
genre, que plufieurs fleurs font raflemblées dans un
même endroit en forme de conque. Plumier, nova
plant, amer, gener. Voye%_ Plante. ( I )
COMMEMORAISON, eft le nom d’une fête que
nous appelions le jour des morts, & qui fe célébré le
1 Novembre en mémoire de tous les fideles trépafles.
Elle fut inftituée dans le onzième fiecle par S . Odilon
abbé de Cluny. Voye^ Fête. (G)
COMMEMORATIF, adj.figne. (Med.) Les lignes
commémoratifs ou ariamneftiques nous apprennent ce
qui s’eft pafl'é avant la maladie , & fe tirent de tout
ce qui l’a précédé : favoir de la maniéré de vivre du
malade, du pays qu’il a habité, de la conftitution de
fes pere 8c mere, des maladies auxquelles il a été fu-
je t , ou de celles qu’il a contractées ; & s’il s’agit d’une
p laie , de la pofition du blefle au tems de fa bleflure,
de la fituation de la perfonne ou de la chofe qui l ’a
bleflee, de la groffeur 8c de la figure de l’inftrument
qui a fait la plaie, qu’on a foin de comparer avec la
plaie même, &c.
Ces fignes conduifent à une connoiflance plus
sûre de la maladie, de fes c aufes, de l’iffne qu’elle
peut
C O M
peut avoir, 8c nous indiquent conjointement avec
les diagnoftics à employer les remedes convenables.
Les fignes commémoratifs en Medecine reviennent à
ce qu’on nomme indices en matière de Droit ; mais
avec cette différence qu’ils ne peuvent jamais que
porter la lumière dans l’efprit du médecin, & que les
indices peuvent cruellement égarer le juge : témoin
en France la trifte affaire du fieur d’Anglade 8c de fa
femme ; témoin celle du pauvre Lebrun. A r tic le de
M . le Chevalier D E JA U C O U R T .
COMMEMORATION, f. f . (Hifi.eccl. & Théôl.)
fouvenir que l’on a de quelqu’un, ce qu’on fait en.
l’honneur de fa mémoire. Voye^ Mo num ent.
C ’eft une coutume parmi les Catholiques romains
, que ceux qui meurent font quelquefois des
legs à l’églife, à la charge de dire tant demeffes ,
8c de faire commémoration d’eux dans les prières.
V o y t { Obit , A nniversaire.
Commémoration fe dit encore particulièrement de
la mémoire qu’on fait dans la récitation du bréviaire,
d’un faint ou quelquefois de la férié , par une an-
tienne, un veri'et, une ^oraifon aux premières vêpres
, aux laudes, 8c aux fécondés vêpres ; 8c par
une collette , uhe fecrete, & une poft-communion
à la meffe. Voye^ Brév iaire , Férié , A ntienne ,
V erset , &c.
COMMENCER un Cheval, (Manège.) c’eft lui
apprendre fes premières leçons de manège. Pour
commencer un cheval fougueux, il faut lui mettre un
Caveçon 8C le mettre autour du pilier. Voye%_ Ca-
Veçon^, Pilier. On attache le cheval avec une
grande corde ou longe qu’on tient autour du pilier,
pour le dénouer, le dégourdir , & lui aflbuplir le
corps. Voye^ Assouplir. Il faut le troterà l’entour
fans perfonne deffus, pour lui apprendre à fuir la
chambrière, 8C à ne pas galopper à faux ni defuni.
F b y e [ Chambrière , Galopper. On peut le monter
enfuite autour du pilier 8c le faire marcher en-
avant , fans qu’il puiffe fe cabrer ni s’arrêter pour
faire des contretems ; car la peur de la chambrière
préviendra tous les defordres, 8c l’empêchera de
s’arrêter. Dans les manèges qui n’ont point de pilier,
un homme tient le bout de la longe, & fe met au
milieu du terrein. On dit cheval commencé, achemin
é , achevé, pour marquer un cheval qu’on commence
à dreffer, celui qui eft déjà monté, rompu & dé*-
gourdi, 8c celui qui eft dreffé 8c confirmé dans le
manège.' (V )
C O M M E N S A L , adj. c’eft ainfi qu’on défigne
ceux des officiers du roi qui font de fervicè, 8c qui
ont bouche en cour pendant ce tems.
COMMENSAUX de la Maison du Roi, de
la Reine, des Enfans & Petits-enfans de
France , (Jurifprud.) & autres princes qui ont une
maifon couchée fur l ’état du ro i, jouifl'ent de plufieurs
privilèges.
i° . Par d’édit de juillet 1653, leurs charges ont
été exemptées de tous privilèges & hypotheques,
& de tous partages 8c rapports dans les fucceflîons,
ce qui a été confirmé par édit du mois de Janvier
16 78 ,8c par deux arrêts du eonfeil du 13 Août 1665
& 17 Ottobre 1679 , qui déclarent en outre que les
gages 8c émolumens de ces charges ne font pas fai-
fiflables.
i ° . Ces officiers, 8c leurs veuves durant leur viduité,
font exempts de toutes contributions pour
v ivres , munitions, 8c conduites de gens de guerre ;
tailles, aides, gros, quatrième, huitième, dixième,
ôc appétiffement de vin ; de guet, gardes des portes
8c murailles, ponts, paflages, travers , détroits,
fournitures, 8c contributions ; d’étapes , logement
de gens de guerre, charrois & chevaux d’artillerie,
ban 8c arriere-ban , fouçhet, traites foraines, péar
Tome III,
C O M 68*
g es, paffàgés, & de toutes chofes de leur crû; francs
nefs, 8c autres fubfides, contributions 8c fubyen-
lions quelconques.
Mais par un arrêt de la cour des aides du 10 Mai
1607, leur exemption a été reftrainte aux impofi-
tions qui exiftoient lors de la concefïion ; on les a
déclarés fujets aux réparations des chemins, fortifications
des villes, ponts , chauffées , 8c autres ouvrages
publics ; au droit d’appétiffement de pinte,
traites 8c impofiîions foraines pour marchandifes qui
ne font de leur cru, 8c à toutes criées & levées de
deniers auxquelles leurs prédéceffeurs ont contribué.
3°. Ils font exempts de tutele.
4°. Ils peuvent faite valoir par leurs mains une
ferme de deux charrues, fans payer de taille.
50. Pour joiiir des exemptions de taille, il faut
que les comrnenfaux ayerit au moins 60 liv. de gages,
8c qu’ils fervent afruellement;néanmoins les officiers
des fept offices de la maifon du roi en jouifl'ent, quoique
leurs gages foient moindres de 60 liv. Ceux qui
n’ont point de dignité attachée à leur office , peu-,
vent même faire trafic de marchandifes, mais non
pas tenir ferme d’autrui.
6°. Les comrnenfaux ne peuvent être difpenfés du
fervice que pour caufe de maladie certifiée par les
médecins & par le juge 8c procureur du roi de leur
demeure, par afre figné du greffier, qui fera fignïfié
aux habitans du lieu de leur domicile, à l’iffue de la
grand’meffe un jour de fête ou dimanche , & à leur
procureur fyndic, & encore au fubftitut du procureur
général en l’éleôion»
7?, Ceux qui, au bout de vingt-cinq ans de fer-
vice , obtiennent des lettres de vétérance dûment
regiftrées, continuent à joiiir de tous les privilèges»
8°. Les comrnenfaux titulaires ou vétérans ne
jouifl'ent de l’exemption des tailles qu’au nombre de
huit, dans les paroifles oit le principal de la taille
eft de 900 liv. & au-deffus, & quatre feulement dans
les lieux où la taille eft moindre. Ceux qui font établis
les premiers jouifl'ent des privilèges ; les furnu-
méraires en jouifl'ent à leur tour ; les veuves ne font
pas comprifes dans ce nombre de huit ou quatre.
90. Faute de payer leur capitation , ils font déduis
de tous leurs privilèges.
io°. Ceux qui ont des bénéfices font difpenfés d’y
réfider pendant qu’ils fervent auprès du prince.
1 i p. Les comrnenfaux ont la préféanCe dans les cérémonies
fur tous les officiers même ro yau x, & autres
perfonnes dont l’état eft inférieur à celui' des
comrnenfaux : par exemple, les écuyers Ordinaires
du Roi ont rang après les confeillers des bailliages
royaux , 8c avant les officiers des éle&ions 8c greniers
en fe l, & autres inférieurs en ordre. Hoye^ le
code des privilèges ; le mémorial alphabétique des tailles
aux mots Comrnenfaux ; le diclionn. des arrêts, au même
article ; le traité des matières bénéficiâtes de Fuet,
liv. I I I . ch. jv . (A )
Commensaux des évêques, (Jurifprud.) fuivant
la difpofition du Droit canonique, font exempts de
la réfidence à leurs bénéfices, & gagnent les gros,
fruits ; mais ce privilège ne s’étend qu’à deux chanoines
, foit de la cathédrale ou d’une collégiale*
Cap. ad aud. iS. x . de cleric.non refid. Fuet, des mat,
bénéf. liv. III. ch.jv. (A )
COMMENSURABLE, adj. Les quantités tom-
mtnfurables , en Mathémat. font celles qui ont quelque
partie aliquote commune, ou qui peuvent être
mefurées par quelque mefure commune, fans laif-
fer aucun refte dans l’une ni dans l’autre. Voyez Mesure
6* Incommensurable.
Ainfi unpié & un autre font commenfurables, parce
qu’il y a une troifieme quantité qui peut les mefu-
rer l’un & l’autre exactement ; lavoir un pouce, fe*
S S s s