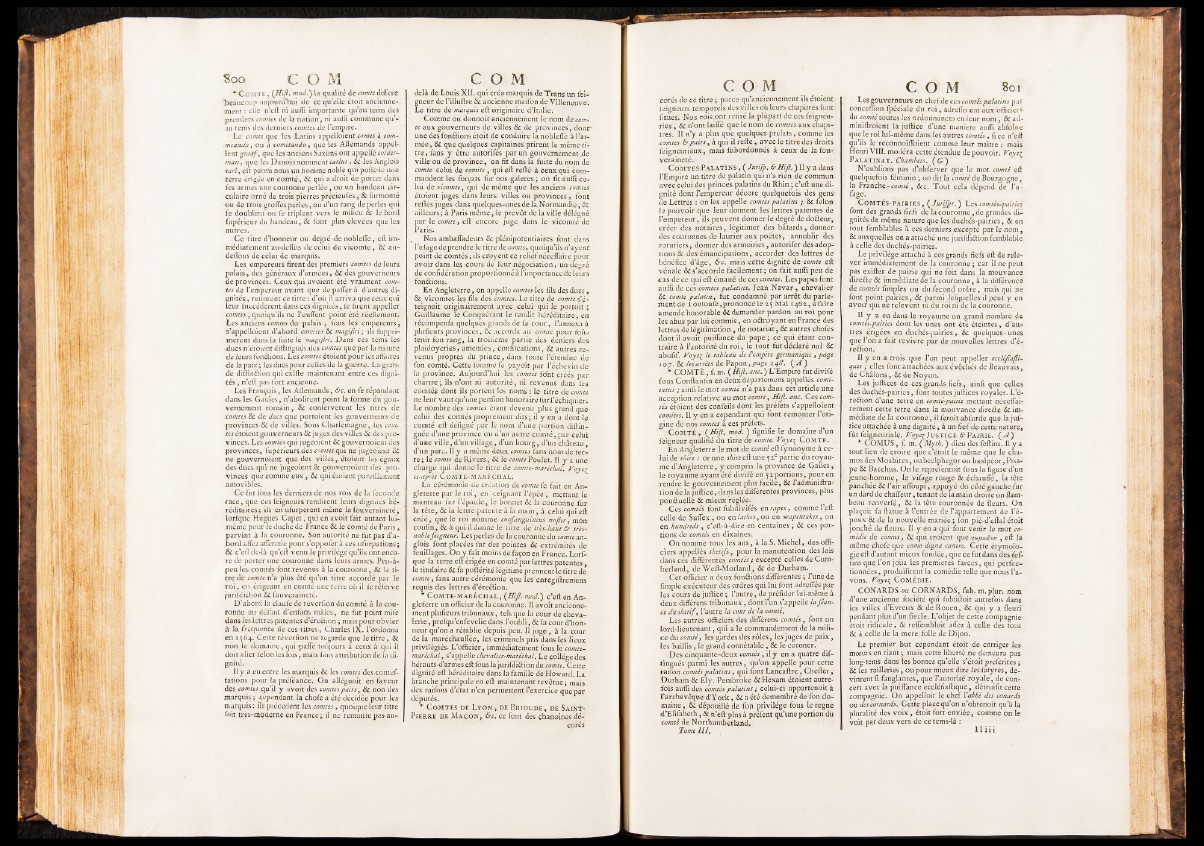
♦ C o m t e , (Hift. mod.) la qualité die comte différé
"beaucoup aujourd’hui de ce qu’elle étoit anciennement
: elle u’ eft ni aufli importante qu’au tems des
premiers comtes de la nation, ni aufli commune qu’au
tems des derniers comtes de l’empire. ■
Le comte que les Latins appelaient cornes à com-
meando, ou à comitando, que les Allemands appellent
graàf, que les anciens Saxons ont appelle eoldtr-
tnan, que les Danois nomment earlus, 6c les Anglois
tari, eft parmi nous un homme noble qui poffede une
terre érigée en comté, 6c qui a droit de porter dans
Les armes une couronne perlée, ou un bandeau circulaire
orné de trois pierres précieufes, & furmonté
ou de trois groffes perles, ou d’un rang de perles qui
fe doublent ou fe triplent vers le milieu 6c le bord
fupérieur du,bandeau, &c font plus élevées que les
autres.
Ce titre d’honneur ou degré de nobleffe, eft immédiatement
au-deffus de celui de vicomte, &c au-
deffous de celui de marquis.
Les empereurs firent des premiers comtes de leurs
palais, des généraux d’armées, 6c des gouverneurs
de provinces. Ceux qui avoient été vraiment comtes
de l’empereur avant que de paffer à d’autres dignités
, retinrent ce titre : d’où il arriva que ceux qui
leur fuccéderent dans ces dignités, fe firent appeller
comtes, quoiqu’ils ne l’euffent point été réellement.
Les anciens comtes du palais , fous les empereurs ,
s’appelloient d’abord comités 6c magifiri; ils fuppri-
merent dans la fuite le magifiri. Dans ces tems les
ducs n’étoient diftingués des comtes que par la nature
de leurs fondions. Les comtes étoient pour les affaires
de la paix ; les ducs pour celles de la guerre. La grande
diftinûion qui exifte maintenant entre ces digni-,
t é s , n’eft pas fort ancienne.
Les François, les Allemands, &c. en fe répandant
dans les Gaules, n’abolirent point la forme du gouvernement
romain, 6c conferverent les titres de
'comtes 6c de ducs que portoient les gouverneurs'de
provinces 6c de villes. Sous Charlemagne, les comtes
étoient gouverneurs 6c juges des villes 6c des provinces.
Les comtes qui jugeoient 6c gouvernoient des
provinces, fupérieurs des comtes qui ne jugeoient 6c
ne gouvernoient que des villes, étoient les égaux
des ducs qui ne jugeoient & gouvernoient des provinces
que comme eux, 6c qui étoient pareillement
amovibles.
Ce fut fous les derniers de nos rois de la fécondé
race, que ces feigneurs rendirent leurs dignités héréditaires
; ils en ufurperent même la fouveraineté,
lorfque Hugues Capet, qui en avoit fait autant lui-
même pour le duché de France & le comté de Paris,
parvint à la couronne. Son autorité ne fut pas d’abord
affez affermie pour s’oppoler à ces ufurpations;
& c’elt de-là qu’eff venu le privilège qu’ils ont encore
de porter une couronne dans leurs armes. Peu-à-
peu les comtés font revenus à la couronne, 6c le titre
de comte n’a plus été qu’un titre accordé par le
r o i , en érigeant en comté une terre où il fe réferve
jurifdiéhon 6c fouveraineté.
D ’abord la claufe de réverfion du comté à la couronne
au défaut d’enfans mâles, ne fut point mife
dans les lettres patentes d’éreétion ; mais pour obvier
à la fréquence de ces titres, Charles IX. l’ordonna
en 1 564. Cette réverfion ne regarde que le titre, &
non le domaine, qui palfe toujours à ceux à qui il
doit aller félon les lois, mais fans attribution de la dignité.
Il y a eu entre les marquis 6c les comtes des contef-
tations pour la préféance. On alléguoit en faveur
des comtes qu’il y avoit des comtes pairs, 6c non des
marquis ; cependant la chofe a été décidée pour les
marquis : ils précèdent les comtes , quoique leur titre
foit très-iqoderne en France ; il ne remonte pas audelà
de Louis XII. qui créa marquis de Trans un feigneur
de l’illuftre & ancienne maifon de Villeneuve.
Le titre de marquis eil originaire d’Italie.
Comme on donnoit anciennement le nom de comte
aux gouverneurs de villes 6c de provinces, dont*“
une des fondions étoit de conduire la nobleffe à l ’armée,
& que quelques capitaines prirent le même titre,
fans y être autorifés par un gouvernement de
ville ou de province, on fit dans la fuite du nom de
comte celui de comité, qui eft refté à ceux qui commandent
les forçats fur nos galeres ; on fit aufli celui
de vicomte, qui de meme que les anciens comtes
étoient juges dans leurs villes ou provinces, font
reftés juges dans quelques-unes de la Normandie, 6c
ailleurs ; à Paris même, le prévôt de la ville délégué
par le comte, eft encore juge dans le vicomté de
Paris.
. Nos ambaffadeurs 6c plénipotentiaires font dans
l’ufage de prendre le titre de comte, quoiqu’ils n’ay enfc
point de comtés ; ils cuoyent ce relief néceffaire pour
avoir dans les cours de leur négociation, un degré
de confidération proportionné à l’importance de leurs
fondions.
En Angleterre, on appelle comtes les fils des ducs,
6c vicomtes les fils des comtes. Le titre de comte s’é-
teignoit originairement avec celui qui le portoit ;
Guillaume le Conquérant le rendit héréditaire, en
récompenfa quelques grands de fa cour, l’annexa à
plufieurs provinces, 6c accorda au comte pour foû-
tenir fon rang, la troifieme partie des deniers des
plaidoyeries , amendes, confifcations, 6c autres revenus
propres du prince, dans toute l’étendue de
fon comté. Cette fomme fe payôit par l’échevin de
la province. Aujourd’hui les comtes foht créés par
chartre; ils n’ont ni autorité, ni revenus dans les
comtés dont ils portent les noms : le titre de comte
ne leur vaut qu’une penfion honoraire fur l’échiquier.
Le nombre des comtes étant devenu plus grand que
celui des comtés proprement dits ; il y en a dont le
comté eft défigné par le nom d’une portion diftin-
guée d’une province ou d’un autre comté, par celui
d’une v ille , d’un village, d’un bourg, d’un château,
d’un parc. Il y a même deux comtes tans nom de terre
; le comte de Rivers, 6c le comte Poulet. II y a une
charge qui donne le titre de comte-maréchal. Voyez
ci-après COMTE-MARÉCHAL.
La cérémonie de création de comte fe fait en Angleterre
par le ro i, en ceignant l’épée, mettant le
manteau fur l’épaule, le bonnet 6c la couronne fur
la tête, 6c la lettre patente a la main, à celui qui eft
créé, que le roi nomme confanguineus no fier, mon
coufin, 6c à qui il donne le titre de très-haut 6- très-
noble feigneur. Les perles de la couronne du comte anglois
font placées fur des pointes 6c extrémités de
feuillages. On y fait moins de façon en France. Lorfque
la terre eft érigée en comté par lettres patentes,
le titulaire 6c fa poftérité légitime prennent le titre de
comte, fans autre cérémonie que les enregiftremens
requis des lettres d’éreûion.
* C omte-marechal , (Hift. mod.) c’eft en Angleterre
un officier de la couronne. Il avoit anciennement
plufieurs tribunaux, tels que la cour de chevalerie
, prefqu’enfe velie dans l’oubli, 6c la cour d’honneur
qu’on a rétablie depuis peu. Il juge, à la cour
de la maréchauffée, les criminels pris dans les lieux
privilégiés. L’officier, immédiatement fous le comte-
maréchal, s’appelle chevalier-maréchal. Le collège des
hérauts-d’armes eft fous la jurifdiûion du comte. Cette
dignité eft héréditaire dans la famille de Howard. La
branche principale en eft maintenant revêtue ; mais
des raifons d’état n’en permettent l’exercice que par
députés.
* Comtes de Lyon , de Brioude, de Saint-
Pierre de Maçon, &c. ce font des chanoines décorés
corés de ce titre ; parce qu’anciennement ils étoient J
feigneurs temporels des villes Où leurs chapitres font ;
fitués. Nos rois ont retiré la plupart de ces feigneu-
rie s , 6c n’ont laiffé que le nom de comtes aux chapitres.
Il n’y a plus que quelques prélats, comme les
comtes & pairs 9 à qui il refte, avec le titre des droits
feigneuriaux, mais fubordonnés à ceux de la fouveraineté.'
C omtes Palatins , ( Jurifp.& Hifi. ) II y a dans
l’Empire un titre de palatin qui n’a rien de commun
avec celui des princes palatins du Rhin ; c’eft une dignité
dont l’empereur décore quelquefois des gens;
de Lettres : on les appelle comtes palatins ; 6c félon
le pouvoir que leur donnent les lettres patentes de
l’empereur, ils peuvent donner le degré de dofteur,
créer des notaires, légitimer des bâtards, donner
des couronnes de laurier aux poètes, annoblir des
roturiers, donner des armoiries, autorifer des adop- •
tions & des émancipations, accorder des lettres de
bénéfice d’âge, &c. mais cette dignité de comte eft
vénale & s’accorde facilement ; on fait aufli peu de
cas dé ce qui eft émané de ces comtes. Les papes font
aufli de ces comtes palatins. Jean N av ar , chevalier
6c comte palatin, fut condamné par arrêt du parlement
de Touloufe ,prononcé le 15 Mai 146z, à faire
amende honorable 6c demander pardon au roi pour
les abus par lui commis, en oâroyant en France des
lettres de légitimation, de notariat, 6c autres chofes
dont il avoit puiffance du pape ; ce qui étant contraire
à l’autorité du roi, le tout fut déclaré nul &
abufif. Voyei le tableau de P empire germanique , page
1 o j . 6c les arrêts de Papon, page 2.48. ( A )
* COM TÉ , f. m. ( Hifi.anc. ) L’Empire fut divifé
fous Conftantin en deux départemens appelles comi-
tatus ; ainfi le mot comté n’a pas dans cet article une
acception relative au mot comte, Hift. anc. Ces comtés
étoient des confeils dont les préfets s’appelloient
comités. Il y en a cependant qui font remonter l’origine
de nos comtes à ces préfets.
C omté ; {Hift. mod. ) fignifie le domaine d’un
feigneur qualifié du titre de comte. Voyeç Comte.
En Angleterre le mot de comté eft fynonyme à celui
d e s aire : or une shire eft une 5 i e partie du royaume
d’Angleterre, y compris la province de Galles,
le royaume ayant été divifé en 52 portions, pour en
rendre le gouvernement plus facile, 6c l ’adminiftra-
tion delà juftice, dans les différentes provinces, plus
ponétuelle & mieux réglée.
Ces comtés font fubdivifés en râpes, comme l’eft
celle de Suffex , ou en lathes,ou en wapentakes, ou
en hundreds , c’eft-à-dire en centaines ; 6c ces portions
de comtés en dixaines.
On nomme tous les ans, à la S. Michel, des officiers
appelles shérifs, pour la manutention des lois
dans ces différentes comtés ; excepté celles de Cumberland,
de Weft-Morland, 6c de Durham.
Cet officier a deux fondions différentes ; l’une de
fimple exécuteur des ordres qui lui font adreffés par
les cours dé juftice ; l’autre, de préfider lui-même à
deux différens tribunaux ,• dont l’un s’appelle laféan-
ce du shérif, l’autre la cour de la comté.
Les autres officiers des différens comtés, font un
lord-lieutenant, qui a le commandement de la milice
du comté, les gardes des rôles, les juges de paix,
les baillis, le grand connétable, 6c le coroner.
Des cinquante-deux comtés, il y en a quatre distingués
parmi les autres, qu’on appelle pour cette
raifon comtés palatins, qui font Lancaftre, Chefter,
Durham 6c Ely. Pembroke 6c Hexam étoient autrefois
aufli des comtés palatins ; celui-ci appartenoit à
l’archevêque d’Y o rk , & a été démembré de fon domaine
, 6c dépouillé de fon privilège fous le regne
d’Elifabeth, & n’eft plus à préfent qu’une portion du
comté de Northumberland.
Tome I I I , ,
Les gouverneurs en chef de ces comtés palatins par
conceffion fpéciale du ro i, adreffo ent aux officiers
du comté toutes les ordonnances en leur nom, & ad-
miniftroient la juftice d’une maniéré aufli abfolue
que le roi lui-même dans les autres comtés , fi ce n’eft
qu’ils le reconnoiffoient comme leur maître : mais
Henri VIII. modéra cette étendue de pouvoir. Voye{
P a l a t i n a t . Çhafnbers. { G )
N’oublions pas d’obferver que le mot comté eft
quelquefois féminin ; on dit là comté de Bourgogne,
la Franche - comté, &c. Tout cela dépend de l’u-
fage. ■
C o m t e s - p a i r i e s , ( Jurifpr. ) Les comtés-pairies
font des grands fiefs de la couronne, de grandes dignités
de même nature que les duchés-pairies, & en
tout femblables à ces derniers excepté par le nom,
6c auxquelles on a attaché une jurifdiétion femblable
à celle des duchés-pairies.
Le privilège attaché à ces grands fiefs eft de relever
immédiatement de la couronne ; car il ne peut
pas exifter de pairie qui ne foit dans la mouvance
direéle 6c immédiate de la couronne, à la différence
de comtés fimples ou du fécond ordre, mais qui ne
font point pairies, 6c parmi iefquelles il peut y en
avoir qui ne relevent ni dû roi ni de la couronne.
Il y a eu dans le royaume un grand nombre de
comtes-pairies dont les unes ont été éteintes, d ’autres
érigées en .duchés-pairies , 6c quelques - unes
que l’on a fait revivre par de nouvelles lettres d’é-r
reéfion.
Il y en a trois que l’on peut appeller eccléfiafti-
ques ; elles font attachées aux évêchés de Beauvais,
de Châlons, 6c de Noyon.
Les juftices de ces grands fiefs, ainfi que celles
des duchés-pairies, font toutes juftices royales. L’éT
reftion. d’une terre en çorpté-pqirie mettant nécpffai-
rement cette terre dans la mouvance direéle 6c immédiate
de la couronne, il feroit afifurde que la juftice
attachée à une dignité, à un fief de cette nature,
fût feigneuriale. Voye^ J u s t i c e & P a i r i e . ( A )
* COfvlUS, f. m. ( Myth. ) dieu des feftins. Il y a
tout lieu de croire que c’éfoit le même que le çha-
mos des Moabites, ou beelphegor ou baalpéor, Pria-
pe 6c Bacchus. On le repréfentoit fous la figure d’un
jeune-homme, le vifiage rouge & échauffe, la tête
panchée & l’air aflbupi,,appuyé du côté gauche fur
un dard de chaffeur, tenant de ta main droite un flambeau
renverfé, 6c la tête couronnée de fleurs. On
plaçoit fa ftatue à l’entrée de l’appartement de l’époux
6c de la nouvelle mariée ; lo/i pié-d’eftal étoit
jonché de fleurs. Il y en a qui font venir le mot comédie
dé cornus, 6c qui croient que au/JwS'tiv, eft la
même chofe que como digna cancre. Cette étymologie
eft d’autant mieux fondée, que ce fut dans des feftins
que l’on joiia les premières farces, qui perfectionnées
, produifirent la comédie telle que nous l’avons.
f^oye{ C o m é d i e .
CONARDS ou CORNARDS, fub. m. plur. nom
d’une ancienne fociété qui fubfiftoit autrefois dans
les villes d’Evreux & de Rouen, 6c qui y a fleuri
pendant plus d’un fiecle. L’objet de cette compagnie
étoit ridicule, & reffembloit affez à celle des fous '
6c à celle de la mere folle de Dijon.
Le premier but cependant étoit de corriger les
moeurs en riant ; mais cette liberté ne demçura pas
long-tems dans les bornes qu’elle s’étoit preferites ;
& les railleries, ou pour mieux dire les fatyres, devinrent
fi fanglantes, que l’autorité royale, de concert
avec la puiffance eccléfiaftique, détruifit cette
compagnie. On appelloif le chef l’abbé des conards
ou des cornards. Cette place qu’on n’obtenoit qu’à la
pluralité des v o ix , étoit fort enviée, comme on le
voit par deux vers de ce tems-là :
I l i i i