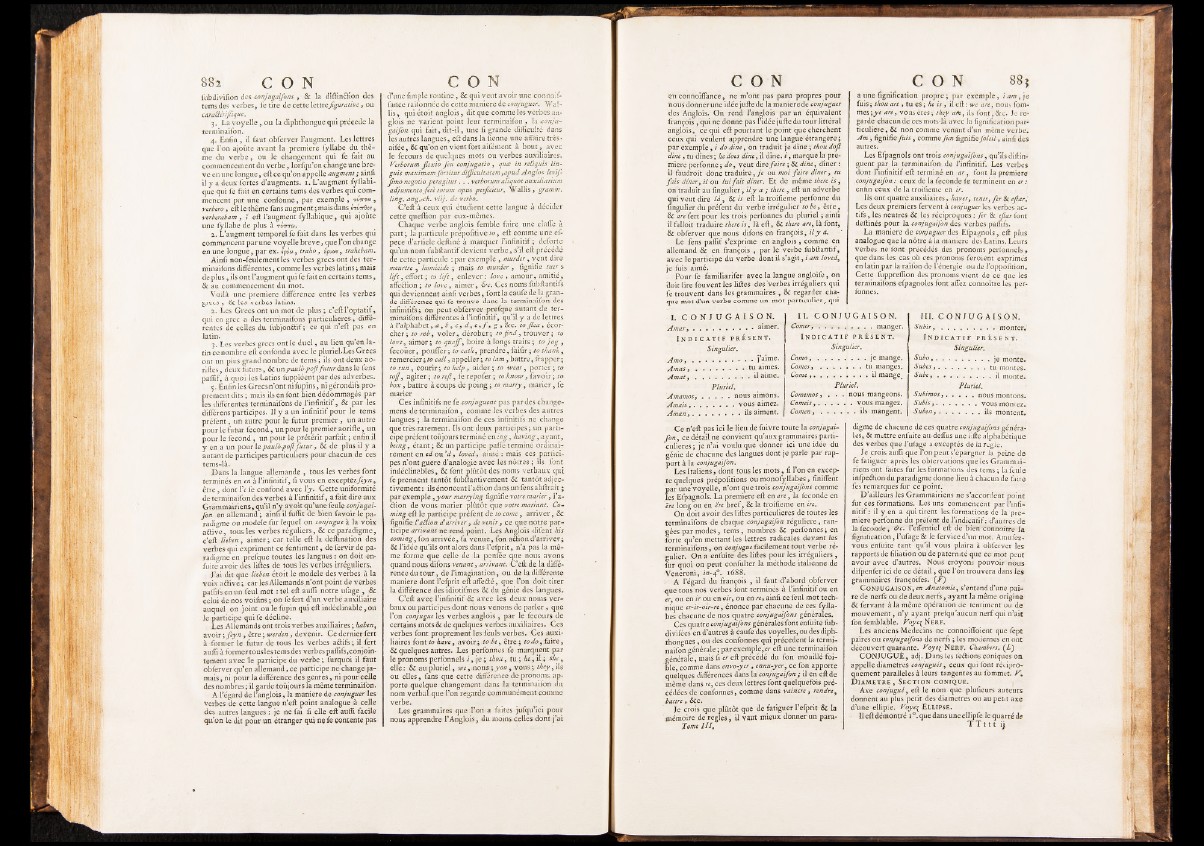
fubdivifion des conjugaifons , & la diftinâion des
temsdes verbes, fetire de cette \kt\xefigurative , ou
caraclérifiique.
3. La v o y e lle , ou la dlphthongue qui précédé la
terminaifon.
4. Enfin , il faut obferver l’augment. Les lettres
que l’on ajoute avant la première fyllabe du thème
du v erb e, ou le changement qui fe fait au
commencement du verbe, lorfqu’on change une brèv
e en une longue, eft ce qu’on appelle augment; ainfi
il y a deux fortes d’augments. 1. L’augment fyllabi-
que qui fe fait en certains tems des verbes qui commencent
par une confonne, par exemple , tutti-» ,
verbero, eft le thème fans augment ; mais danstrvwdov,
verberabam , î eft l’augment fyllabique, qui ajoûte
une fyllabe de plus à tÛttt».
z. L’augment temporel fe fait dans les verbes qui
commencent par une voyelle breve, que l’on change
en une longue, par ex. »pu», traho, »pvuv, trahebam.
Ainfi non-feulement les verbes grecs ont des ter-
minaifons différentes, comme les verbes latins ; mais
de plus, ils ont l’augment qui fe fait en certains tems,
& au commencement du mot.
Voilà une première différence entre les verbes
grecs , & les verbes latins.
z. Les Grecs ont un mot de plus ; c’eft l’optatif,
qui en grec a des terminaifons particulières, différentes
de celles du fubjon&if ; ce qui n’eft pas en
latin. . t
3. Les verbes grecs ont le du el, au lieu qu en latin
ce nombre eft confondu avec le pluriel.Les Grecs
ont un plus grand nombre de tems ; ils ont deux ao-
riftes, deux futurs, & un paulb-poft futur dans le fens
paflif, à quoi les Latins fuppléent par des adverbes.
5. Enfin les Grecs n’ont nifupins, ni gérondifs proprement
dits ; mais ils en font bien dédommagés par
les différentes terminaifons de l’infinitif, & par les
différensparticipes. Il y a un infinitif pour le tems
prélent, un autre pour le futur premier , un autre
pour le futur fécond, un pour le premier aorifte, un
pour le fécond , un pour le prétérit parfait ; enfin il
y en a un pour le paulb-pojl futur, &c de plus il y a
autant de participes particuliers pour chacun de ces
tems-là.
Dans la langue allemande , tous les verbes font
terminés en en à l’infinitif, fi vous en exceptezfeyn,
être, dont Ve fe confond avec l’y . Cette uniformité
de terminaifon des verbes à l’infinitif, a fait dire aux
Grammairiens, qu’il n’y avoit qu’une feule conjugai-
fon en allemand ; ainfi il fufiit de bien favoir le paradigme
ou modèle fur lequel on conjugue à la voix
a&ive, tous les verbes réguliers, & ce pafadigme,
c’eft lieben, aimer ; car telle eft la deftination des
verbes qui expriment ce fentiment, de fervir de paradigme
en prefque toutes les langues : on doit en-
fuite avoir des liftes de tous les verbes irréguliers.
J’ai dit que lieben étoit le modèle des verbes à la
voix a&ive ; car les Allemands n’ont point de verbes
palfifs en un feul mot : tel eft aulfi notre ufage , &
celui de nos voifins ; on fe fert d’un verbe auxiliaire
auquel on joint ou le fupin qui eft indéclinable, ou
le participe qui fe décline.
Les Allemands ont trois verbes auxiliaires ; haben,
avoir ; fty n » être j werden, devenir. Ce dernier fert
à former le futur de tous les verbes aûifs ; il fert
aulfi à former tousles tems des verbes palfifs,conjointement
avec 'le participe du verbe ; furquoi il faut
obferver qu’ en allemand, ce participe ne change jamais
, ni pour la différence des genres, ni pour celle
des nombres ; il garde toûjours la même terminaifon.
A l’égard de l’anglois, la maniéré de conjuguer les
Verbes de cette langue n’eft point analogue à celle
des autres langues : je ne fai fi elle eft aulfi facile
qu’on le dit pour un étranger qui ne fe contente pas
d’une fimple routine, & qui veut avoir une connoif*
farice railonnée de cette maniéré de conjuguer. "Wallis
, qui étoit anglois, dit que comme les verbes anglois.
ne varient point leur terminaifon , la ..conjugaifon
qui fa it ,d it - il, une fi grandè difficulté dans
les autres langues, eft dans la lienne une affaire très-
aifée, & qu’on en vient fort aifément à bout, avec
le fecours de quelques mots ou verbes auxiliaires.
Vtrborum ûexio Jeu conjugdtio , quee in reliquis lin-
guis maximum fortitur difficultatem ,apud Anglos levif-
Jîmo negotio peragitur. . . verborum aliquot auxiliarium
adjumento ferb totum opus perficitur. Wallis , gramm,
ling. ang.-cb. viij. de verbo.
C ’eft à ceux qui étudient cette langue à décider
cette queftion par eux-mêmes.
Chaque verbe anglois femble faire une elaffe à
part ; la particule prépofitive to, eft comme une efi
pece d’article deftiné à marquer l’infinitif ; deforte
qu’un nom fubftantif devient verbe, s’il eft précédé
de cette particule : par exemple , murder, veut dire
meurtre , homicide ; mais to murder , lignifie tuer »
lift , effort ; to lif t , enlever : love , amour, amitié,
affe&ion ; to love, aimer, &c. Ces noms fubftantifs
qui deviennent ainfi verbes, font la caufe; de la grande
différence qui fe. trouve dans la terminaifon des
infinitifs ; on peut obferver prefque autant de terminaifons
différentes à l’infinitif, qu’il y a de lettres
à l’alphabet, a , b , c , dytyf.y g , &c. to jlea , écorcher
; to robt voler, dérober; tofind, trouver; to
love, aimer ; <to ‘juaffy boire à longs traits ; to jog ,
fecoiier, pouffer.; 10 cath, prendre, faifir ; to thank ,
remercier; to call, appeller ; to lam, battre, frapper ;
to run, courir; to help , aider ; to wear, porter ; to
tofj, agiter ; to rejl, fe repofer ; to know, favoir ; to
box, battre à coups de poing ; to marry, marier, fe
marier
Ces infinitifs ne fe conjuguent pas par des change-
mens de terminaifon, comme les verbes des autres
langues ; la terminaifon de ces infinitifs né change
que très-rarement. Ils ont deux participes;; un participe
préfent toûjours terminé en ing9 having, ayant,
being , étant ; & un participe paffé terminé ordinai-,
rement en ed ou fd , loved., aimé : mais ces participes
n’ont guere d’analogie avec les nôtres ; ils font
indéclinables, & font plutôt des noms verbaux qui
fe prennent tantôt fubftantivement & tantôt adjec-
tivement : ils énoncent l’a&ion dans un fens abftrait ;
par exemple ,your marry ing lignifie votre marier, l’a-
clion de vous marier plutôt que votre mariant. Corning
eft le participe préfent de to-cotne , arriver, &
lignifie Vaction d’arriver’, de venir , ce que notre participe
arrivant ne rend point. Les Anglois difent his
coming, fon arrivée, fa venue,ion adiond’arriver;
& l’idée qu’ils ont alors dans l’efprit, n’a pas la même
forme que celle de :1a penfée que nous avons
quand nous difons venant, arrivant. C ’eft de la différence
du tour, de l’imagination, ou de la différente
maniéré dont l’efprit eft affedé, que l’on doit tirer
la différence des idiotifmes & du génie des langues.
C’eft avec l’infinitif & avec les deux noms verbaux
ou participes dont nous venons de parler, que
l’on conjugue les verbes anglois , par le fecours de
certains mots & de quelques verbes auxiliaires. Ces
verbes font proprement les feuls verbes. Ces auxiliaires
font to have f avoir.; to.be, être ; todo.yfaire,
& quelques autres. Les perfonnes fe marquent par
le pronoms perfonnels i ,-je ; thon, tu ; he.t il.; she,
elle : & au pluriel, wt, mous ; y ou, vous ; they, ils
ou elles, fans que cette différence de pronoms apporte
quelque changement dans ;la terminaifon du
nom verbal,que l’on regarde communément comme
verbe.
Les grammaires que l’on a faites jufqu’ici pour
nous apprendre l’Anglois, du.moins celles dont j’ai
eu cônnoiffance, ne m’ont pas paru propres pour
nous donner une idée juftede la maniéré de conjuguer
des Anglois. On rend l’anglois par un équivalent
françois , qui ne donne pas l’idée jufte du tour littéral
anglois, ce qui eft pourtant le point que cherchent
ceux qui veulent apprendre une langue étrangère;
par exemple, i do dine, on traduit je dîne ; thou dojl
dint, tu dînes ; he dots dine, il dîne, i , marque la premiere
perfonne; do, veut dire faire ; & dine, dîner :
il faudrait donc traduire, je ou moi faire dîner, tu
fais dîner y il ou lui fait dîner. Et de même there i s ,
on traduit au fingulier, il y a ; there, eft un adverbe
qui veut dire là , & is eft la troifieme perfonne du
fingulier du préfent du verbe irrégulier to be, être,
& are fert pour les trois perfonnes du pluriel ; ainfi
il falloit traduire there is , là e ft, & there arey là font,
& obferver que nous difons en françois, il y a.
Le fens paflif s’exprime en anglois , comme en
allemand & en françois , par le verbe fubftantif,
avec le participe du verbe dont il s’agit, i am loved,
je fuis aimé.
. Pour fe familiarifer avec la langue angloife, on
'doit lire fouvent les liftes des verbes irréguliers qui
fe trouvent dans les grammaires , & regarder chaque
mot d’un verbe comme un mot particulier, qui
a une lignification propre ; par exemple, i am, je
fuis; thou art, tu es ; he i s , il eft : we are y nous fom-
mes \ye are, vous êtes ; they ate, ils font, &c. Je regarde
chacun de ces mots-là avec la lignification particulière
, & non comme venant d’un même verbe.
Am y lignifie fu is , comme fun lignifie foleil, ainfi des
autres«
Les Efpagnols ont trois conjugaifons, qu’ils diftin-
guent par la terminaifon de l’infinitif. Les verbes
dont l’infinitif eft terminé en ar, font la première
ponjugaifon ; ceux de la fécondé fe terminent en er :
enfin ceux de la troifieme en ir.
Ils ont quatre auxiliaires, haver, tener, fer & eflari
Les deux premiers fervent ï. conjuguer les verbes actifs
, les neutres & les réciproques : fer & eftar font
deftinés pour la conjugal fon des verbes palfifs.
La maniéré de conjuguer des Efpagnols, eft plus
analogue que la nôtre à la maniéré des Latins. Leurs
verbes ne font précédés des pronoms perfonnels,
que dans les cas oii ces pronoms feraient exprimés
en latin par la raifon de l’énergie ou de l’oppofition.
Cette fuppreflion des pronoms vient de ce que les
terminaifons efpagnoles font affez connoître les perfonnes.
I. C O N J U G A I S O N .
Amary ................................ aimér.
I n d i c a t i f p r é s e n t .
Singulier.
Amo y . . ......................... j âinte.
Amas y ..........................tu aimes.
Amat, . . . . . . . il aime.
Plunel.
AmamoSy . . . . . nous aimons.
Amaisy. . . . . . . vous aimez.
Aman y ......................... ils aiment.
I L C O N J U G A I S O N .
Comer y . . . . . . . . . manger.
I n d i c a t i f p r é s e n t .
Singulier.
Como y ............... ... je mange.
Cornes y . . . . . . . tu manges.
Corne y. . . .................. il mange
Pluful.
Comemos y . . . nous mangeons.
Comeis, . . . . . . vous mangez. ■
Comeny . . . . . . ils mangent.
I II. C O N J U G A I S O N .
Subir y . . .................. . monter.'
I n d i c a t i f p r é s e n t .
Singulier.
Subo y ............................ je monte.
Subes............................tu montes.'
S u b e ,............................ fi monte.
Pluriel.
Subimos, . . . nous montons.
Subis y. , . . . . . . vous montez.-
Suben3 ......................ils montent.'
Ce n’eft pas ici le lieu de fuivre toute la conjugai-
fon , ce détail ne convient qu’aux grammaires particulières
; je n’ai voulu que donner ici uné idée du
•génie de chacune des langues dont je parle par rapport
à la conjugaifon.
Les Italiens, dont tous les m ots, fi l’on en excepte
quelques prépofitions ou monofyllabes, finiffent
par une voyelle, n’ont que trois conjugaifons comme
les Efpagnols. La première eft en are, la fécondé en
ère long ou en ere bref, & la troifieme en ire.
On doit avoir des liftes particulières de toutes les
terminaifons de chaque conjugaifon régulière, rangées
par modes, tems, nombres &c perfonnes ; en
forte qu’en mettant les lettres radicales devant les
terminaifons, on conjugue facilement tout verbe régulier.
On a enfuite des liftes pour les irréguliers ,
lur quoi on peut confulter la méthode italienne de
Veneroni, i/z-40. 1688.
A l’égard du françois , il faut d’abord obferver
que tous nos verbes font terminés à l’infinitif ou en
er ou en ir ou en oir, ou en re, ainfi ce feul mot technique
er-ir-oir-re, énonce par chacune de ces fylla-
bes chacune de nos quatre conjugaifons générales.
Ces quatre conjugaifons générales font enfuite fub-
divifées en d’autres à caufe des voyelles, ou desdiph-
thongues, ou des confonnes qui précèdent la terminaifon
générale ; par exemple, er eft une terminaifon
générale, mais fi er eft précédé du fon mouillé foi-
ble comme dans envo-ytr, ennu-yer y ce fon apporte
quelques différences dans la conjugaifon ; il en eft de
même dans re, ces deux lettres font quelquefois précédées
de confonnes, comme dans vaincre y rendre y
battre , & c .
Je crois que plutôt que de fatiguer l’efprit & la
mémoire de réglés, il vaut mieux donner un para-
fome I I I ,
digme de chacune de ces quatre conjugaifons générales,
& mettre enfuite au-deffus une lifte alphabétique
des verbes que l ’ufàge a exceptés de la réglé.
Je crois aufli que l’on peut s’épargner la peine de
fe fatiguer après les obfervations que les Grammairiens
ont faites fur les formations des tems ; la feule
inlpeftion du paradigme donne lieu à chacun de faire
fes remarques fur ce point.
D ’ailleurs les Grammairiens ne s’accordent point
fur ces formations. Les uns commencent par l’infinitif
: il y en a qui tirent les formations de la première
perfonne du préfent de l’indicatif: d’autres de
la fécondé , &c. l’effentiel eft de bien 'connoîrre la
lignification, l’ufage & le fervice d’un mot. Amufez-
vous enfuite tant qu’il vous plaira à obferver les
rapports de filiation ou de paternité que ce mot peut
avoir avec d’autres. Nous croyons pouvoir nous
difpenfer ici de ce détail, que l’on trouvera dans les
grammaires françoifes. (F)
C onjugaison, en Anatomie y s’entend d’une paire
de nerfs ou de deux nerfs, ayant la même origine
& fervant à la même opération de lentiment ou de
mouvement, n’y ayant prefqu’aucun nerf qui n’ait
fon femblable. Voytç Nerf.
Les anciens Médecins ne connoiffoient que fept
paires ou conjugaifons de nerfs ; les modernes en ont
découvert quarante. Voye^ Nerf. Chambers. (L\
CONJUGUÉ, adj. Dans les ferions coniques on
appelle diamètres conjugués, ceux qui font réciproquement
parallèles à leurs tangentes au fommet. V.
D iam è t r e , Sec t io n coniq ue.
Axe conjugué y eft le nom que plufieurs auteurs
donnent au plus petit des diametres ou au petit axe
d’une ellipfe. P’oye^ Ellipse.
Il eft démontré i° . que dans une ellipfe le quarré de
T T111 iy