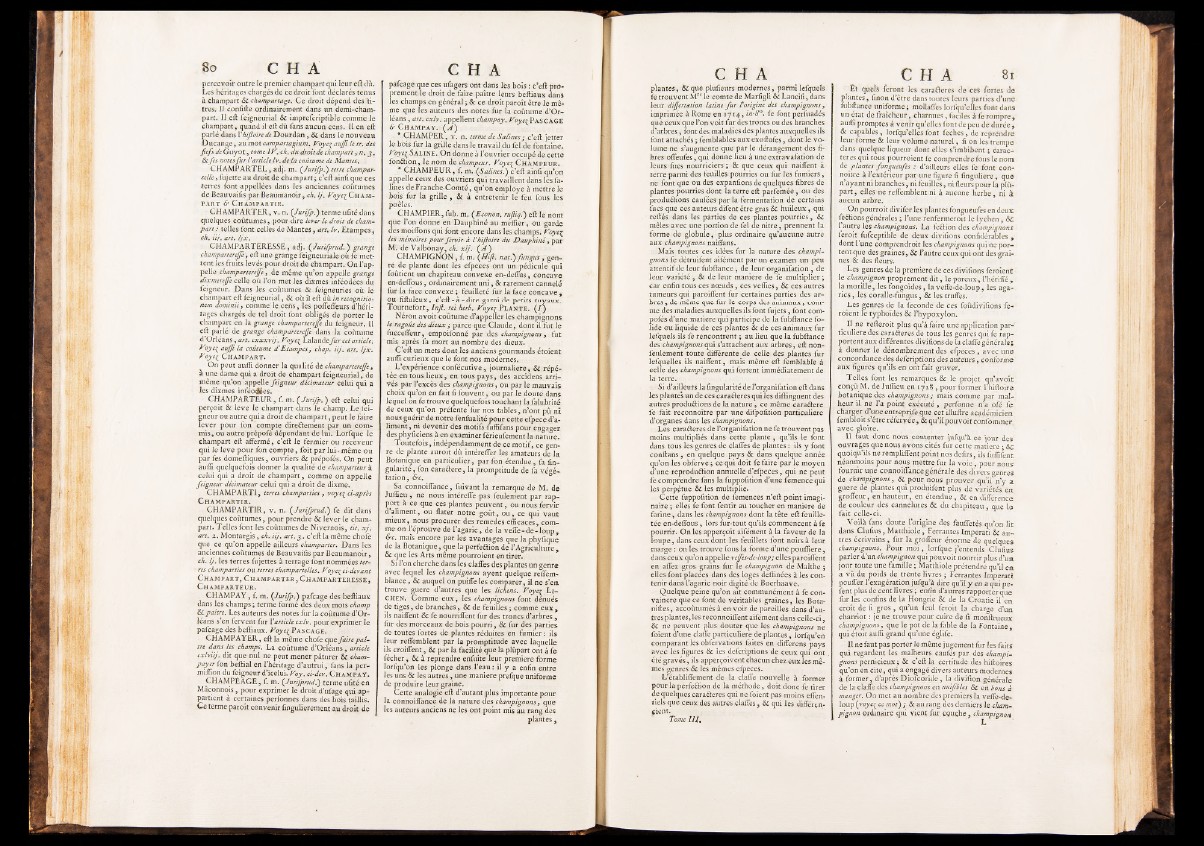
percevoir outre le premier champart qui leur eft du.
Les héritages chargés de ce droit font déclarés tenus
à champart champarcage. Ce droit dépend des t itres;
Il cpnfifte ordinairement dans un demi-cham-
part. Il eft feigneurial & imprefcriptible comme le
champart, quand il eft dû fans aucun cens. Il en eft
parlé dans l'hifioire de Dourdan, & dans le nouveau
Ducange, au mot eampartagium. Voye^ aujfiletr. des
fiefs de Guyot, tome I V. ch.dudroit de champart >n. j .
&fes notes fur l'article Iv. delà coutume de Mantes. .
CHAMPARTEL, adj. m. ( Jurifp.) terre champar-
telle ,-fu jette au droit de champart ; c’eft ainli que ces
terres font appellées dans les anciennes coûtumes
de Beauvaifis par Beaumanoir, ch. Ij. Voye? C hamp
a r t & C h âm pa r t ir .
CHAMPARTER, v. n. (Jurifp.) terme ulitédans
quelques coûtumes, pour dire lever le droit de champart
telles font celles de Mantes, art. Iv. Etampes,
ch. iij. art. Ijx. '
CHAMPARTERESSE, adj. (Jurifprud. ) grange
champartèrejji , eft une grange feigneuriale où fé mettent
les fruits levés pour droit de champart.On l’appelle
champarterejfe, de même qu’on appelle grange
dixmereffe celle où l’on met les dixmes inféodées du
feigneur. Dans les coûtumes &,feigneuries où< le
champart eft feigneurial, & où il eft dû in récognition
nem dominii, comme le cens, les poffeffeurs d’héritages
chargés de tel droit font obligés de porter le
champart en la grange champarterejje du feigneur. Il
eft parlé de grange' champdrtereffe dans la coûtume
d’Orléans, art. cxxxyij. Voye[ Lalandefur cei article.
Voye^ aujfi la coutume d'Etampes, chap. iij. art, Ijx.
Voyei C ham pa rt.
On peut aufli donner la qualité dé champarterejfe,
à une dame qui a droit de champart feigneurial, de
même qu’on appelle feigneur décimateur celui qui a
les dixmes inféodées.
CHAMPARTEUR, f. m. ( Jurifp’. ) eft celui qui
perçoit & leve le champart dans le champ. L e fe i-
gneur ou autre qui a droit de champart, peut le faire
lever pour fon compte directement par un commis
, ou autre prépofé dépendant de lui. Lorfque le
champart eft affermé, c’eft le fermier ou receveur
qui le leve pour fon compte, foit par lui - même ou
par fes domeftiques, ouvriers & prépofés. On peut
aufti quelquefois donner la qualité de champarteur à
celui qui a droit de champart, comme on appelle
feigneur décimateur celui qui a droit de dixme.
CHAMPARTI, terres champarties , voye^ ci-après
C h am p a r t ir .
CHAMPARTIR, v . n. ( Jurifprud.) fe dit dans
quelques coûtumes, pour prendre & lever le champart.
Telles font les coûtumes de Nivernois, tit. xj<
art. 2. Montargis, ch.dij. art. 3 . c’eft la même chofe
que ce qu’on appelle ailleurs champarter. Dans les
anciennes coûtumes de Beauvaifis par Beaumanoir,
ch. Ij. les terres fujettes à terrage font nommées terres
champarties ou terres champartelles. Voyt{ ci-devant
C h am pa r t , C ham pa rter, C hamparter esse,
C ham pa rteu r.
CHAMPAY, f. m. (jurifp j) pafcage des beftiaux
dans les champs ; terme formé des deux mots champ
& paître. Les auteurs des notes fur la coûtume d’Or-
leans s’en fervent fur l’article cxly. pour exprimer le i
pafcage des beftiaux. Voye^ Pas cage.
CHAMPAYER, eft la même chofe que faire paître
dans les champs. La coûtume d’Orléans, article
cxlviij. dit que nul ne peut mener pâturer & cham-
payer fon beftial en l’héritage d’autrui, fans la per-
miftion du feigneur d’icelui. Voy. ci-dev. C h am p a y .
CHAMPÉAGE, f. m. (Jurifprud.') terme ufité en
Mâconnois, pour exprimer le droit d’ufage qui appartient
à certaines perfonnes dans des bois. taillis.
Ce terme paroît convenir fingulierement au droit de
pafcage que ces ufagers ont dans lfes bois : c’eft proprement
le droit de faire paître leurs beftiaux dans
les champs en général ; & ce droit paroît être le même
que les auteurs des notes fur la coûtume d’Orléans
, art. cxlv. appellent champay, Voye? Pas CAGE
& C h am p a y . ( A )
• * CHAMPER, v . n. terme de Salines ; c’eft jetter
le bbis fur la grille dans,le travail du fel. de fontaine.
Voye^ Saline. On donne à l’ouvrier occupé de cette
fonction, le nom de champeur. Voye^ C hampeur.
* CHAMPEUR, f. m. (Salines.) c’eft ainfi qu’on
appelle ceux des ouvriers qui travaillent dans les fa-
linçs de Franche-Comté, qu’on employé à mettre le
bois fur la grille , & à entretenir le feu fous les
poêles'. "
CHAMPIER, fub. m. (Econùn. rujliqi) eft le nom
que l’on donne en Dauphiné au meflier, ou garde
des moiffons qui font encore dans les champs; Voyeç
les mémoires pour fervir-à rhifioire du Dauphiné y par
Mv de Valbonay, ch. xij. (A )
CHAMPIGNON, f. nu (Hijl. nat.) fungiCs,g en -
rë de plante dont les éfpe.ces ont un pédicule qui
foûtient un chapiteau convexe en-deffüs, concave
en-deffous, ordinairement uni, & rarement cannelé
fur la face convexe ; feuilleté fur la face concave ,
oufiftuleux, c’eft-à-T dire garni de petits tuyaux.
Tourne fort, Injl. rej he.rb, Voye^ Pla n t e , (ƒ )
Néron avoit coûtume d’appeller les champignons
le ragoût des dieux ; parce que Claude., dont il fut ie
fue.ceffeur, empoifonné par des champignons , ; fut
mis après fa mort au nombre des dieux.
C ’eft un mets dont les anciens gourmands étoient
aufli curieux que le font nos modernes.
L ’expérience confécutive, journalière, & répétée
en tous lieux, en tous pays, des accidens.arrivés
par l’excès des champignons, ou par le mauvais
choix qu’on en fait fi fouvent, ou par le doute dans
lequel on fe trouve quelquefois touchant lafalubrité
de ceux qu’on prélente fur nos tables, n’ont pû ni
nous guérir de notre fenfualité pour cette efpece d’aliment,
ni devenir des motifs fuffifans pour engager
des phyficiens à en examiner férieufement la nature.
Toutefois, indépendamment de ce m otif, ce genre
de plante auroit dû intéreffer les amateurs de la
Botanique en particulier , par Ion étendue , fa fin-
gularite, fon cara&ere, la promptitude de fa végétation,
&c.
Sa eonnoiffance, fuivant la remarque de M. de
Juflieu, ne nous intéreffe pas feulement par rapport
à ce que ces plantes peuvent, ou nous fervir
d aliment, ou Hâter notre goût, o u , ce qui vaut
mieux, nous procurer des remedes efficaces, comme
on l’éprouve de l’agaric, de la veffe-de -lou p,
&c. mais encore par les avantages que la phyfique
de la Botanique, que la perfeftion de l’Agriculture,
& que les Arts même pourroient en tirer.
Si l’on cherche dans les claffes des plantes un genre
avec lequel les champignons ayent quelque reffem-
blance, 8c auquel on puiffe les comparer, il ne s’en
trouve guere d’autres que les lichens. Voye{ h i-
chen. Comme eux, les champignons font dénués
de tiges, de branches, 8c de feuilles ; comme eux ,
ils naiffent 8c fe nourriffent fur des troncs d’arbres ,
fur des morceaux de bois pourri, 8c fur des parties
de toutes fortes de plantes réduites en fumier : ils
leur reffemblent par la promptitude avec laquelle
ils croiffent, & par la facilité que la plûpart ont à fe
fécher, 8c à reprendre enfuite leur première forme
lorfqu’on les plonge dans l’eau : il y a enfin entre
les uns & les autres, une maniéré prefque uniforme
de produire leur graine.
Cette analogie eft d’autant plus importante pour
la eonnoiffance de la nature des champignons > que
les auteurs anciens ne les ont point mis au rang des
plantes ,
plantes, &: que pîulieurs modernes, parmi lefquels
lè trouvent Mrs le comte de Marfigli & Lancifi, dans
leur dijfertation latine fur Corigine des champignons,
imprimée à Rome en 17 14 , in-8°. fe font perfuadés
qué.ceüx que l’on voit fur des troncs ou des branches
d’arbres, font des maladies des plantes auxquelles ils
font attachés ; femblables aux exoftofes, dont le volume
ne s’augmente que par le dérangement des fi-
bres ofleufes, qui donne lieu à une extravafation de
leurs-fues nourriciers; & que ceux qui naiffent à
terre parmi des feuilles pourries ou fur les fumiers,
ne font que ou des expanfions de quelques fibres de
plantes pourries dont la terre eft parfemée, ou des
productions caufëes par la fermentation de certains
fucs que ces auteurs difent être gras & huileux, qui
reftés dans les parties de ces plantes pourries, &
mêles avec une portion de fel de nitre, prennent la
forme de globule, plus ordinaire qu’aucune autre
aux champignons naiffans.
Mais toutes ces idées fur la nature des champignons
fe détruifent aifément par un examen un peu
attentif de leur fubftance ; de leur organifation , de
leur variété , & de leur maniéré de fe multiplier ;
car enfin tous ces noeuds, ces veflies, & ces autres
tumeurs qui paroiffent fur certaines parties des arbres
, de même que fur le corps des animaux, comme
des maladies auxquelles ils font fujets, font com-
pofés d’une matière qui participe de la fubftance fo-
lide ou liquide de ces plantes & de ces animaux fur
lefquels ils fè rencontrent ; au lieu que la fubftance.
des champignons qui s’attachent aux arbres, eft non-
feulement toute différente de celle des plantes fur
lefquelles ils naiffent, mais même eft femblable à
celle des champignons qui fortent immédiatement de
la terre.
Si d’ailleurs la Angularité de l’organifation eft dans
les plantes un de ces caraâeres qui les diftinguent des
autres produftions de la nature, ce même cara&ere
fe fait reconnoître par une difpolition particuliere
d’organes dans les champignons.
Les carafteres de l’organifation ne fe trouvent pas
moins multipliés dans cette plante, qu’ils le font
dans tous les genres de claffes de plantes : ils y font
conftans, en quelque pays & dans quelque année
qu’on les obferve ; ce qui doit fe faire par le moyen
d’une reproduftion annuelle d’efpeces, qui ne peut
fe comprendre fans la fuppofition d’une femence qui
les perpétue & les multiplie*
Cette fuppofition de femences n’eft point imaginaire
; elles fe font fentir au toucher en maniéré de
farine, dans les champignons dont la tête eft feuille^-
tée en-deffous, lors fur-tout qu’ils commencent à fe
pourrir. On les apperçoit aifément à la faveur de la
loupe, dans ceux dont les feuillets font noirs à leur
marge : on les trouve fous la forme d’une pouffiere,
dans ceux qu’on appelle vejfes-de-loup; elles paroiffent
en affez gros grains fur le champignon de Malthe ;
elles font placées dans des loges deftinées à les contenir
dans l’agaric noir digité de Boerhaave*
Quelque peine qu’on ait communément à fe convaincre
que ce font de véritables graines, les Bota-
niftes , accoûtumés à en voir de pareilles dans d’autres
plantes, les reconnoiffent aifément dans celle-ci,
& ne peuvent plus douter que les champignons ne
foient d’une claffe particuliere de plantes, lorfqu’en
comparant les obfervations faites en differens pays
avec les figures & les deferiptions de ceux qui ont
été gravés, ils apperçoivent chacun chez eux les mêmes
genres & les mêmes efpeces.
L’établiffement de la clafl'e nouvelle à former
pour la .perfeûion de la méthode, doit donc fe tirer
de quelques cara&eres qui ne foient pas moins effen-
tiels que ceux des autres claffes, & qui les différencient.
Tome l i t .
Et queîfc feront les carafteres de ces fortes de
plantes, finon d’être dans toutes leurs parties d’une
fubftance uniforme ; mollâffes lorfqu’elles font dans
un état de fraîcheur,,charnues, faciles à fe rompre,
aufli promptes à venir qu’elles font de peu de durée ,
& capables, lorfqu’elles font feches , de reprendre
leur forme & leur volume naturel, .fi on les trempe
dans quelque liqueur dont elles s’imbibent ; Caractères
qui tous pourroient fe comprendre fous le nom
dé^ plantes fongueufes : d’ailleurs elles fe font con-
noître à l’extérieur pat;'Une figure fi finguliere, que
n’ayant ni branches, ni feuilles, ni fleurs pour la plûpart,
elles ne reffemblent ni à aucune herbe , ni à
aucun arbre.
On pourroit divifer les plantes fongueufes en deux
ferions générales ; l’une renfermeroit le lychen, 8c
lautre les champignons. La fe&ion des champignons
feroit fufceptible de deux divifions confidérables ,
dont l ’une comprendroit les ckampignons qui ne portent
que des graines, & l’autre ceux qui ont des graines
& des fleurs.
Les genres de la première de ces divifions feroient
le champignon proprement d it, le poreux., l’hériffé
la m orille, les fongoïdes $ la veffe-de-loup, les agarics
, les coralle-fungus, & les truffes. :
Les genres de la fécondé de Ces foûdivifions feroient
le typhoïdes & l’hypoxylon.
Il ne refteroit plus qu’à faire une application par-'
ticulieredes carafteres de tous les genres qui fe rapportent
aux différentes divifions de la claffe générale;
à donner le dénombrement des efpeces , avec une
concordance des deferiptions des auteurs, conforme '
aux figures qu’ils en ont fait gravef.
Telles font les remarques & le projet qu’avoit
cbnçû M. de Juflieu en 1718 , pour former l’hiftoire
botanique des champignons; mais comme par malheur
il ne l’a point exécuté, perfonne n’a ofé fe
charger d’une entoeprife.que cet illuftre académicien
fembloit s’être réferyée , & qu’il pou voit confom mer,
avec gloire.
Il faut donc nous contenter jufqu’à ce jour des
ouvrages que nous avons ,cités fur cette matière • 8c
quoiqu’ ils ne rempliffent point nos defirs, iis fuffifent
néanmoins pour nous mettre fur la v o ie , pour nous
fournir une eonnoiffance générale des divers genres
de champignons, & pour, nous prouver qu’il n’y a
guere de plantes qui produifent plus de variétés en
groffeur, en hauteur, en étendue , & en différence
de couleur des cannelures & du chapiteau, que le
fait celle-ci.
Voilà fans doiite l'origine des fauffetés qu’on lit
dans Clufius, Matthiole, Ferrantes Imperati & autres
écrivains -, fur la groffeur énorme de quelques
champignons. Pour m o i, lorfque j’entends Clufius
parler d’un champignon qui pouvoit nourrir plus d’un
jour toute une famille ; Matthiole prétendre qu’il en
a vu du poids de trente livres ; Ferrantes Imperati
pouffer l’exagération jufqu’à dire qu’il y en a qui pe-
fent plus de cent livres ; enfin d’aurres rapporter que
fur les confins de là Hongrie & de la Croatie il en
croît de fi g ro s , qu’ùn feul feroit la charge d’un
charriot : je ne trouve pour cuire de fi monftrueux
champignons, que le pot de la fable de la Fontaine,
qui étoit aufli grand qu’une églife.
Il ne faut pas porter le même jugement fur les faits
qui regardent les malheurs eaufés par des champignons
pernicieux ; & c’eft la certitude des hiftoires
qu’on en cite, qui a engagé divers auteurs modernes
à former, d’après Diofcoritle, la divifion générale
de la claffe des champignons en nuijibles 8c en bons à
manger. On met au nombre des premiers la veffe-de-
loup (yoye^ ce mot) ; & au rang des derniers le champignon
ordinaire qui vient fur couche, champignon