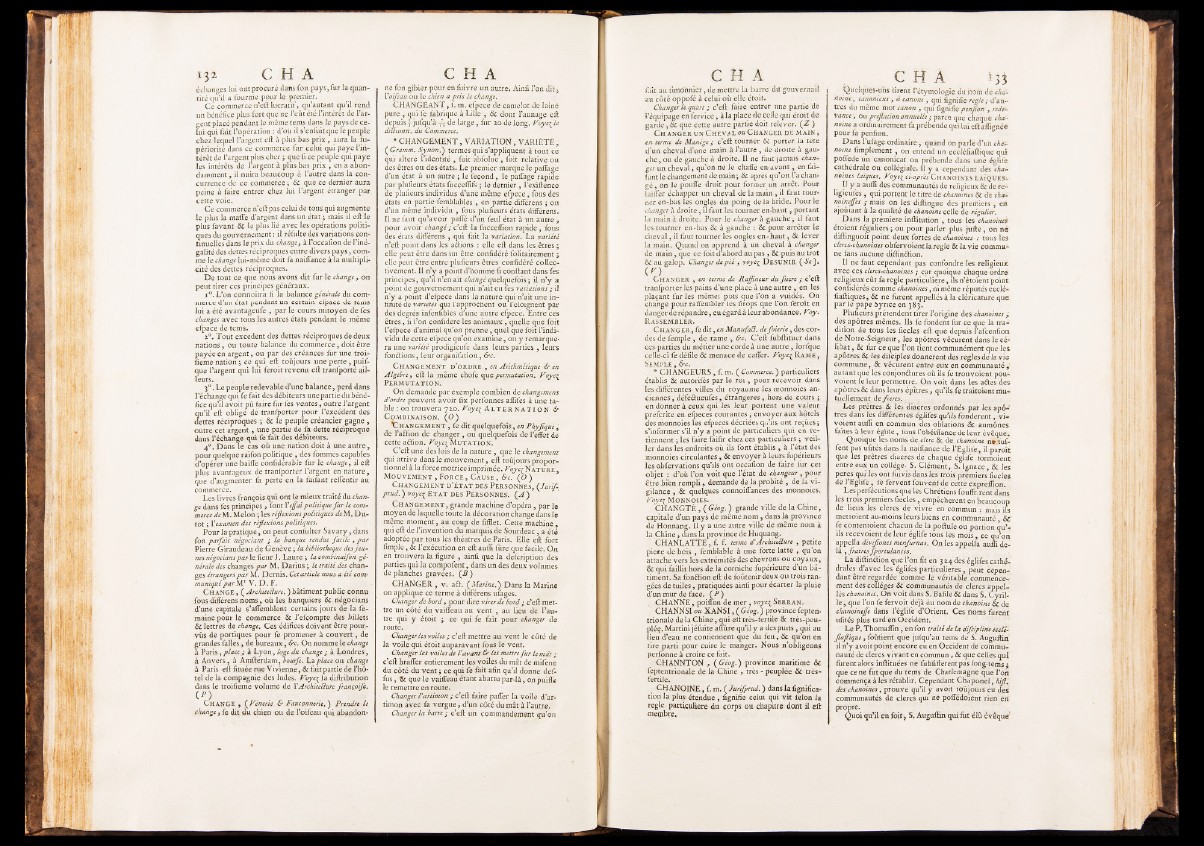
échanges lui ont procuré dans fon pays, fur la quantité
qu’il a fournie pour le premier.
Ce commerce n’eft lucratif, qu’autant qu’il rend
un bénéfice plus fort que ne l’eût été l’intérêt de l’argent
placé pendant le même tems dans le pays de celui
qui fait l’opération : d’où il s’enfuit que le peuple
chez lequel l’argent eft à plus bas prix , aura la fu-
périorite dans ce commerce fur celui qui paye l’intérêt
de l’argent plus cher ; que fi ce peuple qui paye
les intérêts de l’argent à plus bas prix , en a abondamment
, il nuira beaucoup à l’autre dans la concurrence
de ce commerce ; 6c que ce dernier aura
peine à faire entrer chez lui l’argent étranger par
cette voie.
Ce commerce n’eft pas celui de tous qui augmente
le plus la maffe d’argent dans un état ; mais il eft le
plus favant 6c le plus lié avec les opérations politiques
du gouvernement : il réfulte des variations continuelles
dans le prix du change, à l’occafion de l’inégalité
des dettes réciproques entre divers p ays, comme
le change lui-même doit fa naiffance à la multiplicité
des dettes réciproques.
De tout ce que nous avons dit fur le change , on
peut tirer ces principes généraux.
i °. L ’on connoîtra fi la balance générale du commerce
d’un état pendant un certain efpaee de tems
lui a été avantageufe , par le cours mitoyen de fes
changes avec tous les autres états pendant le même
efpaee de tems.
2°. Tout excédent des dettes réciproques de deux
nations, ou toute balance du commerce, doit être
payée en argent, ou par des créances fur une troi-
fieme nation ; ce qui eft toujours une perte, puisque
l’argent qui lui feroit revenu eft tranfporté ailleurs.
3°. Le peuple redevable d’une balance, perd dans
l ’échange qui fe fait des débiteurs une partie du bénéfice
qu’il avoit pû faire fur fes ventes, outre l’argent
qu’il eft obligé de tranfporter pour l’excédent des
dettes réciproques ; 6c le peuple créancier gagne,
outre cet argent, une partie de fa dette réciproque
dans l’échange qui fe fait des débiteurs.
4°. Dans le cas où une nation doit à une autre,
pour quelque raifon politique , des fommes capables
d’opérer une baiffe confidérable fur le change, il eft
plus avantageux de tranfporter l’argent en nature,
que d’augmenter fa perte en la failànt reffentir au
commerce.
Les livres françois qui ont le mieux traité du change
dans fes principes , font Yeffai politique fur le commerce
de M. Melon ; les réflexions politiques de M. Du-
tot ; Y examen des réflexions politiques.
Pour la pratique, on peut conl'ulter Sava ry, dans
fon parfait négociant ; la banque rendue facile , par
Pierre Giraudeau de Genève ; la bibliothèque des jeu-
nesnégocianspar le fieur J. Laure ; la combinaifon générale
des changes par M. Darius ; le traité des changes
étrangers par M. Demis. Cet article nous a été communiqué
par Mr V. D. F.
C hange , ( Architecture. ) bâtiment public connu
fous différens noms, où les banquiers 6c négocians
d’une capitale s’affemblent certains jours de la fe-
maine pour le commerce & l’efcompte des billets
6c lettres de change. Ces édifices doivent être pour-
vûs de portiques pour fe promener à cou ve rt, de
grandes falles, de bureaux, &c. On nomme le change
à Paris, place ; à Lyon, loge du change ; à Londres,
à Anvers, à Amfterdam, bourfe. La place ou change
à Paris eft fituée rue V ivienne, & fait partie de l’hôtel
de la compagnie des Indes. Voye{ fa diftribution
dans le troifieme volume de Y Architecture françoife, Hfl ' ■ ■
C hange , ( vénerie & Fauconnerie.') Prendre le
change 3 fe dit du chien ou de l’oifeau qui abandonne
fon gibier pour en fuivre un autre. Ainfi l’on dit j
Yoifeau ou le chien a pris le change.
CHANGEANT, 1. m. efpece de camelot de Iainë
pure , qui fe fabrique à Lille , 6c dont l’aunage eft
depuisf jufqu’à f z large, fur 20 de long. Voyelle
dictionn. du Commerce.
* CHANGEMENT, VARIATION, VARIÉTÉ,
( Gramm. Synon.) termes qui s’appliquent à tout ce
qui altéré l’identité , foit abfolue , foit relative ou
des êtres ou des états. Le premier marque le paflage
d’un état à un autre ; le fécond, le paflage rapide
par plufieurs états fucceflifs ; le dernier , l’exiftence
de plufieurs individus d’une même efpece, fous des
états en partie femblables , en partie différens ; ou
d’un même individu , fous plufieurs états différens.
Il ne faut qu’avoir paffé d’un feul état à un autre ,
pour avoir changé ; c’eft la fucceflion rapide, fous
des états différens , qui fait la variation. La variété
n’eft point dans les allions : elle eft dans les êtres ;
elle peut être dans un être confidéré folitairement ;
elle peut être entre plufieurs êtres confidéré collectivement.
Il n’y a point d’homme fi confiant dans fes
principes, qu’il n’en ait changé quelquefois ; il n’y a
point de gouvernement qui n’ait eu fes variations ; il
n’y a point d’elpece dans la nature qui n’ait une infinité
de variétés qui l’approchent ou l’éloignent par
des degrés infenfibles d’une autre efpece. Entre ces
êtres, fi l’on confidéré les animaux , quelle que foit
l’efpece d’animal qu’on prenne, quel que foit l’individu
de cette elpeee qu’on examine, on, y remarquera
une variété prodigieufe dans leurs parties , leurs
fondions, leur organifation, &c.
C h angement d’ordre , en Arithmétique & en
Algèbre , eft la même chofe que permutation. Voye£
Pe rm u t a t io n .
On demande par exemple combien de changement
d'ordre peuvent avoir fix perfonnes aflifes à une table
: on trouvera 720. Voye1 A l t e r n a t i o n &
C om bin aiso n . (O )
C hangement , fe dit quelquefois, en Phyfîque ,'
de l’adion de changer, ou quelquefois de l’effet de
cette a&ion. Voyeç Mu t a t io n .
C ’eft une des lois de la nature , que le changement
qui arrive dans le mouvement, eft toûjours proportionnel
à la force motrice imprimée. Voye1 Nature ,
Mouv em en t , For ce , C ause , &c. (O )
C hangement d’é t a t des Personnes, (Jurifprud.
) voyei ÉTAT DES PERSONNES. ( A )
C han g em en t , grande machine d’opéra, par le
moyen de laquelle toute la décoration change dans le
même moment, au coup de fifHet. Cette machine ,
qui eft de l’invention du marquis de Sourdeac, a été
adoptée par tous les théâtres de Paris. Elle eft fort
fimple, & l’exécution en eft aufli fûre que facile. On
en trouvera la figure , ainfi que la defeription des
parties qui la compofent, dans un des deux volumes
de planches gravées. (2? )
CHANGER , v . att. {Marine.) Dans la Marine
on applique ce terme à différens ulages.
Changer de bord, pour dire virer de bord ; c’eft mettre
un côté du vaifleau au vent , au lieu de l’autre
qui y étoit ; ce qui fe fait pour changer de
route.
Changer les voiles ; c’eft mettre au vent le côté de
la voile qui étoit auparavant fous le vent.
Changer les voiles de l'avant & les mettre fur le mât •
c’eft braffer entièrement les voiles du mât de mifene
du côté du vent ; ce qui fe fait afin qu’il donne def-
fus, & que le vaifleau étant abattu par-là, on puifle
le remettre en route.
Changer l'artimon ; c’eft faire pafler la voile d’artimon
avec fa vergue, d’un côté du mât à l’autre.
Changer la barre ; ç’eft un commandement qu’on
fait au timonnier, de mettre la barre du gouvernail
au côté oppofé à celui où elle étoit.
Changer le quart ; c’eft faire entrer une partie de
l’équipage en fervice, à la place de celle qui étoit de
garde, 6c que cette autre partie doit relever. ( Z )
C han g e r un C hev al on C hanger de ma in *
en terme de Manège ; c’eft tourner 6c porter la tête
d’un cheval d’une main à l’autre , de droite à gauche,
ou de gauche à droite. Il ne faut jamais changer
un cheval, qu’on ne le chaffe en-avant, en fai-
fantle changement de main; 6c après qu’on l’a changé
, on le pouffe droit pour former un arrêt. Pour
laitier échapper un cheval de la main , il faut tourner
en-bas les ongles du poing de la bride. Pour le
changer à droite, il faut les tourner en-haut, portant
la main à droite. Pour le changer à gauche * il faut
les tourner en-bas 6c à gauche : 6c pour arrêter le
ch eval, il faut tourner les ongles en-haut, & lever
la main. Quand on apprend à un cheval à changer
de main, que -ce foit d’abord au pas , 6c puis au trot
6c au galop. Changer de pie , voye^ DESUNIR ( Se );
( V )
CHANGER , en terme de RaÆncur du fucre ; c’eft
tranfporter les pains d’une place à une autre , en les
plaçant fur les mêmes pots que l’on a vuidés. On
change pour raffembler les firops que l’on feroit en
danger de répandre, eu égard à leur abondance. Vyy.
R assembler.
C hanger , fe dit, en Manufacl. de foierie, des cordes
de femple , de rame , &c. C ’eft fubftituer dans
ces parties du métier une corde à une autre, lorfque
celle-ci fe défile 6c menace de caffer. Voyeç Ram e ,
Semple , &c.
* CHANGEURS, fi m. ( Commerce. ) particuliers
établis & autorifés par le roi , pour recevoir dans
les différentes villes du royaume les monnoies anciennes
, défeélueufes, étrangères , hors de cours ;
en donner à ,ceux qui les leur portent une valeur
preferite en efpeces courantes ; envoyer aux hôtels
des monnoies les efpeces décriées qu’ils ont reçûes ;
s’informer s’il n’y a point de particuliers qui en retiennent
; les faire faifir chez ces particuliers ; veiller
dans les endroits où ils font établis , à l’etat des
monnoies circulantes, & envoyer à leurs fupérieurs
les obfervations qu’ils ont occafion de faire fur cet
objet : d’où l’on voit que l’état de changeur , pour
être bien rempli, demande de la probité , de la v igilance
, & quelques connoiffances des monnoies.
V oy ei Monnoies. <•
CH ANGTÉ, ( Géog. ) grande ville de la Chine,
capitale d’un pays de même nom, dans la province
de Honnang. Il y a une autre ville de même nom à
la Chine * dans la province de Huquang.
CH AN LATTE, fi fi terme d'Architecture , petite
pieee de bois , femblable à une forte latte , qu’on
attache vers les extrémités des chevrons ou coyaux,
6c qui faillit hors de la corniche fupérieure d’un bâtiment.
Sa fon&ion eft de foûtenir deux ou trois rangées
de tuiles, pratiquées ainfi pour écarter là pluie
d’un mur de face. ( P )
. CH ANNE, poifl'on de mer, voyc^ Serran.
CHANNSI ou XANSI ,{Géog.) provincéfepten-
trionale de la C hine, qui eft très-fertile & très-peu-
pléç. Martini jéfuite affûre qu’il y a des puits, qui au
lieu d’eau ne contiennent que du feu , 6c qu’on en
tire parti pour cuire le manger * Nous n’obligeons
perfonne à croire ce fait.
CHANNTON , {Géog.) province maritime 6c
feptentrionale de la Chine , très - peuplée 6c très-
fertile.
CHANOINE, fi m. ( Jurifprud. ) dans la lignification
la plus étendue , fignifie celui qui vit lelon la
réglé particulière du corps ou chapitre dont il eft
membre,
Quelques-uns tirent l’étymologie du hörn de chanoine
, canonicus , à. canone, qui fignifie regle ; d’autres
du meme mot canon , qui fignifie penfion , redevance;
ou prefiation annuelle ; parce que chaque chanoine
a ordinairement fa prébende qui lui eft aflignée
pour fa penfion.
Dans l’ufage ordinaire ; quand on parle d’un cha-
home Amplement , on entend un eccléfiaftique qui
poffede un canonicat ou prébende dans une églife
cathédrale ou collégiale. Il y a cependant des chanoines
laïques. Vyye^ ci-après C hanoines LÀÏQÜESi.
Il y a aufli des communautés de religieux 6c de re-
ligieufes , qui portent le titre de chanoines & de çha-
noineffes ; mais on les diftingue des premiers \ eii
ajoutant à la qualité de chanoine celle de régulier.
Dans la première inftitution , tous les chanoihei;
étoient réguliers ; ou pour parler plus jufte, on né
diftinguoit point deux fortes de chanoines : tous les
clercs-chanoines obfervoient la regle & la vie commune
fans aucune diftinftion.
Il ne faut cependant pas confondre les religieux
avec ces clercs-chanoines ; car quoique chaque ordre
religieux eût fa regle particulière, ils n’étoient point
confidérés comme chanoines, ni même réputés ecclé-
fiaftiques, 6c ne furent appellés à la cléricature que
par le pape Syrice en 383.
Plufieurs prétendent tirer l’origine des chanoines ,
des apôtres mêmes. Ils fe fondent fur ce que la tradition
de tous les fieeles eft que depuis l’afeenfion
de Notre-Seigneur, les apôtres vécurent dans le célibat
, & fur ce que l’on tient communément que les
apôtres 6c les dilciples donnèrent des réglés de la vie
commune, & vécurent entre eux en communauté,
autant que les conjonctures où ils fe trouvoient pourvoient
le leur permettre. On voit dans les a£tes des
apôtres 6c dans leurs épîtres , qu’ils fe traitoient mu-,
tuellement clefreres.
Les prêtres & les diacres ordonnés par les apôtres
dans les différentes églifes qu’ils fondèrent, vi-
voient aufli en commun des oblations. & aumônes
faites à leur églite, fous l’obéiffance de leur évêque^
Quoique les noms de clerc & de chanoine n*.iuf-
fent pas ufités dans la naiflançe de l’Eglile , il paroît
que les prêtres diacres de chaque églife tbrmoient
entre eux un collège. S. Clément, S. Ignace, 6c les
peres qui les ont fuivis dans les trois premiers fieeles
de i’Eglife, fe fervent fouvent de cette expreffion.
Les perfécutions que les Chrétiens fouffnrent dans
les trois premiers fieeles, empêchèrent en beaucoup
de lieux les clercs de vivre en commun : mais ils
mettoient au-moins leurs biens en communauté, 6c
fe contentoient chacun de la poftule ou portion qu’ ils
recevoient de leur églife tous les mois, ce qu’on
appella divïfiones menfurnas. On les appella aufli delà
, fratres fportulantes,
La diftin&ion que l’on fit en 3 24 des églifes cathédrales
d’avec les églifes particulières, peut cependant
être regardée comme le véritable commencement
des collèges & communautés de clercs appelles
chanoines. On voit dans S. Bafile 6c dans $. Cyrille
, que l’on fe fervoit déjà du nom de chanoine 6c de
chanöineffe dans l’églife d’Orient. Ces noms furent
ufités plus tard en Occident.
Le P. Thomaflin, en fon traité de la difcipline ecclé-
fiafliqüe, foûtient que jusqu’au tems de S. Auguftin
il n’y avoit point encore eu en Occident de communauté
de clercs vivant en commun, & que celles qui
furent alors inftituées ne fubfifterentpas long-tems ;
que ce ne fut que du tems de Charlemagne ique l’on
commença à les rétablir. Cependant Chaponel, hiß,
des chanoines, prouve qu’il y avoit toûjours eu des
communautés de clercs qui né poffédoient rien en
propre.
Quoi qu’il en foit, S, Auguftin qui fut élû évêque'