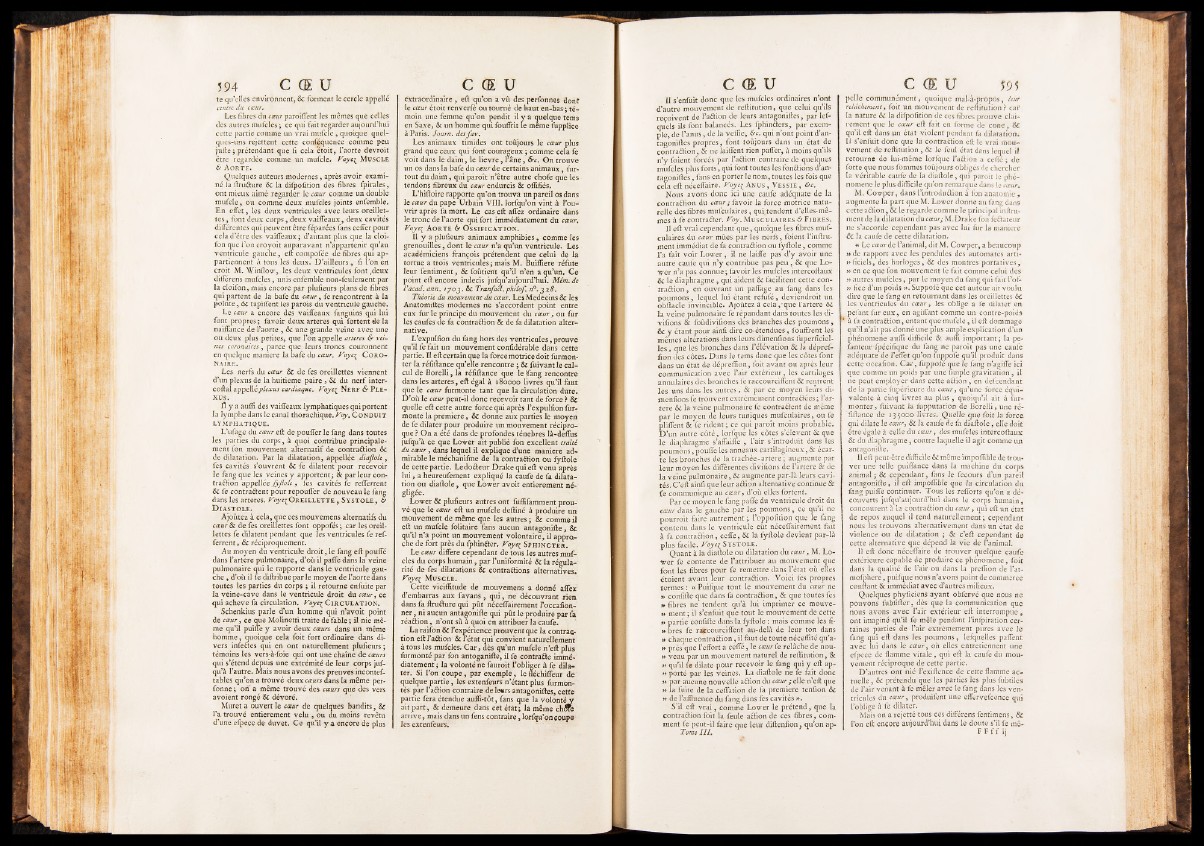
te qu’elles environnent, & forment le cercle appelle
centre du coeur.
Les fibres du coeur paroiffent les mêmes que celles
des autres mufcles ; ce qui fait regarder aujourd’hui
cette partie comme un vrai mufcle , quoique quelques
uns rejettent cette conséquence comme peu
jufte; prétendant que fi cela étoit, l’aorte devroit
être regardée comme un mufcle. Voye^ Muscle
O. A o r te .
Quelques auteurs modernes, après avoir examiné
la ftruéture & la difpofition des fibres fpirales,
ont mieux aimé regarder le coeur comme un double
mufcle, ou comme deux mufcles joints enfemble.
En effet, les deux ventricules avec leurs oreillettes
, font deux corps, deux vaiffeaux, deux cavités
différentes qui peuvent être Séparées fans ceffer pour
cela d’être des vaiffeaux ; d’autant plus que la cloi-
fon que l’on croyoit auparavant n’appartenir qu’au
ventricule gauche, eft compofée de fibres qui appartiennent
à tous les deux. D ’ailleurs, fi l ’on en
croit M. "Winflow, les deux ventricules font tdeux
différens mufcles, unis enfemble non-feulement par
la cloifon,>mais encore par plufieurs plans de fibres
qui partent de la bafe du coeur, fe rencontrent à la
pointe, & tapiffent les parois du ventricule gauche.
Le coeur a encore des vaiffeaux fanguins qui lui
font propres; favoir deuxarteres qui fortent de la
naiffance de l’aorte , Sc une grande veine avec une
ou deux plus petites, que l’on appelle artères & veines
coronaires, parce que leurs troncs couronnent
en quelque maniéré la bafe du coeur. Voye.£ C orona
ire.
Les nerfs du coeur & de fes oreillettes viennent
d’un plexus de la huitième paire, & du nerf inter-
coftal appelléplexus cardiaque. Voye{ Nerf & Plex
u s .
fl y a aufîi des vaiffeaux lymphatiques qui portent
la lymphe dans le canal thorachique. Voy. C onduit
LYMPHATIQUE.
L ’ufage du coeur eft de pouffer le fang dans toutes
les parties du corps, à quoi contribue principalement
fon mouvement alternatif de contraction &
de dilatation. Par la dilatation, appellée diajlole,
fes cavités s’ouvrent & fe dilatent pour recevoir
le fang que les veines y apportent; & parleur contraction
appellée fyftole, fes cavités fe refferrent
& fe contractent pour repouffer de nouveau le fang
dans les arteres. Voye^Ore il le t te , Sy s t o l e , O
D ia sto le .
Ajoûtez à cela, que ces mouvemens alternatifs du
coeur & de fes oreillettes font oppofés; car les oreillettes
fe dilatent pendant que les ventricules fe refferrent,
& réciproquement.
Au moyen du ventricule droit, le fang eft pouffé
dans l’artere pulmonaire, d’oii il paffe dans la veine
pulmonaire qui le rapporte dans le ventricule gauche
, d’où il fe diftribue par le moyen de l’aorte dans
toutes les parties du corps ; il retourne enfuite par
la veine-cave dans le ventricule droit du coeur, ce
qui achevé fa circulation. Voye^ C ir c u l a t io n .
Schenkius parle d’un homme qui n’avoit point
de coeur, ce que Molinetti traite de fable ; il nie même
qu’il puiffe y avoir deux coeurs dans un même
homme, quoique cela foit fort ordinaire dans divers
infeCtes qui en ont naturellement plufieurs;
témoins les vers-à-foie qui ont une chaîne de coeurs
qui s’étend depuis une extrémité de leur corps juf-
qu’à l’autre. Mais nous avons des preuves incontef-
tables qu’on a trouvé deux coeurs dans la même per-
fonne ; où* a même trouvé des coeurs que des vers
avoient rongé & dévoré.
Muret a ouvert le coeur de quelques bandits, &
l’a trouvé entièrement velu , ou du moins revêtu
d’une efpece de duvet. Ce qu’il y a encore de plus
extraordinaire , eft qu’on a vû des perfonnes dont
le coeur étoit renverfé ou tourné de haut en-bas ; témoin
une femme qu’on pendit il y a quelque tems
en Saxe, & un homme qui fouffrit le meme fupplice
à Paris. Journ. desfav.
Les animaux timides ont toujours le coeur plus
grand que ceux qui font courageux ; comme cela fe
voit dans le daim, le lievre, l’âne, &c. On trouve
un os dans la bafe du coeur de certains animaux, fur-
tout du daim, qui paroît n’être autre chofe que les
tendons fibreux du coeur endurcis & oflifiés.
L’hiftoire rapporte qu’on trouva un pareil os dans
le coeur du pape Urbain VIII. lorfqu’on vint à l’ouvrir
après fa mort. Le cas eft affez ordinaire dans
le tronc de l’aorte qui fort immédiatement du coeur.
Voyei A o rte 6* O s s if ic a t io n .
Il y a plufieurs animaux amphibies, comme les
grenouilles, dont le coeur n’a qu’un ventricule. Les
académiciens ffançois prétendent que celui de la
tortue a trois ventricules ; mais M. Buifliere réfute
leur fentiment, & foûtient qu’il n’en a qu’un. Ce
point eft encore indécis jufqu’aujourd’hui. Mèm. de
Tacad. ann. 1703. & Tranfacl. philof. n°. 32.8.
Théorie du mouvement du coeur. Les Médecins & les
Anatomiftes modernes ne s’accordent point entre
eux fur le principe du mouvement du coeur , ou fur
les caufes de fa contraction & de fa dilatation alternative.
L’expulfion du fang hors des ventricules, prouve
qu’il fe fait un mouvement confidérable dans cette
partie. Il eft certain que la force motrice doit furmon-
ter la réfiftance qu’elle rencontre ; & fuivant le calcul
de Borelli, la réfiftance que le ffang rencontre
dans les arteres, eft égal à 180000 livres qu’il faut
que le coeur furmonte tant que la circulation dure.
D ’où le coeur peut-il donc recevoir tant de force ? &
quelle eft cette autre force qui après l’expulfion fur-
monte la première, & donne aux parties le moyen
de fe dilater pour produire un mouvement réciproque
? On a été dans de profondes ténèbres là-deffus
jufqu’à ce que Lover ait publié fon excellent traité
du coeur , dans lequel il explique d’une maniéré admirable
le méchanifme de la contraction ou fyftole
de cette partie. LedoCteur D rake qui eft venu après
lu i, a heureufement expliqué la caufe de fa dilatation
ou diaftole, que Lover avoit entièrement négligée.
Lover & plufieurs autres ont fuffifamment prouv
é que le coeur eft un mufcle deftiné à produire un
mouvement de même que les autres ; & comme il
eft un mufcle folitaire fans aucun antagonifte , &:
qu’il n’a point un mouvement volontaire, il approche
de fort près du fphinéter. Voye{ Sph in c te r .
Le coeur différé cependant de tous les autres mufcles
du corps humain, par l’uniformité & la régularité
de fes dilatations & contrarions alternatives.
Voyt{ Mu sc le.
Cette viciffitude de mouvemens a donné affez
d’embarras aux favan s , qui, ne découvrant rien
dans fa ftruCIure qui pût néceffairement l’occafion-
ner, ni aucun antagonifte qui pût le produire par fa
réa âion, n’ont sû a quoi en attribuer la caufe.
La raifon & l’expérience prouvent que la contraction
eft l’aCtion & l’état qui convient naturellement
à tous les mufcles. C a r , dès qu’un mufcle n’eft plus
furmonte par fon antoganifte, il fe contracte immédiatement
; la volonté ne fauroit l’obliger à fe dilater.
Si l’on coupe, par exemple, le fléchiffeur de
quelque partie, les extenfeürs n’étant plus furmon-
tés par l’aCtion contraire de leurs antagoniftes, cette
partie fera étendue aufli-tôt, fans que la volontév
ait part, & demeure dans cet état ; la même chdïe
arrive, mais dans un fens contraire, lorfqu’on coupe
lés extenfeürs.
II s’enfuit donc que les mufcles ordinaires n’ont
d’autre mouvement de reftitution, que celui qu’ils
reçoivent de l’aCtion de leurs antagoniftes, par lef-
quels ils font balancés. Les fphinéters, par exemple,
de l’anus, de la veflie, Oc. qui n’ont point d’an-
tagoniftes propres, font toûjours dans un état de
contraction, & ne laiffent rien paffer, à moins qu’ils
n’y foient forcés par l’aCtion contraire de quelques
mufcles plus forts, qui font toutes les fonctions d’an-
tagoniftes, fans en porter le nom, toutes les fois que
cela eft néceflaire. Voye{ A nus , V essie , Oc.
Nous avons donc ici une caufe adéquate de la
contraction du coeur ; favoir la force motrice naturelle
des fibres mufculaires , qui„tendent d’elles-mêmes
à fe contracter. Voy. Musculaires O Fibres.
Il eft vrai cependant que, quoique les fibres mufculaires
du coeur mûes par les nerfs, foient l’inftru-
ment immédiat de fa contraction ou fyftole, comme
l’a fait voir L o v e r , il ne laiffe pas d’y avoir une
. autre caufe qui n’y contribue pas peu , & que Lov
e r n’a pas connue ; favoir les mufcles intercoftaux
& le diaphragme, qui aident & facilitent cette contraction,
en ouvrant un paffage au fang dans les
poumons, lequel lui étant refufé, deviendroit un
obftacle invincible. Ajoûtez à cela,-que l’artere ôc
la veine pulmonaire fe répandant dans toutes les di-
vifions & foûdivifions des branches des poumons,
& y étant pour ainfi dire co-étendues, fouffrent les
mêmes altérations dans leurs dimenfions fuperficiel-
le s , que les bronches dans l’élévation & la dépref-
fion des côtes. Dans le tems donc que les côtes font
dans un état de dépreflion, foit avant ou après leur
communication avec l’air extérieur, les cartilages
annulaires des bronches fe raccourciffent & rentrent
les uns dans les autres, & par ce moyen leurs dimenfions
fe trouvent extrêmement contractées ; l’ar-
tere & la veine pulmonaire fe contractent de même
par le moyen de leurs tuniques mufculaires, ou fe
pliffent & fe rident ; ce qui paroît moins probable.
D ’un autre cô té, lorfque les côtes s’élèvent & que
le diaphragme s’affaiffe , l’air s ’introduit dans les
poumons, pouffe les anneaux cartilagineux, & écarte
les bronches de la trachée-artere ; augmente par
leur moyen les différentes divifions de l’artere & de
la veine pulmonaire, & augmente par-là leurs cavités.
C’eft ainfi que leur aCtion alternative continue &
fe communique au coeur, d’où elles fortent.
Par ce moyen le fang paffe du ventricule droit du
coeur dans le gauche par les poumons, ce qu’il ne
pourroit faire autrement ; l’oppofition que le fang
contenu dans le ventricule eût néceffairement fait
à fa contraction, ceffe, & la fyftole devient par-là
plus facile. Voye^ Sy s t o l e .
Quant à la diaftole ou dilatation du coeur, M. Lov
e r fe contente de l’attribuer au mouvement que
font les fibres pour fe remettre dans l’état où elles
étoient avant leur contraction. Voici fes propres
termes: « Puifque tout le mouvement du coeur ne
„ confifte que dans fâ contraction, & que toutes fes
h fibres ne tendent qu’à lui imprimer ce mouve-
» ment ; il s’enfuit que tout le mouvement de cette
» partie confifte dans la fyftole : mais comme les fi-
» bres fe raccourciffent au-delà de leur ton dans
» chaque contraction, il faut de toute, néceflité qu’a-
» près que l’effort a ceffé, le coeur fe relâche de nou-
» veau par un mouvement naturel de reftitution, &
» qu’il fe dilate pour recevoir le fang qui y eft ap-
» porté par les veines. La diaftole ne fe fait donc
» par aucune nouvelle aCtion du coeur ; elle n’eft que
» la fuite de la ceffation de fa première tenfion &
» de l’affluence du fang dans fes cavités ».
S’il eft v r a i, comme L o v e r le prétend, que la
contraction foit la feule aCtion de ces fibres, comment
fe peut-il faire que leur diftenfion, qu’on ap-
Tome III.
pelle communément, quoique mal-â-propos, leuf
relâchement, foit un mouvement de reftitution ? car
la nature & la difpofition de ces fibres prouve clairement
que le coeur eft fait en forme de cône, &C
qu’il eft dans un état violent pendant fa dilatation*
Il s’enfuit donc que la contraction eft le vrai mouvement
de reftitution , & le feül état dans lequel il
retourne de lui-même lorfque l’aCtion a ceffé ; de
forte que nous fommes toûjours obligés de chercher
la véritable caufe de la diaftole, qui paroît le phénomène
le plus difficile qu’on remarque dans le coeur.
M. Cowper, dans l’introduCtion à fon anatomie ,
augmente la part que M. Lower donne au fang dans
cette aCtion, & le regarde comme le principal infiniment
de la dilatation du coeur; M .Drake fon feCtateur
ne s’accorde cependant pas avec lui fur la maniéré
& la caufe de cette dilatation.
« Le coeur de l’animal, dit M. Covper, a beaucoup
» de rapport avec les pendules des automates arti-
» ficiels, des horloges, & des montres portatives ,
» en ce que fon mouvement fe fait comme celui des
» autres mufcles, par le moyen du fang qui fait l’of-
» fice d’un poids ». Suppofé que cet auteur ait voulu
dire que le fang en retournant dans les oreillettes ôc
les ventricules du coeur, les oblige à fe dilater en
pefant fur eu x , en agiffant comme un contre-poids
• à fa contraction, entant que mufcle, il eft dommage
qu’il n’ait pas donné une plus ample explication d’un
phénomène aufli difficile & aufîi important ; la pe-
fanteur'fpécifique du fang ne paroît pas une caufe
adéquate de l’effet qu’on fuppofe qu’il produit dans
cette occafion. C a r , fuppofé que le fang n’agiffe ici
que comme un poids par une fimple gravitation, il
ne peut employer dans cette aCtion , en defeendant
de la partie fupérieure du coeur, qu’une force équivalente
à cinq livres au plus , quoiqu’il ait à tur-
monter, fuivant la fupputation de Borelli, une ré-
'fiftance de 135000 livres. Quelle que foit la force
qui dilate le coeur, & la caufe de fa diaftole, elle doit
être égale à celle du coeur, des mufcles intercoftaux
& du diaphragme, contre laquelle il agit comme un
antagonifte.
Il eft peut-être difficile & même impoflible de trouver
une telle puiffance dans la machine du corps
animal ; & cependant, fans le fecours d’un pareil
antagonifte, il eft impofîxble que la circulation du
fang puiffe continuer. Tous les refforts qu’on a découverts
jufqu’aujourd’hui dans le corps humain,
concourent à la contraction du coeur, qui eft un état
de repos auquel il tend naturellement ; cependant
nous les trouvons alternativement dans un état de
violence ou de dilatation ; & c’eft cependant de
cette alternative que dépend la vie de l’animal.
Il eft donc néceflaire de trouver quelque caufe
extérièure capable de produire ce phénomène, foit
dans la qualité de l’air ou dans la preflion de l’at-
mofphere, puifque nous n’avons point de commerce
confiant & immédiat avec d’autres milieux.
Quelques phyficiens ayant obfervé que nous ne
pouvons fubfifter, dès que la communication que
nous avons avec l’air extérieur eft interrompue,
ont imaginé qu’il fe mêle pendant l’infpiration cer-
j taines parties de l’air extrêmement pures avec le
fang qui eft dans les poumons, lefquelles paffent
avec lui dans le coeur, où elles entretiennent une
efpece de flamme v ita le, qui eft la' caufe du mouvement
réciproque de cette partie.
D ’autres ont nié l’exiftence de cette flamme actuelle
, & prétendu que les parties les plus fubtiles
de l’air venant à fe mêler avec le fang dans les ventricules
du coeur, produifent une effervefeence qui
l’oblige à fe dilater.
Mais on a rejetté tous Ces différens fentimens, &
l’on eft encore aujourd’hui dans le doute s’il fe mê-
F F f f ij