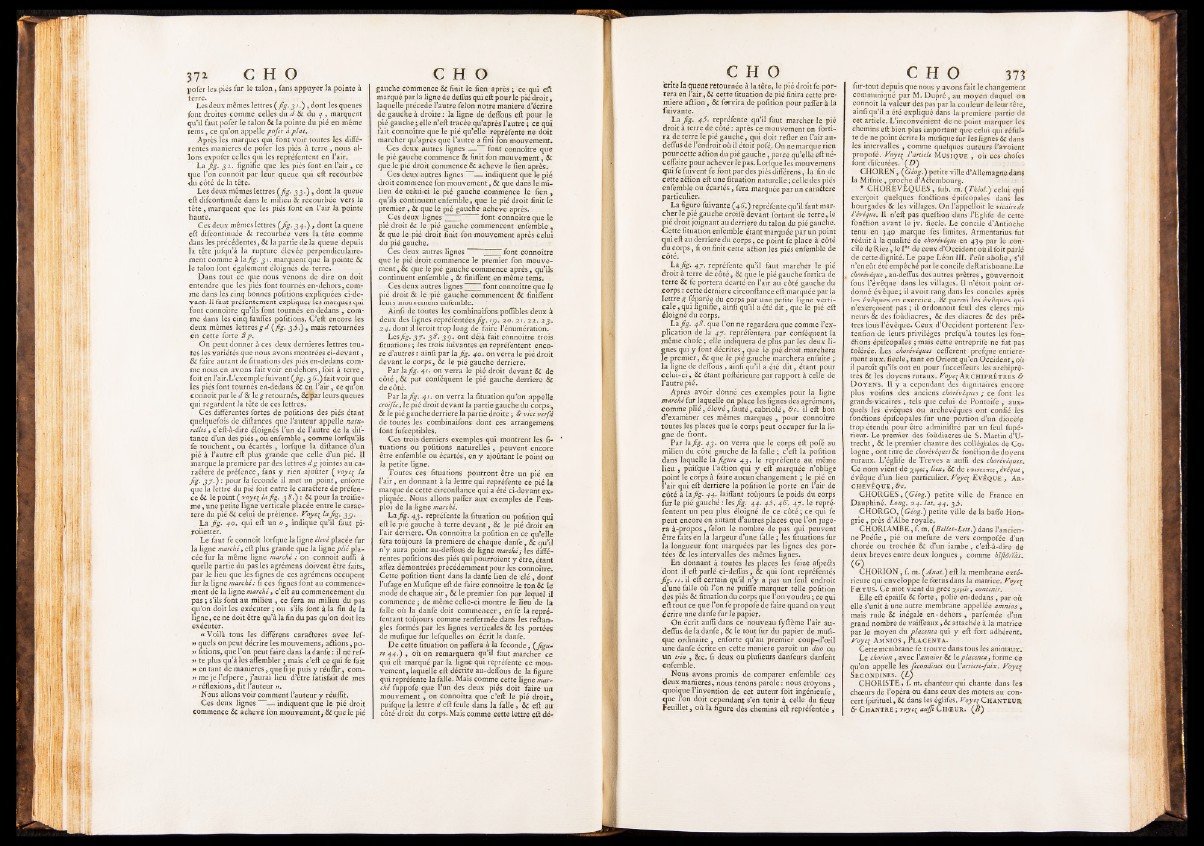
pofer les pies fur le talon, fans appuyer la pointe à
térre.
Les deux mêmes lettres ( fig. 3 / .) , dont les queues
font droites comme celles du d & du q , marquent
qu’il faut pofer le talon & la pointe du pié en même
tems, ce qu’on appelle pofer à plat,
Après les marques qui font voir toutes les différ
rentes maniérés de pofer les pies à terre , nous allons
expofer celles qui les repréfentent en l’air.
La fig. 3 a. fignine que les pies font en l’air , ce
que l’on connoît par leur queue qui eft recourbée
du côté de la tête.
Les deuxmêmes lettres (fig.'3 3 .) , dont la queue
eft difcontinuée dans le milieu & recourbée vers la
tê te , marquent que les piés font en l’air la pointe
haute.
Ces deux mêmes lettres (fig. 34 .) > dont la queue
eft difcontinuée & recourbée vers la tête comme
dans les précédentes, & la partie de la queue depuis
la tête, jufqu’à la rupture élevée perpendiculairement
comme à la fig. 31. marquent que la pointe &
le talon font également éloignes de terre.
Dans tout ce que nous venons de dire on doit
entendre que les piés font tournés en-dehors, comme
dans les cinq bonnes pofitions expliquées ci-devant.
Il faut prélentement expliquer les marques qui
font connoître qu’ ils font tournés en-dedans , comme
dans les cinq fauffes pofitions. C ’eft encore les
deux mêmes lettres g d (fig. 3 3 .) , mais retournées
en cette forte 3 p.
On peut donner à ces deux dernieres lettres toutes
les variétés que nous avons montrées ci-devant,
.& faire autant de fituations des piés en-dedans comme
nous en avons fait voir en-dehors, foit à terre,
foit en l’air.L’exemple fuivant (fig. 3 6'.') fait voir que
tes piés font tournés en-dedans & en l’a ir , ce qu’on
connoît par le d & le g retournés, ôepar leurs queues
qui regardent la tête de ces lettres.*
Ces différentes fortes de pofitions des piés étant
quelquefois de diftances que l’auteur appelle naturelles
, c’eft-à-dire éloignés l’un de l’autre de la distance
d’un des p iés, ou enfemble, comme lorfqu’ils
fe touchent , ou écartés , Iorfque la diftance d’un
pié à l’autre eft plus grande que celle d’un pié. Il
marque la première par des lettres dg jointes au ca-
ra&ere de préfence, fans y rien ajoûter ( voyeç la
fig. 3 7 .) : pour la fécondé il met un point, enforte
que la lettre du pié foit entre le cara&ere de préfence
S i le point ( voye[ la fig. 38.) : & pour la troifie-
me, une petite ligne verticale placée entre le caractère
du pié & celui de préfence. Foye^ la fig. 3$.
La fig. 40. qui eft un o , indique qu’il faut pirouetter.
Le faut fe connoît Iorfque la ligne élevé placée fur
la ligne marché, eft plus grande que la ligne plié placée
fur la même ligne marché : on connoît auffi à
quelle partie du pas les agrémens doivent être faits,
par le lieu que les lignes de ces agrémens occupent
lur la ligne marché: fi ces lignes font au commencement
de la ligne marché, c’eft au commencement du
pas ; s’ils font au milieu , ce fera au milieu du pas
qu’on doit les exécuter ; ou s’ils font à la fin de la
ligne, ce ne doit être qu’à la fin du pas qu’on doit les
exécuter.
« Voilà tous les différens caraûeres avec lef-
» quels on peut décrire les mouvemens, aérions, po-
» fitions, que l’on peut faire dans la danfe : il ne ref-
» te plus qu’à les affembler ; mais c’eft ce qui fe fait
» en tant de maniérés, que fi je puis y réuffir, com-
» me je l’efpere, j’aurai lieu d’être fatisfait de mes
» réflexions, dit l’auteur ».
Nous allons voir comment l’auteur y réufîit.
Ces deux lignes — indiquent que le pié droit
commence & achevé fon mouvement, & que le pié
gauche commence & finit le lien après ; ce qui eft
marqué par la ligne de deffus qui eft pour le pié droit,
laquelle précédé l’autre félon notre maniéré d’écrire
de gauche à droite : la ligne de deffous eft pour îe
pié gauche ; elle n’eft tracée qu’après l’autre ; ce qui
fait connoître que le pié qu’elle -repréfente ne doit
marcher qu’après que l’autre a fini ion mouvement.
Ces deux autres lignes — font connoître que
le pié gauche commence & finit fon mouvement, &
que le pié droit commence & achevé le fien après.
Ces deux autres lignes — indiquent que le pié
droit commence fon mouvement, & que dans le milieu
de celui-ci lè pié gauche commence le fien ,
qu’ils continuent enfemble;, que le pié droit finit le
premier , & que le pié gauche achevé après.
Ces deux lignes ~ font connoître que le
pié droit & le pié gauche commencent enfemble ,
& que le pié droit finit fon mouvement après celui
du pié gauche.
Ces deux autres lignes , font connoître
que le pié droitcommence le premier fon mouvement,
& que le pié gauche commence après, qu’ils
continuent enfemble , & finiffent.en même tems. -
Ces deux autres lignes ~ font connoître que le
pié droit & le pié gauche commencent & finiffent
leurs mouvemens enfemble.
Ainfi de toutes les combinaifons poffibles deux à
deux des lignes repréfentées fig. 19. 20.2.1.22. 23-,
24. dont il leroit trop long de faire l’énumération.-
Les fig. 3 7 ' 38. 3 £). ont déjà fait connoître trois
fituations ; les trois fuivantes en repréfentent encore
d’autres : ainfi par la fig. 40. on verra le pié droit
devant le corps, & le pié gauche derrière.
Parla fig. 41. on verra le pié droit devant & de
cô té , & par conféquent le pié gauche derrière &
de côté,.
Par la fig. 41. on verra la fituation qu’on appelle
croifée, le pié droit devant la partie gauche du corps-,
& le pié gauche derrière la partie droite ; £ vice verfâ
de toutes Ijes combinaifons dont ces arrangemens
font fufceptibles.
Ces trois derniers exemples qui montrent les fituations
ou pofitions naturelles , peuvent encore
être enfemble ou écartés , en y ajoûtant le point ou
la petite ligne.
Toutes c es fituations pourront être un pié en
l’a ir , en donnant à la lettre qui repréfente ce pié la
marque de cette circonftance qui a été ci-devant expliquée.
Nous allons paffer aux exemples de l’emploi
de la ligne marché.
La. fig. 43. repréfente la fituation ou pofition qui
eft le pié gauche à terre devant, & le pié droit en
l’air derrière. On connoîtra la pofition en ce qu’elle
fera toûjours la première de chaque danfe, & qu’il
n’y aura point au-deffous de ligne marché; les différentes
pofitions des piés qui pourroient y être, étant
affez démontrées précédemment pour les connoître.
Cette pofition tient dans la danfe lieu de clé , dont
l’ufage en Mufique eft de faire connoître le ton & le
mode de chaque air, & le premier fon par lequel il
commence ; de même celle-ci montre le lieu de la
falle où la danfe doit commencer, en fe la repré-
fentant toujours comme renfermée dans les rettan-
gles formés par les lignes verticales & les portées
de mufique fur lefquelles on écrit la danfe.
De cetté fituation on paffera à la fécondé, (figure
44.) , où on remarquera qu’il faut marcher ce
qui eft marqué par la ligne qui repréfente ce mouvement,
laquelle eft décrite au-deffous de la figure
qui repréfente la falle. Mais comme cette ligne marché
fuppofe que l’un des deux piés doit faire un
mouvement, on connoîtra que c ’eft le pié droit,
puifque la lettre d eft feule dans la falle, & eft au'
côré droit du corps. Mais comme cette lettre eft décrite
la queue retournée à la tête, le pié droit fe portera
en l’a ir , & cette fituation de pié finira cette première
aélion, & fervira de pofition pour paffer à la
luivante. .
La fig. 46. repréfente qu’il faut marcher le pié
droit à terre de côté : après ce mouvement on forti-
ra de terre le pié gauche, qui doit relier en l’àir au-
deffus de l’endroit où il étoit .pofé.. On ne marque rien
pour cette a&ion du pié gauche, parce qu’elle eft né-
ceffaire pour achever lè pas. Lorfque les mouvemens
qui fe fuivent fe font par des piés différens, la fin de
cette aérion eft une fituation naturelle ; celle des piés
enfemble ou écartés, fera marquée par un cara&ere
particulier.
La figure fuivante (4<5\) repréfente qu’il fautmar-
cher le piq gauche croifé devant fortant de terre,le
pié droit joignant au derrière du talon du pié gauche.
Cette fituation enfemble étant marquée par un point
qui eft au derrière du corps, ce point fe place à côté
du corps, fi on finit cette aftion les piés enfemble de
côté.
La fig. 47. repréfente qu’il-faut marcher le pié
droit à terre de côté, & que le pié gauche fortira de
terre Sg. fe portera écarté en l’air au côté gauche du
corps : cette derniere circonftance eft marquée par la
lettre g fépârée du corps par une petite ligne verticale
, qui lignifie, ainfi qu’il a été dit, que le pié eft
éloigné du corps.
La fig. 48. que l’on ne regardera que comme l’explication
de la 47. repréfentera par conféquent la
même chofe ; elle indiquera de plus par les deux lignes
qui y font décrites, que le pié droit , marchera
le premier, & que le pié gauche marchera enfuite ;
la ligne de deffous, ainfi qu’il a été dit, étant pour
celui-ci, & étant poftérieure par rapport à celle de
l’autre pié.
Après avoir donné ces exemples pour la ligne
marché fur laquelle on place les lignes des agrémens,
comme plié, élevé, fauté, cabriolé, &c. il eft bon
d’examiner ces mêmes marques , pour connoître
toutes les places que le corps peut occuper fur la ligne
de front.
Par la fig. 43. on verra que le corps eft pofé au
milieu du côté gauche de la falle ; c’eft la pofition
dans laquelle la figure 43. le repréfente au même
lieu , puifque l’aftion qui y eft marquée n’oblige
point le corps à faire aucun changement ; le pié en
l ’air qui eft derrière la pofition le porte en l’air de
côté à la fig. 44' laiffant toûjours le poids du corps
fur le pié gauché : les fig. 44. 46. 4 17. 47. le repréfentent
un peu plus éloigné de ce-côté; ce qui fe
peut encore en autant d’autres places que l’on jugera
à-propos, félon le nombre de pas qui peuvent
être faits en la largeur d’une falle ; les fituations fur
la longueur font marquées par les lignes des portées
& les intervalles des mêmes lignes.
En donnant à toutes les places les feize afpeéls
dont il eft parlé ci-deffus, & qui font représentés
fig. 11. il eft certain qu’il n’y a pas un feul endroit
d’une falle où l’on ne puiffe marquer telle pofition
des piés & fituation du corps que l’on voudra; ce qui
eft tout ce que l’on fe propofe de faire quand on veut
écrire une danfe fur le papier.
On écrit auffi dans ce nouveau fyftème l’air au-
deffus de la danfe, & le tout fur du papier de mufique
ordinaire , enforte qu’au premier çoup-d’oeil
une danfe écrite en cette maniéré paroît un duo ou
un trio , &c. fi deux ou plufieurs danfeurs danfent
enfemble.
Nous avons promis de comparer enfemble ces
deux maniérés, nous tenons parole : nous croyons ,
quoique l’invention de cet auteur foit ingénieufe ,
que l’on doit cependant s’en tenir à celle du fieur
Feuillet, où la figure dès chemins eft repréfentée ,
fur-tout depuis que nous y avons fait le changement
communiqué par M. Dupré, au moyen duquel on
connoît la valeur des pas par la couleur de leur tête,
ainfi qu’il a été expliqué dans la première partie dé
cet article. L’inconvénient de ne point marquer les
chemins eft bien plus important que celui qui réful-
te de ne point écrire la mufique fur les lignes & dans
les intervalles , comme quelques auteurs l’avoient
propofé. Foyt{ l'article Musique , où ces chofes
font difeutées. (D )
CHOREN, ( Géog.) petite ville d’Allemagne dans
la Mifnie, proche d’Aélembourg.
* CHORÉVÉQUES, fub. m. (Théol.y celui qui
exerçoit quelques fondrions épifcopales dans les
bourgades & les villages. On l ’appelloit le vicaire de
l'évêque. Il n’eft pas queftion dans l’Eglife de cette
fonftion avant le jv. fiecle. Le concile d’Antioùhe
tenu en 340 marque fes limites. Armentarius fut
réduit à la qualité de chorèvêque en 439 par le concile
de Riez , 1e Ier de ceux d’Occident où il foit parlé
de cette dignité. Le pape Léon III. l’eût abolie, s’il
n’en eût été empêché par le concile deRatisbonne.Le
chorèvêque ,.au-deffus des autres prêtres, gouvernoit
fous l’évêque dans les villages. Il n’étoit point ordonné
évêque; il avoit rang dans les conciles après
les évêques en exercice & parmi les évêques qui
n’exerçoient pas ; il ordonnoit feul. des clercs mif
ncurs & des foûdiacres, & des diacres & des prê4<
très fousTéyêque. Ceux d’Ocçident portèrent l’ex-
tenfion de leurs privilèges prefqu’à toutes les fondrions
épifcopales ; mais cetté entreprife ne fut pas
tolérée. Les chorévéques cefferent prefque entièrement
aux. fiecle, tant en Orient qu’en Occident, où '
il paroît qu’ils ont eu pour fucceffeurs les archiprê-
tres & les doyens ruraux. Fiay^ARCHiPRÊTRES &
D o yen s. Il y a cependant des dignitaires encore
plus voifins des anciens chorévéques ; ce font les
grands-vicaires , tels que celui de Pontoife , auxquels
les évêques ou archevêques ont confié les
fondrions épifcopales fur une portion d’un diocèlè
trop étendu pour être adminiftré par un feul fupé-
rieur. Le premier des foûdiacres de S. Martin d’U-
trecht, & le premier chantre des collégiales de Cologne
, ont titre de chorévéques & fondrion de doyens
ruraux. L ’églife de Treves a auffi des chorévéques.
Ce nom vient de yopoc, lieu, & de t-nr/moTroc, évêque,
évêque d’un lieu particulier. Foye^ Evêque , Arch
e v êq u e , &c.
CHORGES, (Géog.') petite ville de France en
Dauphiné. Long. 24. lat. 44. 36.
CHORGO, (Géog.) petite ville de la baffe Hongrie
, près d’Albe royale.
CHORIAMBE, fi. m. (Belles-Lett.) dans l’ancienne
Poéfie, pié ou mefure de vers compofée d’un
chorée ou trochée & d’un ïambe, c’eft-à-dire de
deux brèves entre deux longues , comme hïfldrïàs. HH , , WÊ CHORION, fi m. (Anal.) eft la membrane extérieur
e qui enveloppe le foetus dans la matrice. Foyeç
Foetus. Ce mot vient du grec %opt7v, contenir.
Elle eft épaiffe & forte, polie emdedans , par où
elle s’unit à une autre membrane appellée amnios ,
mais rude & inégale en-dehors , parfemée d’un
grand nombre de vaiffeaux, & attachée à la matrice
par le moyen du placenta qui y eft fort adhérent.
Foye^ Amnios , Pla c en ta .
Cette membrane.fe trouve dans tous les animaux.’
Le chorion, avec l’amnios & le placenta, forme ce
qu’on appelle les fecondines ou Y arriéré-faix. Foyeç
Secondines. (L)
CHORISTE, fi m. chanteur qui chante dans les
choeurs de l’opéra ou dans ceux des motets au concert
fpirituel, & dans leséglifes. Foye^C hanteur
& C hantre ; voye{ auffi C hoeur. (B )