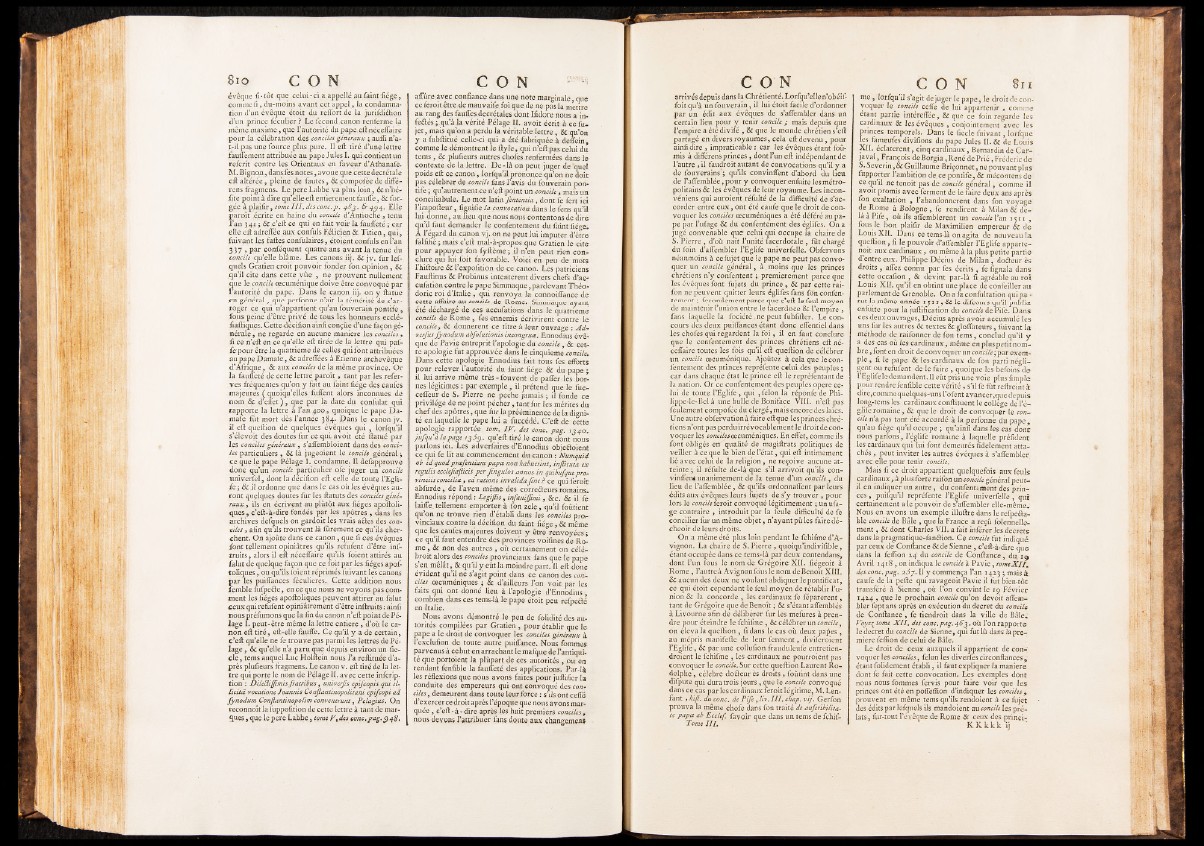
évêque fl-tôt que celui-ci a appelle au faintfiége,
comme l i , du-moins avant cet appel, la condamnation
d’un évêque étoit du reffort de ,1a jurifdiftion
d’un prince féculier ? Le fécond,canon renferme la
même niaxime, que l’autorité du pape,eft néceflaire
pour la célébration deS conciles généraux ; aulïi n’a-
t-il pas une fource plus pure. Il eft tiré d’une iettre
faulfement attribuée au pape Jules I. qui,contient un
referit contre les Orientaux en fayçur d’Athanafe.
M. Bignon, dansfes notes, avoue que cette deçrétale
eft altérée, pleine de fautes, & .compofée de différons
fragmens. Le pere Labbe va plus loin, & n ’hér
fite point à dire qu’elle eft entièrement fauffe, & forgée
àplaifir, tome I I I . desconc.p. 483. & 494. Elle
paroît qqrite en haine du concile d’Antioche , tenu
l ’an 34J ; & c’eft ce qui en fait voir la fauffeté ; car
elle eft adreffée aux confuls F,élicien & Titien, qui,
fuivant les faites confulaires, étoient,confuls en l’an
337 , par conféquent quatre ans avant la tenue du
concile qu’elle blâme. Les canons iij. & jv. fur lef-
quels Gratien croit pouvoir fonder fon .opinion, &
.qu’il cite dans cette vûe , ne prouvent nullement
que le concile oecuménique doive être convoqué par
l ’autorité du pape. Dans le canon iij. on y ftatue
.en général, que perfonne n’ait la témérité de s’arroger
ce qui n’appartient qu’au fouverain pontife ,
fous peine d’être privé de tous les honneurs ecclé-
fiaftiques. Cette-décifion ainli conçue d’une façon générale
, ne regarde en aucune maniéré les conciles,
li ce n’elt en ce qu’elle eft tirée de la lettre qui paf-
fe pour être la quatrième de celles qui font attribuées
au pape Damalè, ôc adrelfées à Etienne archevêque
d’Afrique, & aux conciles de la même province. Or
la fauffeté de cette lettre paroît, tant par les refer-
ves fréquentes qu’on y fait au faint liège des caufes
majeures ( quoiqu’elles fuffent alors inconnues de
nom & d’effet ) , que par la date du cpnfulat qui
rapporte la lettre à l’an 400, quoique le pape Da-
mafe fût mort dès l’année 3 8^4. Dans le canon jv.
il efr queftion de quelques évêques qui , lorfqu’il
s’élevoit des dputes fur ce qui avoit été ftatué par
les conciles généraux , s’affembloient dans des conciles
particuliers , & là jugeoient le concile général ;
ce que |e pape Pélage 1. condamne. Il defapprpuve
donc qu’un concile particulier ofe juger un concile
îiniverlel, dont la décifion eft celle de toute l’Egli-
fe ; & il ordonne que dans le cas où les évêques auront
quelques doutes fur les ftatuts des conciles généraux
, ils en écrivent au plutôt aux fiéges apoftoli-
ques, c’ eft-à-dire fondés par les apôtres , dans les
archives defquels on gardoit les vrais a êtes des conciles
, afin qu’ils trouvent là fûrement ce qu’ils cherchent.
On ajoute dans ce canon, que li ces évêques
font tellement opiniâtres qu’ils refufent d’être inf-
truits, alors il eft néceflaire qu’ils foient attirés au
falut de quelque façon que ce lpit par les fiéges apof-
toliques, ou qu’ils foient réprimés fuivant les canons
par les puiffances fpçulieres. Cette addition nous
lemble fufpeéte, en ce que nous ne voyons pas comment
les fiéges apoftoliques peuvent attirer au falut
ceux qui refufent opiniâtrement d’être inftruits : ainfi
nous préfumons que la fin du canon n’eft point de Pélage
I. peut-être même la lettre entière, d’où le canon
eft tiré, eft-elle fauffe. Ce qu’il y a de certain,
c ’eft qu’elle ne fe trouve pas parmi les lettres de Pélage
, & qu’elle n’a paru que depuis environ un fie-
c le , tems auquel Luc Holftein nous l’a reftituée d’après
plufieurs fragmens. Le canon v . eft tiré de la lettre
qui porte le nom de Pélage II. avec cette inferip-
tion : Dilecliffimis fratribus, univerjîs epifeopis qui il-
licitâ vocatione Joannis Conjlanûnopolitani epifeopi ad
fynodum Conflantinopolim convenerunt, Pelagius. On
reconnoît la luppofition de cette lettre à tant de marques
, que le pere Labbe , tome V^dcs çonc.pag.^S.
affûre avec confiance dans une note marginale, que
ce feroitêtrede mauvaifefpi que de ne pas la mettre
au rang des fauffes. décrétales dont Ifidore nous a infectés.;,
qu’à la vérité Pélage II. avoit écrit à.ce fu-
jet, mais qu’on a perdu la véritable lettre, & qu’on
y a fubftitué celle-ci qui a été fabriquée àdeffein,
comme le démontrent le fty le , qui n’eft pas celui du
tems , & plufieurs autres çhofe.s renfermées dans le
contexte de la lettre. D e - là on peut juger de 'quel
poids eft ce canon, lorfqu’jjl prononce qu’on ne doit
pas célébrer de .concile fans l’avis du fouverain pontife
; qu’autrement ce n’eft point un concile , mais un
conciliabule. Le mot latin fententia, dont fe fert ici
l’impofteur, fignifie la çonvflcatio.n dans le fens qu’il
lui donne, au fieu que nous nous contentons de dire
qu’il faut demander le confentement du faint fié^e.
A l’égard du canon v j. on ne peut lui imputer d’être
falfifié ; mais c’eft mal-à-propos que Gratien le cite
pour appuyer fon fyftème ; il n’en peut rien conclure
qui lui foit favorable. Voici en peu de mots
l’hiftoire & l’expofition de ce canon. Les patriciens
Fauftinus & Probinus intentèrent divers chefs d’ac-
eufation contre le pape Simmaque ,pardevant Théo*
doric roi d’Italie , qui renvoya la connoiffance de
cette affaire au concile, de Rome. Simmaque ayant
été déchargé de ces aecufations dans le quatrième
concile de Rome , fes ennemis écrivirent contre le
concile, & donnèrent ce titre à leur ouvrage : Ad-*
v.erfus fynodum abfolutionis incongmee. Ennodius évêque
de Pavie entreprit l’apologie-du concile, & cette
apologie fut approuvée dans le cinquième concile.
Dans cette apologie Ennodius fait tous fes efforts
pour relever l’autorité du faint fiége & du pape ;
il lui arrive même très - fouyent de paffer les bornes
légitimes : par exemple, il prétend que le fu o
ceffeur de S, Pierre ne peche jamais ; il fonde ce
privilège de ne point pécher, tant fur les mérites du
chef des apôtres, que fur la prééminence de la dignité
en laquelle le pape lui a fuccédé. C ’eft de cette
apologie rapportée tom. IV. des conc. pag. 1340.
jufquàlapage 135$ . qu’eft tiré le canon dont nous
parlons ici. Les adverfaires d’Ennodius obje&oient
ce qui fe lit au commencement du canon : Numquid
ob id quod prafçntiam papa non habuerint, inftituta ex
regulis ecclejiaflicis per Jîngulos annos in quibufque pra-
yincüs concilia , eâ ratione invalidaJînt > ce qui feroit
abfurde, de l’aveu même des corre&eurs romains.
Ennodius répond : Legijlis, infaniffimi , &c. & il fe
laiffe. tellement emporter à fon zele, qu’il foûtient
qu’on ne trouve rien d’établi dans les conciles pro»-
vinciaux contre la décifion du faint fiége , & même
que les caufes majeures doivent y être renvoyées ;
ce qu’il faut entendre des provinces voifines de Rome
, & non des autres , où certainement on célé-
broit alors des conciles provinciaux fans que le pape
s’en mêlât, & qu’il y eût la moindre part. II eft donc
évident qu’il ne s’agit point dans ce canon des corn*
elles oecuméniques ; & d’ailleurs l’on voit par les
faits qui ont donne lieu à l’apologie d’Ennodius ;
combien dans çes tems-là le pape étoit peu refpeûé
en Italie.
Nous avons démontré le peu de folidité des autorités
compilées par Gratien, pour établir que le
pape a le drqit de convoquer les conciles généraux à
l’exclufion de toute autre puiffance. Nous fommes
parvenus à ce but en arrachant le mafque de l’antiqub
té que portoient la plûpart de ces autorités , ou en
rendant fenfible la fauffeté. des applications. Par-là
les réflexions que nous avons faites pour juftifîer la
conduite des empereurs qui ont convoqué des conciles,
demeurent dans toute leur force : s’ils ont ceffê
d’exercer ce droit après l’époque que nous avons marquée
, c’eft-à-dire après les huit premiers conciles,
nous devons l’attribuer fans doute aux changement
arrivés depuis dans la Chrétienté. Lorfqu’ellen’obéif-
foit qu’à un fouverain, il lui étoit facile d’ordonner
par un édit aux évêques de s’affembler dans un
certain lieu pour y tenir concile ; mais depuis que
l’empire a été divifé , & que le monde chrétien s’eft
partagé en divers royaumes, cela eft devenu, pour
ainfi dire , impraticable : car les évêques étant fournis
à différens princes , dont l’un eft indépendant de
l ’autre, il faudroit autant de convocations qu’il y a
de fouverains’; qu’ils convinffent d’abord du lieu
de Paffemblée, pour y convoquer enfuite les métropolitains
& les evêques de leur royaume. Les incon-
véniens qui auroient réfulté de la difficulté de s’accorder
entre eu x, ont été caufe que le droit de convoquer
les conciles oecuméniques a été déféré au pape
par l’ufage & du confentement des églifes. On a
jugé convenable quo celui qui occupe la chaire de
S. Pierre , d’où naît l’unité lacerdotale , fût chargé
du foin d’affembler l’Eglife univerfelle. Obfervons
néanmoins à cefujet que le pape ne peut pas convoquer
un concile général, à . moins que les princes
chrétiens n’y confentent ; premierement parce que
les évêques font fujets du prince , & par cette rai-
fon ne peuvent quitter leurs églifes fans fon confentement
; fecondement parce que c’eft le feul moyen
de maintenir l’union entre le l’acerdoce & l’empire ,
fans laquelle la fociété .ne peut fubfifter. Le concours
des deux puiffances étant donc effentiel dans
les chofes qui regardent la f o i , il en faut conclure
que le confentement des princes chrétiens eft néceffaire
toutes les fois qu’il eft queftion de célébrer
un concile oecuménique. Ajoutez à cela que le confentement
des princes repréfente celui des peuples ;
car dans chaque état le prince eft le repréfentant de
la nation. Or ce confentement des peuples opéré celui
de toute l’Eglife, qui , félon la réponfe de Phi-
lippe-le-Bel à une bulle de Boniface VIII. n’eft pas
feulement compofée du clergé, mais encore des laïcs.
Une autre obfervationà faire eft que les princes chrétiens
n’ont pas perdu irrévocablement le droit de convoquer
les conciles oecuméniques. En effet, comme ils
font obligés enf^qualité de magiftrats politiques de
veiller à ce que le bien de l’état, qui eft intimement
lié avec celui de la religion, ne reçoive aucune atteinte
; il réfulte de-là que s’il arrivoit qu’ils con-
vinffen* unanimement de la tenue d ’un concile, du
lieu de l’affemblée, & qu’ils ordonnaffent par leurs
édits aux évêques leurs fujets de s’y trouver , pour
lors le concile feroit convoqué légitimement ; un ufa-
ge contraire , introduit par la feule difficulté de fe
concilier fur un même objet, n’ayant pû les faire dé-
cheoir de leurs droits.
On a même été plus loin pendant le fchifme d’Avignon.
La chaire de S. Pierre , quoiqu’indivifible,
étant occupée dans ce tems-là par deux contendans,
dont l’un fous le nom de Grégoire XII. fiégeoit à
Rome , l’autre à Avignon fous le nom de Benoit XIII.
& aucun des deux ne voulant abdiquer le pontificat,
ce qui étoit cependant le feul moyen de rétablir l’union
& la concorde , les cardinaux fe féparerent,
tant de Grégoire que de Benoît ; & s’étant affemblés
à Livourne afin de délibérer fur les mefiires à prendre
pour éteindre le fchifme , & célébrer un concile,
on éleva la queftion , fi dans le cas où deux papes ,
au mépris manifefte de leur ferment, diviferoient
l’Eglife, & par une collufion frauduleufe entretien-
droient le fchifme , les cardinaux ne pourroient pas
convoquer le concile. Sur cette queftion Laurent Rodolphe
, célébré dofreur ès droits, foûtint dans une
difpute qui dura trois jours , que le concile convoqué
dans ce cas par les cardinaux feroit légitime, M. Len-
fan t, hiß. du conc. de Pife, liv. III. chap. vij. Gerfon
prouva la même chofe dans fon traité de auferibilita-
te papa ab Ecdef. favoir que dans un tems de fehif-
Tome III.
me, lorfqu’il s’agit déjuger le pape, le droit de convoquer
le concile ceffe de lui appartenir , comme
étant partie intéreffée, & que ce foin regarde les
cardinaux & les évêques , conjointement avec les
princes temporels. Dans le fiecle fuivant, lorfque
les fameiîfes divifions du pape Jules II. & de Louis
XII. éclatèrent, cinq cardinaux, Bernardin de Car-
javal, François de Borgia, René de Prié, Frédéric de
S. Severin, & Guillaume Briçonnet, ne pouvant plus
fupporter l’ambition de.ee pontife, & mécontens de
ce qu’il ne tenoit pas de concile général, comme il
avoit promis avec ferment de le faire deux ans après
Ion exaltation , l’abandonnèrent dans fon voyagé
de Rome à Bologne , fe rendirent à Milan & delà
à P ife, où ils affemblerent un concile l’an 1511 ,
fous le bon plaifir de Maximilien empereur & de
Louis XII. Dans ce tems-là on agita de nouveau la
queftion, fi le pouvoir d’affembler l’Eglife apparte-
noit aux cardinaux, ou même à la plus petite partie
d’entre eux. Philippe Décius de Milan, dofteur ès
droits , affez connu par fes écrits , fe fignala dans
cette occafion , & devint par-là fi agréable au rot
Louis XII. qu’il en obtint une place de confeiller au
parlement de Grenoble. On a fa confultation qui pa -
rut la même année 1 5 1 1 , & le difeours qu’il publia
enfuite pour la juftification du concile de Pife. Dans
ces deux ouvrages, Décius après avoir accumulé les
uns fur les autres & textes ôc gloffateurs, fuivant la
méthode de raifonner de fon tems, conclud qu’il y
a des cas où les cardinaux, même en plus petit nombre
, font en droit de convoquer un concile ; par exemple
, fi le pape & les cardinaux de fon parti négligent
ou refufent de le faire , quoique les befoins de
l’Eglife le demandent. Il eût pris une voie plus fimple
pour rendre fenfible cette vérité , s’il fe fût reftreintà
dire,comme quelques-uns l’ofent avancer,que depuis
long-tems les cardinaux conftituent le collège de l’é-
glife romaine, & que le droit de convoquer le concile
n’a pas tant été accordé à la perfonne du pape ,
qu’au fiége qu’il occupe ; qu’ainfi dans les cas dont
nous parlons, l’églife romaine à laquelle préfident
les cardinaux qui lui font demeurés fidèlement attachés
, peut inviter les autres évêques à s’affembler
avec elle pour tenir concile.
Mais fi ce droit appartient quelquefois aux feuls
cardinaux , à plus forte raifon un concile général peut-
il en indiquer un autre, du confentement des princes
, puilqu’il repréfente l’Eglife univerfelle, qui
certainement a le pouvoir de s’affembler elle-même.
Nous en avons un exemple illuftre dans le refpeâa-
ble concile de Bâle , que la France a reçû folennelle-
ment, & dont Charles VII. a fait inférer les decrets
dans la pragmatique-fanfrion. Ce concile fut indiqué
par ceux de Confiance & de Sienne, c’eft-à-dire que
dans la feflion 24' du concile de Confiance, du 19
Avril 1418 , on indiqua le concile à Pavie, tomeXII.
des.conc. pag. %5 j . Il y commença l’an 1423 ; mais à
caufe de la pefte qui ravageoit Pavie il fut bien-tôt
transféré à Sienne , où l’on convint le 19 Février
1424 , que le prochain concile qu’on devoit affeai-
bler fept ans après en exécution du decret du concile
de Confiance, fe tiendroit dans la ville de Bâle.
Voyc%_ tome X I I . des conc.pag. 46"3. où l’on rapporte
le decret du concile de Sienne, qui futlû dans la première
feflion de celui de Bâle.
Le droit de ceux auxquels il appartient de con-i
voquerles conciles, félon les diverfes circonftances ,
étant folidement établi, il faut expliquer la maniéré
dont fe fait cette convocation. Les exemples dont
nous nous fommes fervis pour faire voir que les
princes ont été en poffeflion d’indiquer les conciles ,
prouvent en même tems qu’ils rendoient à ce fujet
des édits par Iefquels ils mandoient au concile les prélats,
fur-tout l’évêque de Rome & ceux des princi-
K K .k k k ij "