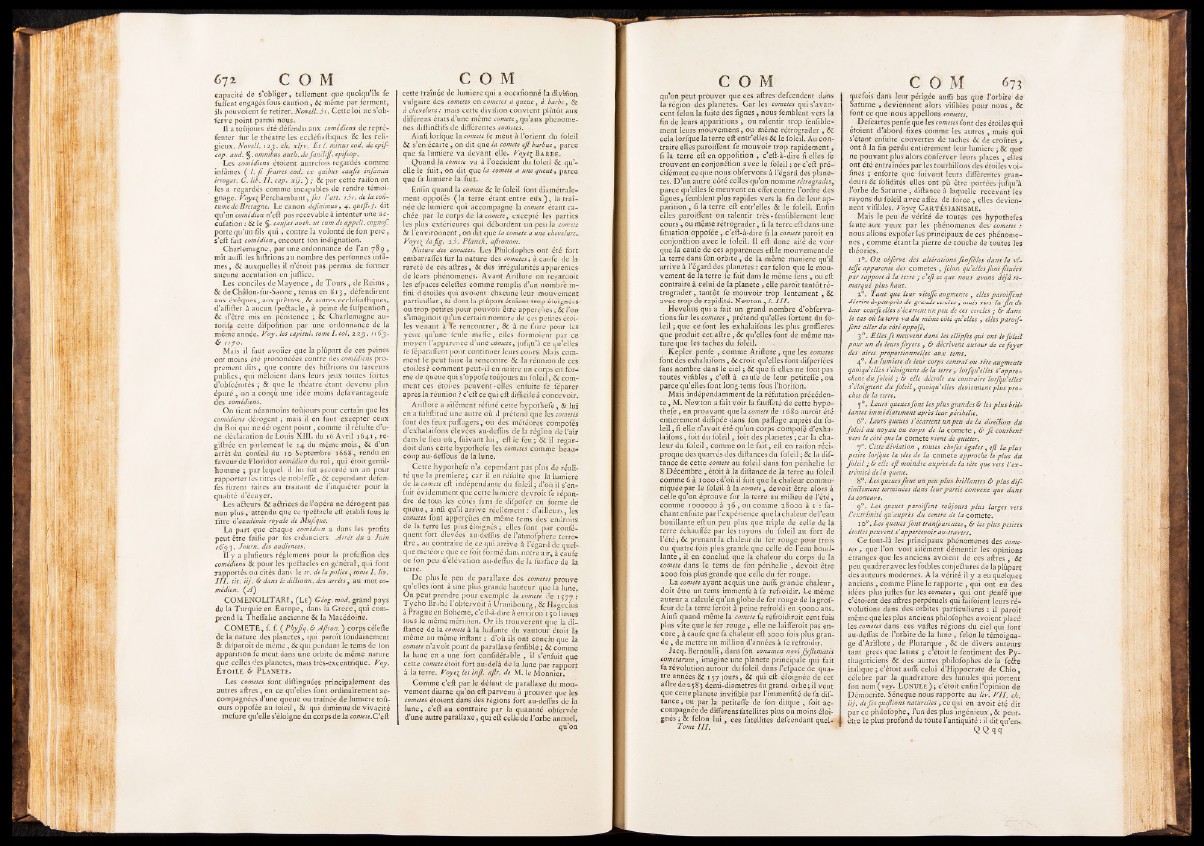
capacité de s’obliger, tellement que quoiqu’ils fe
fuirent engagés fous caution, & même par ferment,
ils pou voient fe retirer. Novell, â i. Cette loi ne s’ob-
ferve point parmi nous.
Il a toûjours été défendu aux comédiens de repré-
fenter fur le théâtre les eccléfiaftiques & les religieux.
Novell. 123. ch. x ljv . E t l. minus cod. de epif-
cop. and. § . omnibus auth.de fanclijf. epifcop.
Les comédiens étoient autrefois regardés comme
infâmes ;( l .J i fratres cod. ex quibus caujis infamia
irrogat. Ç. lib. I I . cap. x ij. ) ; & par cette raifon on
les a regardés comme incapables de rendre témoignage.
Voye^ Perchambaut , fu r l'art. 1S1. de la coutume
de Bretagne. Le canon definimus, 4. quefl.j. dit
qu’un comédien n’eft pas recevable à intenter une ac-
cufation : & le §. caufas auth. ut cum de appell. cognof.
porte qu’un fils qui , contre la volonté de fon pere,
s’eft fait comédien, encourt Ion indignation.
Charlemagne, par une ordonnance de l’an 789 ,
mit auffi les hiftrions au nombre des perfônnes infâmes
, & auxquelles il n’étoit pas permis de former
aucune acculâtion en juftice.
Les conciles de M ayence, de T ou r s , de Reims,
& deChâlon-fur-Saone, tenus en 813, défendirent
aux évêques, aux prêtres, & autres eccléfiaftiques,
d’affifter à aucun fpe&acle, à peine de fufpenfion,
& d’être mis en pénitence ; &c Charlemagne au-
toriÇi cette difpofition par une ordonnance de la
même année. Voy. les capital, tome I . col. 2 2 $ . 11S 3 .
& n j o .
Mais il faut avoiier que la plupart de ces peines
ont moins été prononcées contre des comédiens proprement
dits, que contre des hiftrions ou farceurs
publics, qui mêloient dans leurs jeux toutes fortes
d’obfcénités ; & que le théâtre étant devenu plus
épuré , on a conçu une idée moins defavantageufe
des comédiens.
On tient néanmoins toûjours pour certain que les
comédiens dérogent ; mais il en faut excepter ceux
du Roi qui ne dérogent point, comme il réfulte d’une
déclaration de Louis XIII. du 16 Avril 1641, re-
giftrée en parlement le 24 du même mois, & d’un
arrêt du confeil du 10 Septembre 1668, rendu en
faveur de Floridor comédien du ro i, qui étoit gentilhomme
; par lequel il lui fut accordé un an pour
rapporter fes titres de nobleffe, & cependant défen-
fes furent faites au traitant de l’inquiéter pour la
qualité d’écuyer.
Les aâeurs & aârices de l’opéra ne dérogent pas
non plus, attendu que ce lpeftacle eft établi fous le
titre d’académie royale de Mujique.
La part que chaque comédien a dans les profits
peut être faifie par fes créanciers. Arrêt du 2 Juin
y 6 c)3 . Journ. des audiences.
Il y a plufieurs réglemens pour la profeflion des
comédiens & pour les fpettacles en général, qui font
rapportés ou cités dans le tr. de la police j tome I . liv.
I I I . tit. iij. & dans le diclionn. des arrêts, au mot comédien.
(A')
COMENOLITARI, (Le) Géog.mod. grand pays
de la Turquie en Europe, dans la Grece, qui comprend
la Theffalie ancienne & la Macédoine.
COMETE, f. f. ( Phyjiq. & Aflron. ) corps célefte
de la nature des planètes, qui paroît foudainement
& difparoît de même, 6c qui pendant le tems de fon
apparition fe meut dans une orbite de même nature
que celles des planètes, mais très-excentrique. Voy.
Eto ile & Planete.
Les cometes font diftinguées principalement des
autres aftres, en ce qu’elles font ordinairement accompagnées
d’une queue ou traînée de lumière toû-
ours oppofée au foleil, & qui diminue de vivacité
mefure qu’elle s’éloigne du corps de la comete.C'eü
cette traînée de lumière qui a occafionné la divifion
vulgaire des cometes en cometes à queue, à barbe, &
à chevelure: mais cette divifion convient plutôt aux
différens états d’une même comete, qu’aux phénomènes
diftin&ifs de différentes cometes.
Ainfi lorfque la comete fe meut à l’orient du foleil
& s’en écarte, on dit que la comete efi barbue, parce
que fa lumière va devant elle. Voye^ Barbe.
Quand la comete. y a à l’occident du foleil & qu’elle
le fuit, on dit que la. comete a une queue, parce
que fa lumière la fuit.
Enfin quand la comete Si le foleil font diamétralement
oppofés ( la terre étant entre e d x ) , la traînée
de lumière qui accompagne la comete étant cachée
par le corps de la comete, excepté les parties
les plus extérieures qui débordent un peu la comete
& l’environnent, on dit que la comete a une chevelure..
Voye£ la fig. 25, Planch. afironom.
Nature des cometes. Les Philofophes ont été fort
embarraffés fur la nature des cometes, à caufe de la
rareté de ces aftres, & des irrégularités apparentes
de leurs phénomènes. Avant Ariftote on regardoit
les efpaces céleftes comme remplis d’un nombre infini
détoiles qui avoient chacune leur mouvement
particulier, & dont la plûpart étoient trop éloignées
ou trop petites pour pouvoir être apperçûes ; & l’on
s’imaginoit qu’un certain nombre de ces petites étoi-:
les venant à ‘Te rencontrer, & à ne faire pour les'
y eux. qu’une feule maffe, elles formoient par ce.
moyen l’apparence d’une comete, jufqu’à ce qu’elles
fe féparaffent pour continuer leurs cours. Mais comment
fe peut faire la rencontre & la réunion de ces
étoiles ? comment peut-il en naître un corps en forme
de queue qui s’oppofe toûjours au foleil, Si comment
ces étoiîes peuvent-elles enfuite fe féparer
après la réunion ? c’eft ce qui eft difficile à concevoir.
Ariftote a aifément réfuté cette hypothefe, & lui
en a fubftitué une autre où il prétend què les cometes
font des feux paffagers, ou des météores compofés
d’exhalaifons élevees au-deffus delà région de l’air
dans le lieu o ù , fuivant lui, eft le feu ; & il regardoit
dans cette hypothefe les cometes cdmme beaucoup
au-deffous de la lune.
Cette hypothefe n’a cependant pas plus de réalité
que la première; car il en réfulte que la lumière
de la comete eft indépendante du foleil ; d’où il s’enfuit
évidemment que cette lumière devroit fe répandre
de tous les côtés fans fie difpofer en forme de
queue, ainfi qu’il arrive réellement : d’ailleurs, les
cometes font apperçûes eh même tems des endroits
de la terre les plus éloignés ; elles font par confé-
quentfort élevées au-deffus de l’atmofphere terre-
ftre, au contraire de ce qui arrive à l’égard de quelque
météore que ce foit formé dans notre air, à caufe
de fon peu d’élévation au-deffus de la furface de là
terre.
De plus le peu de parallaxe des cometes prouve
qu’elles font aune plus grande hauteur que la lune.
On peut prendre pour exemple la comete de 1577.:
Tycho Brahé 1’obfervoit à Uranibourg, Si Hagecius
à Prague en Bohème, c’eft-à-dire à environ 150 lieues
fous le même méridien. Or ils trouvèrent que la di-
ftance de la comete à la luifante du vautour étoit la
même au même inftant : d’où ils ont conclu que la
comete n’avoit point de parallaxe fenfible ; & comme
la lune en a une fort confidérable , il s’enfuit que
cette comete étoit fort au-delà de la lune par rapport
à la terre. Voye^ les infl. a(lr. de M. le Monnier. '
Comme c’eft par le défaut de parallaxe du mouvement
diurne qu’on eft parvenu à prouver que les
cometes étoient dans des régions fort au-deffus de la
lune, c ’eft au contraire par la quantité obfervée
d’une autre parallaxe, qui eft celle de l ’orbe annuel,
qu’on
qu’on peut prouver que ces aftres defcendent dans
la région des planètes. C a r les cometes qui s’avancent
félon la fuite des lignes, nous femblent vers la
fin de leurs apparitions , ou ralentir trop fenfible-
ment leurs mouvemens, ou même rétrograder , S i
cela lorfque la terre eft entr’elles S i le foleil. Au contraire
elles paroiffent fe mouvoir trop rapidement i
fi la terre eft en oppofition , c’eft-à-dire fi elles fe
trouvent en conjonûion avec le foleil : o r c’eft pré-
cifément ce que/nous obfervons à Pégard des planètes.
D ’un autre côté celles qu’on nomme rétrogrades,
parce qu’elles fe meuvent en effet contre l’ordre des
lignes, femblent plus rapides vers la fin de:leur apparition
, fi la terre eft entr’elles & le foleil. Enfin
elles paroiffent ou ralentir très - fenfiblement leur
c ou r s, ou même rétrograder, fi la terre eft dans une
fituation oppofée , c’eft-à-dire fi la comete paroît en
conjonction avec le foleil. Il eft donc ailé de voir
que la caufe de ces apparences eft le mouvement de
la terre dans fon o rb ite , de la même maniéré qu’il
arrive à l’égard des planètes : car félon que le mouvement
de la terre fe fait dans le même fens , ou eft
contraire à celui de la p lanete, elle paroît tantôt rétrograder
, tantôt fe mouvoir trop lentement , &
avec trop de rapidité. Newton, /. III.
Hevelius qui a fait un grand nombre d’obferva-
tions fur les cometes, prétend qu’elles fortent du foleil
; que ce font les exhalaifons les plus groffieres
que produit cet a ftre , S i qu’elles font de même nature
que les taches du foleil.
Kepler penfe , comme Ariftote, que les cometes
font des exhalaifons, S i croit qu’elles font difperfées
fans nombre dans le ciel ; S i que fi elles ne font pas
toutes vifibles , c’eft à caufe de leur pe tite ffe ,ou
parce qu’elles font long-tems fous l’horifon.
Mais indépendamment de la réfutation précédente
, M. Newton a fait voir la fauffeté de cette hypo-
thefe, en prouvant que la comete de 1680 auroit été
entièrement diffipée dans fon paffage auprès du foleil
, fi elle n’avoit été qu’un corps compofé d’exhalaifons
, foit du fo le il, foit des planètes ; car la chaleur
du fo le il, comme on le f a it , eft en raifon réciproque
des quarrés des diftances du foleil ; S i la distance
de cette comete au foleil dans fon périhélie le
8 Décembre , étoit à la diftance de la terre au foleil
comme 6 à 1000 : d’où il fuit .que la chaleur communiquée
par le foleil à la comete, devoit être alors à
celle qu’on éprouve fur la terre au milieu de l’é té ,
comme 1000000 à 36 , ou comme 2.8000 à 1 : fa-
chant enfuite par l’expérience que la chaleur de l’eau
bouillante eft un peu plus que triple de celle de la
terre échauffée par les rayons du foleil au fort de
l’été ; S i prenant la chaleur du fer rouge pour trois
ou quatre fois plus grande que celle de l’eau bouillante
, il en conclud que la chaleur du corps de la
comete dans le tems de fon périhélie , devoit être
2000 fois plus grande que celle du fer rouge.
L a comete ayant acquis une auffi grande chaleur,
doit être un tems immenfe à fe refroidir. L e même
auteur a calculé qu’un globe de fer rouge de la grof-
feur de la terre feroit à peine refroidi en 50000 ans.
Ainfi quand même la comete fe refroidiroit cent fois
plus vîte que le fer rouge , elle ne laifferoit pas encore
, à caufe que fa chaleur eft 2000 fois plus grande
, de mettre un million d’années à fe refroidir.
Jacq. Bernoulli, dans fon conamen novi fyfiematis
cometarum, imagine une planete principale qui fait
fa révolution autour du foleil dans l’efpace de quatre
années & 157 jou rs, S i qui eft éloignée de cet
aftre de 2583 demi-diametres du grand orbe ; il veut
que cette planete invifible par l’immenfité de fa dif-
tan cé, ou par la petiteffe de fon difque , foit accompagnée
de différens fatellites plus ou moins éloignes
; & félon lu i , ces fatellites defeendant queL-ëi i
Tome III, W
quefois dans leur périgée auffi bas que l’orbite de
Saturne , deviennent alors vifibles pour nous , S i
font1 ce que nous appelions cometes.
Defcarfes penfe que les cometes font des étoiles qui
étoient d ’abord fixes comme les autres , mais qui
s’étant enfuite couvertes de taches S i de croûtes ,
ont à la fin perdu entièrement leur lumière ; & que
ne pouvant plus alors conferver leurs places , elles
ont été entraînées par lés tourbillons des étoiles voi-
fines ; enforte que fuivant leurs différentes grandeurs
S i folidités elles ont pû être portéèsjufqu’à
l’orbe de Saturne , diftance à laquelle recevant les
rayons du foleil avec affez de/force , elles deviennent
vifibles. Voyei C artésianisme.
Mais le peu de vérité de toutes ces hypothefes
faute aux yeux par les phénomènes des' cometes :■
nous allons expofer les principaux de ces phénomènes
, comme étant la pierre de touche de toutes les
théories.
i ° . On obferve des altérations fenjîbles dans la vî-
tejfe apparente des cometes , félon qu'ellesfontjïtuèes
par rapport à la terre ; c'ejl ce que nous avon's déjà remarqué
plus haut.
2°. Tant que leur vîtejfe augmente , elles paroiffent
décrire a-pêu-prïs de grands cercles ; mais vers la fin de
leur coürfe elles s'écartent un peu de ces cercles ; & dans
le cas ou l'a terre va du même côté qtt elles , elles paroiffent
aller du côté oppofé.
30. Elles fe meuvent dans les ellipfes qui ont le foleil
pour un de leurs foyers , & décrivent autour de ce foyer
des aires proportionnelles aux tems.
4 0. La lumière de leur corps central ou . tête augmente
quoiqu'elles s'éloignent de la terre , lorfqu'elles s'approchent
du foleil ; & elle décroît au contraire 'lorfqu'elles-
s'éloignent du foleil, quoiqu'elles deviennent plus proches
de la terre.
50. Leurs queues font les plus grandes & les plus brillantes
immédiatement apres leur périhélie.
- ,6°. Leurs queues s'écartent un peu de la direction du
foleil au noyau du corps de la comete, & Je courbent
vers le côté que la comete vient de quitter.
70 . Cette déviation , toutes chofes égales, efi la plus
petite lorfque la tête de la comete approche le plus du
foleil ; 6* elle efi moindre auprès de la tête que vers l'extrémité
de la queue.
8°. Les queues font un peu plus brillantes & plus difi
tinclement terminées dans leur partie convexe que dans
la concave.
9®. Les queues paroiffent toujours plus .larges vers
Vextrémité qu auprès du centre de la comete.
10°. Les queues font tranfparentes, & les plus petites
étoiles peuvent s'appercevoir au-travers.
C e font-là les principaux phénomènes des cometes
, que l’on voit aifément démentir les opinions
étranges-que les anciens avoient de ces aftres , &
peu quadreràvec les foibles cohjeâures de la plûpart
des auteurs modernes. A la vérité il y a eu quelques
anciens , comme Pline le rapporte , qui ont eu des
idées plus juftes fur les cometes, qui ont penfé que
c’étoient des aftres perpétuels qui-faifoient leurs révolutions
dans des orbites particulières : il paroît
même que les plus anciens philofophes avoient placé
les cometes dans ces vaftes régions du ciel qui font
au-deffus de l’orbite de la lune , félon le témoignage
d’Ariftote, de Plutarque , & de divers auteurs
tant grecs que latins' ; c’étoit le fentiment des Pythagoriciens
& des autres philofophes de la feû e
italique ; c’étoit auffi celui d’Hippocrate de C h io ,
célébré par la quadrature des lunules qui portent
fon nom (voy. L unule ) ; c’étoit enfin l’opinion de
Démocrite. Séneque nous rapporte au liv. VII. ch.
ïij. de fes quefiions naturelles, ce qui en avoit été dit
par ce philofophe, l’un des plus ingénieux, & peut-
être le plus profond de toute l’antiquité : il dit qu’en