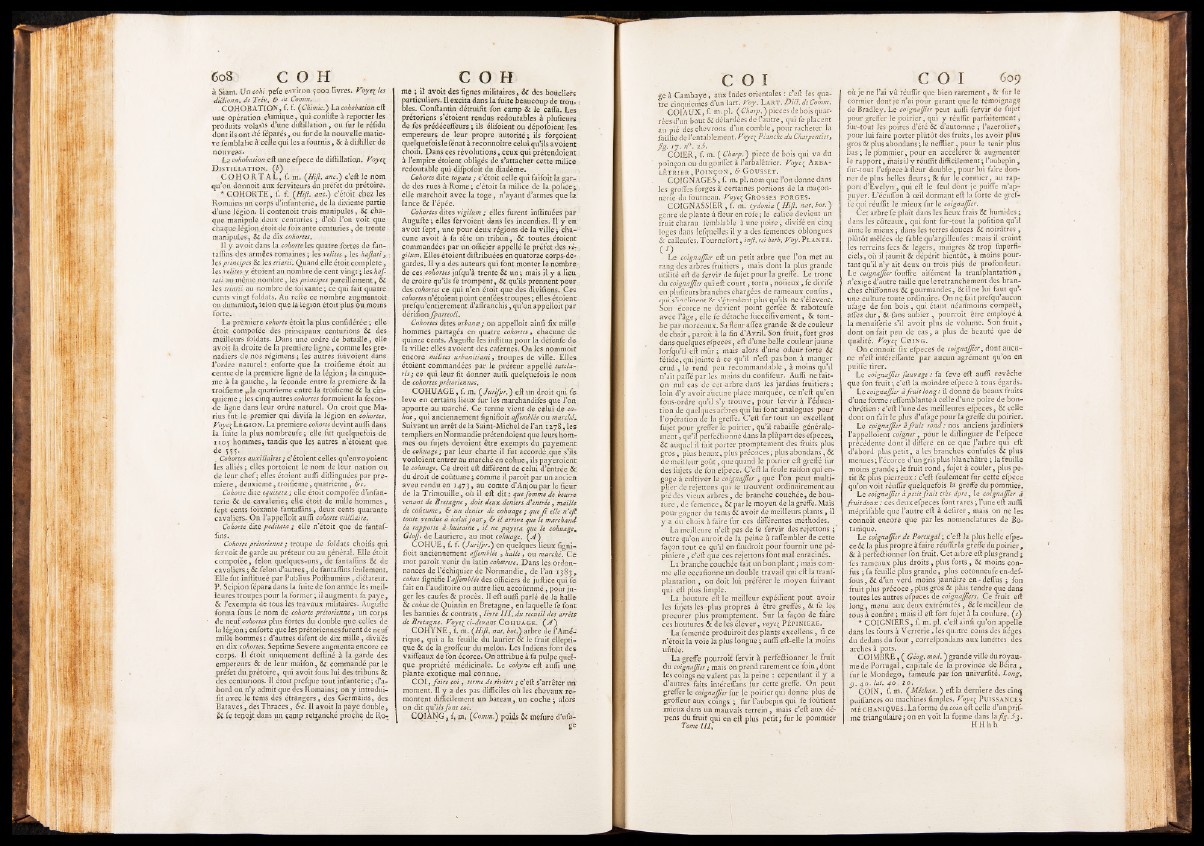
à Siam. \5 ncohi pefe environ. 5000 livres. Voye\ les
dïçHonn. de Trév. & Lu Comrn, .
COHOBATION» f- f. ( Chimie.) La cohobation eft
«ne opération comique, qui confifte à reporter les
produits v o la is d’une diftillation, ou fur le réfidu
dont ils ont «té féparés, ou fur de la nouvelle matière
femblahe à celle qui les a fournis, & à diftiller de
n o u v e l* /
La cohobation ,eft une efpece de diftillatioji. Voye[
DlSTlLjLATION. (b )
C O U O R T A L , f. m. (Hijl. anc.) c’eft le nom
qu’on dqnnoit aux ferviteurs du préfet du prétoire.
* COHORTE, f. f. (Hijl.anc.) c’étoit chez les
Romains un corps d’infanterie, de la dixième partie
d ’une légion. Il contenait trois manipules, & chaque
manipule deux centuries; d’où l’on voit que
chaque légion étoit de foixante centuries, de trente
manipules, & de dix cohortes.
Il y- a voit dans la cohorte les quatre fortes de fan- ,
taffins des armées romaines ; les velites , les hajlati ;
les principes & les triarii. Quand elle étoit complété,
les velites y étoient au nombre de cent vingt ; les haf- .
tati au même nombre, lés principes pareillement, &
les triarii au nombre de foixante ; ce qui fait quatre
cents vingt foldats. Au refte ce nombre augmentoit
ou diminuoit, félon que lâ légion étoit plus ou moins
forte»,
La première cohorte étoit la plus conlidérée ; elle
étoit .composée- des principaux centurions & des
meilleurs foldats. Dans une ordre de bataille, elle
avoit la droite de la première ligné, comme les g re-.
nadiers de nos régimens; les autres fuivoient dans
l ’ordre naturel : enforte que la troilieme étoit au
centre de la première ligne de la légion ; la cinquième
à la gauche, la fécondé entre la première & la
troifieme „ la quatrième entre la troifieme & la cinquième
; les cinq autres cohortes formoientlafecon-
<le ïigne dans leur ordre naturel. On croit que Ma-
rius fu t le premier qui divifa la légion en cohortes.
F o y e iL ég io n . La première cohorte devint auffi dans
la fuite la plus nombreufe ; elle fut quelquefois de
1105 hommes, tandis que les autres n’étoient que
de 545-ju -'-P-‘ "‘ v , ''
. Cohortes auxiliaires ; ç étoient celles qu envoyoïent
les alliés ; elles portaient le nom de leur nation ou
de leur chef ; elles étoient auffi diftinguées par première
, deuxieme, troifieme, quatrième, &c.
Cohorte dite equitata; elle étoit cpmpofée d’infanterie
& de cavalerie ; elle étoit de mille hommes,
fept cents foixante fantaffins, deux cents quarante
cavaliers. On l’appelloit aufli cohorte milliaire.
Cofiorte, dite peditata ; elle n’étoit que de fantaffins..
,
Cohorte prétorienne ; troupe de foldats çhoifis qui
fervoit de garde au préteur ou au général. Elle étoit
compofée, félon quelques-runs, de fantaffins Ôc de
cavaliers ; & félon d’autres, de fantaffins feulement.
Elle fut inftitueé par Publius Pofthumius, dictateur.
P. Scipion fépara dans la fuite de fon armée les meilleures
troupes pour la former ; il augmenta fa paye,
& l’exempta de tous les travaux militaires. Augufte
forma -fous le nom de cohorte prétorienne , un corps
de neuf cohortes plus fortes du double que^celles de
la légion ; enforte que les prétoriennes furent de neuf
mille hommes : d’autres difent de dix mille, divifés
en dix cohortes. Septime Severe augmenta encore ce
corps. Il étoit uniquement deftiné à la garde des
empereurs & de leur maifon, & commandé par le
préfet du prétoire, qui avoit fous lui des tribuns &
des centurions. II étoit prefque tout infanterie ; d’abord
on n’y admit que des Romains ; on y introdui-
.fit avec le tems des étrangers, des Germains, des
Bataves, des Thraces, &c. Il avoit la paye double^
& fe tepçjt dans un çamp retranché proçhe de Rqme
; il avoit des lignes militaires, & des boucliers
particuliers. Il excita dans la fuite beaucoup de trou- 7
blés. Conftantin détruifit fon camp & le caffa. Les
prétoriens s’étoient rendus redoutables à plufieurs
de fes prédéceffeurs ; ils élifoient ou dépofoient les
empereurs de leur propre autorité ; ils forçoient
quelquefois le fénat à reconnoître celui qu’ils a voient
choifi. Dans ces révolutions, ceux qui prétendaient
à l’empire étoient obligés de s’attacher cette milice
redoutable qui difpofoit du diadème.
Cohorte dite togata ; c’étoit celle qui faifoit la garde
des rues à Rome; c’étoit la milice de la policej
elle marchoit avec la toge, n’ayant d’armes que la'
lance & l’épée.
Cohortes dites vigilum ; elles furent inftituées' par
Augufte ; elles"fervoient dans les incendies. Il y en
avoit fept, une pour deux régions de la ville ;1 ch a -:
cune avoit à fa tête un tribun, &c toutes étoient
commandées.par un officier appellé le préfet des vU .
gilum. Elles étoient diftribuées en quatorze c,errps-de- \
gardes. Il y a des auteurs qui font monter le nombre ,
de ces cohortes jufqu’à trente & un; mais il y a lieu .
de croire qu’ils fe trompent, & qu’ils prennent pour .
des cohortes ce qui n’en étoit que des divifions. Ces
cohortes n’étoient point cenféès troupes ; elles étoient
prefqu’entièrement d’affranchis, qu’on appelloit par
dérinon fparteoli.
Cohortes dites urbance; On appelloit ainfi fix mille
hommes partagés en quatre cohortes, chacune de
quinze cents. Augufte les inftitua pour la défenfe de
la ville : elles avoient des cafernes. On les nommoit
encore milites urbaniùani, troupes de ville. Elles,
étoient commandées par le préteur appellé tutela-
ris; ce qui leur fit donner auffi quelquefois le nom
de cohortes prétoriennes.
COHUAGE , f. m, ( Jurifpr, ) eft un droit qui fe
leve en certains lieux fur les marchandifes que l’on
apporte au marché. Ce terme vient de celui de cohue
y qui anciennement fignifioit ajfemblée ou marché
Suivant un arrêt de la Saint-Michel de l’an 1x78 , les
templiers en Normandie prétendoient que leurs hommes
ou fujets dévoient être exempts du payement
de cohuage ; par leur charte il fut accordé .que s’ils
vouloient entrer au marché en cohue, ils payeroient
le cohuage. Ce droit eft différent de celui d’entrée &
du droit de coûtume ; comme il paroît par un ancien
aveu rendu en 1473, au comte d’Anjou par le fieür
de la Trimouille, oii il eft dit: quefommede.beurre
venant de Bretagne , doit deux deniers d?entrée , maille
de coutume y & un denier de cohuage ; queß elle n’efi
toute vendue à icelui jour y & il arrive que le marchand
La rapporte a huitaine , il ne payera que le cohuage*
Glojf. de Lauriere, au mot cohuage. (A )
COHUE, f. f. (Jurifpr.’) en quelques lieux fignifioit
anciennement affemblée 3 halle y ou marché. Ce
mot paroît venir du latin coheerere. Dans les ordonnances
de l’échiquier de Normandie, de l’an 1383 ,
cohue fignifie Yajfemblée des officiers, de juftice qui fe
fait en l’auditoire ou autre lieu accoutumé, pour juger
les caufes & procès. Il eft auffi parlé de la halle
& cohue de Quintin en Bretagne, en laquelle fe font
les bannies & contrats, livre LII,. du recueil des arrêts
de Bretagne. Voye{ ci-devant COHUAGE. (A )
COHYNE, 1. m. (Hiß. nat. bot.) arbre de.l’Amé-
rique, qui a la feuille au laurier oc le fruit ellepti—
que & de la groffeur du melon. Les Indiens font des
vaiffeaux de fon écorce. On attribues fa pulpe quelque
propriété médicinale. Le cohyne eft auffi une
plante exotique mal connue..
CO I, faire coi, terme de riviere ; c’eft s’arrêter u iï
moment. Il y a des pas difficiles oh les chevaux remontent
difficilement un bateau,.un coche; alorè
on dit qu ’ils font coi.
J COIANG % f, oïl ([Comm. ) poids & mçfure d’ufa-
C 0 1
®e à Cambaye, aux Indes orientales : c eft les quatre
cinquièmes d’un lart. Voy. LA.RT.Dicl. deComm.
COI AU X , f. m. p l. ( Charp. ) piecës de bois quar-
rées d’un bout & délardees de l’autre, qui fe placent
au pie des chevrons d’un comble, pour racheter la
faillie de l’entablement. V y ^Planche du Charpentier,
fig. >y. n°. 2.5.
COIER, f. m. ( Charp.) piece de bois qui va du
poinçon ou du gouffet à l’arbalétrier. Voye^ A r ba lé
t r ie r , Po in ço n , & G ousset.
COIGNAGES, f. m. pl. nom que l’on donne dans
les groffes forges à' certaines portions de la maçonnerie
du fourneau. Voye^ GROSSES FORGES.
COIGNASSIER , f. m. cydonia (Hijl. nat. bot.)
genre de plante à fleur en rofe ; le calice devient un
fruit charnu femblable à une poire, divifé en cinq
loges dans lefquelles il y a des femences oblongues
& calleufes.Tournefort, injt. reiherb. V y . Plan t e .
ML
e coignafier eft un petit arbre que I on met au
rang des arbres fruitiers , mais dont la plus grande
utilité eft de fervir de fujet pour la greffe. Le tronc
du coignajjitr qui eft cou rt, tortu, noiieux, fe divife
en plufieurs branches chargées de rameaux confus ,
qui s’indinent & s’étendent'plus qu’ils ne s’élèvent.
Son écorce ne devient point gerfée & raboteufe
avec l’âge, elle fe détache fucceffivement, & tombe
par morceaux. Sa fleur affez grande & de couleur
de chair, paroît à la fin d’Avril. Son fruit, fort gros
dans quelques efpeces, eft d’une belle couleur jaune
lorfqu’il eft mûr ; mais alors d’une odeur forte &
fétide, qui jointe à ce qu’il n’eft pas bon à manger
crud , le rend peu recommandable , à moins qu’il
n’ait paffé par les mains du confifeur. Auffi ne fait-
on nul cas de cet-arbre dans les jardins fruitiers :
loin d’y avoir aucune place marquée, ce n’eft qu’en
fous-ordre qu’il s’y trouve, pour fervir à l’éducation
de quelques arbres qui lui font analogues pour
l ’opération de la greffe. C’eft fur tout un excellent
fujet pour greffer le poirier, qu’il rabaiffe généralement
, qu’ il perfectionne dans la plupart des efpeces,
& auquel il fait porter promptement des fruits plus
gros , plus beaux, plus précoces ; plus abondans, &
de meilleur goût, que quand le poirier eft greffé lur
des fujets de fon elpece. C’eft la feule raifon qui engage
à cultiver le coignajjier , que l’on peut multiplier
de rejettons qui fe trouvent ordinairement au
pié des vieux arbres, de branche couchée, de bouture
, de femence, & par le moyen de la greffe. Mais
pour gagner du tems & avoir de meilleurs plants, il
y a du choix à faire fur ces différentes méthodes.
La meilleure n’ eft pas de fe fervir des rejettons ; ’
outre qu’on auroit de la peirie à raffembler de cette
façon tout ce qu’il en faudroit pour fournir une pépinière
, c’eft que ces rejettons font mal enracinés.
La branche couchée fait un bon plant ; mais comme
elle occafionne un double travail qui eft la tranf-
plantation , on doit lui préférer le moyen fuivant
qui eft plus fimple.
La bouture eft le meilleur expédient pout avoir
les fujets les -plus' propres à être greffés, & fe les
procurer plus promptement. Sur la façon de faire
ces boutures & de les é lever, voyè^ Pépinière.
La femenée produiroit des plants excellens , fi ce
n’étoit la voie la plus longue ; auffi eft-elle la moins
ufitée.
La greffe pourroit fervir à perfectionner lé fruit
du coignajjier; mais on prend rarement ce foin, dont
les coings ne valent pas la peine : cependant' il y a
d’autres faits intéreffans fur cette greffé. On peut
greffer le coigna jjier fur le poirier qui donne plus de
groffeur aux coings ; fur l’aubepin qui fe foûtient
mieux dans un mauvais terrein , mais c’eft aux dépens
du fruit qui en eft plus petit ; fur le pommier
Tome I II,
C O I 609
ou je ne l’ai vû réuffir que bien rarement, & fur lé
cormier dont je n’ai pour garant que le témoignage
de Bradley. Le coignajjier peut auffi fervir de fujet
pour greffer le poirier, qui y réuffit parfaitement,
îur-tout les poires d’été & d’automne ; l’azerolier,
pour lui faire porter plûtôt des fruits, les avoir plus
gros & plus abondans ; le nefflier, pour le tenir plus
bas ; le pommier, pour en accélérer & augmenter
le rapport, mais il y réuffit difficilement ; l’aubepin ,
fur-tout l’efpece à fleur double, pour lui faire donner
de plus belles fleurs ; & fur le cormier, au rapport
d’Evelyn , qui eft le feul dont je puiffe m’appuyer.
L’écuffon à oeil dormant eft la forte de greffe
qui réuffit le mieux fur le coignajjier.
Cet arbre fe plaît dans les lieux frais & humides ;
dans les coteaux, qui font fur-tout la pofition qu’il
aime le mieux ; dans les terres douces & noirâtres ,
plûtôt mêlées de fable qu’argilleufes : mais il craint
les terreins fecs & légers, maigres & trop fuperfi-
ciels, oîi il jaunit & dépérit bientôt, à moins pourtant
qu’il n’y ait deux ou trois piés de profondeur.
Le coignajjier fouffre aifément la transplantation,
n’exige d’autre taille que le retranchement des branches
chiffonnes •& gourmandes, & il ne lui faut qu’*
une culture toute ordinaire. On n^fait prefqu’aucun
ufage de fon bois, qui étant néanmoins com^aft,
affez dur, & fans aubier , pourroit être employé à
la menuiferie s’il avoit plus de volume. Son fruit,
dont on fait peu de ca s, a plus de beauté que de
qualité. Poye^ CoifoG.
On connoît fix efpeces de coignajjier, dont aucune
n’eft intéreffante par aucun agrément qu’on en
. puiffe tirer.
Le coignajjier fauvâge : fa feve eft auffi revêche
que fon fruit ; c’eft la moindre efpece à tous égards!
Le coignajjier à fruit long: il donne de beaux fruits
d’une forme reffemblanteà celle d’une poire de bon-
chrétien : c’eft l’une des meilleures efpeces, & celle
dont on fait le plus d’ufage pour la greffe du poirier.
Le cpignajjier a fruit rond: nos anciens jardiniers
l’appelloient coignet, pour le diftinguer de l’efpece
précédente dont ii différé en ce que l’arbre qui eft:
d’abord plus petit, a les branches confufes oc plus
menues ; l’écorce d’un gris plus blanchâtre ; la feuille
moins grande ; le fruit rond, fujet à couler, plus petit
& plus pierreux: c’eft feulement fur cette efpece
qu’on voit réuffir quelquefois la greffe du pommier.
Le coignajjier à petit fruit très- âpre, le coignajjier à
fruit doux : ces deux efpeces font rares ; l’une éft auffi
méprifable que l’autre eft à defirer, mais on ne les
connoît encore que par les nomenclatures de Botanique.
Le coignajjier de Portugal ; c’eft la plus belle efpece
& la plus propré à faire réiiffirla greffe du poirier,
& à perfectionner fon fruit. Cet arbre eft plusgrand ;
fes rameaux plus droits, plus forts, & moins con-
fus ; fa feuille plus grande, plus cotonneufe en-def-
fous, & d’un verd moins jaunâtre en - deffus ; fon
fruit plus précoce, plus gros & plus tendre que dans
toutes les autres efpeces de coignajjiêrs. Ce fruit eft
long , menu aux deux extrémités , & le meilleur de
tous a confire ; mais il eft fort fujet à la coulure, (c)
* COIGNIERS, f. m. pl. c’eft ainfi qu’on appelle
dans lés fours à Verrerie, les quatre coins des fiéges
du dedans du four , correfpondans aux lunéttes des
arches à pots.
COIMBRE, ( Géog. mod. ) grande ville du royaume
de Portugal, capitale de la province de Béira ,
fur le Mondego, fameufe par fon univerfité. Long.
,g . 40. lai. 40. 10.
COIN, f. m. (Méchan. ) eft la derniere des cinq
puiffances ou machines Amples, f^oye^ Puissances
m échaniq ue s. La forme du coin eft celle d’unprif-
me triangulaire ; on en voit la forme dans la fig. 53 .
HH h h