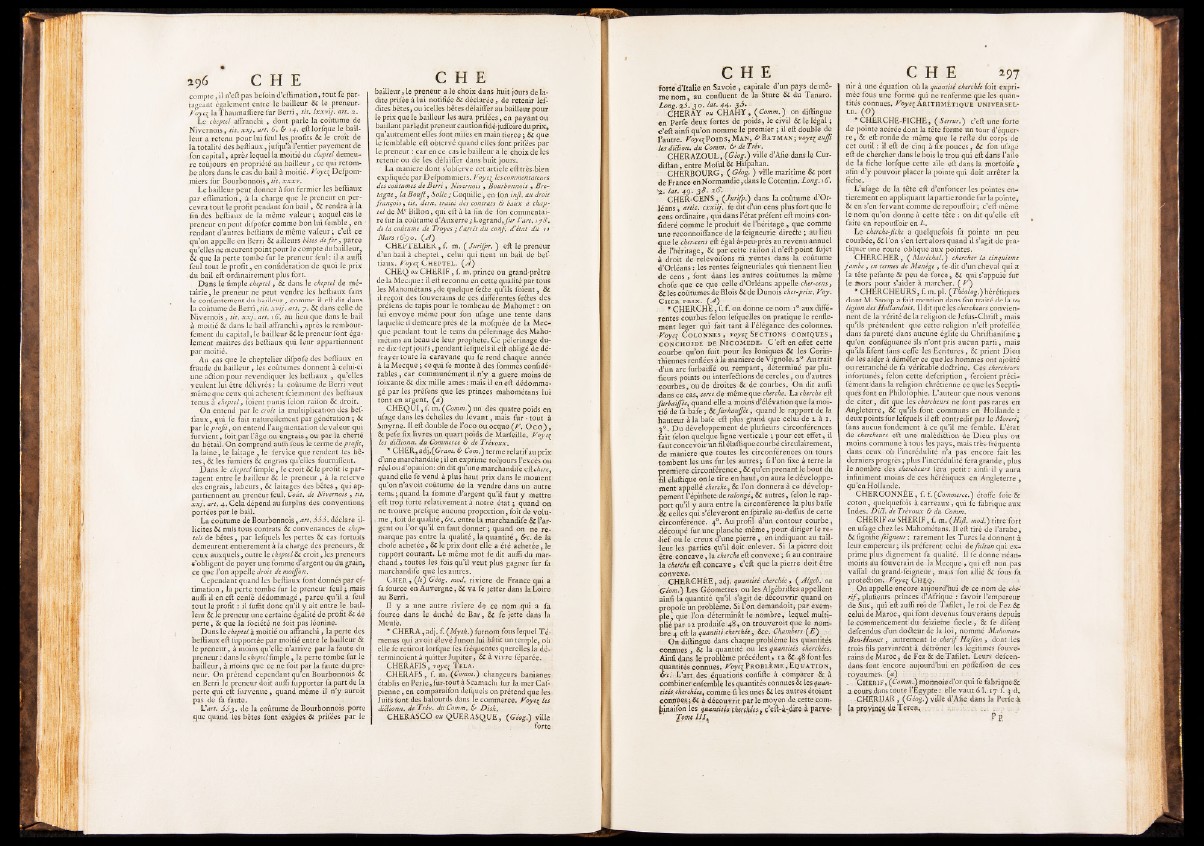
compte ,il n’eft pas befoin d’eftimation, tout fe partageant
également entre le bailleur 6c le preneur.
y oyez la Thaumafîiere fur Berri, tit. Ixxvij. art. a.
Le cheptel affranchi , dont parle la coutume de
Nivémois, tit. xx j. art. C. & 14. eft lorfque le bailleur
a retenu pour lui feul les profits & le croit de
la totalité des beftiaux, jufqu’à l’entier payement de
fon capital, aprèi lequel la moitié du c/«//«/ demeure
toujours en propriété au bailleur, ce qui retombe
alors dans le cas du bail à moitié. Voyez Defpom-
miers fur Bourbonnois, tit. xxxv.
Le bailleur peut donner à fon fermier les beftiaux
par eftimation, à la charge que le preneur en percevra
tout le profit pendant fon b a il, 6c rendra à la
fin des beftiaux de la même valeur ; auquel cas le
preneur en peut difjpofer comme bon lui femble, en s
rendant d’autres beftiaux de même valeur ; c’eft ce
qu’on appelle en Berri 6c ailleurs bêtes de f e r ,parce
qu’elles ne meurent point pour le compte du bailleur,
& que la perte tombe fur le preneur feul : il a aufli
feul tout le profit, en confidération de quoi le prix
du bail eft ordinairement plus fort.
Dans le fimple cheptel, 6c dans le cheptel de métairie
, le preneur ne peut vendre les beftiaux fans
le confentëment du bailleur, comme il eft dit dans
la coutume de Bef r i, tit. xvij. art. 7 . & dans celle de
Nivernois, tit. xx j. art. iC. au lieu que dans le bail
à moitié & dans le bail affranchi, après le rembour-
fement du capital, le bailleur 6c le preneur font également
maîtres des beftiaux qui leur appartiennent
par moitié.
Au cas que le cheptelier difpofe des beftiaux en
fraude du bailleur, les coutumes donnent à celui-ci
une aûion pour revendiquer les beftiaux , qu’elles
veulent lui être délivrés : la coûtume de Berri veut
même que cçux qui achètent feiemment des beftiaux
tenus à cheptel , l'oient punis félon raifon 6c droit.
On entend par le croît la multiplication des beftiaux
, qui fe fait naturellement par génération ; &
par le profit, on entend l’augmentation de valeur qui
furvient, foit par l'âge ou engrais, ou par la cherté
du bétail. On comprend aufli fous le terme de profit,
la laine, le laitage , le fervice que rendent les bêtes
, 6c les fumiers 6c engrais qu’elles fourniffent.
Dans le cheptel fimple, le croît 6c le profit fe partagent
entre le bailleur 6c le preneur , à la referve
des engrais, labeurs, 6c laitages des bêtes , qui appartiennent
au preneur feul. Coût, de Nivernois , tit.
x x j. art. 4. Cela dépend aufurplus des conventions
portées par le bail.
La coûtume de Bourbonnois, art. 555. déclare illicites
6c nuis tous contrats 6c convenances de cheptels
de bêtes, par lefquels les pertes 6c cas fortuits
demeurent entièrement à la charge des preneurs, &
ceux auxquels, outre le cheptel 6c croît, les preneurs
s’obligent de payer une fomme d’argent ou du grain,
ce que l’on appelle droit de moijfon.
Cependant quand les beftiaux font donnés par eftimation
, la perte tombe fur le preneur feul ; mais
aufli il en eft cenfé dédommagé, parce qu’il a feul
tout le profit : il fuffit donc qu’il y ait entre le bailleur
6c le preneur une certaine égalité de profit 6c de
perte, & que la fociété ne foit pas léonine.
Dans le cheptel à moitié ou affranchi, la perte des
beftiaux eft l'upportée par moitié entre le bailleur &
le preneur, à moins qu’elle n’arrive par la faute du
preneur : dans le cheptel fimple, la perte tombe fur le
bailleur, à moins que ce ne foit par la faute du preneur.
On prétend cependant qu’en Bourbonnois 6c
en Berri le preneur doit aufli lupporter fa part de la
perte qui eft furvenue, quand même il n’y auroit
pas de fa faute.
U art. 55$. de la coûtume de Bourbonnois porte
que quand les bêtes font exigées & prifées par le
ba illeur, le preneur a le choix dans huit jours de ladite
prifée à lui notifiée 6c déclarée , de retenir lef-
dites b ê tes , ou icelles bêtes délaifler au bailleur pour
le prix que le bailleur les apra p rifée s , en payant ou
baillant par ledit preneur caution fidé-juffoiredu p r ix ,
qu’autrement elles font miles en main tierce ; 6c que
le femblable eft oblerv é quand elles font prifées par
le preneur : car en ce cas le bailleur a le choix de les
retenir ou de les délaifler dans huit jours.
L a maniéré dont s’obferve cet article eft très-bien
expliquée par Defpommiers. Voyez les commentateurs
des coutumes de B erri, Nivernois , Bourbonnois , Bretagne
, la B o u jl, Solle ; C oq u ille , en fon injl. au droit
françois, lit. dern. traité des contrats & baux à chap-
tel de Me B illon , qui eft à la fin de fon commentai^
re fur la coûtume d’Auxerre ,■ Legrand, fu r l'art. iy 8 .
delà coutume de Troyes; ! arrêt du conf. d'état du 11
Mars 1Ç90. ( A )
CH E P T E L IE R , f. m. ( Jurifpr. ) eft le preneur
d’un bail à c h e p te l, celui qui tient un bail de beftiaux.
Voyez C heptel. ( A )
C H E Q ou CH E R IF , f. m. prince ou grand-prêtre
de la M ecque : il eft reconnu en cette qualité par tous
les Mahométans, de quelque fe fte qu’ils fo ie n t , 6c
il reçoit des fouverains de ces différentes feétes des
préiens de tapis pour le tombeau de Mahomet : on
lui e n vo y é même pour fo n ufage une tente dans
laquelle il demeure près de la mofquée de la Mecque
pendant tout le tems du pèlerinage des Mahométans
au beau d e leur prophète. C e pèlerinage dure
dix-lept jo u rs , pendant lefquels il eft obligé de défra
y e r toute la caravan e qui fe rend chaque année
à la M ecque ; ce qui fe monte à des fommes confidé-
r ab le s , car communément il n’y a guere moins de
foixante 6c dix mille âmes : mais il en e ft dédommagé
par les préfens que les princes mahométans lui
fo n t en argent, (a )
CH E Q U I , f ; m. ( Comm.) un dès quatre poids en
ufage dans les échelles du le v a n t , mais fur - tout à
Smyrne. Il eft double de l’o co o u ocquo ( V . O c o ) ,
& pefe fix liv res un quart poids de Marfeille. Voyez
les diclionn. du Commerce & de Trévoux,
* CH E R , ad).(Gram. & Corn.) terme rela tif au prix
d’une m archandée ; il en exprime toûjours l’excès ou
ré e l ou d’opinion: on dit qu’une marchandife eftehere,
quand e lle fe vend à plus haut prix dans le moment
qu’on n’a v o it coûtume de la v endre dans un autre
tems ; quand la fomme d’argent qu’il faut y mettre
eft trop forte relativement à notre état ; quand on
ne trou v e prefque aucune proportion, foit de v olu -
* me , fo it de qu alité , &c. entre la marchandife 6c l’argent
ou l’or qu’il en faut donner ; quand on ne re marque
pas entre la qualité, la qu an tité , &c. de la
chofe a ch e té e , & le prix dont e lle a été a ch e té e , le
rapport courant. L e même mot fe dit aufli du marchand
, toutes les fois qu’ il v eut plus gagner fur fa
marchandife que les autres.
C her , (le) Géog. mod. riv ie re de France qui a
fa fource en A u v e rgn e , & v a fe jetter dans la Loire
au Berri.
Il y a une autre riv ie re de ce nom qui a fa
fource dans le duché de. B a r , 6c fe jette dans la
Meufe.
* C H E R A , adj. f. (Myth.) furnom fous lequel Té-'
menus qui avo ir é le v é Junon lui bâtit un temple, oit
e lle fe retiroit lorfque fes fréquentes quercllesla dé--
terminoient à quitter Jup ite r, 6c à v iv re féparée.
CHER AF1S , voyez T ela.
CH E R A F S , f. m. (Comm.) changeurs banianes
établis en Perfe., fur-tout à Scamachi fur la mer C a fi
pienn e , en comparaifon defquels on prétend que les
Juifs font des balourds dans le commerce. Voyez les
diclionn.. de Trév. du Comm. & Dish.
CH E R A S C O ou Q U E R A S Q U E , (Géog.) v ille
forte
forte d’Italie en Savoie , capitale d’un pays de même
nom, au confluent de la Sture & du Tanaro.
Lo n g. 2 5 ê 3 0 . lat. 44 . 3 6 -
CHER.AY ou CH AH Y , ( Comm. ) on diftingue
en Perfe deux fortes de poids, le civil & le légal ;
c ’eft ainfi qu’on nomme le premier ; il eft double de
l’autre. f'oyeçPoiDS, Man, & Ba tm an ; voyez auJTl
les diction, du Comm. 6* de Trev.
CHERAZOUL, (Géog.) ville d’Afie dans le Cur-
diftan, entre Moful 6c Hifpahan.
CHERBOURG , ( Géog. ) ville maritime & port
de France en Normandie, dans le Cotentin. Long.rS.
>2. la t . '40,^38. adYii'v ;
CHER-CENS , (jurifp.) dans la coûtume d’Orléans
, artic. ckxiij. • fe dit d-iin cens plus fort que le
cens ordinaire, qui dans l’état préfent eft moins con-
fideré. comme le produit de l’héritage, que comme
une reconnoiflance de laféigneurie direéte ; au lieu
que le cher-cens eft égal à^peu-près au revenu annuel
de l’héritage, 6c par cette raifon il n’eft point fujet
à droit de relevoifons ni yentes dans la coûtume
d’Orléans : les rentes feigneuriales qui tiennent lieu
de cens , font dans les autres coûtumes la même
chofe que ce que celle d’Orléans appelle cher-cens,
& les coûtumes de Blois 6c de Dunois cher-prix. Voy.
C her-pr ix . (A )
* CHERCHE, f. f. on donne ce nom i° aux différentes
courbes félon lefquelles on pratique le renflement
leger qui fait tant à l’élégance des colonnes.
Voy e( C o l o n n e s y voyez S e c t io n s c o n i q u e s ,
c o n CHÔI’DE d e N ic o m e d e . C ’eft en effet cette
courbe qu’on fuit pour les Ioniques 6c les Corinthiennes
renflées à la maniéré de Vignole. 20 Au trait
d’un arc furbaiffé ou rempant, déterminé parplu-
fieurs points ou interférions de cercles, ou d’autres
courbes, ou de droites & de courbes. On dit aufli
dans ce cas, cercede même que cherche. La cherche, eft
furbaifiee, quand elle a moins d’élévation que la moitié
de fa bafe ; 6c fnrhaujfée, quand le rapport de la
hauteur à la bafe eft plus-grand que celui de 2 a 1.
3°. Du développement de plufieurs circonférences
fait félon quelque ligne verticale ; pour cet effet, il
faut concevoir un fil élaftiquecourbé circulairement,
de maniéré que toutes les circonférences ou fours
tombent les uns fur les autres; fi l’pn fixe à terre la
première circonférence , 6c qu’en prenant le bout du
fil élaftique on le tire.enhaut,on aura le développement
appéllé cherche, 6c l’on donnera à ce développement
l’épithete àtralongé:,6c autres, félon le rapport
qu’il y aura entre la circonférence la plus baffe
.& celles qui s’élèveront en fpirale au-deffus de cette
circonférence. 40. Au profil d’un contour courbe,
.décoùpé fur une planche même, pour diriger le re-
4ief o u ïe creux d’une p ierre, en indiquant au taib
leur-les parties qu’il doit enlever. Si la pierre doit
être concave, la cherche eft convexe ; fi au contraire
la cherche..eft concave, c’eft que la pierre doit être
côftvèxe» • : r . > : .
CHERCHÉE, adj; quantité cherchée , ( Algeb; ou
Géom.') Les Géomètres ou les Algébriftes appellent
ainfi la quantité qu’il s’àgit de* découvrir quand on
propofe un problème. Si l’on.demandoit, par exemple
? que l’on déterminât dénombré, lequel multiplié
par ix produife 48, on trouveroit que le nombre
4 eft la quantité cherchée., 6cc. Chambers (£ ) .
On diftingue dans chaque problème lés qu'antités
connues , & la quantité ou les quantités cherchées.
Ainfi dans le problème précédent , 12 8648 fontdes
quantités connues. Voyez Problème , Eq u a t io n ,
L’art.des équations confifte à comparer & â
combiner enfemble les quantités connues & les quarir
tités. cherchées, comfne fi les. unes 6C les autres étoient
connues; 6c à déoouvrirpar le moyen de c.ette com-
binaifon les' quantités: 'çherçhées , c’eft-à-.dire à parve-
jTwra c III^
nir à une équation où la quantité cherchée foit exprimée
fous une forme qui ne renferme que les quantités
connues. Ployez Arithmét iq ue universel-
le,; ( o )
■ * CHERCHE-FICHE, (Serrur.) c’eft une forte
de pointe acérée dont la tête forme un tour d’équerre
, & eft ronde de même que le refte du corps de
cet outil : il eft de cinq à fix pouces, & fon ufage
eft de chercher dans le bois le trou qui eft dans l’aile
de la fiche lorfque cette aile eft dans la mortoife ,
afin d’y pouvoir placer la pointe qui doit arrêter la
fiche,
L’ufage de la tête eft d’enfoncer les pointes entièrement
en appliquant la partie ronde fur la pointe,
& en s’en fervant comme de repouffoir ; c’eft même
le nom qu’on donne à cette tête : on dit qu’elle eft
faite en repouffoir en L.
Le cherche-fiche a quelquefois fa pointe un peu
courbée, & l ’on s’en lèrt alors quand il s’agit de pratiquer
une route oblique aux pointes.
CHERCHER, (Maréchal.) chercher la cinquième
jambe, en termes de Manège , fe-dit d’un cheval qui a
la tête pefante & peu de force, 6c qui s’appuie fur
le mors pour s’aider à marcher. ( V )
* CHERCHEURS, f. m. pl. (Théolog.) hérétiques
dont M. Stoup a fait mention dans fon traité de la religion
des Hollandois. Il dit que les chercheurs conviennent
de la vérité de la religion de Jefus-Chrift, mais
qu’ils prétendent que cette religion n’eft profeffée.
dans fa pureté dans aucune églife du Chriftianifme ;
qu’en conféquence ils n’ont pris aucun parti, mais
qu’ils lifent fans cefle les Ecritures, 6c prient Dieu
de les aider à démêler ce que les hommes ont ajoûté
ou retranché de fa véritable doélrine. Gts chercheurs
infortunés; félon cette defeription, feroient préci-
fémentidans la religion chrétienne ce que les Sceptiques
font en Philofophie. L’auteur que nous venons
de citer, dit que les chercheurs ne font pas rares en
Angleterre, 6c qu’ils font communs en Hollande r
deux points fur lefquels il eft contredit par le Moreriÿ
fans aucuR fondement à ce qu’il me femble. L’état
de chercheurs eft une malédiôion de Dieu plus ou
moins-commune à tous les pays, mais très-fréquente
dans ceux où l’incrédulité n’a pas encore fait les
derniers progrès ; plus l’incrédulité fera grande, plus
le nombre des chercheurs fera petit: ainfi1 il y aura
infiniment moins de ces hérétiques en Angleterre ,
qü’en Hollande.
CHERCONNÉE, f. f. (Commerce.) étoffe foie &
coton, quelquefois à carreaux, qui fe fabrique aux
Indes. Dicl. de Trévoux & du Comm.
CHERIF ou SHERIF, f. m. (Hifi. mod.) titre fort
en ufage chez les Mahométans. Il eft tiré <le l’arabe,
6c fignifie feigneur: rarement les Turcs le donnent à
leur empereur ; ils préfèrent celui dt fiultan qui exprime
plus dignement fa qualité. Il fe donne néanmoins
au fouvérain dé la Mecque , qui eft. non pas
vaffal du grand-feigneùr, mais Ton allié 6c fous Ta
prote&ion. . Voyez C hçq.
.. On appelle encore aujourd’hui de ce nom de che-t
rif, plufieiirs princes d’Afrique : favoir l ’empereur
de Stis , qui eft aufli roj de Tafilet, le roi de Fez &
celui de Maroc, qui font devenus fouveïairis depuis
le commencement du feiziefne fiecle, & fe difent
defeendus d’un dofteûr.de Iadoi, nommé Mahomet-
Ben-Mamet, autrement le cherif Hafc'en., .’dont:. lés
trois fils parvinrent :à détrôner les légitimes foiivé-
rainsfle Maroc, de Fez &.de Tafilet. Leurs defeen-
dans font encore aujourd’hui en poffeflion .de ces
•royauméSi. (4 ) •• ; ; .p ■ : - 1
- CHERIF, (Comm.) monnoie d’or qui fe fabrique &
.a cours dans toute l’Egypte : elle vaut.6 h. 17 T 3 d.
QHÉRIJAR , (Géog.) yille d’Afie dans la Perfe à
la prQYÛwe. de Tçretu. ijo - . ~ è f i . . oup
7 W ' P é '