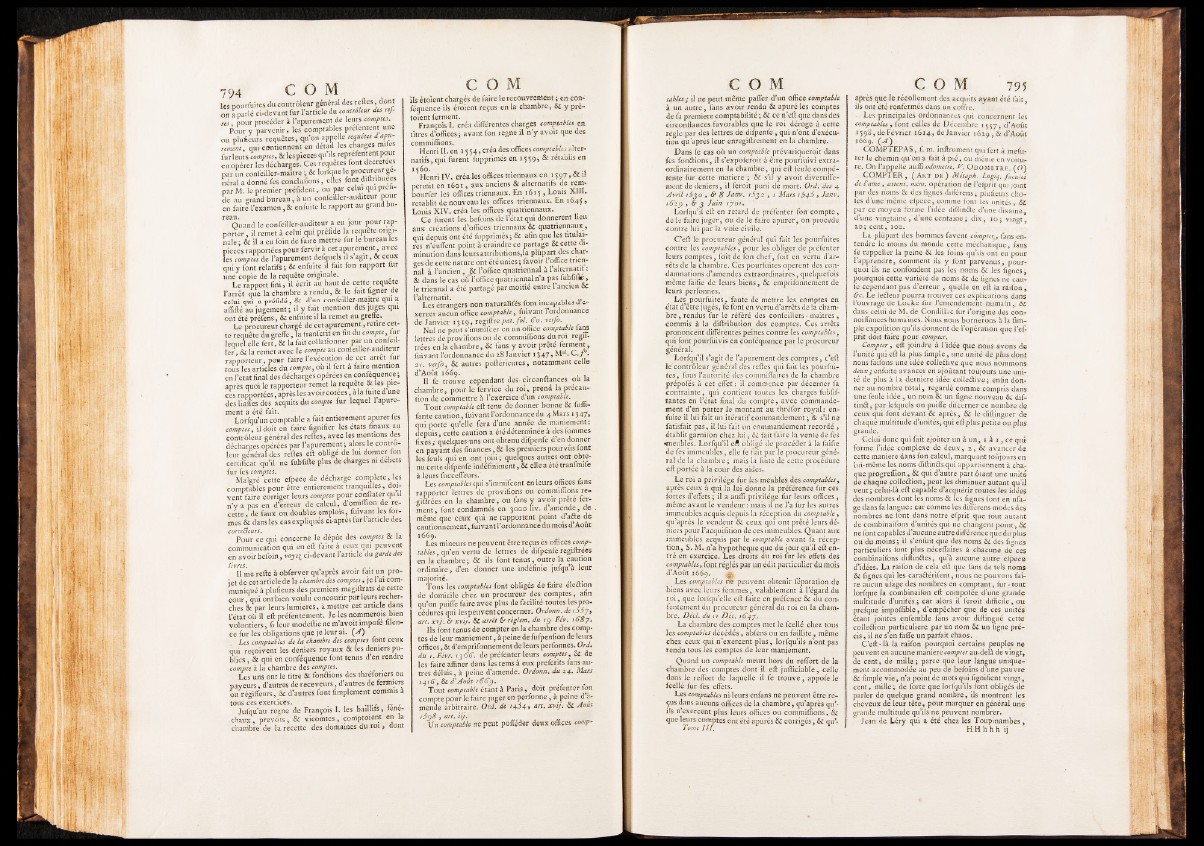
les poursuites du contrôleur général des HH W M
on a parlé ci-de vant fur l’article du controleur des rej-
.tes, pour procéder à l’apurement de leurs comptes.
Pour y parvenir, les comptables prefentent une
ou plufieurs requêtes, qu’on appelle requêtes d apurement.
qui contiennent en détail les charges mue
fur leurs comptes, & lespieces qu’ils reprefentent pour
en opérer les décharges. Ces requêtes font decretees
par M confeiller-maitre ; & lorl'que le procureur général
a donné fes con c ilion s, elles font diftnbuees
par M. le premier préfident, ou par celui qui pre 1-
de au grand bureau, à un eonfeiller-auditeur pour
en faire l’examen, & enfuite le rapport au gran u-
Quand le confeiller-auditeur a eu jour pour rapporter
, il remet à celui qui préfide la requete originale
; éc il a eu foin de faire mettre fur le bureau les
pièces rapportées pour fervirà cet apurement, avec
les comptes de l’apurement defquels il s’agit, & ceux
qui y font relatifs ; & enfuite il fait fon rapport iur
une copie de la requête originale. A
Le rapport fini, il écrit au haut de cette requete
l’arrêt que la chambre a rendu, & le fait ligner de
celui qui a préfidé, & d’un confeiller-maître qui a
aflifté au jugement ; il y fait mention des juges qui
ont été préfens, & enfuite il la remet au greffe.
Le procureur chargé de cet apurement, retire cette
requête 4u greffe, la tranferit en fin du compte {ur
lequel elle fert, & la fait collationner par un conleil-
le r , & la remet avec le compte au conleiller-auditeur
rapporteur, pour faire l’exécution de cet arrêt fur
tous les articles du compte, où il fert à faire mention
en l’etat final des décharges opérées en confequence ;
après quoi le rapporteur remet la requete & les pièces
rapportées, après les avoir cotees, a la fuite d une
des baffes des acquits du compte fur lequel 1 apurement
a été fait. . •
Lorfqu’un comptable a fait entièrement apurer les
comptes, il doit en faire lignifier les états finaux au
contrôleur général des relies, avec les mentions des
décharges opérées par l’apurement; alors le controleur
général des relies eft obligé de lui donner Ion
certificat qu’il ne fubfifte plus de charges ni débets
fur fes comptes.
Malgré cette efpece de décharge complété, les
comptables pour être entièrement tranquilles, doivent
faire corriger leurs comptes pour conftater qu il
n’y a pas eu d’erreur de calcul, d’omiflion de recette
, de faux ou doubles emplois, fuivant les formes
& dans les cas expliqués ci-après lur l’article des
Pour ce qui concerne le dépôt des comptes & la
communication qui en efl faite à ceux qui peuvent
en avoir befoin, voye^ ci-devant l’article du garde des
livres. . . . • ■ . , ,
Il me relie à obferver qu’apres avoir fait un projet
de cet article de la chambre des comptes , je l’ai communiqué
à plufieurs des premiers magiftrats de cette
cour, qui ont bien voulu concourir parleurs recherches
& par leurs lumières, à mettre cet article dans
l’état où il eft préfentement. Je les nommerons bien
volontiers, fi leur modeftie ne m’avoit impofe filen-
ce fur les obligations que je leur ai. (A )
Les comptables de la chambre des comptes font ceux
qui reçoivent les deniers royaux & les deniers publics
, & qui en conséquence font tenus d’en rendre
.compte à la chambre àescomptes.
Les uns ont le titre & fondions des thréforiers ou
payeurs, d’autres de receveurs, d’autres de fermiers
ou régiffeurs, &c d’autres font Amplement commis à
tous ces exercices. ,
Jufqu’au régné de François I. les baillirs, lene-
chaux, prévôts, & vicomtes, comptoient en la
chambre de la recette des domaines du r o i, dont
ils étoient chargés de faire le recouvrement ; en con-
féquence ils étoient reçus en la chambre, & y prê-
toient ferment.
François I. créa différentes charges comptables en
titres d’offices; avant fon régné il n’y avoit que des
commiffions.
Henri II. en 1 5 54, créa des offices comptables alternatifs,
qui furent fupprimés en 15 59» & rétablis en
1560. . 9 ..
Henri IV. créa les offices triennaux en 1597 , oc il
permit en 1601 , aux anciens & alternatifs de rem-
bourfer les offices triennaux. En 16 15 , Louis XIII.
rétablit de nouveau les offices triennaux. En 1645 ,
Louis XIV. créa les offices quatriennaux..
Ce furent les befoifts 'de l’état qui donnèrent lieu
aux créations d’offices triennaux & quatriennaux ,
qui depuis ont été fupprimés ; & afin que les titulat-
res n’euffent point à craindre ce partage & cette di*
minutiondans leurs attributions,la plupart des charges
de cette nature ont été unies ; favoir l’office triennal
à l’ancien, .§£ l’office quatriennal à l’alternatif:
& dans le cas o ù l’office quatriennal n’a pas fubfifte,
le triennal a été partagé par moitié entre l’ancien OC
l’alternatif. , . , , ' „
Les étrangers non naturalifes font incapables cl e-
xercer aucun office comptable, fuivant 1 ordonnance
de Janvier 1319, regiftrepat.fol. Go.verfo.
Nul ne peut s’immifeer en un office comptable fans
lettres de provifions ou de commiffions du roi régit-
trées en la chambre, & fans y avoir prete ferment^,
fuivant l’ordonnance du 28 Janvier 1347, Mal. C .f* .
21. verfo, & autres poftérieures, notamment celle
d’Août 1669. '
Il fe trouve cependant des- circonftances ou la
chambre, pour le fervice du ro i, prend la précaution
de commettre à l’exercice d’un comptable.
Tout comptable eft tenu de donner bonne & fuffi-
fante caution, fuivant l’ordonnance du 4 Mars 1347»
qui porte qu’elle fera d’une année de maniement:
depuis, cette caution a été déterminée à des fommes
fixes; quelques-uns ont obtenu difpenfe d en donner
en payant des finances, & les premiers pourvus font
les feuls qui en ont joiii ; quelques autres ont obtenu
cette difpenfe indéfiniment, & elle a ete tranfmife
à leurs fucceffeurs."
Les comptables qui s’immifeent en leurs offices fans
rapporter lettres de provifions ou commiffions re-
•giftrées en la chambre, ou fans y avoir prêté ferment,
font condamnés en 3000 liv. d’amende, de
même que ceux qui ne rapportent point d’aéle de
cautionnement, fuivant l’ordonnance du mois d’Août
1669.
Les mineurs ne peuvent être reçus ès offices comptables,
qu’en vertu de lettres de difpenfe regiftrées
en la chambre ; & ils font tenus, outre la caution
ordinaire, d’en donner une indéfinie jufqu’à leur
majorité. t t
Tous les comptables font obligés de faire élection
de domicile chez un procureur des comptes, afin
qu’on puiffe faire avec plus de facilité toutes les procédures
qui les peuvent concerner. Ordonn. de i55y,
art. xvj. & xvij. & arrêt & réglern. du 1$ Fév. 1687.
Ils font tenus de compter en la chambre des comptes
de leur maniement, à peine de fufpenfion de leurs
offices, & d’emprifonnement de leurs perfonnes. Ord.
du i.Févr. 13GG. de préfenter leurs comptes, & de
. les faire affiner dans les tems à eux preferits fans autres
délais, à peine d’amende. Ordonn. du 24. Mars
141G, & d’Août i G G c ) i ' ' • ‘i •
Tout comptable étant à Paris, doit préfenter fon
compte pour le faire juger en perfonne, à peine d à-
mende arbitraire. Ord. de 1464, art. xvij. & Août
■ iî>C)8 , art, iij. •
Un comptable ne peut pofféder deux offices comptables
; il ne peut même paffer d’un office comptable
à un autre, fans avoir rendu & apuré les comptes
de fa première comptabilité ; & ce n’eft que dans des
circonftances favorables que le roi déroge à cette
réglé par des lettres de difpenfe , qui n’ont d’exécution
qu’après leur enregiftrement en la chambre.
Dans le cas où un comptable prévariqueroit dans
fes fondions, il s’expoferoit à être pouffuivi extraordinairement
en la chambre, qui eft feule compétente
fur cette matière ; & s’il y avoit divertiffe-
ment de deniers, il feroit puni de mort. Ord. des 4
Avril 1S3 o , & 8 Jariv. 1S32 , 1 Mars 1646 , Janv.
iGzÿ , & 3 Juin îyor. '
Lorfqu’ii eft en retard de préfenter fon compte,
de le faire juger, ou de le faire apurer, on procédé
contre lui par la voie civile.
C ’eft le procureur général qui fait les pourfuites
contre les comptables , pour les obliger de préfenter
leurs comptes, foit de fon chef, foit en vertu d’arrêts
de la chambre. Ces pourfuites opèrent des condamnations
d’amendes extraordinaires, quelquefois
même faifie de leurs biens, & emprifonnement de
leurs perfonnes.
Lés pourfuites, ‘faute de mettre les comptes en
état d’être jugés, fe font en vertu d’arrêts de la chambre
, rendus fur le référé des confeillers - maîtres ,
commis à la diftribution des comptes. Ces arrêts
prononcent différentes peines, contre les comptables,
qui font poùrfuivis en conféquence par le procureur
général.
Lorfqu’il s’agit de l’apurement des comptes, c’eft
le contrôleur général des relies qui fait les pourfuites
, fous l’autorité des commiffaires de la chambre
prépofés à cet effet : il commence par décerner fa
Contrainte, qui contient toutes les charges fubfif-
tantes en l’état final du compte, avec commandement
d’en porter le montant au thréfor royal: en-
fuite il lui fait un itératif commandement ; & s’il ne
fatisfait pas, il lui fait un commandement recordé ,
établit garnifon chez lui, & fait faire la vente de fes
«neubles. Lorfqu’il eft obligé de procéder à la faifie
de fes immeubles, elle fe fait par le procureur général
de la chambre ; mais la fuite de cette procédure
eft portée à la cour des aides.
Le roi a privilège fur les meubles des comptables,
après ceux à qui la loi donne la préférence Air ces
fortes d’effets ; il a auffi privilège fur leurs offices,
même avant le vendeur : mais il ne l’a fur les autres
immeubles acquis depuis la réception du comptable,
qu’après le vendeur & ceux qCii ont prêté leurs deniers
pour l’acquifition de ces immeubles. Quant aux
immeubles acquis par le comptable avant fa réception,
S. M. n’a hypotheque que du jour qu’il eft entré
en exercice. Les droits dit roi lur les effets des
comptables, font réglés par un édit particulier du mois
d’AoÛt I669. ÿ;
Les comptables ne peuvent obtenir féparation de
biens avec leurs femmes, valablement à l ’égard du
ro i, que lorfqu’elle eft faite en préfence & du con-
fentement du procureur général du roi en la chambre.
Dècl. du 11 Déc. 1G47.
La chambre des comptes met le fcellé chez tous
les comptables décédés, abfens ou en faillite, même
chez çeux qui n’exercent plus, lorfqu’ils n’ont pas
rendu tous les comptes de leur maniement.
Quand un comptable meurt hors du reffort de la
chambre des comptes dont il eft jufticiable, celle
dans le reffort de laquelle il fe trouve, appofe le
fcellé fur fes effets.
Les comptables ni leurs enfans ne peuvent être reçus
dans aucuns offices de la chambre, qu’après qu’ils
n’exercent plus leurs offices ou commiflions, &
que leurs comptes ont été apurés & corrigés, & qu’-
Tome I I 1.
C O M 795
après que le récollement des acquits ayant été fait,
ils ont été renfermés dans un coffre.
Les principales ordonnances qui concernent les
comptables y font celles de Décembre 1557, d’Août
1598, de Février 1614, de Janvier i6zo , & d’Août
1669. (.4/)
COMPTEPAS, f. m. infiniment qui fert à mefii-
rer le chemin qu’on a fait à pié, ou même en voiture.
On l’appelle auffi odometre. y. Odom étr é. (O)
COMPTER, (A rt de) Métaph. Logiq. faculté
de lame, attent, mém. opération de l’elprit qui /oint
par des noms & des Agnes différens, plufieurs cho-
fes d’une même efpece, comme font les unités &
par ce moyen forme l’idée diftinête d’une dixaine,
d’une vingtaine, d’une centaine; dix, io-; vingt,
zo ; cent, 100,
La plupart des hommes favent compter^ fans entendre
le moins du monde cette méchanique, fans
fe rappeller la peine & les foins qu’ils ont eu pour
l’apprendre, comment ils y font parvenus, pourquoi
ils ne confondent pas les noms & les fignes ,
pourquoi cette variété de noms ôc de fignes ne cau-
fe cependant pas d’erreur , quelle en eft la raifon,
&c. Le leéleur pourra trouver ces explications dans
l’ouvrage de Locke fur l’entendement humain, &
dans celui de M. de Condillac fur l’origine des con-
noiffances humaines. Nous nous bornerons à la fim-
ple expofition qu’ils donnent de l’opération que l’ef-
prit doit faire pour compter.
Compter y eft joindre à l ’idée que nous avons de
l’unité qui eft la plus fimple, une unité de plus dont
nous faifons une idée colleélive que nous nommons
deux; enfuite avancer en ajoutant toujours, une unité
de plus à la derniere idée colleélive; enfin donner
au nombre total, regardé comme compris dans
une feule idée, un nom & un ligne nouveau & dif-
tin d, par lefquels on puiffe dilcerner ce nombre de
ceux qui font devant & après, & le diftinguer de
chaque multitude d’unités, qui eft plus petite ou plus
grande, : . . V
Celui donc qui fait ajoûter un à un, 1 à 1 , ce qui
forme l’idée complexe de deux , 2 , & avancer de
cette maniéré dans fon calcul, marquant toûjours en
lui-même les noms diftinâs qui appartiennent à chaque
progrefiion, & qui d’autre part ôtant une unité
de chaque colledion, peut les diminuer autant qu’il
veut; celui-là eft capable d’acquérir toutes les idées
des nombres dont les noms & les fignes font en ufa-
ge dans fa langue : car comme les différens modes des
nombres ne font dans notre efprit que tout autant
de combinaifons d’unités qui ne changent point, &
ne font capables d’aucune autre différence que du plus
ou du moins ; il s’enfuit que des noms & des fignes
particuliers font plus néceffaires à chacune de ces
combinaifons diftinfles, qu’à aucune autre efpece
d’idées. La raifon de cela eft que fans de tels noms
& fignes qui les cara&érifent, nous ne pouvons faire
aucun ufage des nombres en comptant, fur - tout
lorfque la combinaifon eft compofée d’une grande
multitude d’unités ; car alors il feroit difficile, ou
prefque impoffible, d’empêcher que de ces unités
étant jointes enfemble fans avoir diftingué cette
colleélion particuliere par un nom ôc un ligne précis
, il ne s’en faffe un parfait chaos.
C ’eft - là la raifon pourquoi certains peuples ne
peuvent en aucune maniéré compter au-delà de vingt,
de cent, de mille; parce que leur langue uniquement
accommodée au peu de befoins d’une pauvre
& fimple v ie, n’a point de mots qui lignifient vingt,
cent, mille; de forte que lorfqu’ils font obligés de
parler de quelque grand nombre, ils montrent les
cheveux de leur tête, pour marquer en général une
grande multitude qu’ils ne peuvent nombrer.
Jean de Léry qui a été chez les Toupinambes,
H H h h h i j
!