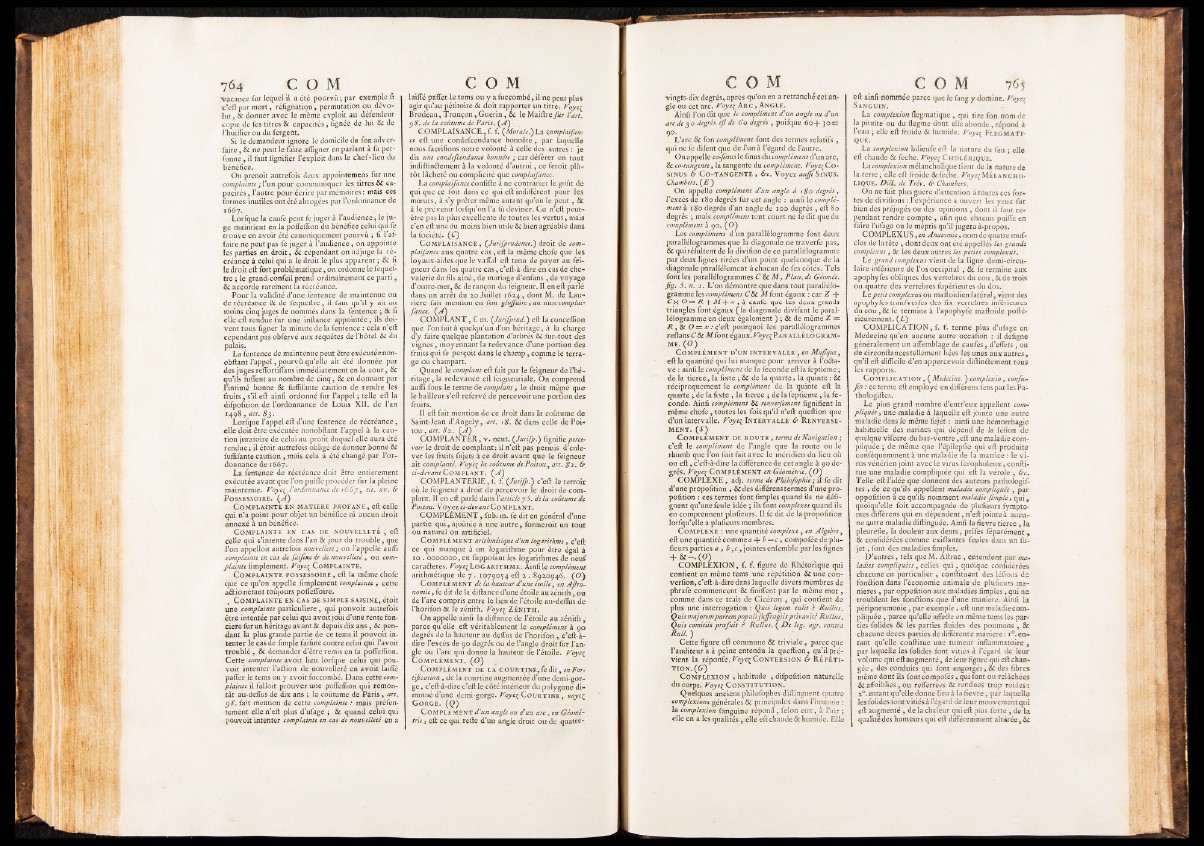
Vacance fur lequel il a été pourvu ; par exemple fi
•c’eft par mort, réfignation, permutation ou dévolu!
, & donner avec le même exploit au défendeur
copie de fes titres & capacités, lignée de lui &c de
Thuillier ou du fergent.
Si le demandeur ignore le domicile de fon adver-
faire, & ne peut le faire afligner en parlant à fa personne
, il faut lignifier l’exploit dans le chef-lieu du
bénéfice.
On prenoit autrefois deux appointemens fur une
•complainte ; l’un pour communiquer les titres & capacités
, l’autre pour écrire par mémoires : mais ces
formes inutiles ont été abrogées par l’ordonnance de
1667. '
Lorfque la caufe peut fe juger à l’audience, le juge
maintient en la pofleflion du bénéfice celui qui fe
trouve en avoir été canoniquement pourvû ; li l’affaire
ne peut pas fe juger à l’audience, on appointe
les parties en droit, & cependant on adjuge la recréance
à celui qui a le droit le plus apparent ; & fi
le droit eft fort problématique, on ordonne le fequef-
tre ; le grand-confeil prend ordinairement ce parti,
& accorde rarement la récréance.
Pour la validité d’une fentence de maintenue ou
de récréance & de fe'queftre, il faut qu’il y ait au
moins cinq juges de nommés dans la fentence ; & fi
elle eft rendue fur une inftance appointée, ils doivent
tous ligner la minute de la fentence : cela n’eft
cependant pas obfervé aux requêtes de l’hôtel & du
palais.
La fentence de maintenue peut être exécutée non-
obftant l’appel, pourvu qu’elle ait été donnée par
des juges reffortiffans immédiatement en la cour, &
qu’ils fuffent au nombre de cinq, & en donnant par
l’intimé bonne & fuflifante caution de rendre les
fruits, s’il eft ainfi ordonné fur l’appel ; telle eft la
difpofition de l’ordonnance de Louis XII. de Tan
1498, art. 83.
Lorfque l’appel eft d’une fentence de récréance,
elle doit être exécutée nonobftant l’appel à la caution
juratoire de celui au profit duquel elle aura été
rendue ; il étoit autrefois obligé de donner bonne &
fuflifante caution , mais cela a été changé par l’ordonnance
de 1667.
La fentence de récréance doit être entièrement
exécutée avant que Ton puifle procéder fur la pleine
maintenue. Voye^ l'ordonnance de , tit. xv. &
POSSESSOIRE. ( A )
Com p la in t e en matière profane, eft celle
qui n’a point pour objet un bénéfice ni aucun droit
annexé à un bénéfice.
C omplainte en cas de nouvelleté , eft
celle qui s’intente dans Tan & jour du trouble, que
Ton appelloit autrefois nouvelleté ; on l’appelle aufli
complainte en cas de faifine & de nouvelleté , ou complainte
fimplement. Voye[ C omplainte.
C om p la in te possessoire, eft la même chofe
que ce qu’on appelle fimplement complainte , cette
a&ionétant toujours poffeflbire.
C omp lainte en cas de simple saisine, étoit
une complainte particulière, qui pouvoit autrefois
être intentée par celui qui avoit joiii d’une rente foncière
fur un héritage avant & depuis dix ans, & pendant
la plus grande partie de ce tems il pouvoit intenter
le cas de fimple faifine contre celui qui l’avoit
troublé , & demander d’être remis en là pofleflion.
Cette complainte avoit lieu lorfque celui qui pouvoit
intenter l’a&ion de nouvelleté en avoit laiffé
paffer le tems ou y avoit fuccombé. Dans cette complainte
il falloit prouver une pofleflion qui remontât
au-deffus de dix ans ; la coutume de Paris, art.
C)8. fa’ t mention de cette complainte : mais préfen-
tement elle n’eft plus d’ufage ; & quand celui qui
pouvoit intenter complainte en cas de nouvelleté en a
laiffé paffer le tems ou y a fuccombé, il ne peut plus
agir qu’au pétitoire & doit rapporter un titre. Voye{
Brodeau, T ronçon, Guérin, &c le Maiftre fur l'art.
C)8. de la coutume de Paris. (A)
COMPLAISANCE,f. f. (Morale.")La eomplaifan1
ce eft une condefcendance honnête, par laquelle
nous facrifions notre volonté à celle des autres : je
dis une condefcendance honnête ; car déférer en tout
indiftinétement à la volonté d’autrui, ce feroit plutôt
lâcheté ou complicité que complaifance.
La complaifance confifte à ne contrarier le goût de
qui que ce foit dans ce qui eft indifférent pour les
moeurs, à s’y prêter même autant qu’on le peut , &
à le prévenir lorfqu’on Ta fû deviner. Ce n’eft peut-
être pas la plus excellente de toutes les vertus, mais
c’en eft une du-moins bien utile & bien agréable dans
la fociété. (C)
C omp laisan ce , (Jurifprudence.) droit de complaifance
aux quatre ca s , eft la même chofe que les
loyaux-aides que le vaffal eft tenu de payer au fei-
gneur dans les quatre cas, c’eft-à-dire en cas de chevalerie
du fils aîné, de mariage d’enfans , de voyage
d’outre-mer, & de rançon du feigneur. Il en eft parlé
dans un arrêt du 20 Juillet 16 14 , dont M. de Lau-
riere fait mention en fon glojfaire, m mot complaifance.
(A )
COMPLANT, f. m. (Jurifprud.) eft la conceflion
que Ton fait à quelqu’un d’un héritage, à la charge
d’y faire quelque plantation d’arbres & fur-tout des
vignes, moyennant la redevance d’une portion des
fruits qui fe perçoit dans le champ, comme le terrage
ou champart.
Quand le comptant eft fait par le feigneur de l’héritage
, la redevance eft feigneuriale. On comprend
aufli fous le terme de comptant, le droit même que
le bailleur s’eft refervé de percevoir une portion des
fruits.
Il eft fait mention de ce droit dans la coûtume de
Saint-Jean d’Angely, art. 18. & dans celle de Poitou
, art. 82.. (A )
COMPLANTER, v . neuf. (Jurifp.) lignifie percevoir
le droit de complant : il n’eft pas permis d’enlever
les fruits fujets à ce droit avant que le feigneur
ait complantè. Voyes^ la coutume de Poitou, art. 82. <5*
ci-devant COMPLANT. (A )
COMPLANTERIE, f. f. ( Jurifp.) c’eft le terroir
011 le feigneur a droit de percevoir le droit de complant.
Il en eft parlé dans l'article y5. de la coutume de
Poitou. Voyez ci-devant C om p lan t .
COMPLÉMENT, fub. m. fe dit en général d’une
partie qui, ajoutée à une autre, formeroit un tout
ou naturel ou artificiel.
COMPLÉMENT arithmétique d'un logarithme , c’eft
ce qui manque à un logarithme pour être égal à
10.0000000,en fuppofant les logarithmes de neuf
caraûeres. Voye^ L o g a r ithm e ; Ainfi le complément
arithmétique de 7.10 790 5 4 eft 2.8920946. (O )
COMPLÉMENT de la hauteur d'une.étoile, en Agronomie
, fe dit de la diftance d’une étoile au zénith, ou
de Tare compris entre le lieu de l’étoile au-defliis de
l’horifon & le zénith. Voye^ Z én ith .
On appelle ainfi la diftance de l’étoile au zénith
parce qu’elle eft véritablement le complément à 90
degrés de la hauteur au-deffus de Thorifon , c’eft-à-
dire l’excès de 90 degrés ou de l’angle droit fur l’angle
ou Tare qui donne la hauteur de l’étoile. Voye^
C omp lémen t. (O)
C omplément de la co u r t in e , fe dit, en Fortification
, de la courtine augmentée d’une demi-gorge
, c’eft-à-dire c’eft le côté intérieur du polygone diminué
d’une demi-gorge. Vcye% C o u r t in e , voye^
G o rg e. ( Q )
C omp lémen t d'un angle ou d? un arc, en Géométrie
, eft ce qui refte d’un angle droit ou de quatrevingts
dix degrés, après qu’on en a retranché cet angle
ou cet arc. Voyeç Ar c , Angle.
Ainfi Ton dit que le complément d'un angle ou d'un
arc de j o degrés efl de 60 degrés , puifque 60+ 303=
90.L
’arc & fon complément font des termes relatifs ,
qui ne fe difent que de l’un à l’égard de l’autre.
On appelle co-Jinus le finus du complément d’un arc,
& co-tangente, la tangente du complément. Voyeç COSINUS
& C o -tan gente , &c. Voyez aujfi Sinus.
Chambers. (E )
On appelle complément etun angle à 180 degrés,
l’excès de 180 degrés fur cet angle : ainfi le complément
à 180 degrés d’un angle de 100 degrés , eft 80
degrés ; mais complément tout court ne le dit que du
complément à 90. (O)
Les complément d’un parallélogramme font deux
parallélogrammes que la diagonale ne traverfe pas,
& quiréfultent de la divifion de ce parallélogramme
par deux lignes tirées d’un point quelconque de la
diagonale parallèlement à chacun de fes côtés. Tels
fondes parallélogrammes C & M , Plan, de Géomèt.
fig. 5. n. 2. L’on démontre que dans tout parallélogramme
les complémens CSc M font.égaux : car Z - j- jj
C x 0 =z R -\-M-\-x , à caufe que les deux grands i
triangles font égaux ( la diagonale divifant le parallélogramme
en deux également ) ; & de même Z =
R , & O = x : c’eft pourquoi les parallélogrammes
reftans C ScM font égaux. Voye^Par al lé log r am m
e . (O )
C omplémen t d’un in terv al le , en Mujique,
eft la quantité qui lui manque pour arriver à l’o&a-
v e : ainfi le complément de la fécondé eft la feptieme ;
de la tierce, la fixte ; & de la quarte, la quinte : 8c
réciproquement le complément de la 'quinte eft la
quarte ; de la fixte , la tierce ; de la feptieme, la fécondé.
Ainfi complément & renverfement lignifient la
même chofe , toutes les fois qu’il n’eft queftion que
d’un intervalle. Voyc^ Intervalle & Renversem
en t . (S }
C omp lémen t de r o u t e , terme de Navigation ;
c’eft le complément de l’angle que la route ou le
rhumb que Ton fuit fait avec le méridien du lieu oii
on e ft , c’eft-à-dire la différence de cet angle à 90 degrés.
Voye%_ C om p lém en t en Géométrie. (O)
COMPLEXE , adj. terme de Philofophie; il fe dit
d’une proposition , & des différens termes d’une pro-
pofition : ces termes font fimples quand ils ne défi-
gnent qu’une feule idée ; ils font complexes quand ils
en comprennent plufieurs. Il fe dit de la propofition
lorfqu’elle a plufieurs membres.
C omplex e : une quantité complexe, en Algèbre,
eft une quantité comme a 4- b — ç , compofée de plufieurs
parties a , b , c , jointes enfemble parles lignes
+ & - . ( 0 )
COMPLEXION, f. f. figure de Rhétorique qui
contient en même tems une répétition & une côn-
verfion, c’eft-à-dire dans laquelle divers membres de
phrafe commencent & finiffent par le même mot,
comme dans ce trait de Cicéron , qui contient de
plus une interrogation : Quis legem tulit } Rullus.
Quis majorempartem pop ulifujfragiis privaviû Rullus.
Quis comitiis proefuit i Rullus. f De leg. agr. contra
Rull. )
Cette figure eft commune & triviale, parce que
l’auditeur a à peine entendu la queftion, qu’il prévient
la réponfe. Voye{ C onver sion & R é p é t it
io n . (<r)
C omp lex ion , habitude , difpofition naturelle
du corps. Vqye{ C o n s t it u t io n .
Quelques anciens philofophes diftinguent quatre
complexions générales & principales dans l’homme :
la complexion fanguine répond, félon eu x, à l’air ;
elle en a les qualités, elle eft chaude & humide. Elle
eft ainfi nommée parce que le fang y domine. Voyt7
Sanguin.
La complexion flegmatique , qui tire fon nom de
la pituite ou du flegme dont elle abonde, répond à
l’eau ; elle eft froide & humide. Voyt{ Flegmatique.
La complexion bilieufe eft la nature du feu ; elle
eft chaude & feche. Voyeç C holérique.
La complexion mélancholique tient de la nature de
la terre; elle eft froide & feche. Voye^ Mélan cho «
LIQUE. Dicl. de Trév. & Chambers.
On ne fait plus guere d’attention à toutes ces fortes
de divifions : l’expérience a ouvert les yeux fur
bien des préjugés ou des opinions , dont il faut cependant
rendre compte , afin que chacun puiffe en
faire l’ufage ou le mépris qu’il jugera à-propos.
COMPLEXUS ,en Anatomie, nom de quatre muf-
des de la tête , dont deux ont été appellés les grands
complexus, & les deux autres les petits complexus.
Le grand complexus vient de la ligne demi-circulaire
inférieure de l’os occipital , & fe termine aux
apophyfes obliques des vertebres du cou , & de trois
ou quatre des vertebres fupérieures du dos.
Le petit complexus ou maltoïdien latéral, vient des
apophyfes tranfverfes des fix vertebres inférieures
du cou , & fe termine à l’apophyfe maftoïde pofté-
rieurement. (L)
COMPLICATION, f. f. terme plus d’ufage en
Medecine qu’en aucune autre occafion : il défigne
généralement un affemblage de caufes, d’effets, ou
de eirconftancestellement liées les unes aux autres,
qu’il eft difficile d’en appercevoir diftinôement tous
les rapports.
Complication , (Medecine. ) complexio, confu-
fio : ce terme eft employé en différens fens par les Pa-
thologiftes.
Le plus grand nombre d’entr’eux appellent compliquée
, une maladie à laquelle eft jointe une autre
maladie dans le même fujet : ainfi une hémorrhagie
habituelle des narines qui dépend de la léfion de
quelque vifeere du bas-ventre ,eft une maladie compliquée
; de même que l’épilepfie qui eft produite
conféquemment à une maladie de la matrice : le v irus
vénérien joint avec le virus fcrophuleux, confti-
tue une maladie compliquée qui eft la vérole , &c.
Telle eft-l’idée que donnent des auteurs pathologif-
tes , de ce qu’ils appellent maladie compliquée , par
oppofition a ce qu’ils nomment maladie fimple, qui,
quoiqu’elle foit accompagnée de plufieurs fympto-
mes différens qui en dépendent, n’eft jointe à aucune
autre maladie diftinguée. Ainfi la fievre tierce , la
pleuréfie, la douleur aux dents, prifes féparément ,
& confidérées comme exiftantes feules dans un fujet
, font des maladies fimples.
D ’autres, tels que M. Aftruc , entendent par maladies
compliquées, celles q u i, quoique confidérées
chacune en particulier , conftituent des léfions de
fonction dans l’économie animale de plufieurs maniérés
, par oppofition aux maladies fimples, qui ne
troublent les fondions que d’une maniéré. Ainfi la
péripneumonie, par exemple, eft une maladie compliquée
, parce qu’elle affefte en même tems lés parties
folides & les parties fluides des poumons , &
chacune deces parties de différente maniéré; i°.entant
qu’elle conftitue une tumeur inflammatoire ,
par laquelle les folides font vitiés à l’égard de leur
i volume qui eft augmenté, de leur figure qui eft changée
, des conduits qui font engorgés, & des fibres
même dont ils font compofés, qui font ou relâchées
& affaiblies, ou refferrées & rendues trop roides :
20. entant qu’elle donne lieu à la fievre, par laquelle
les folides font vitiés à l’égard de leur mouvement qui
eft augmenté, de la chaleur qui eft plus forte , de la
qualité des humeurs qui eft différemment altérée, &