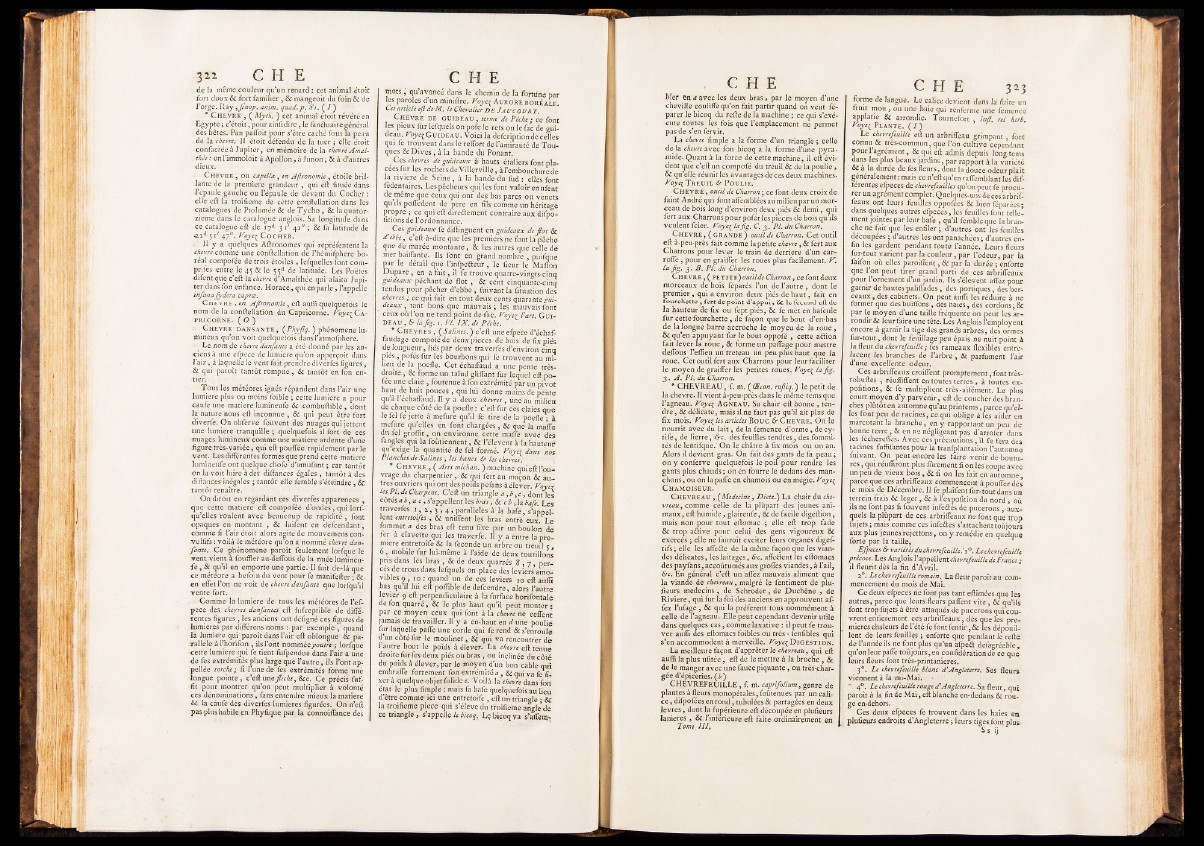
t
J0ÉP C H E
de la même couleur.qu’un renard : cet animal étoit
fort doux & fort familier , & mangeoit du foin & de
l ’orge. Ray ,finop. anim. quad.p. Si. ( I )
* C hevre , ( Myth. ) cet animal étoit révéré en
Egypte ; c’étoit, pour ainfi dire, le fanâuaire général
des bêtes. Pan paffoit pour s’être caché fous lapeau
de la chevre. Il étoit défendu de la tuer ; elle étoit
confacréeà Jupiter, en mémoire de la chevre Amal-
-thée : onl’immoloit à Apollon , à Junon, & à d’autres
dieux.
C hevre , ou capella , en Aflronomie , étoile brillante
de la première grandeur , qui eft fituée dans
l’épaule gauche ou l’épaule de devant du Cocher :
elle eft la troifieme de cette conftellation dans les
catalogues de Ptolomée & de Tycho , & la quatorzième
dans le catalogue anglois. Sa longitude dans
ce catalogue eft de i7 d 3 1' 41" ; & fa latitude de
û i d- 51' 47". Voyc^ C o ch er .
- Il y a quelques Aftronomes qui repréfentent la
chevre comme une conftellation de l’hémifphere boréal
compbfée de trois étoiles , Iefquelles font comptai
l’es entre le 45 & le 55d de latitude. Les Poètes
difent que c’eft la chevre d’Amalthée qui alaita Jupiter
dans fon enfance. Horace, qui en parle, l’appelle
infanafyderaçaprce.
C hevre , en Aflronomie, eft aufli quelquefois le
nom de la conftellation du Capricorne, C apr
ico rn e . ( O )
!i C hevre d an san t e , ( Phyflq. ) phénomène lumineux
qu’on voit quelquefois dansl’atmofphere.
Le nom de chevre danfante a été donné par les anciens
à une efpece de lumière qu’on apperçoit dans
l’a ir , à laquelle le vent fait prendre diverfes figures,
& qui paroît tantôt rompue , & tantôt en fon entier.
Tons les météores ignés répandent dans l’air une
lumière plus ou moins fôible ; cette lumière a pour
caufe une matière Iumineufe & combuftible , dont
la nature nous eft inconnue , & qui peut être fort
diverfe. On obferVe fouvent des nuages qui jettent j
une lumière tranquille ; quelquefois il fort de ces '
nuages lumineux comme une matière ardente d’une
figure très-variée, qui eft pouffée rapidement par le
vent. Les différentes formes que prend cette matière
Iumineufe ont quelque chofe •d’amufant ; car tantôt
on la voit luire à des diftances égales , tantôt à'des
diftanees inégales ; tantôt elle femble s’éteindre, &
tantôt renaître.
On difôit en regardant ces diverfes apparences ,
que cette matière eft compofée d’ondes, qui lorf-
qu’elles roulent avec beaucoup de rapidité , font
opaques en montant , & luifent en dèfcendant j
comme fi l’air étoit alors agité de mouvemerts eOn-
vullifs : voilà le météore qu’on a nommé chèvre danfante.
Ce phénomène paroît feulement lorfque le
vent vient à fouffler au-deffous de la nuéelumineu-
f e , & qu’il en emporte ünë partie. Il fuit de-là que
ce météore a befoin du vent pour fe manifefter ; &
en effet l’on ne voit de chevre danfante que lorfqu’il
vente fort.
Comme la lumière de tous les météores de l’ef-
pece des chevres danfantes eft fufceptible de diffé-
-rentes figures , les anciens' ont défigné ces figures de
lumières par différens noms : par exemple , quand
la lumière qui paroît dans l’air eft oblongue & parallèle
à l’horifon , ils l’ont nommée poutre*; 'lorfque
•cette lumière qui fe tient fufpendue dans l’air a une
de fes extrémités plus large que l’autre , ils Tónt ap-
pellée torche; fi l’une de fes extrémités forme une
longue pointe, c’eft unQflecheytkc. Ce précis Suffit
pour montrer qu’on peut multiplier à volonté
ces dénominations, fans entendre mieux la matière
& la càufe des diverfes lumières figurées. On n’eft
pas plus habile en Phyfique par la connoiffance des
C H E
mots qu’avancé dans le chemin de la fortuné par
les paroles d’un miniftre. Voye^ Aurore boréale.
Cet article efl de M . le Chevalier D E J a U C q ü r t .
C hevre de guideau , terme de Pêche; ce font
les pieux fur léfquels on pofe le rets ou le fac de guideau.
Pbye^GuiDEAV. Voici la defcription de celles
qui fe trouvent dans le reffort de l’amirauté de Touques
& D iv e s , à la bande du Ponant.
, Ces chevres de guideaux à hauts étaliers font placées
fur les rochers de Villerville, à l’embouchure de
la riviere de Seine , à la bande du fud : elles font
fedentaires. Les pêcheurs qui les font valoir en ufent
de même que ceux qui ont des bas parcs ou venets
qu’ils poffedent de pere en fils comme un héritage
propre ; ce qui eft directement contraire aux difpo-
fitiohs de l’Ordonnance.
( Ces guideaux fe diftinguent en guideaux de flot Sc
d’ebbe, C’eft-à-dire que les premiers ne font la pêche
| que de marée montante , & les autres que celle de
j mer baiffante. Ils font en grand nombre , puifque
par le détail que l’infpefteur, le fieur le Mafl'on
Duparc , en a fa it , il fe trouve quatre-vingts-cinq
guideaux pêchant de flot , & cent cinquante-cinq
tendus pour pêcher d’ebbe , fuivant la fituation des
chevres ; ce qui fait en tout deux cents quarante guideaux
, tant bons que mauvais ; les mauvais font
ceux où l’on ne tend point de fac. Voyez l'art. G uideau
, & la fig. /. PI. IX . de Pêche.
* C hevres , ( Salines. ) c’eft une efpece d’échaf-
faudage compofé de deux pièces de bois de fix pies
de longueur, liés par deux traverfes d’environ cinq
piés, pofés fur les bourbons qui fe trouvent au milieu^
de la poefle. Cet échaffaud a une pente très-
droite , & forme un talud gliffant fur lequel eft po-
fée une claie-, foutenue à fon extrémité par un pivot
haut de huit pouces , qui lui donne moins de pentè
qu à l’echaffaud. II y à deux chevres , une au milieu
de chaque côté de la poefle : c’eft fur cès claies que
le fel fe jette à mefure qu’il fe tire de la poefle ; à
mefure qu’elles èn font chargées , & que la maffe
dn fel groflit, on environne cette maffe avec dès
fangles qui la foûtiennent, & l’élevent à la hauteur'
qu’exige la quantité de fel formé. Voye[ dans nos
Planches de Salines , les bancs & les chevres.- • -
* C hevre , ( Arts méchan. ) machine qui eft l’ouvrage
du charpentier , & qui fert au maçon & autres
ouvriers qui ont des poids pefans à élever. Voyer
ielW m M È M C ’eft un triangle a ,b , c , dont les
côtés a b,a 0^ s’appellent les bras , & c b > la bafe. Les
traverfes 1 , z , 3 , 4 , parallelès à la bafé , s’appellent
entretoifes , & uniffent 4 èj> bras entre eux. Le
fommet a des bras eft tenu fixe par un boulon de
fer à clavette qui les traverfe. Il y a entre la première
entretoife & la fecdnde un arbre ou treuil c ,
6 , mobile fur lui-même à l’aide de deux tourillons
pris dans lés bras , & de deux quarrés 8 , 7 , percés
de trous dans lefquels on place des leviers amovibles
5», iq : quand un de ces leviers 10 eft aufli
bas qu’il lui eft poflible de defcendre, alors l’autre
levier 9 eft perpendiculaire à la furface horifontale
de fon quarre, & le plus haut qu’il peut monter :
par ce moyen ceux qui font à la chevre ne ceffent
jamais de travailler. Il y a en-haut en d une poulie
fur laquelle paffe une corde qui fe rend & s’enroulé
d’un Côté fur le moulinet, & qui va rencontrer de
l’autre bout'le poids à élever. La chevre eft tenue
droite fur fes deux piés ou b ras, ou inclinée du côté
du poids à élever, par le moyen d’un bon cable qui
embralfe fortement fon extrémités , & qui va fe fixer
à quelque objet folide e. Voilà la chevre dans fon
état le plus fimple : mais fa bafe quelquefois au lieu
d’être comme-ici une entretoife, eft un triangle ; &
la troifieme piece qui s’élève du troifieme angle*de
ce triangle , s’appelle le bicoq. Lç bicoq va s’affem-
, C H E
hier en a avec les deux bras, par le moyen d’une
cheville couliffe qu’on fait partir quand on veut fé-
parer le bicoq du refte de la machine ; ce qui s’exécute
toutes fes fois que l’emplacement ne permet
pas de s’en fervir.
La chevre fimple a la forme d’un triangle ; celle
de la chevre avec fon bicoq a la forme d’une pyramide.
Quant à la force de cette machine, il eft évident
que c’eft un compofé du treuil & de la poulie ,
& qu’elle réunit les avantages de ces deux machines.
V6ye{ T reuil & Po ulie.
C hevre , outil de Charron ; ce font deux croix de
faint André qui font affemblées au milieu par un morceau
de bois long d’environ deux piés & demi, qui
fert aux Charrons pour pofer les pièces de bois qu’ils
veulent fcier. Voye^ la fig. C. g. PL du Charron.
C h ev re, ( GRANDE ) outil de Charron. Cet outil
eft à-peu-près fait comme la petite chevre, & fert aux
Charrons pour lever le train de derrière d’un car-
roffe , pour en graiffer les roues plus facilement. V .
la fig. g. B. PI. du Charron.
C hevre , ( p e t ite ) outilde Charron, ce font deux
morceaux de bois féparés l’un de l’autre, dont le
premier , qui a environ deux piés de haut, fait en
fourchette, fert de point d’appui; & le fécond eft de
la hauteur de fix ou fept piés, & fe met en bafcule
fur cette fourchette, de façon que le bout d’en-bas
de la longue barre accroche le moyeu de la roue,
& qu’en appuyant fur le bout oppofé , cette aâion
fait lever la roue, & forme un paflage pour mettre
deffous l’eflieu un treteau un peu plus haut que la
roue. Cet outil fert aux Charrons pour leur faciliter
le moyen de graiffer les petites roues. Voye^ la fig.
g . A . PI. du Charron.
* CHEVREAU, f. m. ( (Econ. rufliq. ) le petit de
la chevre. Il vient à-peu-près dans le même tems que
l’agneau. Voye{ A gneau. Sa chair eft bonne , tendre
, & délicate, mais il ne faut pas qu’il ait plus de
fix mois. Voyelles articles B o u c & C hevre. On le
nourrit avec du la it , de la femence d’orme, de cy-
tife, de lierre, &c. des feuilles tendres, des fommi-
tés de lentifque. On le châtre à fix mois ou un an.
Alors il devient gras. On fait des gants de fa peau ;
on y conferve quelquefois le poil pour rendre les
gants plus chauds ; on en fourre le dedans des manchons
, ou on la paffe en chamois ou en mégie. Voyeç
C hamoiseur.
C hevreau , (Médecine, Diete.') La chair du chevreau
, comme celle de la plupart des jeunes animaux
, eft humide, glaireufe, 6c de facile digeftipn,
mais non pour tout eftomac ; elle eft trop fade
& trop aâive pour celui des gens vigoureux &
exercés ; elle ne fauroit exciter leurs organes digef-
tifs ; elle les affeûe de la même façon que les viandes
délicates, les laitages, &c. affeftent les eftomacs
des payfans, accoutumés aux groffes viandes, à l’ail,
&c. En général c’eft un affez mauvais aliment que
la viande de chevreau, malgré le fentiment de plusieurs
médecins , de Schroder , de Duchêne , de
Riviere, qui fur la foi des anciens en approuvent affez
l’ufage , & qui la préfèrent tous nommément à
celle de l’agneau. Elle peut cependant devenir utile
dans quelques cas, comme laxative : il peut fe trouver
aufli des eftomacs foibles ou très - fenfibles qui
s’en accommodent à merveille. Voye\ D ig e s t io n .
La meilleure façon d’apprêter le chevreau, qui eft
aufli la plus ufitée, eft de le mettre à la broche , &
de le manger avec une fauce piquante, ou très-char-
gée d’épiceries. (1»)
CHEVREFEUILLE, f. m. caprifolium, genre de
plantes à fleurs monopétales, foûtenues par un calice
, difpofées en rond, tubulées & partagées en deux
levres, dont la fupérieure eft découpée en plufieurs
lanières , & l’inférieure eft faite ordinairement en
Tome I I I .
C H E 323
forme de langue. Le calice devient dans la fuite un
fruit mou, ou une baie qui renferme une femence
applatie & arrondie. Tournefort infl. rei htrb.
Voyei Plante. ( 7 )
Le chèvrefeuille eft un arbrifleau grimpant, fort
connu & très-commun, que l’on cultive cependant
pour l’agrément, & qui eft admis depuis long-tems
dans les plus beaux jardins, par rapport à la variété
& à la duree de fes fleurs, dont la douce odeur plaît
généralement : mais ce n’eft qu’en raffemblant les differentes
efpeces de chèvrefeuilles qu’on peut fe procurer
un agrément complet. Quelques-uns de ces arbrif-
feaux ont leurs feuilles oppofees & bien féparées ;
dans quelques autres efpeces, les feuilles font tellement
jointes par leur bafe , qu’il femble que la branche
ne fait que les enfiler ; d’autres ont les feuilles
découpées ; d’autres les ont panachées ; d’autres enfin
les gardent pendant toute l’année. Leurs fleurs
fur-tout varient par la couleur, par l’odeur, par la
faifon où elles paroiffent, & par la durée ; enforte
que l’on peut tirer grand parti de ces arbriffeaux
pour l’ornement d’un jardin. Ils s’élèvent affez pour
garnir de hautes paliffades, des portiques, des berceaux
, des cabinets. On peut aufli les réduire à ne
former que des buiffons , des haies, des cordons ; &
par le moyen d’une taille fréquente on peut les arrondir
& leur faire une tête. Les Anglois l’employent
encore à garnir la tige des grands arbres, des ormes
fur-tout, dont le feuillage peu épais ne nuit point à
la fleur du chèvrefeuille; fes rameaux flexibles entrelacent
les branches de l’arbre, & parfument l’air
d’une excellente odeur.
Ces arbriffeaux croiffent promptement, font très-
robuftes , réufliffent en toutes terres , à toutes ex-
pofitions, & fe multiplient très-aifément. Le plus
court moyen d’y parvenir, eft de coucher des branches
plutôt en, automne qu’au printems, parce qu’elles
font peu de racines, ce qui oblige à les aider en
marcotant la branche, en y rapportant un peu de
bonne terre, & en ne négligeant pas d’arrofer dans
les féchereffes. Avec ces précautions, il fe fera des
racines fuffifantes pour la tranfplantation l’automne
fuivant. On peut encore les faire venir de boutures
, qui réufliront plus fûrement fi on les coupe avec
un peu de vieux bois, & fi on les fait en-automne,
parce que ces arbriffeaux commencent à pouffer dès
le mois de Décembre. U fe plaifent fur-tout dans un
terrein frais & leger, & à l’expofition du nord, où
ils ne font pas fi fouvent infeftés de pucerons, auxquels
la plupart de ces arbriffeaux ne font que trop
lujets ; mais comme ces infeftes s’attachent toujours
aux plus jeunes rejettôns, on y remédie en quelque
forte par la taille,
Efpeces & variétés du chèvrefeuille.' \°. Le chèvrefeuille
précoce. Les Anglois l’appellent chèvrefeuille de France ;
il fleurit dès la fin d’Avril.
z°. Le chèvrefeuille romain. La fleur paroît au com mencement
du mois de Mai.
Ce deux efpeces ne font pas tant eftimées que les
autres, parce que leurs fleurs paffent v îte , & qu’ils
font trop fujets à être attaqués de pucerons qui couvrent
entièrement ces arbriffeaux, dès que les premières
chaleurs de l’été fe font fentir, & les dépouillent
de leurs feuilles ; enforte que pendant le reftei
de l’année ils ne font plus qu’ua afpeét defagréable ,
qu’on leur paffe toûjours, en confidération de ce que_
leurs fleurs font très-printanieres.
30. Le chèvrefeuille blanc d'Angleterre. Ses fleurs
viennent à la mi-Mai.
' 40. Le chèvrefeuille rouge d?Angleterre. Sa fleur, qui
paroît à la fin de Mai, eft blanche en-dedans & rouge
en-dehors.
Ces deux efpeces fe trouvent dans les haies en
plufieurs endroits d’Angleterre ; leurs tiges font plus
S s 'ij '