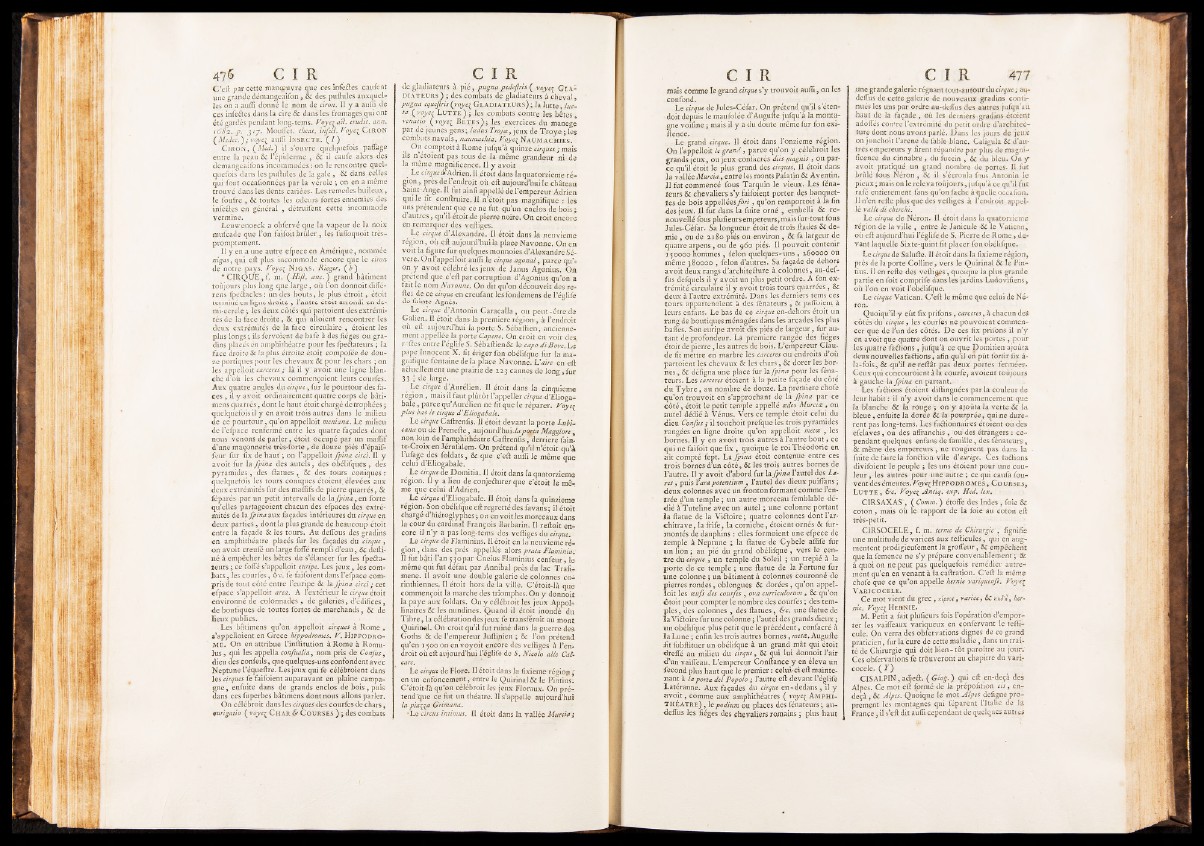
C ’eft pat cette manoeuvre que cesinfefles caufent
une grande démangeaison, 6c des pullules auxquelles
on a auffi donné le nom de ciron. Il y a auffi de
ces infefles dans la cire 6c dans les fromages qui ont
été gardés pendant long-tems. Voye^acl. érudit, ann.
1682 . p . 3 17 - Mouffe't. theat, infect. Voye^_ CiRON
(Medec. ) ; voye{ auffi INSECTE. ( / )
C ir o n , ( Med. ) il s’ouvre quelquefois partage
entre la peau 6c l’épiderme , 6c il caufe alors des
demangcaifons incommodes : on le rencontre quelquefois
dans les p u llu le s de la pale , 6c dans celles
qui-font occafionnées par la verole ; on en a môme
trouvé dans les dents cariées. Les remedes huileux,
le foufre , 6c toutes les odeurs fortes ennemies des
infefles en général ., détruifent cette incommode
vermine.
Leuwenoeck a obfervé que la vapeur de la noix
mufca.de que l’on faifoit brider , les fuffoquoit très-
promptement.
Il y en a une autre efpece en Amérique, nommée
nigas, qui eft plus incommode encore que le ciron
de notre pays. Voye^ Nig a s . Rieger. (/>)
* C IRQUE, f. m. ( Hifl. anc. ) grand bâtiment
toujours plus long que large, oii l’on donnoit diffé-
rens fpecîacles : un des bouts, le plus étroit , étoit
terminé en ligne droite ; l’autre étpit arrondi en demi
cercle ; les deux cotés qui partoient des extrémités
de la face droite, & qui alloient rencontrer les
deux extrémités de la face circulaire , étoient les
plus longs ; ils fervoiçnt de bafe à des lièges ou gradins
placés en amphithéâtre pour les fpeflateurs ; la
face droite & la plus étroite étoit compofée de douze
portiques pour les chevaux 6c pour les chars ; on
les appelloit carceres ; là il y avoit une ligne blanche
d’où les chevaux commençoient leurs courfes..
Aux quatre angles dii cirque, fur le poiirtour des faces
, il y avoit ordinairement quatre corps de bâti-
mens quarrés, dont le haut étoit chargé de trophées ;
quelquefois il y en avoit trois autres dans le milieu
de ce pourtour, qu’on appelloit meniana. Le milieu
de l’efpaçe renfermé entre les quatre façades dont
nous venons de parler, étoit occupé par un malîif
d’une maçonnerie très-forte , de douze piés d’épaif-
feur fur fix de haut' ; on l’appelloit fp in a circi. Il y
avoit fur la fpina des autels, des obélifques , des
pyramides , des flatues , 6c des tours coniques :
quelquefdis les tours, coniques étoient, élevées aux
deux extrémités fur des maffifs de pierre quarrés, &
féparés par un petit intervalle de la fpina, en forte
qu’elles partageoient chacun des efpaces des extrémités
de la fpina aux façades intérieures du cirque en
deux parties, dont la plus grande de beaucoup étoit
entre la façade & les tours. Audeffous des gradins
en amphithéâtre placés fur les façades du cirque ,
on avoit creufé un large foffé rempli d’eau, 6c defti-
né à empêcher les bêtes de s’élancer fur les fpefta-
îeurs ; ce foffé s’appelloit euripe. Les jeux, les combats
, les courfes, &c. fefaifoient dans l’efpace compris'de
tout côté entre l’euripe & la fpina circi ; cet
efpace s’appelloit area. A l’extérieur le cirque étoit
environné de colonnades , de galeries, d’édifices,
de boutiques de toutes fortes de marchands , 6c de
lieux publies.
Les bâtimens qu’on appelloit cirques à Rome ,
s’appelloient eh Grece hippodromes. V. Hippodrom
e . On en attribue l’inflitution à Rome à Romu-
lus y qui les appella confualia, nom pris de Confus,
dieu des confeils, que quelques-uns confondent avec
Neptune l’équeftre. Les jeux qui fe célébroient dans
les cirques fe faifoient auparavant en plaine campagne
, enfuite dans de grands enclos de bois, puis
dans ces fuperbes bâtimens dont nous allons parler.
On célébroit dans les cirques des courfes de chars,
çurigatio ( voye{ CHAR & COURSES ) ; des combats
de gladiateurs à pié, pugna pedeflris ( voye^ Gladiateurs
) ; des combats de gladiateurs à,cheval ,
pugna equejtris (voye{ Gla d ia teu r s ) ; la lutte, lue-
ta ( voye{ Lu t t e ).;, les combats contre les bêtes
venaiip (voyei Be t e s ) ; les exercices du manege
par de jeunes gens ; ludus Troja, jeux de Troye ; les
combats navals, naumachia. Voye^ Naum a ch ie s .
On comptoit à Rome jufqu’à quinze cirques ; mais
ils n’étoient pas tous de la même grandeur ni de
la même magnificence. Il y avoit
Le cirque d’Adrien. Il ptoit dans la quatorzième région
, près de l’endrojt oit eft aujourd’hui le château
Saint-Ange. Il fut ainfi appellé de l’empereur Adrien
qui le fit conftruire. Il.n’étoit pas magnifique : les
uns prétendent que ce ne fut qu’un enclos de bois ;
d’autres, qu’i l étoit de pierre noire. On croit encore
en remarquer des vertiges.
t Le cirque d’Alexandre. Il étoit dans la neuvième
région, où eft aujourd’hui la place Navonne. On en
voit la figure fur quelques monnoies d’Alexandre Sévère.
O nl’appelloit auffi le cirque agonal, parce qu’-
On y avoit célébré les jeux de Janus Agonius. On
prétend que ç’eft par corruption d’Agonius qu’on a
fait le nom Navonne. On dit qu’on découvrit des relies
de ce cirque en creufant lesfondemens de leglife
de fainte Agnès.
Le cirque d’Antonin Caracalla , ou peut-être de
Galien. 11 étoit dans la première région , à l’endroit
ou eft aujourd’hui la porte S. Sébaftien, anciennement
appellée la porte Capene. On croit en voir des,
roftes entrel’églife S. Sébaftien 6c le capo di Bove.Le
pape Innocent X. fit ériger fan obélifque fur la magnifique
fontaine de la place Navonne. L ’aire en eft
aéluellement une prairie de 213 cannes de long, fur
33 i-de_ largé.^
; Le cirque d’Aurélien. II étoit dans la cinquième
région, mais il faut plutôt l’appellèr cirque d’Elioga-
bale, parce qu’Aurélien ne fit que le réparer. Voye{
plus bas le cirque d’Eliogabale.
Le cirque Caftrenfis. Il étoit devant la porte LubU
cana ou de Prenefte, aujourd’hui./«pogta Maggiore 9
non loin de l’amphithéatre Caftrenfis, derrière fain-
te-Croix en Jérulalem. On prétend qu’il n’étoit qu’à
I ufage des foldats, 6c que c’eft auffi le même que
celui d’Eliogabale.
Le cirque de Domitia. II étoit dans la quatorzième
région. Il y a lieu de conjeflurer que c’étoit le même
que celui d’Adrien.
j Le cirque d’Eliogabale. Il étoit dans la quinzième
région. Son obélifque eft regretté des favans; il étoit
chargé d’hiéroglyphes ; on en voit les morceaux dans
la cour du cardinal François Barbarin. Il reftoit en-,
core il n’y a pas long-tems des vertiges du cirque.
Le cirque de Flaminius. Il étoit en la neuvième région
, dans des prés appellés alors prata Flaminiaï
II fut b£ti l’an 530par Cneius Flaminius cenfeur* le
même qui fut défait par Annibal près du lac Trafic
mene. Il avoit une double galerie de colonnes corinthiennes.
Il étoit hors de la ville. C ’étqit-là que
commençoit la marche des triomphes. On y donnoit
la paye aux foldats. On y célébroit les jeux Appol-
linaires 6c les nundines. Quand il étoit inondé du
Tibre, la célébration des jeux fe transféroit au mont
Quirinal, On croit qu’il fut ruiné dans la guerre des
Goths & de l’empereur Juftinien ; 6c l’on prétend
qu’en 1500 on en voyoit encore des veftiges à l’endroit
oii eft aujourd’hui l’églife de S. Nicolo aile Cal»
care.
Le cirque de Flore. Il étoit dans la fixieme régiop ;
en un enfoncement ,• entre le Quirinal 6c le Pintius:
C ’étoit-rà qu’on célébroit les jeux Floraux. On prétend
que ce fut un théâtre. Il s’appelle aujourd’hui
la pia^ga Grimana.
•Le circus intirnus. Il étoit dans la vallée Mur cia;
mais comme le grand cirque s’y trouvoit auffi, on les
confond. , . ;
Le cirque de Jules-Céfar. On prétend qu’il s ’éten-
doit depuis le maufolée d’Augufte jufqu’à la montagne
voifine ; mais il y a du doute même fur fon existence.
Le grand cirque. Il étoit dans l’onzieme région.
On l’appelloit Le grandy par ce qu’on y célébroit les
grands jeux, ou jeux confacrés dits piagnis , ou parce
qu’il étoit le plus grand des cirques. Il étoit dans
la vallée Murcia., entre les monts Palatin 6c Aventin.
Il fut commencé fous Tarquin le vieux. Les féna-
leurs 6c chevaliers s’y faifoieijt porter des banquettes
de bois appellées fo r i, qu’on remportoit à la fin
des jeux. Il fut dans la fuite orné , embelli 6c re-
nouvellé fous plufieurs empereurs, mais fur-tout fous
Jules-Céfar. Sa longueur étoit de trois ftades 6c demie
, ou de 2180 piés ou environ , & fa largeur de
quatre arpens, ou de 960 piés. Il pouvoit contenir
150000 hommes , félon quelques-tins , 260000 ou
même 380000 , félon d’autres. Sa façade de dehors
avoit deux rangs d’architeflure à colonnes, au-def-
fus defquels il y avoit un plus petit ordre. À fon extrémité
circulaire il y avoit trois tours quarrées, 6c
deux à l’autre extrémité. Dans les derniers tems ces
tours appartenoient à des fénateurs , & partoient à
leurs enfans. Le bas de ce cirque en-dehors étoit un
rang de boutiques ménagées dans les arcades les plus
bafles. Son euripe avoit dix piés de largeur, fur autant
de profondeur. La première rangée des fiéges
étoit de pierre, les autres de bois. L’empereur Claude
fit mettre en marbre les carceres ou endroits d’oii
partoient les chevaux & les chars, 6c dorer les bornes,
6c défigna une place fur la fpina pour les fénateurs.
Les carceres étoient à la petite façade du côté
du T y b r e , au nombre de douze. La première chofe
qu’on trouvoit en*s’approchant de la fpina par ce
cô té , étoit le petit temple appellé cédés Murciae , ou
autel dédié à Vénus. Vers ce temple étoit celui du
dieu Confus ; il touchoit prefque les trois pyramides
rangées en ligne droite qu’on appelloit metee , les
bornes. Il y en avoit trois autres à l’autre bout, ce
qui ne faifoit que fix , quoique le roiTheodoric en
ait compté fept. La Jpina étoit contenue entre ces
trois bornes d’un côté , & les trois autres bornes de
l ’autre. Il y avoit d’abord fur la fpina l’autel des Lares
y puis l’arapotentium , l’autel des dieux puiffans ;
deux colonnes avec un fronton formant comme l’entrée
d’un temple ; un autre morceau femblable dédié
à Tuteline avec un autel ; une colonne portant
la ftatue de la Victoire ; quatre colonnes dont l’architrave,
la frife, la corniche , étoient ornés & fur-
montés de dauphins : elles formoient une efpece de
temple à Neptune ; la ftatue de Cybele affife fur
un lion; au pié du grand obélifque, vers le centre
du cirque , un temple du Soleil ; un trepié à la
porte de ce temple ; une ftatue de la Fortune fur
une colonne ; un bâtiment à colonnes couronné dè
pierres rondes, oblongues & dorées, qu’on appelloit
les oeufs des courfes , ova curriculorum , 6c qu’on
ôtoit pour compter le nombre des courfes ; des temples,
des colonnes , des flatues, &c. une ftatue de
la Viéloire fur une colonne ; l’autel des grands dieux ;
un obélifque plus petit que le précédent, confacré à
la Lune ; enfin les trois autres bornes, metà. Augufte
fit fubftituer ui> obélifque à un grand mât qui étoit
drefle au milieu du cirque, & qui lui donnoit l’air
d’un vaiffeau. L’empereur Confiance y en éleva un
fécond plus haut que le premier : celui-ci eft maintenant
à la porta del Popolo ; l’autre eft devant l’églife
Latéranne. Aux façades du cirque en -dedans , il y
a v o it , comme aux amphithéâtres ( voye{ Amph ith
é â tr e ) , le podium ou places des fénateurs ; au-
deffus les fiéges des chevaliers romains ; plus haut
une grande galerie régnant tout-autour du cirque ; aq-
deffus de cette galerie de nouveaux gradins continués
les uns par ordre au-deffus des autres jufqu’au
haut de la façade, où les derniers gradins étoient
adoffés contre l’extrémité du petit ordre d’architecture
dont nous avons parlé. Dans les jours de jeux
on jonchoit l’arene de fable blanc. Caligula 6c d’autres
empereurs y firent répandre par plus de magnificence
du cinnabre, du fuccin , 6c du bleu. On y
avoit pratiqué un grand nombre de portes. Il fut
brûlé fOus Néron, 6c il s’écroula fous Antonin le
pieux ; mais on le releva toujours, jufqu’à ce qu’il fut
rafé entièrement fans qu’on fâche à quelle occafion.
Il n’en relie plus que des veftiges à l’endroit appellé
valle di cherchi.
Le cirque de Néron. Il étoit dans la quatorzième
région de la ville , entre le Janicule 6c le Vatican,
où eft aujourd’hui l’églife de S, Pierre de Rome > devant
laquelle Sixte-quint fit placer fon pbélifque.
Le cirque de Salufte. Il étoit dans la fixieme région,
près de la porte Colline, vers le Quirinal & le Pintius.
Il en relie des veftiges, quoique la plus grande
partie en fôit comprife dans les jardins Ludovifiens,
où l’on en voit l’obélifque.
Le cirque Vatican. C ’ eft le même que celui de Néron
.Q
uoiqu’il y eût fix prifons , carceres, à chacun des
côtés du cirque , les courfes ne pouvoient commencer
que de l’un des côtés. De ces fix prifons il n’y
en avoit que quatre dont on ouvrît les portes , pour
les quatre faélions , jufqu’à ce que Domitien ajoûta
deux nou velles faéliôns, afin qu’il en pût fortir fix à-
la-fois, & qu’il ne reliât pas deux portes fermées»
Ceux qui concouroient à la courfe, avoient toûjours
à gauche -la fpina en partant.
Les fa fiions étoient diftinguées parla couleur de
leur habit : il n’y avoit dans le commencement que
la blanche 6c la rouge ; on y ajoûta la verte ô i la
bleue, enfuite la doree 6c la pourprée, qui ne durèrent
pas long-tems. Les faflionnaires étoient ou des
efclaves , ou des affranchis , :ou des étrangers : cependant
quelques enfans de famille, des fenateurs,
& même des empereurs , ne rougirent pas dans la
fuite de faire la fo n flio n - v i l e à ’aurige. Ces taftions
divifoient le peuple ; les uns étoient pour une couleu
r , les autres pour une autre ; ce qui caufa fou-
vent des émeutes.. / ^ « { H i p p o d r o m e s , C o u r s e s ,
L u t t e , & c . Voye{ A n t iq . e x p . Hed. le x .
CIRSAXAS', ( Comm. ) étoffe des Indes , foie 6c
coton, mais où le rapport de la foie au coton eft:
très-petit.
CIRSOCELE, f. m. terme de Chirurgie , fignifie
une multitude de varices aux tefticules, qui en augmentent
prodigieufement la groffeur, 6c empêchent
que la femence ne s’y prépare convenablement ; &
à quoi on ne peut pas quelquefois remédier autrement
qu’en en venapt à la caftration. C ’eft la même
chofe que ce qu’on appelle hernie variqueufe. Voye£
VARICOCELE.
Ce mot vient du grec, y.lfxroc, varice} & «»«T», hernie.
Voye{ Hernie. .
M. Petit a fait plufieurs fois l’opération d’emporter
les vaiffeaux variqueux en confervant le tefti-
cule. On verra des oblervations dignes de ce grand
praticien, fur la cure de cette maladie, dans un traité
de Chirurgie qui doit bien-tôt paroître au jour;
Ces obfervations fe trôuveront au chapitre du varicocèle*
( T )
CISALPIN, adjefl. ( Géog. ) qui eft en-deçà des
Alpes. Ce mot eft formé de la prépofition cis, en-
deçà , 6c Alpes. Quoique le mot Alpes defigne proprement
les montagnes qui féparent l’Italie de la
France, il s’eft dit auffi cependant de quelques autres