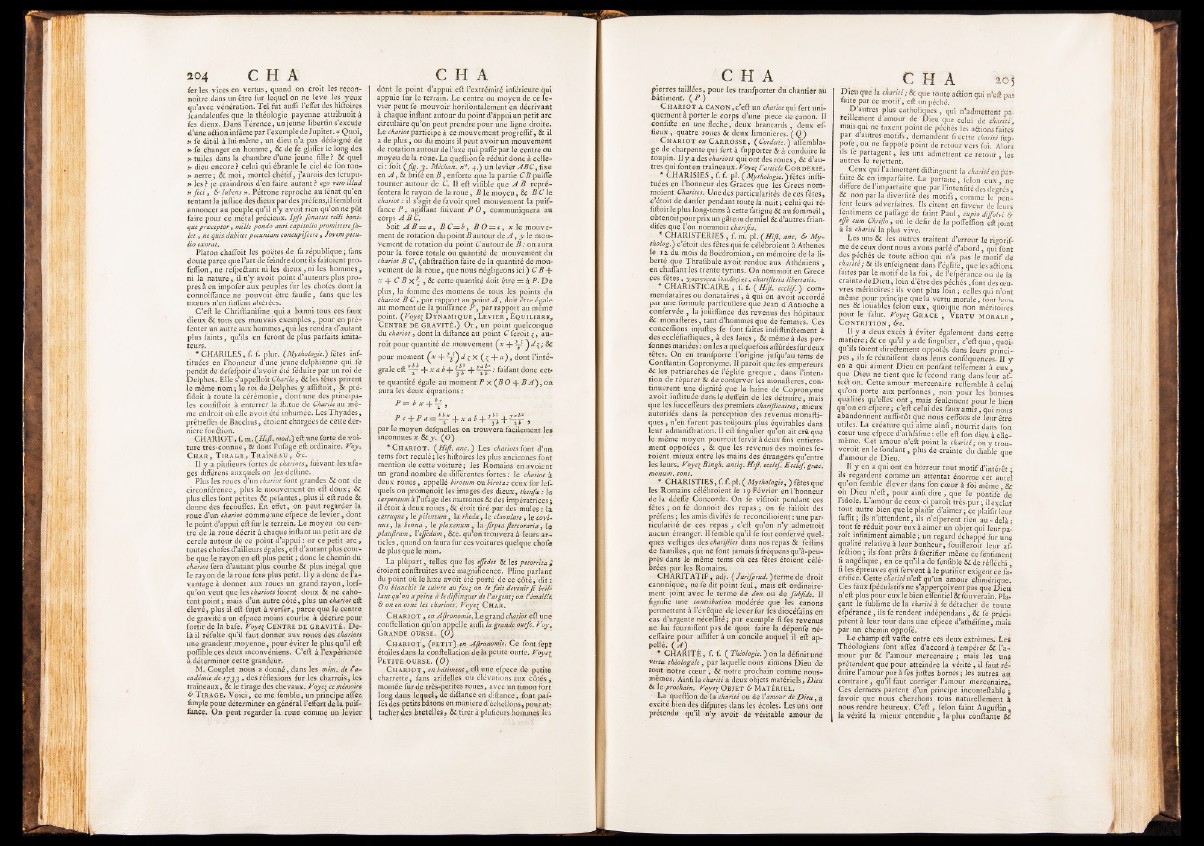
ao4 C H A
fer les vices en vertus, quand on croit les recon-
noître dans un être fur lequel on ne leve les yeux
qu’avec vénération. T el fut aufli l’effet des hiftoires
fcandaleufes que la théologie payenne attribuoit à
fes dieux. Dans Térence, un jeune libertin s’excuie
d’une attion infâme par l’exemple de Jupiter. « Quoi,
» fe dit-il à lui-même, un dieu n’a pas dédaigné de
» fe changer en homme, & de fe giiffer le long des
» tuiles dans la chambre d’une jeune fille ? & quel
» dieu encore ? celui qui ébranle le ciel de fon ton-
» nerre ; & moi, mortel chétif, j’aurois des fcrupu-
» les ? je craindrois d’en faire autant ? ego vero illud
» feci t & lubens ». Pétrone reproche au fénat qu’en
tentant la juftice des dieux par des préfens,il fembloit
annoncer au peuple qu’il n’y avoit rien qu’on ne pût
faire pour ce métal précieux. Ipfe fenatus recli boni-
que practptor, mille pondo auri capitolio promittere foin
y nequis dubitu pecuniam concupifçere , Jovem pecu-
lio exorat.
Platon chaffoit les poètes de fa république ; fans
doute parce que l’art de feindre dont ils faifoient pro-
fefïion, ne refpeûant ni les dieux, ni les hommes,
ni la nature, il n’y avoit point d’auteurs plus propres
à en impofer aux peuples fur les chofes dont la
connoiffance ne pouvoit être fauflê, fans que les
moeurs n’en fuffent altérées.
C ’eft le Chriftianifme qui a banni tous ces faux
dieux & tous ces mauvais exemples, pour en pré*
fenter un autre aux hommes, qui les rendra d’autant
plus faints, qu’ils en feront de plus parfaits imita.-
teurs.
*CHARILES, f. f. plur. (Mythologie.') fêtes inf-
tituées en l’honneur d’une jeune delphienne qui fe
pendit de dëfefpoir d’avoir été féduite par un roi de
Delphes. Elle s’appelloit ChariUy Scies fêtes prirent
le même nom ; le roi de Delphes y afliftoit, & pré-
fidoit à toute la cérémonie, dont une des principar
les confiftoit à enterrer la ftatue de Charité au même
endroit oii elle avoit été inhumée. Les Thyades,
prêtreffes de Bacchus, étoient chargées de cette derr
niere fonction.- :
CHARIOT, f. m. (Hijl. mod.)eft une forte de voiture
très-connue, & dont l’ufage eft ordinaire. Voy.
C h a r , T ir a g e ,.T r aîne au , & c. .
Il y a plufieurs fortes de chariots, fuivant les ufa-
ges différens auxquels on les-deftine.,
Plus les roues d’un chariot font grandes & ont de
circonférence, plus le mouvement en eft doux; &
plus elles font petites & pelantes, plus il eft rude &
donne des fecoufies. En effet, on peut regarder la
roue d’un chariot comme une efpece de levier, dont
le point d’appui eft fur le terrein. Le moyeu ou centre
de la roue décrit à chaque inftant un petit arc de
cercle autour de ce point d’appui : or ce petit a rc ,
toutes ehofes d’ailleurs égalés., eft d’autant plus courbe
que le rayon en eft plus petit ; donc le chemin dii
chariot fera d’autant plus courbe & plus inégal que
le rayon de la roue fera plus petit. 11 y a donc de l’avantage
à donner aux roues un grand rayon, lorf-
qu’on veut que les. chariots foient doux & ne cahotent
point ; mais d’un autre côté, plus un chariot eft
élevé, plus il eft fujet à v erfer, parce que le centre
de gravité a un efpace moins courbe à décrire peur
fortir de la bafe. Ÿoyei C entre de g r a v it é . De-,
là il réfulte qu’il faut donner aux roues des chariots
une grandeur moyenne, pour éviter le plus qu’il eft
poffibleces deuxinconvénieos. C ’eft à l'expérience
à. déterminer cette grandeur.
M.- Couplet nous a donné, dans les mém, de l'académie
de 1.733 * des réflexions fur les charrois, les
traîneaux, & le tirage des chevaux. Voye^ ce mémoire
& T irage. V o ic i, ce me femble, un principe affez,
fimple pour déterminer en générai l’effort de la puif-
fàitee. On peut regarder la. roue comme un levier
C H A
dont le point d’appui eft l’extrémité inférieure qui
appuie fur le terrain. Le centre ou moyeu de ce levier
peut fe mouvoir horifontalement en décrivant
à chaque inftant autour du point d’âppui un petit arc
circulaire qu’on peut prendre pour une ligne droite.
Le chariot participe à ce mouvement progreflif, & il
a de plus, ou du moins il peut avoir un mouvement
de rotation autour de l’axe qui paffe par le centre ou
moyeu de la roue. La queftion fe réduit donc à celle-
ci : foit (fig. 3 . Méchan. n°. 4.) un levier A B C , fixe
en A , 8c brifé en B , enforte que la partie C B puiffe
tourner autour de C. Il eft vifible que A B repré-
fentera le rayon de la roue, B le m oyeu, & B C le
chariot : il s’agit de favoir quel mouvement la puifi-
fance P , agiffant fuivant P O , communiquera au
corps A B C .
Soit A B — a , B C = b , B O = c , x le mouvement
de rotation du point B autour de A , y le mouvement
de rotation du point C autour de B : .on aura
pour la force totale ou quantité de mouvement du
chariot B C, (abftraûion faite de la quantité de mouvement
de la roue, que nous négligeons ici ) C B
x - C B ,&c cette quantité doit être = à P. De
plus, la fomme des momens de tous les points du
chariot B C , par rapport au point A , doit être égale
au moment de la puiffance P , par rapport au même
point. (P ’oyeiD y n am iq u e ,L e v ie r , Équilibre,
C entre de g r a v it é .) O r , un point quelconque
du chariot, dont la diftance au point C feroit 1 , au-
roit pour quantité de mouvement Çx
pour moment Qc - f d ^ x ( { + <*), dont l’inté*
grale eft — ■ + x a b -{-y—^ -J- : faifant donc cette
quantité égale au moment P x (B O B A ') , on
aura les deux équations :
P = b x + i i ,
P c + P » ^ + x « i + Z± i +
par le moyen defquelles on trouvera facilement lest
inconnues x & y . (O)
* C h a r io t . ( Hijl. anc. ) Les chariots font d’un
tems fort reculé ; les hiftoires les plus anciennes font
mention de cette voiture ; les Romains enavoient
un grand nombre de différentes fortes : le chariot à
deux roues, appellé birotum ou birota: ceux fur lef-
quèls on promenoit les images des dieux, thenfoe : le
carpentum à l’ufage des matrones & des impératrices 5
il étoit à deux roues, & étoit tiré-par des mules : la
càrruque, le piUntum, la rheda , le clavulart, le eoyi-
nus, la benna , le ploxenum, la firptaJlercoraria, le
plaujirum, Yeffedum,, & c . qu’on trouvera à leurs articles
, quand on faura fur ces voitures quelque chofé
de plus que le nom.
La plupart, telles que les éfîedes & les petorrita ,
étoient Cônftruites avec magnificence. Pline parlant
du point oii le luxe avoit été porté de ce côté, dit i
On blanchit le cuivre au feu; on le fait devenir f i brillant
qu’on a peine à le dijlinguerde T argent; on Vémaillé,
& on èn orne lis chariots. Voy'e^ C har.
C h a r iq t , en Ajlronomie. Le grand chariot eft une
conftellation qu’on appelle, aufli la grande, ourfe. Voy.
Grande ourse. (D)
C h a r io t * ( p e t it ) «« Aflronomie< Ce font fept
étoiles dans la conftellation; de la petite ourfe, Voye£
Pe t it e .ourse. (O')
C h a r io t , en bâtiment, ,e f t une efpece. de petite
charrette, fans aridelles ou élévations aux cô.tés »
montée fur de très--petites roues, avec un timon fort
long dans, lequel» de diftance en diftance, four paf-
fés des petits bâtons en maniéré d’échellons, pour.at?
tacher des bretelles » & tirer à plufieurs hommes les
C H A
pierres taillées, pour les tranfporter du chantier au
bâtiment. ( P )
C h a r io t a c a n o n , c’eft un chariot qui fert uniquement
à porter le corps d’une piece de canon. Il
confifte en une fléché, deux brancards, deux ef-
fieu x, quatre roues & deux limonieres. ( Q )
C h a r io t ou C a rros se, (Corderie.) affembla*
ge de charpente qui fert à fupporter & à conduire le
toupin. 11 y a des chariots qui ont des roues, & d’au*
très qui font en traîneaux. Voye{ l'article C orderie*
* CHARISIES, f. f. pi. ( Mythologie. ) fêtes infti-
iüées en l’honneur des Grâces que les Grecs noni-
moient Charités. Une des particularités de ces fêtes»
c ’étoit de danfer pendant toute la nuit ; celui qui ré-
fiftoit le plus long-tems à cette fatigue & au fommeil,
obtenoit pour prix un gâteau de miel & d’autres frian-
difes que Ton nommoit charifia.
* CHARISTERIES, f. m* pl. (Hiß. anc, & My-
eholog.) c’étoit des fêtes qui fe célebroient à Athènes
le 1 z du mois de Boëdromion, en mémoire de la l i berté
que Thrafibule avoit rendue aux Athéniens ,
en chaffant les trente tyrans. On nommoit en Grece
Ces fêtes , îp/a tXtvßtpsetc, charißeria libertatis.
* CHARISTICAIRE , f. f. ( Hiß. eccléf. ) com-
mendataires ou donataires , à qui on avoit accordé
par une formule particulière que Jean d’Antioche a
confervée , la joiiiffance des revenus des hôpitaux
& monafteres, tant d’hommes que de femmes. Ces
conceflions injuftes fe font faites indiftin&ement à
des eccléfiaftiques, à des laïcs , & même à des per-
fonnes mariées: onles a quelquefois aflïiréesfurdeux
têtes* On en tranfporte l’origine jufqu’au tems de
Conftantin Copronyme* Il paroît que les empereurs
& les patriarches de l’églife greque , dans l’intention
de réparer & de conl'erver les monafteres, continuèrent
une dignité que la haine de Copronyme
avoit inftituée dans le deffein de les détruire, mais
que les fucceffeurs des premiers charßicaires, mieux
autorifés dans la perception des revenus monafti-
ques, n’en furent pas toûjours plus équitables dans
leur adminiftratiön. Il eft fingulier qu’on ait crû que
le même moyen pourroit fervir à deux fins entière*
ment oppofées , & que les revenus des moines fe*
Soient mieux entre les mains des étrangers qu’entre
les leurs. Voye£ Bingh. antiq. Hiß. ecclef Ecclef. grac.
moniun. cont.
* CHARISTIES, f. f. pl. ( Mythologie, ) fêtes que
les Romains célébroient le 19 Février en l ’honneur
de la déeffe Concorde. On fe vifitoit pendant ces
fêtes ; on fe donnoit des repas ; on fe faifoit des
préfens ; les amis divifés fe reconcilioient : une particularité
de ces repas » c’eft qu’on n’y admettoit
aucun étranger. Il femble qu’il fe foit confervé quelques
veftiges des ckarißies dans nos repas & feftins
de familles, qui ne font jamais fi fréquensqu’à-peu*
près dans le même tems où ces fêtes étoient célébrées
par les Romains.
CHARITATIF, adj. ( Jurifprud. ) terme de droit
canonique, nefe dit point feul, mais eft ordinairement
joint avec le terme de don. ou de fubfide. Il
fignifie une contribution modérée que les canons
permettent à l’évêque de lever fur fes diocéfâins en
cas d’urgente néceflité ; par exemple fi fes revenus
ne lui fourniffent pas dé quoi faire la dépenfe né*
ceflaire pour aflifter à un concile auquel il eft ap-
pellé. ( A )
* CHARITÉ, f. f. ( Théologie. ) on la définit uriè
vertu théologale, par laquelle nous aimons Dieu de
tout notre coeur , & notre prochain comme nous*
mêmes. Ainfila charité a dèux objets matériels, Dieu
& le prochain. Voye^ OBJET & MATÉRIEL.
- La queftion de la charité ou de Y amour de D ieu, ä
excité bien des difputes dans les écoles. Les uns ont
prétendu qu’il n y -avoit de véritable amour de
C H A ±0 )
Dieu qtie là charité; & que toute aélioil qui n*eft pas
faite par ce motif, eft un péché.
D autres plus catholiques , qui h’admetterit pareillement
d’amour de Dieu que celui de charité,
mais qui né taxent point de péchés lés aftions faites
par d’autres motifs, demandent fi cette chaiitè fup-
pofe, ou ne fuppofe point de retour vers foi. Alors
ils fe partagent, les uns admettent ce retour, les
autres le rejettent;
Ceux qui Tadmetféht diftirigüeiit la charité en parfaite
& en imparfaite. La parfaite, félon eux ne
différé de l’imparfaite que par l’intenfité des degrés ;
& non par la diverfité des motifs, comme le pen^
fent leurs adverfaires. Ils citent en faveur de leurs
fentimens ce paffage de faint Paul, cupio dijfolvi &
effe cum Chriflo, où le defir de la poffeflion eft joint
à la charité la plus vive;
Les uns & les autres traitent d’erreiir le rigorif*
me de ceux dont nous avons parlé d’abord, qui font
des péchés de toute a&iOn qui ri’a pas le motif de
charité; & ils enfeignent dans Téglife, que lès avions
faites par le motif de la fo i , de Tefpérance ou de la
crainte de Dieu, loin d’être des péchés ,font des oeuvres
méritoires : ils vont plus loin ; celles qui n’ont
même pour principe que la vertu morale, font bon*
nés & loiiables félon eux, quoique non méritoires
pour le fâlüt. Voyt{ Gr â c e , V ertu morale ,
C o n tr it io n , &e.'
Il y a deux excès à éviter également dans cette
matière ; & ce qu’il y a de fingulier, c’eft que, quoi*
qu’ils foient dire&ement oppofés dans leurs princi*
pes , ils fe réunifient dans leurs conféquences. Il y
en a qui aiment Dieu en penfant tellement à eu x ,
que Dieu ne tient que leleéond rang dans leur af-
feébon. Cette amour mercenaire reffemble à celui
qu’on porte aux perfonnes, non pour les bonnes
qualités qu’elles ont » mais feulement pour le bien
qu’on en efpere; c ’eft celui des faux amis, qui nous
abandonnent auflï-tôt que nous ceflbns de leur être
utiles. La créature qui aime ainfi, nourrit dans fon
coeur une efpece d’athéifme : elle eft fon dieu à elle-
même; Cet amour n’ eft point la charité; on y trou-
veroit èn le fondant, plus de crainte du diable que
d’amour de Dieu. *
II y en a qui ont en horreur tout m otif d’intérêt ;
ils regardent comme un attentat énorme cet autel
qu’on femble élever dans fon coeur à foi même &
où Dieu n’eft, pouf ainfi dire , que le pontife*de
l’idole. L ’amour de ceux-ci paroît très-pur ; il exclut
tout autre bien que le plaifir d’aimer ; ce plaifir leur
fuflit ; ils n’attendent, ils n’efperent rien au - delà :
tout fe réduit pour eux à aimer lin objet qui leur paroît
infiniment aimable ; un regard échappé fur une
qualité relative à leur bonheur, fouilleroit leur af-
feûion ; ils font prêts à facrifier même ce fentiment
fi angélique, en ce qu’il a de fenfible & de réfléchi '
fi les épreuves qui fervent à le purifier exigent ce fa-
crifice; Cette charité n’eft qu’un amour chimérique.
Ces faux fpéculatifs ne s’apperçoi vent pas que Dieu
n’eft plus pour eux le bien eflentiel&fouverain; Pla*
çant le fublime de fa charité à fé détacher de toute
efpérance , ils fe rendent indépendans , & fe préci*
pitent à leur tour dans une efpece d’athéifme, mais
par un chemin Oppofé.
Le champ eft vafte entré cés deux extrêmes. LeS
Théologiens font affez d’accord à tempérer & î a l
fnour pur & l’amour inefcenaire ; mais les uns
prétendent que pour atteindre la vérité , il faiit ré*
duire l’amour pur à fes juftes bornes; les autres, au
contraire , qu’il faut corriger l’amour mercenaire^
Çes derniers partent d’un principe inconteftable ;
favoir que nous cherchons tous naturellement à
nous rendre heureux. Ç ’eft , félon faint Auguftin ,
la vérité la mieux entendue, la plus confiante ôc
i