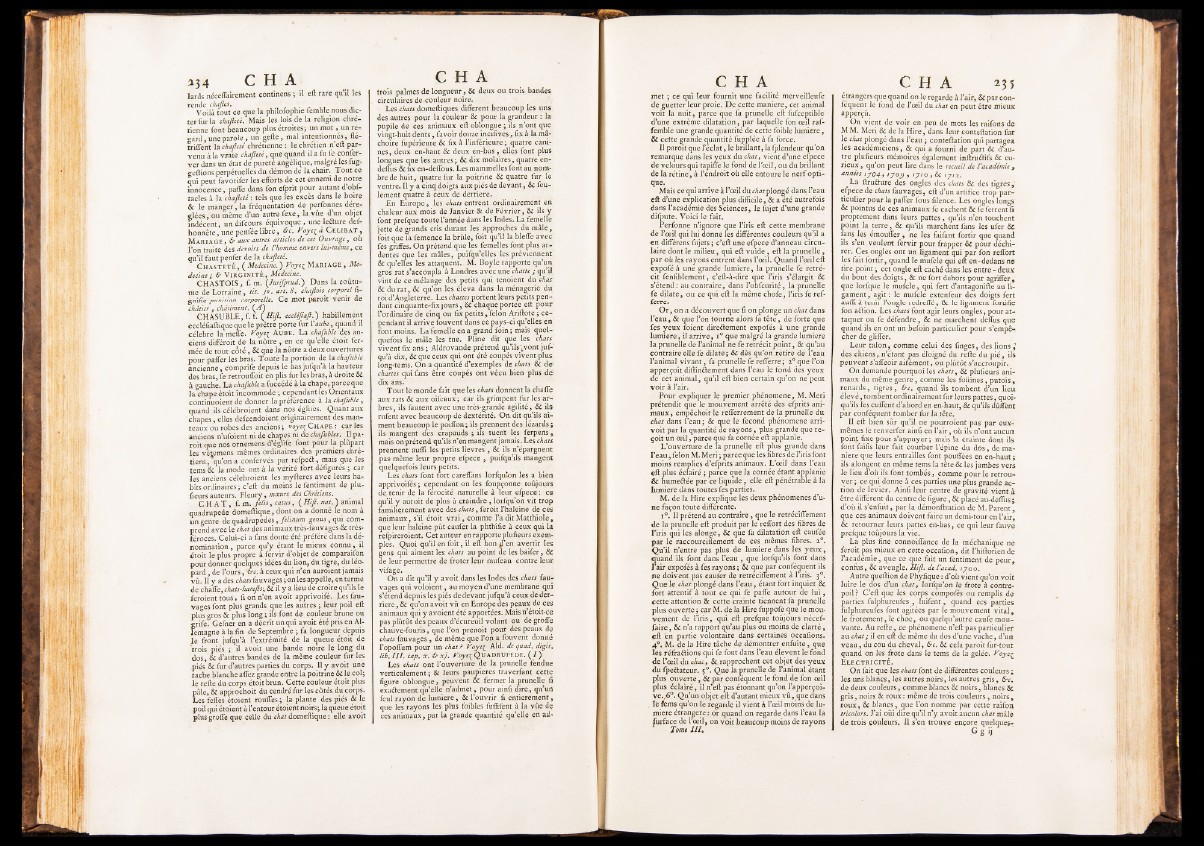
234 C H A
lards néceffairement continens ; il eft rare qu’il les
rende chafies. '
Voilà tout ce que la philofophie femble nous dicter
fur la chafieté. Mais les lois.de la religion chrétienne
font beaucoup plus étroites; un mot } un regard,
une parole, un gefte, mal intentionnés , flétrirent
la chafieté chrétienne : le chrétien n’eft parvenu
à la vraie chafieté, que quand il a fu feconfer-
ver dans un état de purete angélique, malgré les fug-
geftions perpétuelles du démon de la chair. Tout ce
qui peut favorifer les efforts de cet ennemi de notre
innocence, paffe dans fon efprit pour autant d’obf-
tacles à la chafieté : tels que les excès dans le boire
& le manger, la fréquentation de perfonnes déréglées,
ou même d’un autre fexe, la vue d’un objet
indécent, un difeours équivoque, une lefrure def-
honnête, une penfée libre, &c. Voye^ a C é l iba t ,
MARIAGE, & aux autres articles de cet Ouvrage, où
l ’on traite des devoirs de Vhomme envers lui-même , 0$
qu’il faut penfer de la chafieté.
C h a s t e t é , ( Médecine. ) Jfioye^ Ma riage , Médecine
; & V ir g in it é , Médecine.
CHASTOIS, f. m. Çurifprud.) Dans la coutume
de Lorraine, tit. jv . art. 8. chafiois^corporel lignifié
punition corporelle. Ce mot paroît venir de
châtier y châtiment. \Â)
CHASUBLE, f. f. ( Hift. eccléfiafi.) habillement
eccléfiaftique que le prêtre porte fur Vaube^ quand il
célébré la meffe. V oye{ Aube. La chafuble .des anciens
différoit de la nôtre , en ce quelle étoit fermée
de tout cô té, & que la nôtre a deux ouvertures
pour paffer les bras. Toute la portion de la chafuble
ancienne, comprife depuis le bas jufqu’à la hauteur
des bras, fe retroufîoit en plis fur les bras, à droite &
à gauche. La chafuble a fuccédé à la chape, parce que
la chape étoit incommode ; cependant les Orientaux
continuoient de donner la preference a la chafuble ,
quand ils célébroient dans nos églifes. Quant aux
chapes , elles defeendoient originairement des manteaux
ou robes des anciens; voye[ C hape : car les
anciens n’ufoient ni de chapes ni de chafubles. Il pa-
roît que nos ornemens d’églife font pour la plupart
les vêtemens mêmes ordinaires des premiers chrétiens
, qu’on a conferves par refpecl, mais que les
tems & la mode ont à la vérité fort défigurés ; car
les anciens célebroient les myfreres avec leurs habits
ordinaires ; c’eft du moins lefentiment de plu.
fieurs auteurs. Fleury, meeurs des Chrétiens.
C H A T , f. m. felis, catus, ( Hifi. nat. ) animal
quadrupède domeftique, dont on a donné le nom à
un genre de quadrupèdes., felinum genus, qui comprend
avec le chat des animaux très-fauvages & très-
féroces. Celui-ci a fans doute été préféré dans la dénomination
, parce qu’y étant le mieux connu, il
étoit le plus propre à fervir d’objet de comparaifon
pour donner quelques idées du lion, du tigre, du léopard
, de l’ours, G*e. à ceux qui n’en auroient jamais
vû. Il y a des fauvages ; on les appelle, en terme
de chaffe, chats-harefts-y & il y a lieu de croire qu’ils le
feroient tous, fi on n’en avoit apprivoifé. Les fauvages
font plus grands que les autres ; leur poil eft
plus gros & plus long ; ils font de couleur brune ou
grife. Gefner en a décrit un qui avoit été pris en Allemagne
à la fin de Septembre ; fa longueur depuis
le front jufqu’à l’extrémité de la queue étoit de
trois pies ; il avoit une bande noire le long du
dos, & d’autres bandes de la même couleur fur les
piés & fur d’autres parties du corps. Il y avoit une
tache blanche affez grande entre la poitrine & le col;
le refte du corps étoit brun. Cette couleur étoit plus
pâle, & approchoit du cendré fur les côtés du corps.
Les feffes étoient rouffes; la plante des piés & le
poil qui étoient à l’entour étoient noirs; la queue étoit
plus groffe que celle du chat domeftique : elle avoit
trois palmes de longueur, & deux ou trois bandes
circulaires de couleur noire.
Les chats domeftiques different beaucoup les uns
des autres pour la couleur & pour la grandeur : la
püpile de ces animaux eft oblongue ; ils n’ont que
vingt-huit dents, favoir douze incifives, fix à la mâchoire
fupérieure & fix à l’inférieure ; quatre canines,
deux en-haut & deux en-bas, elles font plus
longues que les autres; & dix molaires, quatre en-
deffus & fix en-deffous. Les mammelles font au nombre
de huit, quatre fur la poitrine & quatre fur le
ventre» Il y a cinq doigts aux piés de devant, & feu-
lement quatre à ceux de derrière.
En Europe, les chats entrent ordinairement en
chaleur aux mois de Janvier & de Février, & ils y
font prefque toute l’année dans les Indes. La femelle
jette de grands cris durant les approches du mâle,
foitque fa femence la brîile, foit qu’il la bleffe avec
fes griffes. On prétend que les femelles font plus ardentes
que les mâles, puifqu’elles les préviennent
& qu’elles les attaquent.. M. Boyle rapporte qu’un
gros rat s’accoupla à Londres avec une chatte ; qu’il
vint de ce mélange des petits qui tenoient du chat
& du rat, & qu’on les éleva dans la ménagerie du
roi d’Angleterre. Les chattes portent leurs petits pendant
cinquante-fix jours, & chaque portée eft pour
l’ordinaire de cinq ou fix petits, félon Ariftote ; cependant
il arrive louvent dans ce pays-ci qu’elles en
font moins. La femelle en a grand foin ; mais quelquefois
le mâle les tue. Pline dit que les chats
vivent fix ans ; Aldrovande prétend qu’ils ^vont jufqu’à
dix, & que ceux qui ont été coupés vivent plus
long-tems. On a quantité d’exemples de chats & de
chattes qui fans être coupés ont vécu bien plus de
dix ans.
Tout le monde fait que les chats donnent la chaffe
aux rats & aux oifeaux; car ils grimpent fur les arbres
, ils fautent avec une très-grande agilité, & ils
rufent avec beaucoup de dextérité. On. dit qu’ils aiment
beaucoup le poiffon; ils prennent des lézards ;
ils mangent des crapauds ; ils tuent les ferpens ,
mais on prétend qu’ils n’en mangent jamais. Les chats
prennent aufli les petits lievres , & ils n’épargnent
pa» même leur propre efpece , puifqu’ils mangent
quelquefois leurs petits»
Les chats font fort careffans lorfquîon les a bien
apprivoifés ; cependant on les foupçonne toûjoijrs
de^tenir de la férocité naturelle à leur efpece : ce
qu’il y auroit de plus à craindre , Iorfqu’on vit trop
familièrement avec des chats, feroit l’haleine de ces
animaux, s’il étoit v ra i, comme l’a dit Matthiole ,
que leur haleine pût caufer la phthifie à ceux qui la
refpireroient. Cet auteur en rapporte plufieurs exemples.
Quoi qu’il en foit, il eft bon $Ten avertir les
gens qui aiment les chats au point de les baifer, &
de leur permettre de froter leur mufeau contre leur
vifage.
On a dit qu’il y avoit dans les Indes des chats fau-
vages qui voloient, au moyen d’une membrane qui
s’étend depuis les piés de devant jufqu’à ceux de derrière
, & qu’on avoit vû en Europe des peaux de ces
animaux qui y avoient été apportées. Mais n’étoit-ce
pas plutôt des peaux d’écureuil volant ou de groffe
chauve-fouris, que l’on prenoit pour des peaux de
chats fauvages , de même que l’on a fouvent donné
l’opoffum pour un chat ? Voye%_ Aid. de quad, digit,
lib. III. cap, x. & x j. Voyt{ QUADRUPEDE. ( / )
Les chats ont l’ouverture de la prunelle fendue
verticalement ; & leurs paupières traverfant cette
figure oblongue, peuvent & fermer la prunelle fi
exactement qu’elle n’admet, pour ainfi dire, qu’un
feul rayon de lumière, & l’ouvrir fi entièrement,
que les rayons les plus foibles fuffifent à la vue de
ces animaux, par la grande quantité qu’elle en admet
; ce qui leur fournit une facilité merveilleufe
de guetter leur proie. De cette maniéré, cet animal
voit la nuit, parce que fa prunelle eft fufceptible
d’une extrême dilatation, par laquelle fon oeil raf-
femble une grande quantité de cette foible lumière,
& cette grande quantité fupplée à fa force.
Il paroît que l’éclat, le brillant, la fplendeur qu’on
remarque dans les yeux du chat, vient d’une eipece
de velours qui tapiffe le fond de l ’oeil, ou du brillant
de la rétine, à l’endroit où elle entoure le nerf optique
.M
ais ce qui arrive à l’oeil du chat plongé dans l’eau
eft d’une explication plus difficile, & a été autrefois
dans l’académie des Sciences, le fujet d’une grande
difpute. Voici le fait.
Perfonne n’ignore que l’iris eft cette membrane
de l’oeil qui lui donne les différentes couleurs qu’il a
en différens fujets ; c’eft une efpece d’anneau circulaire
dont le milieu, qui eft vuide, eft la prunelle,
par où les rayons entrent dans l’oeil. Quand l’oeil eft
expofé à une grande lumière, la prunelle fe rétrécit
fenfiblement, c’eft-à-dire que l’iris s’élargit &
s’étend: au contraire, dans l’obfcurité, la prunelle
fe dilate, ou ce qui eft la même chofe, l’iris fe ref-
ferre.
O r , on a découvert que fi on plonge un chat dans
l ’eau, & que l’on tourne alors fa tête, de forte que
fes yeux îoient directement expofés à une grande
lumière, il arrive, i° que malgré la grande lumière
la prunelle de l’animal ne fe rétrécit point, & qu’au
contraire elle fe dilate; & dès qu’on retire de l’eau
l’animal vivant, fa prunelle fe refferre ; 2° que l’on
apperçoit diftinâement dans l’eau le fond des yeux
de cet animal, qu’il eft bien certain qu’on ne peut
yoir à l’air.
Pour expliquer le premier phénomène, M. Meri
prétendit que le mouvement arrêté des efprits animaux
, empêchoit le refferrement de la prunelle du
chat dans l’eau ; & que le fécond phénomène arri-
voit par la quantité de rayons, plus grande que reçoit
un oe il, parce que fa cornée eft applanie.
L’ouverture de la prunelle eft plus grande dans
l’eau, félon M. Meri ; parce que les fibres de l’iris font
moins remplies d’efprits animaux. L’oeil dans l’eau
eft plus éclairé ; parce que la cornée étant applanie
& hume&ée par ce liquide, elle eft pénétrabîe à la
lumière dans toutes fes parties.
M. de la Hire explique les deux phénomènes d’une
façon toute différente.
i° . Il prétend au contraire, que le retréciffement
de la prunelle eft produit par le reffort des fibres de
l ’iris qui les alonge, & que fa dilatation eft caufée
par le raccourciffement de ces mêmes fibres. 2°.
Qu’il n’entre pas plus de lumière dans les y e u x ,
quand ils font dans l’eau , que lorfqu’ils font dans
l ’air expofés à fes rayons ; & que par conféquent ils
ne doivent pas caufer de retréciffement à l’iris. 30.
Que le chat plongé dans l’eau, étant fort inquiet &
fort attentif à tout ce qui fe paffe autour de lu i ,
cette attention & cette crainte tiennent fa prunelle
plus ouverte ; car M. de la Hire fuppofe que le mouvement
de l’iris, qui eft prefque toujours nécef-
faire, & n’a rapport qu’au plus ou moins de clarté,
eft fen partie volontaire dans certaines occafions.
4°. M. de la Hire tâche de démontrer enfuite, que
les réfractions qui fe font dans l’eau élevent le fond
de l’oeil du chat, & rapprochent cet objet des yeux
du fpe&ateur. 50. Que la prunelle de l’animal étant
plus ouverte, & par conféquent le fond de fon oeil
plus éclairé, il n’eft pas étonnant qu’on l’apperçoi-
ve./6°. Qu’un objet eft d’autant mieux v û , que dans
ï Iè fems qu’on le regarde il vient à l’oeil moins de lumière
étrangère : pr quand on regarde dans l’eau la
furfaçe de l’oe il, on voit beaucoup moins de rayons
fome I I I ,
étrangers que quand on le regarde à l’air, & pa r con-
fequent le fond de l’oeil du chat en peut être mieux
apperçû.
On vient de voir en peu de mots les raifons de
MM. Meri & de la Hire, dans leur conteftation fur
le chat plongé dans l’eau ; conteftation qui partagea
les académiciens, & qui a fourni de part & d’autre
plufieurs mémoires également inftruCHfs & curieux
, qu’on peut lire dans le recueil de l ’académie 9
années 1704 , /705) , ty iq , & iyix .
La ftrufrure des ongles des chats & des tigres
efpece de chats fauvages, eft d’un artifice trop particulier
pour la paffer fous filence. Les ongles longs
& pointus de ces animaux fe cachent & fe ferrent fi
proptement dans leurs pattes, qu’ils n’en touchent
point la terre, & qu’ils marchent fans les ufer &
fans les émouffer, ne les faifant fortir que quand
ils s’en veulent fervir pour frapper & pour déchirer.
Ces ongles ont un ligament qui par fon reffort
les fait fortir, quand le mufcle qui eft en-dedans ne
tire point ; cet ongle eft caché dans les entre - deux
du bout des doigts, & ne fort dehors pour agriffer ,
que lorfque le mufcle, qui fert d’antagonifte au ligament
, agit : le mufcle extenfeur des doigts fert
aufli à tenir l’ongle redreffé, & le ligament fortifie
fon afrion. Les chats font agir leurs ongles, pour attaquer
ou fe défendre, & ne marchent deffus que
quand ils en ont un befoin particulier pour s’empêcher
de gliffer.
Leur talon, comme celui des linges, des lions 9
des chiens, n’étant pas éloigné du refte du pié, ils
peuvent s’affeoir aifément, ou plutôt s’accroupir.
On demande pourquoi les chats, & plufieurs animaux
du même genre, comme les fouines, putois ,
renards, tigres, &c. quand ils tombent d’un lieu
élevé, tombent ordinairement fur leurs pattes, quoiqu’ils
les enflent d’abord en en-haut, & qu’ils duffent
par conféquent tomber fur la tête.
Il eft bien sûr qu’il ne pourroient pas par eux-
mêmes fe renverfer.ainfi en l’air, où ils n’ont aucun
poin| fixe pour s’appuyer ; mais la crainte dont ils
font faifis leur fait courber l’épine du dos, de maniéré
que leurs entrailles font pouffées en en-haut ;
ils alongent en même tems la tête & les jambes vers
le lieu d’où ils font tombés, comme pour le retrouver
; ce qui donne à ces parties une plus grande action
de levier. Ainfi leur centre de gravité vient à
être différent du centre de figure, & placé au-deffus ;
d’où il s’enfuit, par la démonftration de M. Parent,
que ces animaux doivent faire un demi-tour en l’air,
& retourner leurs pattes en-bas, ce qui leur fauve
prefque toûjours la vie.
La plus fine connoiffance de la méchanique ne
feroit pas mieux en cette occafion, dit l ’hiftorien de
l’académie, que ce que fait un fentiment de peur,
confus, & aveugle. Hift. deVacad. 1700.
Autre queftion de Phyfique : d’où vient qu’on voit
luire le dos d’un chat, lorfqu’on le frote à contrepoil
? C’eft que les corps compofés ou remplis de
parties fulphureufes , luifent, quand ces parties
fulphureufes font agitées par le mouvement v ita l,
le frotement, le choc , ou quelqu’autre caufe mouvante.
Au refte, ce phénomène n’eft pas particulier
au chat; il en eft de même du dos d’une vache, d’un
veau , du cou du cheval, &c. & cela paroît fur-tout
quand on les frote dans le tems de la gelée. Voyer
El e c t r ic it é .
On fait que les chats font de différentes couleurs ;
les uns blancs, les autres noirs, les autres gris, &c.
de deux couleurs, comme blancs & noirs, blancs &
gris, noirs & roux : même de trois couleurs, noirs ,
roux, & blancs, que l’on nomme par cette raifon
éricolors. J’ai oui dire qu’il n’y avoit aucun chat mâle
de trois couleurs. Il s’en trouve encore quelques*.