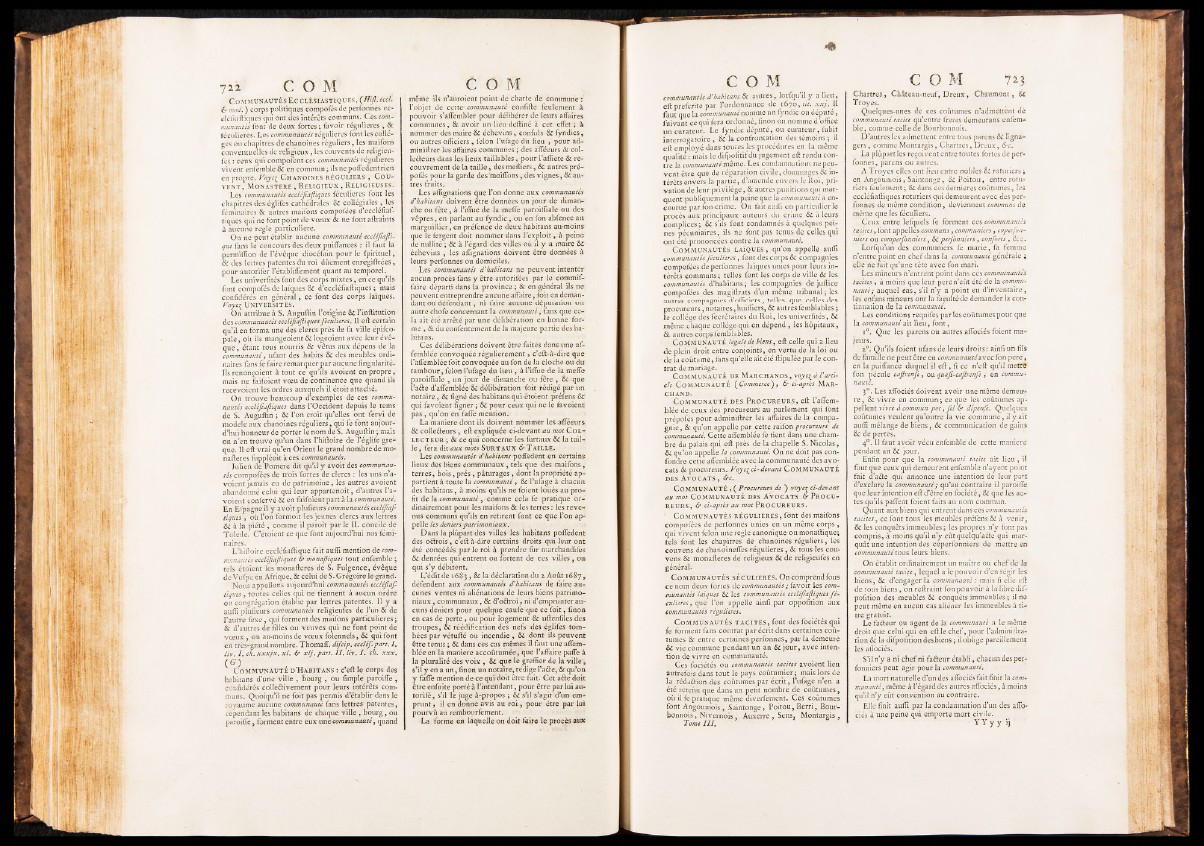
7 * î m v jvi
C ommunautés Ecclésiastiques, ('ffijl.èccl.
& mod. ) corps politiques compofés de perfonnes ec-
cléfiaftique's qui ont des intérêts communs. Ces communautés
fbnt de deux fortes ; favoir régulières , &
iëculieres. Les communautés régulières font lescollé-
ges ©u chapitres de chanoines réguliers, les maifons
conventuelles de religieux, les couvents de rëligieu-
fe s : ceux qui compofent ces communautés régulières
vivent enfemble ôc en commun ; ils ne poffedent rien
en propre, Voye^ C hanoines réguliers , Couvent,
MONASTERE , RELIGIEUX , RELIGIEUSES.
Les communautés eccléjîajîiques féculieres font lés
chapitres des églifes cathédrales ôc collégiales , les
féminaires & autres maifons compofées d’eccléfiaf-
tiques qui ne font point de voeux & ne font aftraints
à aucune réglé particulière.
On ne peut établir aucune communauté eccléjîajli-
que fans le1 concours des deux puiffances : il faut la
permiffion de l’évêque diocéfain pour le fpirituel,
ôc des lettres patentes du roi duement enregistrées,
pour autorifer l’établiffement quant au temporel.
Les univerfités font des corps mixtes, en ce qu’ils
font compofés de laïques ôc d’eccléfiaftiques ; mais
confidérés en général, ce font des corps laïques.
Voyt^ Universités.
On attribue à S. Auguftin l’origine ôc l’inftitution
des communautés ecclèjiafiiques féculieres. Il eft certain
qu’il en forma une des clercs près de fa ville épifco-
pale, oîi ils mangeoient 5c logeoient avec leur évêque,
étant tous nourris ôc vêtus aux dépens de la
communauté, ufant des habits Sc des meubles ordinaires
fans fe faire remarquer par aucune Angularité.
Ils renonçoient à tout ce qu’ils avoient en propre,
mais ne faifoient voeu de continence que quand ils
rece voient les ordres auxquéls il étoit attaché;
On trouve beaucoup d’exemples de ces communautés
eccléjîajîiques dans l’Occident depuis le tems
de S. Auguftin ; ôc l’on croit qu’elles ont feryi de
modèle aux chanoines réguliers, qui fe font aujbur-
d’hui honneur de porter le nom de S. Auguftin ; mais
on n’en trouve qu’un dans l’hiftoire de l’églife gre-
que. Il eft vrài qu’en Orient le grand nombre de mo-
nafteres fuppléoit à ces communautés.
Julien de Pomere dit qu’il y avoit des communautés
compofées de trois fortes de clercs : les uns n’a-,
voient jamais eu de patrimoine, les autres avoient
abandonné celui qui leur appartenoit, d’autres l ’a-
voient cpnfervé ÔC en faifoient part à la communauté.
En Efpagne il y avoit plufieurs communautés eccléjiaf-
tiques , où l’on formoit les jeunes clercs aux lettres
& à la piété , comme il paroît par le II. concile de
Tolede. C ’étoient ce que font aujourd’hui nos féminaires.
L’hiftoire eccléfiaftique fait aufli mention de communautés
eccléjîajîiques & nionajliques tout enfemble ;
tels étoient les monafteres de S. Fulgence, évêque
de Vufpe en Afrique, & celui de S. Grégoire le grand.
Nous appelions aujourd’hui communautés eccléjîaf-
tiques, toutes celles qui ne tiennent à aucun ordre
ou congrégation établie par lettres patentes. Il y a
auffi plufieurs communautés religieuses de l’un & de
l ’autre féxe, qui forment des maifons particulières ;
& d’autres de filles ou veuves qui ne font point de
voe u x , ou au-moins de voeux folennels, ôc qui font
en très-grand nombre. Thomaff. difcip. eccléf.part. 1.
liv. I . ch. x x x jx . xl. & xlj. part. II. liv. I . ch. xxx.
I m ■ ■ : H ■ ■ ■ ■ I -
C ommunauté d'Habitans : c’eft le corps des
habitans d’une ville , Bourg , ou fimple paroiffe ,
confidérés colleftivement pour leurs intérêts communs.
Quoiqu’il ne foit pas permis d’établir dans le
royaume aucune communauté fans lettres patentes,
cependant les habitans de chaque v ille , bourg, ou
paroiffe, forment entre eux une communauté y quand
même iis n’auroient point de charte de commune :
l’objet de cette' communauté confifte feulement à
pouvoir s’affembler pour délibérer de leurs affaires
communes, & avoir un lieu deftiné à cet effet ; à
nommer des maire ôc échevins, confuls ôc fyndics,
ou autres officiers , félon l’ufage du lieu , pour ad-
miniftrer les affaires communes ; des afféeurs Ôt col-
leéleurs dans les lieux taillables, pour l’affiete & recouvrement
de la taille, des meffiers, ôc autres pré-
pofés pour la garde des’moiffons, des vignes, ôc autres
fruits.
Les aflignations que l’on donne aux communautés
d'habitans doivent etre données un jour de dimanche
ou fête, à l’iffue de la -méfié paroiffiale ©u des
vêpres, en parlant au fyndic, ou en fon abfence au
marguillier, en préfence de deux habitans au-moins
que le fergent doit nommer dans l’exploit, à peine
de nullité ; ôc à l’égard des villes où il y a maire ôc
échevins , les afiignations doivent être données à
leurs perfonnes ou domiciles.
Les communautés d'habitans ne peuvent intenter
aucun procès fans y être autorifées par le commif-
faire départi dans la province ; ôc en général ils ne
peuvent entreprendre aucune affaire, foit en demandant
ou défendant, ni faire aucune députation ou
autre chofe concernant la communauté, fans que cela
ait été arrêté par une délibération en bonne forme
, & du confentement de la majeure partie des habitans.
Ces délibérations doivent êtré faites dans une affemblée
convoquée régulièrement, c’eft-à-dire que
l’affemblée foit convoquée au fon de la cloche ou du
tambour, félon l’ufage du lieu , à l’iffue de la mefle
paroiffiale , un jour de dimanche ou fête , ôc que
l?a£te d’affemblée ôc délibération 'foit rédigé par un
notaire, ôc ligné des habitans quiétoient préfens ôc
qui favoient ligner ; Ôc pour ceux qui ne le làvoient
pas , qu’on en faffe mention;
La maniéré dont ils doivent nommer les afféeurs
ôc collecteurs, eft expliquée ci-devant au mot Col-?
lecteur ; Ôc ce qui concerne les furtaux ôc la tail-i
le , fera dit aux mots Surtaux & T aille.
Les communautés d'habitans poffedent en certains
lieux des biens communaux, tels que des maifons ,
terres, bois, prés , pâturages , dont la propriété appartient
à toute la communauté , ÔC l’ufage à chacun
des habitans, à moins qu’ils ne foi eut loués au profit
de la communauté, comme cela fe pratique ordinairement
pour les maifons ôc les terres : les revenus
communs qu’ils en retirent font ce que l’on appelle
les deniers patrimoniaux.
Dans la plupart des villes les habitans poffedent
des octrois, c’eft-à-dire certains droits qui leur ont
été concédés par le roi à prendre fur marchandifes
ôc denrées qui entrent ou fortent de ces v ille s , ou
qui s ’y débitent.
L’édit de 168 3 > ta déclaration du 2 Août 1687,
défendent aux communautés d'habitans de faire aucunes
ventes ni aliénations de leurs biens patrimoniaux
, communaux, ôc d’oétroi, ni d’emprunter aucuns
deniers pour quelque caufe que ce foit, finon
en cas de perte, ou pour logement ôc uftenfiles des
troupes, ôc réédification des nefs des églifes tombées
par vétufté ou incendie , ôc dont ils peuvent
être tenus ; ôc dans ces cas mêmes il faut une affém-
blée en la maniéré accoutumée, que l’ affaire paffe à
la pluralité des voix , ôc que le greffier de la v ille ,
s’il y en a un, finon un notaire, rédige l’afte, Ôc qu’on
y faffe mention de ce qui doit être fait. Cet a&e doit
être enfuite porté à l’intendant, pour être par lui au-
torifé, s’il le juge à-propos ; ôc s?il s’agit d’un emprunt
, il en donne avis au r o i , pour être par lui
pourvu au rembourfement.
La forme en laquelle on doit taire le procès aux
*
communautés d'habitans Ôc autres, lorfqu il y a licit,
eft prefcrite par l’ordonnance de 1670, rir. x x j. Il
faut que la communauté nomme un fyndic ou député,
fuivant ce qui fera ordonné, finon on nomme d ’office
un curateur. Le fyndic député, ou curateur, fubit
interrogatoire , ôc la confrontation des témoins ; il
eft employé dans toutes les procédures en la même
qualité : mais le difpofitif du jugement eft rendu contre
la communauté meme. Les condamnations ne peuvent
être que de réparation civile, dommages ôc intérêts
envers la partie, d’amende envers le Roi, privation
de leur privilège, ôc autres punitions qui marquent
publiquement la peine que la communauté a encourue
par fon crime. On fait auffi en particulier le
procès aux principaux auteurs du crime ôc à leurs
complices; ÔC s’ils font condamnés à quelques peines
pécuniaires, ils ne font pas tenus de celles qui
ont été prononcées contre la communauté.
C ommunautés laïques, qu’on appelle auffi
communautés féculieres, font des corps ÔC compagnies
compofées de perfonnes laïques unies pour leurs intérêts
communs; telles font les corps de ville ôc les
communautés d’habitans; les compagnies de juftice
compofées des magiftrats d’un même tribunal ; les
autres compagnies d’officiers, .telles que celles des
procureurs, notaires, huiffiers, ôc autres femblables ;
le collège des fecrétaires du R o i, les univerfités, ôc
même chaque collège qui en dépend, les hôpitaux,
& autres corps femblables... •
C o m m u n a u t é légale de biens, eft celle qui a lieu
de plein droit entre conjoints, en vertu de la loi ou
de la coutume, fans qu’elle ait été ftipulée par le contrat
de mariage.
C ommunauté de Marchands , voye^à l'article
Communauté ( Commerce) , & ci-après Marchand.
.
C ommunauté des Procureurs, eft l’affem-
blée de ceux des procureurs au parlement qui font
prépofés pour adminiftrer les affaires de la compagnie
, Ôt qu’on appelle par cette raifon procureurs de
communauté. Cette affemblée fe tient dans une cham-
bre du palais qui eft près 4e la chapelle S. Nicolas,
ôc qu’on appelle la communauté. On ne doit pas confondre
cette affemblée avecda communauté des avocats
& procureurs. Voye^ci-devant COMMUNAUTE
des Avocats , &c.
COMMUNAUTÉ , ( Procureurs de ) voye^ ci-devant
au mot Communauté des Avocats & Procureurs,
& ci-après au mot PROCUREURS.
1 C ommunautés régulières , font des maifons
compofées de perfonnes unies en un même corps ,
qui vivent félon une regle canonique oumonaftique;
tels font les chapitres de chanoines réguliers, les
couvens de chanoineffes régulières, & tous les eoü-
vens ôc monafteres dé religieux ôc de religieufes en
général.
C ommunautés séculières. On comprend fous
ce nom deux fortes de communautés ; favoir les communautés
laïques ÔC les Communautés eccüßaßiques fé-
culieres, que l’on appelle ainfi par oppofition aux
communautés régulières.
Communautés ta c it es, font des fociétés qui
fe forment fans contrat par écrit dans certaines coû-
tumes ôc entre certaines perfonnes, par la demeure
ôc vie commune pendant un an ôc jour, avec intention
de vivre en communauté.
Ces fociétés ou communautés tacites avoient lieu
autrefois dans tout le pays coutumier ; mais lors de
la rcdaôion des coutumes par écrit, l’ufage n’en a
été retenu.que dans un petit nombre de coutumes,
où il fe pratique même diverfement. Ces coutumes
font Angoumois, Saintonge, Poitou, Berri, Bour-
bonnois, Nivernois, Auxerre, Sens, Montargis ,
Tome I II,
Chartres, Château-neuf, Dreux, Chaumont, 6t
Troyes.
Quelques-unes de ces coutumes n’açlmëttent dé
communauté tacite qu’entre freres demeurans enfem*
ble, comme celle ae Bourbonnais.
D ’autres les admettent entre tous parens ô£ lignagers
, comme Montargis, Chartres, Dreux, &c.
La plupart les reçoivent entre toutes fortes de per*
Tonnes, parens ou autres.
A Troyes' elles ont lieu entre nobles Ôc roturiers ;
en Angoumois, Saintonge, ôc Poitou, entre roturiers
feulement ; ôc dans ces dernieres coutumes, leà
,e,ccléfiaftiques roturiers qui demeurent avec des perfonnes
de même condition, deviennent communs de
même que les féculiers.
.. Ceux entre lefquels fe forment ces cofnmunautés
tacites y font appellés communs y communiers, coperjon-
niers ou comperfonniers, ÔC ptrfonnïers, conforts, ôcc;
Lorfqu’un des communiers fé marie, fa femme
n’entre, point en chef dans la communauté générale ;
elle rte fait qu’une tête avec fon mari.
Les mineürs n’en t re n t point dans ces communautés
tacites, à moins que leur pere n’eût été de la communauté;
auquel eas, s’il n’y a point eu d’inventaire,
lès enfans mineurs ont la faculté dé demander la continuation
de la communauté.
Les conditions requifes par les coûtumes pour que
la communauté ait lieu, font,
i°. Que les parens ou autres affociés foient ma-»
jeurs.
20. Qu’ils foient ùfans de leurs droits : ainfi un fils
de famille ne peut être en communauté avec fon pere,
ên la puiffance duquel il eft , fi ce n’eft qu’il metté
fon pécule cajlrenfe, ou quajî-cdflrenfè ; en tommu■»
nauté.
30. Les affociés doivent avoir une même demeu*-»
r e , ôc vivre en commun ; ce que les coûtumes ap»
pellent vivre à commun pot, fe l & dépenfe. Quelques
coûtumes veulent qu’outre la vie commune, il y ait
auffi mélange de biens, ôc communication de gains
ôc de pertes.
40. Il faut avoir vécu enfemble de cette maniéré
pendant ail Ôc jour.
Enfin pour que la communauté tacite ait lieü , il
faut que ceux qui demeurent enfemble n’ayent point
fait d’aéle qui annonce une intention de leur part
d’exclure la communauté ; qu’au contraire il paroiffe
que leur intention eft d’être en fociété, Ôc que les ac-4
tes qu’ils paffent foient faits au nom commun.
Quant aux biens qui entrent dans ces communautés
tacites y ce font tous les meubles préfens ôc à venir,
ôc les conqiiêts immeubles ; les propres n’y font pas
compris, à moins qu’il n’y eût quelqu’a&e qui marquât
une intention des coperfonniers de mettre en
communauté tous leurs biens.
On établit ordinairement un maître ou chef dé la
communauté tacite, lequel a le pouvoir d’en tegir IeS
biens, ÔC d’engager la communauté : mais fi elle eft
de tous biens, on reftraint fon pouvoir à la libre diff
pofition des meubles ôc conquêts immeubles ; il ne
peut même en aucun cas aliéner les immeubles à titre
gratuit.
Le fafteur ou agent de la communauté a le même
droit que celui qui en eft le chef, pour l’adminiftra^
tion ôc la difpofition des biens ; il oblige pareillement
les affociés. ,
S’il n’y a ni chef ni fafteur établi, chacun des per-
fonniers peut agir pour la communauté,
La mort naturelle d’un des affociés fait finir la communauté
, même à l’égard des autres affociés, à moins
qu’il n’y eût convention au contraire.
Elle finit auffi par la condamnation d’un des affociés
à une peine qui emporte mort civile.
Y Y y y ij