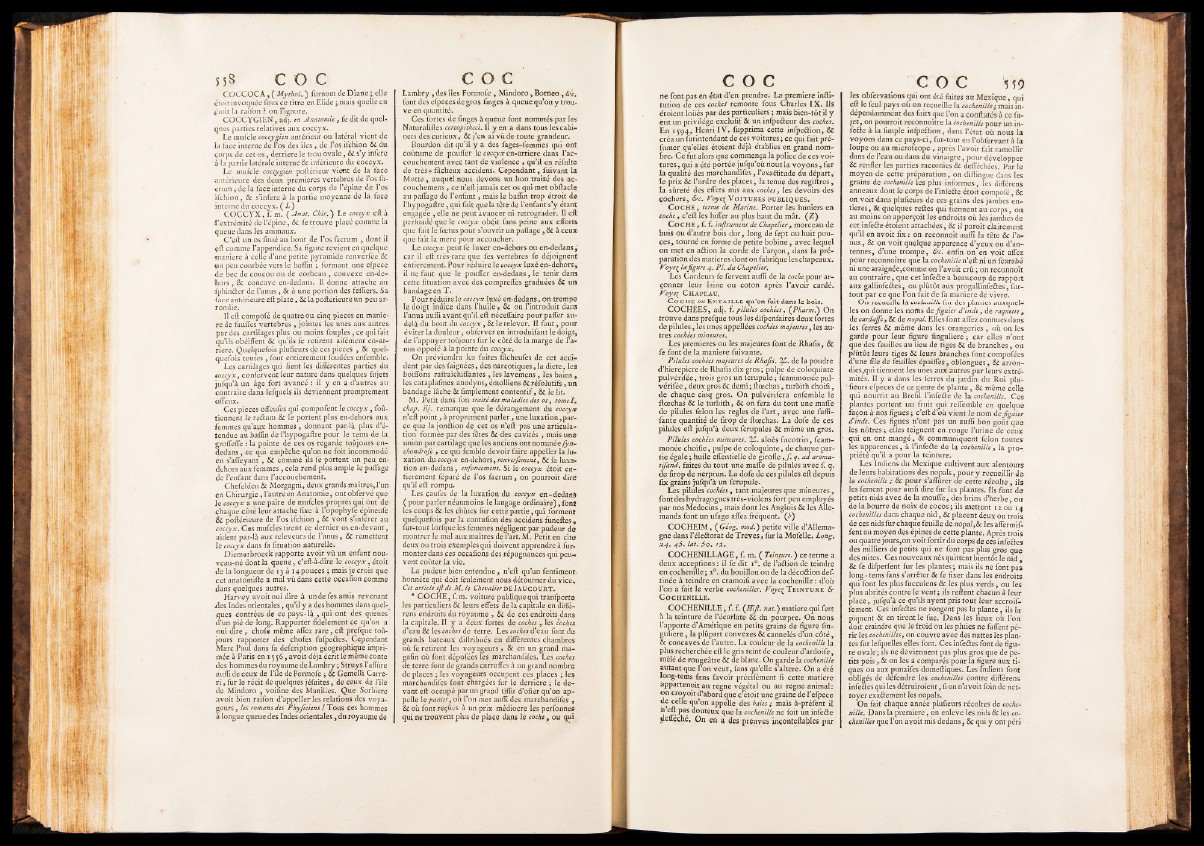
558 C O C
C O C C O C A , ( Mythol. ) furnoni de Diane ; elle
étoit invoquée fous ce titre en Elide ; mais quelle en
étoit la raifon ? on l’ignore.
CO CCYGIEN , adj. en Anatomie , fe dit de quelques
parties relatives aux coccyx.
Le mulcle coccygien antérieur ou latéral vient de
la face interne de l’os des île s , de l’os ifchion 8c du
çorps de cet o s , derrière le trou o vale, 8c s’y inféré
à la partie latérale interne 8c inférieure du coccyx.
Le mufcle coccygien poftérieur vient de la face
antérieure des deux premières vertebres de l’os fa-
crurn ,• de la face interne du corps de l’épine de l’os
ifchion, & s’infere à la partie moyenne de la face
interne du coccyx. ( V )
C O C C Y X , f. m. ( Anat. Chir.) Le coccyx eft à
l ’extrémité de l’épine, 8c fe trouve placé comme la
queue dans les animaux.
C ’eft un os fitué au bout de l’os facrum , dont il
eft comme l’appendice. Sa figure revient en quelque
maniéré à celle d’une petite pyramide renverfée 8c
un peu courbée vers le bafîîn ; formant une el'pece
de bec de coucou ou de corbeau, convexe en-dehors
, 8c concave en-dedans. 11 donne attache au
•fphinûer de l’anus , & à une portion des fefliers. Sa
face antérieure eft plate, 8c la poftérieure un peu arrondie.
Il eft compofé de quatre ou cinq pièces en manie-
re.de fauffes vertebres , jointes les unes aux autres
par des cartilages plus ou moins fouples, ce qui fait
qu’ils obéiffent 8c qu’ils fe retirent aifément en-ar-
riere. Quelquefois plufieurs de ces pièces , & quelquefois
toutes , font entièrement foudées enfemble.
Les cartilages qui lient les différentes parties du
co c cy x confervent leur nature dans quelques fujets
jufqu’à un âge fort avancé : il y en a d’autres au
contraire dans lefquels ils deviennent promptement
offeux.
Ces pièces offeufes qui compofent le coccyx, foû-
tiennent le reâum 8c le portent plus en-dehors aux
femmes qu’aux hommes, donnant par-là plus d’étendue
au baflin de l’hypogaftre pour le tems de la
groffeffe : la pointe de ces os regarde toujours en-
dedans , ce qui empêche qu’on ne foit incommodé
en s’affeyant , 8c comme ils fe portent un peu en-
dehors aux femmes, cela rend plus ample le paffage
de l’enfant dans l’accouchement.
Chefelden & Morgagni, deux grands maîtres, l’un
en Chirurgie, l’autre en Anatomie, ontobfervé que
le coccyx a une paire de mufcles propres qui ont de
çhaque côté leur attache fixe à l’opophyfe épineufe
& poftérieure de l’os ifchion , 8c vont s’inférer au
coccyx. Cas mufcles tirent ce dernier os en-devant,
aident par-là aux releveurs de l’anus, 8c remettent
le coccyx dans fa fituation naturelle.
Diemerbroeck rapporte avoir vu un enfant nou-
veau-né dont la queue, c’efl-à-dire le coccyx, étoit
de la longueur de 13 à 14 pouces ; mais je crois que
cet anatomifte a mal vû dans cette occafion comme
dans quelques autres.
Harvey avoit oui dire à un de fes amis revenant
«des Indes orientales, qu’il y a des hommes dans quel-^
.ques contrées de ce pays-là , qui ont des queues
d’un pié de long. Rapporter fidèlement ce qu’on a
oui dire, chofe même affez rare, eft prefque toujours
rapporter des chofes fufpeétes. Cependant
Marc Paul dans fa defeription géographique imprimée
à Paris en 15 56, avoit déjà écrit le meme conte
des hommes du royaume de Lambry ; Struys l’alïïire
auflide ceux de l*île deFormofe ; oc Gemelli Carre-
r i , fur le récit de quelques jéfuites, de ceux de File
de Mindoro , voifine des Manilles. Que Sorbiere
avoit bien raifon d’appellerles relations des voyageurs
, les romans des Phyjîciens J Tous ces hommes
à longue queue des Indes orientales , du royaume de
C O C
Lambry, des îles Formofe , Mindoro, Bornéo, &c.
font des efpeces de gros linges à queue qu’on y trouve
en quantité-.
Ces fortes de linges à queue font nommés par les
Naturaliftes cercopitheci. Il y en a dans tous les cabinets
des curieux, 8c j’en ai vû.de toute grandeur.
Bourdon dit qu’il y a des fages-femmes qui ont
coutume de pouffer le coccyx en-arriere dans l’accouchement
avec tant de violence , qu’il en réfulte
de très*-fâcheux accidens. Cependant, fuivant la
Motte, auquel nous devons un bon traité des ac-
couchemens, ce n’eft jamais cet os qui met obftacle.
au paffage de l’enfant , mais le bafiin trop étroit de
l’hypogaftre, qui fait que la tête de l’enfant s’y étant
engagée , elle ne peut avancer ni rétrograder. Il eft:
perfuadé que le coccyx obéit fans peine aux efforts
que fait le foetus pour s’ouvrir un pafiage ,8c à ceux
que fait la mere pour accoucher.
Le coccyx peut fe luxer en-dehors ou en-dedans ,
car il eft très-rare que fes Vertebres fe déjoignent
entièrement. Pour réduire le coccyx luxé en-dehors,
il ne faut que le pouffer en-dedans, le tenir dans
cette fituation avec des çomprefles graduées 8c un
bandage en T.
Pour réduire le coccyx luxé en-dedans, on trempe
le doigt indice dans l’huile, 8c on l’introduit dans
l’anus aufli avant qu’il eft néceffaire pourpaffer au-
delà du bout du coccyx, 8c le relever. II faut, pour
éviter la douleur, obferver en introduifant le doigt,
de l’appuyer toujours fur le côté de la marge de l’anus
oppolé à la pointe du coccyx4
On préviendra les fuites fâcheufes de cet accident
par des faignées, des narcotiques, la diete, les
boiffons rafraîchiffantes , les lavemens, les bains,
les cataplafmes anodyns, émolliens 8c réfôlutifs, un
bandage lâche & finalement contentif, 8c le lit.
M. Petit dans fon traité des maladies des os, tomel.
chap. iij. remarque , que le dérangement du coccyx
n’eft point, à proprement parler, une luxation, parce
que la jonction de cet os n’eft pas une articulation
formée par des têtes 8c des cavités , mais une
union par cartilage que les anciens ont nommée Jyn-
chondrofe , ce qui femble devoir faire appeller la luxation
du coccyx en-dehors, renverfement, 8c fa luxation
en-dedans, enfoncement. Si le coccyx étoit entièrement
féparé de l’os facrum , on pourroit dire
qu’il eft rompu.
Les caufes de la luxation du coccyx en-dedans
( pour parler néanmoins le langage ordinaire), font
les coups 8c les chûtes fur cette partie, qui forment
quelquefois par la contufion des accidens funeftes,
iur-tout lorfque les femmes négligent par pudeur de
montrer le mal aux maîtres de l’art. M. Petit en cite
deux ou trois exemples qui doivent apprendre à fur-
monter dans ces occafions des répugnances qui peu-,
vent coûter la vie.
La pudeur bien entendue, n’eft qu’un fentiment
honnête qui doit feulement nous détourner du vice.
Cet article ejl de M. le Chevalier DE J AU COURT.
* CO CHE , f. m. voiture publique qui tranfporte
les particuliers 8c leurs effets de la capitale en diffé-
rens endroits du royaume , 8c de ces endroits dans
la capitale. Il y a deux fortes de coches , des coches
d’eau 8c les coches de terre. Les coches d’eau font de
grands bateaux diftribués en différentes chambres
où fe retirent les voyageurs , & en un grand ma-
gafin où font dépofées les marchandifes. Les coches
de terre font de grands carroffes à un grand nombre
de places ; les voyageurs occupent ces places ; les
marchandifes font changées fur le derrière ; le devant
eft occupé par un grand tiffu d’ofier qu’on appelle
le panier, où l’on met aufli des marchandifes ,
8c où font reçûes à un prix médiocre les perfonnes
qui ne trouvent plus de place dans le coche ? ou qui
C O C
ne font pas en état d’en prendre. La première infti-
tution de ces cocheS remonte fous Charles IX . Ils
étoient loués par des particuliers ; mais bien-tôt il y
eut un privilège exclufif & un infpeéteur des coches.
En 1594, Henri IV . fupprima cette infpeûion, 8c
créa un iurintendant de ces voitures ; ce qui fait préfumer
qu’elles étoient déjà établies en grand nombre.
Ce fut alors que commença la police de ces voitures,
qui a été portée jufqu’où nous la voyon s, fur
la qualité des marchandifes, l’exa&itude du départ,
le prix 8c l’ordre des places, la tenue des regiftres,
la sûreté des effets mis aux coches, les devoirs des
cochers, &c. Voye^ V oitures publiques.
C o ch e, terme de Marine. Porter les huniers en
coche , c’eft les hiffer au plus haut du mât. (Z )
C oche , f. f. infirument de Chapelier, morceau de
buis ou d’autre bois dur, long de fept ou huit pouces
, tourné en forme de petite bobine, avec lequel
on met en aétion la corde de l’arçon, dans la préparation
des matières dont on fabrique les chapeaux.
Voye^ la figure 4. PI. du Chapelier.
Les C ardeurs fe fervent aufli de la coche pour ar-
çonner leur laine ou coton après l ’avoir cardé.
Voye^ C hapeau.
C oche ou Entaille qu’on fait dans le bois.
COCHÉES, adj. f.pilules cochées, ( Pharm.) On
trouve dans prefque tous les difpenfaires deux fortes
de pilules, les unes appellées cochées majeures, les autres
cochées mineures.
Les premières ou les majeures font de Rhafis, 8c
fe font de la maniéré fuivante.
Pilules cochées majeures de Rhafis. ffi. de la poudre
d’hierepicre de Rhafis dix gros ; pulpe de coloquinte
pulvérifée, trois gros un fcrupule ; feammonée pul-
v érifée, deux gros 8c demi ; ftoechas, turbith choifi,
de chaque cinq gros. On pulvérifera enfemble le
ftoechas 8c le turbith, 8c on fera du tout une maffe
de pilules félon les réglés de l’art, avec une fuffi-
fante quantité de firop de ftoechas. La dofe de ces
pilules eft jufqu’à deux fcrupules 8c même un gros.
Pilules cochées mineures. IfL. aloès fucotrin, feammonée
choifie, pulpe de coloquinte, de chaque partie
égale ; huile effentielle de girofle, f . q. ad aroma-
tifand. faites du tout une maffe de pilules avec f. q.
de firop de nerprun. La dofe de ces pilules eft depuis
iix grains jufqu’à un fcrupule.
Les pilules cochées, tant majeures que mineures,
font des hydragogues très-violens fort peu employés
par nos Médecins, mais dont les Anglois 8c les Allemands
font un ufage affez fréquent. (£>)
COCHEIM, ( Géog. mod.') petite ville d’Allemagne
dans l’éleétorat de T rev es, fur la Mofelle. Long.
24. 4S. lat. 5o. 12.
COCHENILLAGE, f. m. ( Teinture. ) ce terme a
deux acceptions : il fe dit i° . de l’aétion de teindre
en cochenille ; z°. du bouillon ou de la décodion def-
tinée à teindre en cramoifi avec la cochenille : d’où
l’on a fait le verbe cocheniller. Voye^ Teinture &
C ochenille.
COCHENILLE, f. f. (H fi. nat.') matière qui fert
à la teinture de l’écarlate 8c du pourpre. On nous
l’apporte d’Amérique en petits grains de figure fin-
guliere, la plûpart convexes 8c cannelés d’un côté,
8c concaves de l’autre. La couleur de la cochenille la
plus recherchée eft le gris teint de couleur d’ardoife,
mêlé de rougeâtre 8c de blanc. On garde la cochenille
autant que l’on v eut, fans qu’elle s’altere. On a été
long-tems fans favoir précifément fi cette matière
appartenoit au régné végétal ou au régné animal:
on croyoit d’abord que c’étoit une graine de l’efpece
celle qu>on appelle des baies ; mais à-préfent il
Paf douteux que la cochenille ne foit un infe&e
defféché» On en a des preuves inconteftables par
C O C 5 59
lés obfervations qui ont été faites au Mexique, qui
eft lefeul pays ou on recueille la cochenille; mais indépendamment
des faits, que l’on a conftatés à ce fu-
je t , on pourrait reconnoître la cochenille pour un in-
féfte à la fimple irafpeûion, dans l’état où nous la
voyons dans ce pays-ci, fur-tout en l’obfervant à la
loupe ou au microfcope , après l’avoir fait ramollir
dans de l’eau ou dans du vinaigre, pour développer
8c renfler les parties racornies 8c defféchées. Par le
moyen de cette préparation, on diftingue dans les
grains de cochenille les plus informes, les différens
anneaux dont le corps de l’infeéte étoit compofé, &
on voit dans plufieurs de ces grains des jambes entières,
8c quelques reftes qui tiennent au corps, ou
au moins on apperçoit les endroits où les jambes de
cet infefte étoient attachées, 8c il paroît clairement
qu’il en avoit fix : on reconnoît aufli la tête 8c l’anus,
8c on voit quelque apparence d’yeux ou d’antennes,
d’une trompe, &c. enfin on en voit affez
pour reconnoître que la cochenille n’eft ni un fearabé
ni une araignée,comme on l’avoit crû ; on reconnoît
au contraire, que cet infefte a beaucoup de rapport
aux gallinfe&es, ou plûtôt aux progallinfeftes, fur-
tout par ce que l’on fait de fa maniéré de vivre.
On recueille la cochenille fur des plantes auxquelles
on donne les nofhs de figuier d'inde , de raquette ,
de cardajfe, 8c de nopal. Elles font affez connues dans
les ferres 8c même dans les orangeries , où on. les
garde pour leur figure finguliere ; car elles n’ont
que des feuilles au lieu de tiges 8c de branches, ou
plûtôt leurs tiges 8c leurs branches font compofées
d’une file de feuilles épaiffes, oblongues, 8c arrondies,
qui tiennent les unes aux autres par leurs extrémités.
Il y a dans les ferres du jardin du Roi plu-
' fieurs efpeces de ce genre de plante, 8c même celle
qui nourrit au Brefil l’infette de la cochenille. Ces
plantes portent un fruit qui reffemble en quelque
façon à nos figues ; c’eft d’où vient le nom d a figuier
d'inde. Ces figues n’ont pas un aufli bon goût que
les nôtres ; elles teignent en rouge l’urine de ceux
qui en ont mangé, 8r communiquent félon toutes
les apparences, à l’infe&e de la cochenille , la propriété
qu’il a pour la teinture.
Les Indiens du Mexique cultivent aux alentours
de leurs habitations des nopals, pour y recueillir de
la cochenille ; 8c pour s’aflïirer de cette récolte, ils
les fement pour ainfi dire fur les plantes. Ils font de
petits nids avec de la moufle, des brins d’herbe, ou
de la bourre de noix de cocos ; ils mettent 1 1 ou 14
cochenilles dans chaque nid, 8c placent deux ou trois
de ces nids fur chaque feuille de nopal,& les affermif-
fént au moyen des épines de cette plante. Après trois
ou quatre jours,on voit fortir du corps de ces infe&es
des milliers de petits qui ne font pas plus gros que
des mites. Ces nouveaux nés quittent bientôt le nid ,
8c fe difperfent fur les plantes ; mais ils ne font pas
long - tems fans s’arrêter & fe fixer dans les endroits
qui font les plus fucculens 8c les plus verds, ou les
plus abrités contre le vent ; ils relient chacun à leur
place, jufqu’à ce qu’ils ayent pris tout leur accroif-
fement. Ces infe&es ne rongent pas la plante, ils la
piquent 8t en tirent le fuc. Dans les lieux où l’on
doit craindre que le froid ou les pluies ne faffent périr
1 as cochenilles y on couvre avec des nattes les plantes
fur Iefquelles elles font. Ces infe&es font de figure
ovale; ils ne deviennent pas plus gros que de petits
pois, St on les i comparés pour la figure aux tiques
ou aux punaifes domeftiques. Les Indiens font
obligés de défendre les cochenilles contre différens
infectes qui les détruiroient, fi on n’avoit foin de nettoyer
exactement les nopals.
On fait chaque année plufieurs récoltes de coche-
nille. Dans la première, on enleve les nids 8c les cochenille
que l’on avoit mis dedans, 8c qui y ont péri