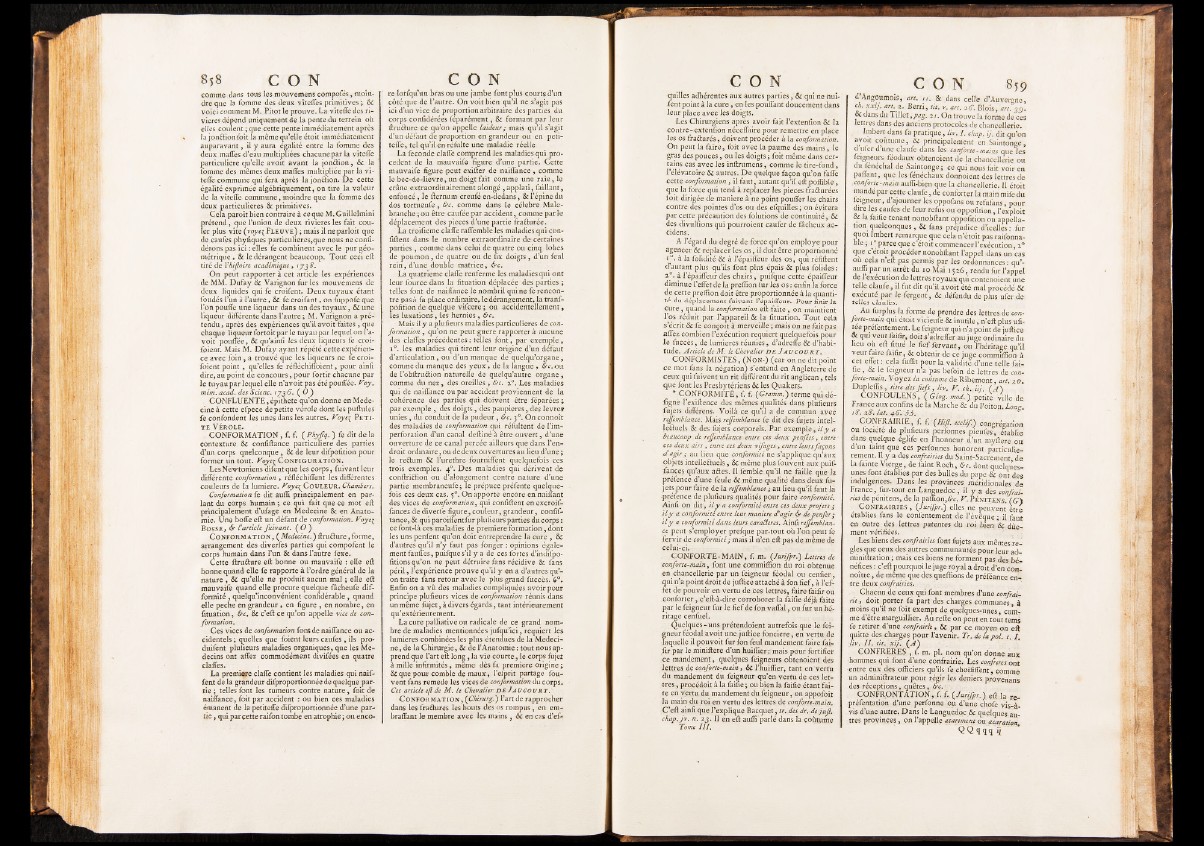
Si8 C O N
comme dans tous les mouvemens compofés,. moindre
que la fomme des deux vîteffes primitives ; ôc
voici comment M. Pitot le prouve. La vîteffe des rivières
dépend uniquement de la pente du terrein où
elles coulent ; que cette pente immédiatement après
la jonèlionfoit la même qu’elle étoit immédiatement
auparavant, il y aura égalité entre la fomme des
deux maffes d’eau multipliées chacune par la vîteffe
particulière qu’elle avoit avant la jon&ion, & la
îbmme des mêmes deux maffes multipliée par la v îteffe
commune qui fera après la jonction. De cette
égalité exprimée algébriquement, on tire la valeur
de la vîteffe commune, moindre que la fomme des
deux particulières & primitives.
Cela paroît bien contraire à ce que M. Guillelmini
prétend, que l’union de deux rivières les fait couler
plus vîte (voyt{ Fleuve) ; mais il ne parloit que
de caufes phyfiques particulières,que nous ne confi-
dérons pas ici : elles fe combinent avec le pur géométrique
, & le dérangent beaucoup. Tout ceci eft
tiré de Ÿhifioire académique , 1738.
On peut rapporter à cet article les expériences
de MM. Dufay & Varignon fur les mouvemens de
deux liquides qui fe croifent. Deux tuyaux étant
foudés l’un à l’autre, & fe croifant, on fuppofe que
Ton pouffe une liqueur dans un des tuyaux, & une
liqueur différente dans l ’autre; M. Varignon a prétendu,
après des expériences qu’il avoit faites , que
chaque liqueur fortoit par le tuyau par lequel on l’a-
voit pouffée, & qu’ainli les deux liqueurs fe croi-
fpient. Mais M. Dufay ayant répété cette expérience
avec foin, a trouvé que les liqueurs ne fe croi-
foient point , qu’elles fe réfléchiffoient, pour ainfi
dire, au point de concours, pour fortir chacune par
le tuyau par lequel elle n’avoit pas été pouffée. Foy.
mém. acad. des Scienc. 173 6. ( O )
CONFLUENTE, épithete qu’on donne en Médecine
à cette efpece de petite verole dont les pullules
fe confondent les unes dans les autres. Foye^ Pe t i t
e V érole.
CONFORMATION, f. f. ( Phyfiq. ) fe dit de la
contexture & conliftance particulière des parties
d’un corps quelconque , & de leur difpolition pour
former un tout. Voye^ C o n f ig u r a t io n .
Les Newtoniens difent que les corps, fuivant leur
différente conformation, réfléchiffent les différentes
couleurs de la lumière. Foye^ C ouleur. Chambers.
Conformation fe dit aufli principalement en parlant
du corps humain ; ce qui fait que ce mot elt
principalement d’ufage en Medecine & en Anatomie.
Une boffe eft un défaut de conformation. Foyt^
Bosse, & C article fuivant. ( O )
C o n form at io n , ( Medecine. ) ftruèhire, forme,
arrangement des diverfes parties qui compofent le
corps humain dans l’un & dans l’autre fexe.
Cette ftru&ure eft bonne ou mauvaife : elle eft
bonne quand elle fe rapporte à l’ordre général de la
nature , & qu’elle ne produit aucun mal ; elle eft
mauvaife quand elle procure quelque fâcheufe difformité
, quelqu’inconvénient confidérable, quand
elle peche en grandeur, en figure , en nombre, en
fituation, &c. & c’eft ce qu’on appelle vice de conformation.
Ces vices de conformation font de naiffance ou accidentels
; quelles que foient leurs caufes , ils pro-
duifent plufieurs maladies organiques, que les Mer
decins ont affez commodément divifées en quatre
claffes.
La première claffe contient les maladies qui naif-
fent de la grandeur difproportionnée de quelque partie
; telles font les tumeurs contre nature, foit de
naiffance, foit par accident : ou bien ces maladies
émanent de la petiteffe difproportionnée d’une partie
t qui par cette raifon tombe en atrophie ; ou enco-
C O N
‘ r.e lorfqii’un bras ou une jambe font plus courts d’un
côté (que de l’autre. On voit bien qu’il ne s’agit pas
ici d’un vice de proportion arbitraire des parties du
corps confidérées féparément, & formant par leur
ftru&ure ce qu’on appelle Laideur ; mais qu’il s’agit
d’un défaut de proportion en grandeur ou en peti-
tëffe j tel qu’il en réfulte une maladie réelle
La fécondé claffe comprend les maladies qui procèdent
de la mauvaife figure d’une partie. Cette
mauvaife figure peut exifter de naiffance , comme
le bec-de-lievre, un doigt fait comme une raie, le
crâne extraordinairement alongé , applati, f aillant,
enfoncé, le fternum creufé en-dedans, & l’épine du
dos tortueufe, &c. comme dans le célébré Male-
branche ;ou être caufée par accident, comme parle
déplacement des pièces d une partie fraèlurée.
La troifieme claffe raffemble les maladies qui confinent
dans le nombre extraordinaire de certaines
parties , comme dans celui de quatre ou cinq lobes
de poumon, de quatre ou de fix doigts , d’un feul
rein, d’une double matrice, &c.
La quatrième claffe renferme les maladies qui ont
leur fouree dans la fituation déplacée des parties ;
telles font de naiffance le nombril qui ne fe rencontre
pas à fa place ordinaire, le dérangement, la tranf-
pofition de quelque vifeere ; ou accidentellement,
les luxations, les hernies , &c.
Mais il y a plufieurs maladies particulières de conformation
, qu’on ne peut guere rapporter à aucune
des claffes précédentes : telles font, par exemple,
i° . les maladies qui tirent leur origine d’un defaut
d’articulation, ou d’un manque de quelqu’organe,
comme du manque des y eu x , de la langue , ô’c.ou
de l’obftru&ion naturelle de quelqu’autre organe ,
comme du nez, des oreilles, &c. r°. Les maladies
qui de naiffance ou par accident proviennent de la
cohérence des parties qui doivent être féparées ;
par exemple , des doigts, des paupières, des levres
unies , du conduit de la pudeur, &c. 30. On connoît
des maladies de conformation qui réfultent de l’im -
perforation d’un canal deftiné à être ouvert, d’une
ouverture de ce canal percée ailleurs que dans l’endroit
ordinaire, ou de deux ou vertures au lieu d’ une j
le re&um & l’urethre fourniffent quelquefois ces
trois exemples. 40. Des maladies qui dérivent de
conftriftion ou d’alongement contre nature d’une
partie membraneufe ; le prépuce préfente quelquefois
ces deux cas. 50. On apporte encore en naiffant
des vices de conformation, qui confiftent en excroif-
fances de diverfe figure, couleur, grandeur, confif-
tance, & qui parodient fur plufieurs parties du corps :
ce font-là ces maladies de première formation, dont
les uns penfent qu’on doit entreprendre la cure , &
d’autres qu’il n’y faut pas fonger : opinions également
fauffes, puifque s’il y a de ces fortes d’indifpo-
fitions qu’on ne peut détruire fans récidive & fans
péril, l’expérience prouve qu’il y en a d’autres qu’on
traite fans retour avec le plus grand fuccès. 6°.
Enfin on a vu des maladies compliquées avoir pour
principe plufieurs vices de conformation réunis dans
un même fujet, à divers égards, tant intérieurement
qu’extérieurement.
La cure palliative ou radicale de ce grand nombre
de maladies mentionnées jufqu’ic i , requiert les
lumières combinées les plus étendues de la Medecine
, de la Chirurgie, & de l’Anatomie : tout nous apprend
que l’art eft long, la v ie courte, le corps fujet
à mille infirmités, même dès fa première origine ;
ÔC que pour comble de maux, l’eforit partage fou-
vent fans remede les vices de conformation du corps.
Cet article ejl de M. le Chevalier DE J AV COU RT.
C o n fo rm at io n , (Ckirurgj) l’art de rapprocher
dans les fraèlures les bouts des os rompus, en em-
braffant le membre avec les mains, & en cas d’ef-
C O N
quilles adhérentes aux autres parties, Sc qui ne nuisent
point à la cure, en les pouffant doucement dans
leur place avec les doigts.
Les Chirurgiens après avoir fait l’extenfion & la
contre-extenfion néceffaire pour remettre en place
les os fraûurés, doivent procéder à la conformation.
On peut la faire, foit avec la paume des mains, le
gras des pouces, ou les doigts ; foit même dans certains
cas avec les inftrumens, comme le tire-fond,
l’élévatoire & autres. De quelque façon qu’on faffe
cette conformation, il faut, autant qu’il eft poflihle,
que la force qui tend à replacer les pièces fra&urées
foit dirigée de maniéré à ne point pouffer les chairs
contre des pointes d’os ou des efquilles ; on évitera
par cette précaution des folutions de continuité, &
des divulfions qui pourroient caufer de fâcheux ac-
cidens.
A l’égard du degré de force qu’on employé pour
agencer & replacer les os, il doit être proportionné
i° . à la folidité & à l’épaiffeur des os, qui réfiftent
d’autant plus qu’ils font plus épais & plus folides :
20. à l’épaiffeur des chairs, puifque cette épaiffeur
diminue l’effet de la preflîon liir les os : enfin la force
de cette preflion doit être proportionnée à la quantité
du déplacement fuivant l’épaiffeur. Pour finir la
cure, quand la conformation eft faite, on maintient
l’os réduit par l’appareil & la fituation. Tout cela
s’écrit & fe conçoit à merveille ; mais on ne fait pas
affez combien l’exécution requiert quelquefois pour
le fuccès, de lumières réunies, d’adreffe & d’habitude.
Article de-M. le Chevalier DE J AU COU RT.
CONFORMISTES, (Non-) (car on ne dit point
ce mot fans la négation) s’entend en Angleterre de
ceux qui’fuivent un rit différent du rit anglican, tels
que font les Presbytériens & les Quakers.
* CONFORMITÉ, f. f. JGramm.') terme qiff.dé-
fignë l’exiftence des mêmes qualités dans plufieurs
fujets différens. Voilà ce qu’il a de commun avec
rejfemblance. Mais reffemblance fe dit des fujets infel-
le&uels & des fujets corporels. Par exemple.;, i l y a
beaucoup de rejjémblance entre ces deux penfées, entre ~
ces deux airs, entre ces deux v i f âges , entre leurs façons
■ d'agir p rw lieu que conformité ne s’applique qu’aux
objets intellectuels, & même plus fouvent aux puiff
fonces qu’aux aCtes. Il femble qu’il ne faille que la
préfenee d’une feule & même qualité dans deux fujets
pour faire de la rejfemblance ; au lieu, qu’il faut la
préfenee de plufieurs qualités pour faire conformité.
Ainfi on dit, il y a conformité entre ces deux projets ; \
i l y a conformité entre leur maniéré (Pagir & de penfer ; I
i l y a conformité dans leurs car acier es. Ainfi reffemblan- !
ce peut s’employer prefque par-tout où l’on peut fe
fervir de conformité; mais il n’en eft pas de même de
celui-ci» - •
CONFORTE-MAIN, f. m. (Jurifpr.') Lettres de
conforte-main, font une commiflion du roi obtenue
en chancellerie par un feigneur féodal ou cenfier ,
qui n’a point droit de juftice attaché à fon fief, à l’effet
de pouvoir en vertu de ces lettres, faire faifir ou
conforter, c’eft-à-dire corroborer la faifie déjà faite
par le feigneur fur le fief de fon vaffal, ou fur un héritage
cenfuel.
Quelques -uns prétendoient autrefois que le feigneur
féodal avoit une juftice foncière, en vertu de
laquelle il pouvoit fur fon feul mandement faire faifir
par le miniftere d’un huiffier; mais pour fortifier
ce mandement, quelques feigneurs obtenoient des
lettres de conforte-main, & Thuillier, tant en vertu
du mandement du feigneur qu’en vertu de ces lettres
, procédoit à la faifie ; ou bien la faifie étant faite
en vertu du mandement du feigneur, on appofoit
la main du roi en vertu des lettres de conforte-main.
C ’eft ainfi que l’explique Bacquet, tr. des dr. de jujl.
chap.jv. n. 23. Il en eft aufli parlé dans la coutume
Tome I II.
C O N 8*9
d’Angotittioif, art. u . & dans celle d’Auvergne,
ch. xxij. art. z. Berri, lit. v. art. zS. Blois, art. 3 q.
dedans du Tille tfpag. 21. On trouve la forme de ces
lettres dans des anciens protocoles de chancellerie.
Imbert dans fa pratique, liv. I . chap. ij. dit qu’on
avoit coutume, & principalement en Saintonge,
d ufer d’une claufe dans les conforte - mains que les
feignéurs féodaux obtenoient de la chancellerie ou
du fénéchal de Saintonge ; ce qui nous fait voir en
paffant, que les fénéchaux donnoient des lettres de
conforte-mainaufli-bien que la chancellerie. II étoit
mande par cette claufe, de conforter la main mife du
leigneur, d’ajourner les oppofans ou refufans, pour
dire les caufes de leur refus ou oppofition, l’exploit
& la faifie tenant nonobftant oppofition ou appellation
quelconques , & fans préjudice d’icelles : fur
quoi Imbert remarque que cela n’étoit pas raifonna-
ble ; 1® parce que c ’étoit commencer l’exécution, 20
que c etoit procéder nonobftant l’appel dans un cas
ou cela n eft pas permis par les ordonnances : qu’-
aulfi par un arrêt du 10 Mai 15,26, rendu fur l’appel
de l’exécution de lettres royaux qui contenoient une
telle claufe, il fut dit qu’il avoit été mal procédé &
exécuté par le fergent, & défendu de plus ufer de
telles claufes.
An furplus la forme de prendre des lettres de co/z-
fone-main qui étoit vicieul'e & inutile, n’eft plus ufi-
tee préfentement. Le feigneur qui n’a point de juftice
& qui veut faifir, doit s’adreffer au juge ordinaire du
lieu où eft fitué le fief fervant, ou l ’héritage qu’il
veur foire faifir , & obtenir de ce juge commiflion à
cet effet : cela fuffit pour la validité d’une telle faifie
, & le feigneur n’a pas befoin de lettres de conforte
main. Voyez la coâtume de Ribemont, art. 20.
Dupleflis, titre des fiefs, liv. F .c h .j ij . (A )
CONFOULE.NS, ( Géog. mod1) petite yille de
France aux confins de la Marche & du Poitou. Lone
1 8 ,2 8 . ja t. ^ S / S à . 5
CONFRAIRIE, f. f. (Hifi. eccléfj) congrégation
ou focieté de plufieurs perfonnes pieufes, établie
dans quelque églife en. l’honneur d ’un myftere ou
d’un faint que ces perfonnes honorent particulièrement.
Il y a des confrairies du Saint-Sacrement, de
la fainte Vierge, de faint R och, & c . dont quelques-
unes font établies par des bulles du pape & ont des
indulgences. Dans les provinces méridionales de
France, fur-tout en Languedoc, il y a des confrairies
de pénitens, de la pamon,#«:. F. Pénitens. (G)
Confrairies, (Jurifpr.) elles ne peuvent être
établies fans le confentement de l’é v êq u e il fout
en outre des lettres patentes du roi bien Sc dûe-
ment vérifiées.
Les biens dës confrairies font fujets aux mêmes,réglés
que ceux des autres communautés pour leur ad*-
minittration ; mais ces biens ne forment pas des bénéfices
: c’eft pourquoi le juge royal a droit d’en con-
noître, de même que des queftions de préféance entre
deux confrairies.
Chacun.de ceux qui font membres d’une confiai-
rie, doit porter (a. part des charges communes à
moins qu’il ne foit exempt de quelques-unes, couir
me d’être marguillier. Au refte on peut en tout tems
fe retirer d’une confrairh, & par ce moyen on eft
quitte des charges pour l’avenir. Tr. de la pol. t. I.
liv. II. tit. xij. (^Q
CONFRERES , f. m. pl. nom qu’on donne aux
hommes qui font d’une confrairie. Les oonfieres ont
entre eux des officiers qu’ils fe choififfent, comme
un adminiftrateur pour régir les deniers provenans
des réceptions, quêtes, &c.!
CONFRQNTATION , ƒ. f. ( Jurifpr. ) eft la re-
préfentation d’une perfonne ou d’une chofe vis-à-
vis d’une autre. Dans le Languedoc &c quelques autres
provinces, on l’appelle acarement ou acaration "Ù'QqqVï
■ wj
k