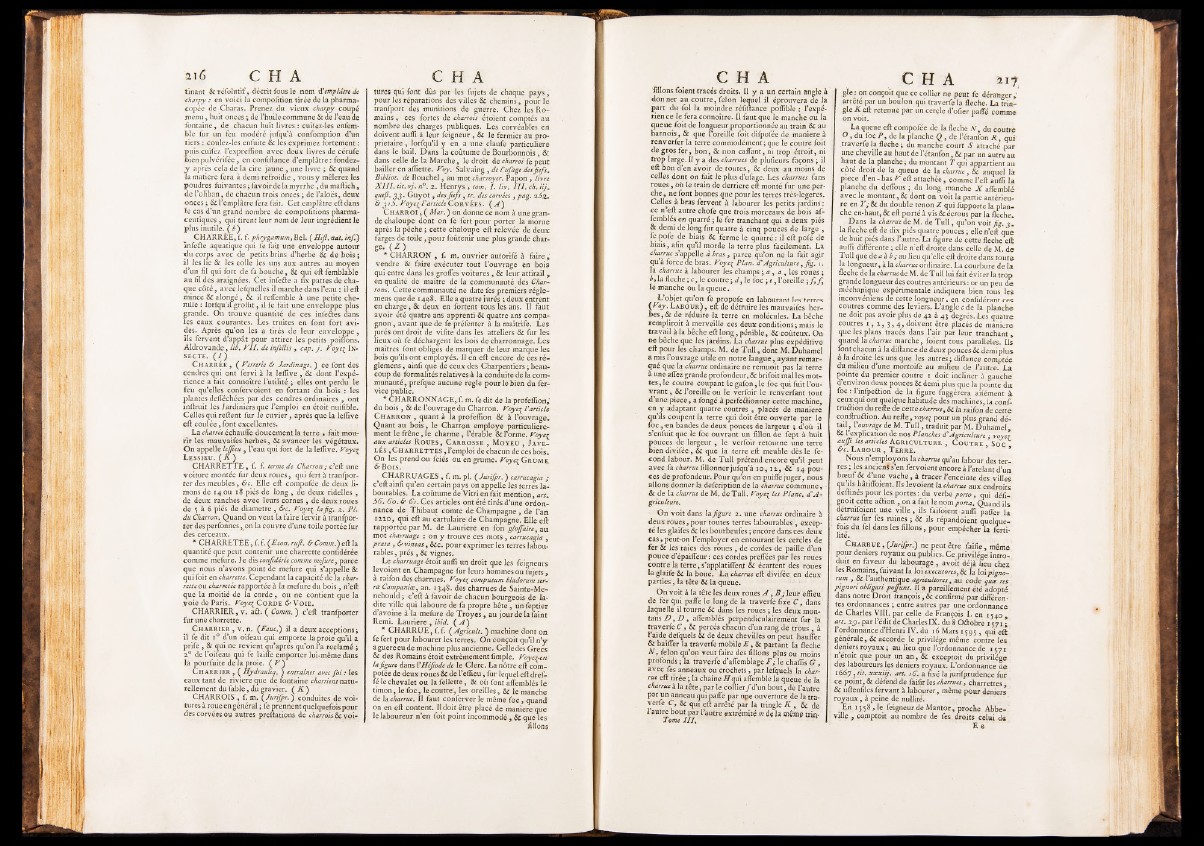
tinant & résolutif, décrit fous le nom d’emplâtre de
charpy : en voici la compofition tirée de la pharmacopée
de Charas. Prenez du vieux charpy coupé
menu, huit onces ; de l’huile commune & de l’eau de
fontaine , de chacun huit livres : cuilez-les enfem-
ble fur un feu modéré jufqu’à confomption d’un
tiers : coülez-les enfuite & les exprimez fortement1:
puis cuifez l’expreiïïon avec deux livres de cérufe
bien pulvérifée, en confiftance d’emplâtre : fondez-
y après cela de la cire jaune , une livre ; & quand
la matière fera à demi refroidie , vous y mêlerez les
poudres fuivantes ; favoir de la myrrhe ,dumaftich,
cle l’oliban, de chacun trois onces ; de l’aloës, deux
onces ; & l’emplâtre fera fait. Cet emplâtre eft dans
le cas d’un grand nombre de compofitions pharmaceutiques
, qui tirent leur nom de leur ingrédient le
plus inutile. ( b)
CHARRÉE, f. f. phrygamum, Bel. ( Hifi.nal. infJ)
ànfede aquatique qui le fait une enveloppe autour
du corps avec de petits brins d’herbe & de bois ;
il les lie & les colle les uns aux autres au moyen
d’un fil qui fort de fa bouche, & qui eft femblable
au fil des araignées. Cet infeûe a fix pattes de chaque
cô té, avec lefquelles il marche dans l’eau : il eft
mince & alongé-, & il relfemble à une petite chenille
: lorfqu’il g roflit, il fe fait une enveloppe plus
grande. On trouve quantité de ces infeftes dans
les eaux courantes. Les truites en font fort avides.
Après qu’on les a tirés de leur enveloppe,
ils fervent d’appât pour attirer les petits poiflons.
Aldrovande, lib. VII. de infeclis , cap. j . Voyeç Inse
c t e . ( / )
C harrÉE , ( Verrerie & Jardinage. ) ce font des
cendres qui ont fervi à la leflive , & dont l’expér
rience a fait connoître l’utilité ; elles ont perdu le
feu qu’elles confervoient en fortant du bois : les
plantes deflechées par dès cendres ordinaires , ont
inftruit les Jardiniers que l’emploi en étoit nuifible.
Celles qui reftent fur le cuvier, après que la leflive
eft coulée, font excellentes.
La charrie échauffe doucement la terre , fait mourir
les mauvaifes herbes, 8c avancer les végétaux.
On appelle leffieu , l’eau qui fort de la leflive. Voye^
L essieu. ( K )
CH ARRETTE, f. f. terme de Charron ; c’eft une
voiture montée fur deux roues, qui fert à tranfpor-
ter des meubles, &c. Elle eft compofée de deux limons
de 14 ou 18 piés de long , de deux ridelles ,
de deux ranches avec leurs cornes , de deux roues
de 5 à 6 piés de diamètre, &c. Voye[ lafig. 2. PI.
du Charron. Quand on veut la faire fervir à tranfpor-
ler des perfonnes ^on la couvre d’une toile portée fur
des cerceaux.
* CHARRETÉE, f. f. ÇEcon. ruß. & Comm J) eft la
quantité que peut contenir une charrette confidérée
comme mefure. Je dis confidérée comme mefure, parce
que nous n’avons point de mefure qui s’appelle &
qui foit en charrette. Cependant la capacité de la charrette
ou charretée rapportée à la mefure du bois , n’eft
que la moitié de la corde, ou ne contient que la
.voie de Paris. Voye£ C orde & V oie.
CHARRIER, v . a&. ( Comm. ) c’eft tranfporter
fur une charrette.
C harrier , v . n. (Fauc'.) il a deux acceptions;
il fe dit i ° d’un oifeau qui emporte la proie qu’il a
prife , & qui ne revient qu’après qu’on l’a réclamé ;
20 de l’oileau qui fe laiffe emporter lui-même dans
la pourfuite de la proie. ( V )
CHARRIER, ( Hydrauliq. ) entraîner avec fo i : les
eaux tant de riviere que de fontaine charrient naturellement
du fable, du gravier. ( K )
CHARROIS , f. m. ( Jurifpr. ) conduites de voitures
à roue en général ; fe prennent quelquefois pour
des corvées ou autres prestations de charrois deyoititres
qui font dûs par les fujets de chaque pa ys,
pour les réparations des villes 8c chemins, pour le
tranfport des munitions de guerre. Chez les Romains
> ces fortes de charrois étoient comptés ait
nombre des charges publiques. Les corvéables en
doivent aufli à leur feigneur , 8c le fermier au proprietaire
, lorfqu’il y en a une claufe particulière
dans le bail. Dans la coutume de Bourbonnois , &
dans celle de la Marche, le droit de ckarroi fe peut
bailler en aflxette. V>y. Salvaing , de l'ufage des fiefs.
Bibliot. de Bouchel, au mot charroyer. Papon, livre
X I I I . tit. vj. n°. 2. Henrys , tom. I. liv. I I I . ch. iij.
quefi. 3 3 . G u y o t , des fiefs, tr. des corvées , pag. 2.5z .
& j / 5. Voye^ l'article C o rvée s. {A ')
C harroi , ( Mar. ) on donne ce nom à une grande
chaloupe dont on fe fert pour porter la morue
après la pêche ; cette chaloupe eft relevée de deux
farges de toile, pour foûtenir une plus grande char-
g<=. ( z )
* CHARRON , f. m. ouvrier autorifé à faire
vendre & faire exécuter tout l ’ouvrage en bois
qui entre dans les greffes voitures , 8c leur attirail ,
en qualité de maître de la communauté des Charrons.
Cette communauté ne date fes premiers régle-
mens que de 1498. Elle a quatre jurés ; deux entrent
en charge, & deux en fortent tous les ans. Il faut
avoir été quatre ans apprenti 8c quatre ans compagnon
, avant que de fe préfenter à la maîtrife. Les
jurés ont droit de vifite dans les atteliers 8c fur les
lieux où fe déchargent les bois de charronnage. Les
maîtres font obligés de marquer de leur marque les
bois qu’ils ont employés. Il en eft encore de ces ré-
glemens, ainfi que de ceux des Charpentiers ; beaucoup
de formalités relatives à la conduite de la communauté,
prefque aucune réglé pour le bien du fer-
vice public.
* CHARRONNAGE, f. m. fe dit de la profeflxon,’
du bois , & de l’ouvrage du Charron. Voye^ l'article
C harron , quant à la profeflion & à l’ouvrage.
Quant au bois, le Charron employé particulièrement
le frêne, le charme, l’érable 8c l’orme. Voye^
aux articles R o ues, CARROSSE , Mo yeu , Jave-
lés , C h a r r e t t e s , l’emploi de chacun de ces bois.
On les prend ou fciés ou en grume. Voye£ Grume
& B o i s .
^ CHARRUAGES , f. m. pl. ( Jurifpr. ) carrucagia ;
c’eft ainfi qu’en certain pays on appelle les terres labourables.
La coûtume de Vitri en fait mention, art.
56. <50. & 61. Ces articles ont été tirés d’une ordonnance
de Thibaut comte de Champagne, de l’an
iz z o , qui eft au cartulaire de Champagne. Elle eft
rapportée par M. de Lauriere en fon glojfairc, au
mot charruage : on y trouve ces mots, carrucagia ,
prata , &vineas9 8cc. pour exprimer les terres labourables
, prés , 8c vignes.
Le charruage étoit aufli un droit que les feigneurs
levoient en Champagne fur leurs hommes ou fujets ,
à raifon des charrues. Vyye^ computum bladorum terra
Campanice, an. 1348. des charrues de Sainte-Me-
nehould; c’eft à fav-oir de chacun bourgeois de ladite
ville qui laboure de fa propre bête, un feptier
d’avoine à la mefure de T ro y e s , au jour de lafaint
Remi. Lauriere , ibid. ÇA')
* CHARRUE, f. f. ( Agricult. ) machine dont on
fe fert pour labourer les terres. On conçoit qu’il n’y
aguereeu de machine plus ancienne. Celle des Grecs
& des Romains étoit extrêmement fimple. Voye^-en
la figure dans ŸHèfiode de le Clerc. La nôtre eft compofée
de deux roues 8c de l’eflieu, fur lequel eft dref-
îé le chevalet ou la fellette, & oïi font aflemblés le
timon, le foc , le coutre', les oreilles, 8c le manche
de la charrue. Il faut conferver le même fo c , quand
on en eft content. Il doit être placé de maniéré que
le laboureur n’en foit point incommodé , 8c que les
filions
filions foient tracés droits. Il y a un certain angle à
don ner au coutre, félon lequel il éprouvera de la
part du fol la moindre réfiftance poflible : l’expérience
le fera connoître. Il faut que le manche ou la
queue foit de longueur proportionnée au train 8c au
harnois, & que l’oreille foit difpofee de maniéré à
renverfer la terre commodément ; que le coutre foit
de gros fe r , bon, & non caflant, ni trop étroit, ni
trop Iarge.il y a des charrues de plufieurs façons ; il
eft bon d’en avoir de toutes, 8c deux ail moins de
celles dont on fait le plus d’ufage. Les charrues fans
roues, Oïi le train de derrière eft monté fur une perche,
ne font bonnes que pour les terres très-legeres.
Celles à bras fervent à labourer les petits jardins :
ce n’eft autre chofe que trois morceaux de bois af-
femblés en quarré ; le fer tranchant qui a deux piés
& demi de long fur quatre à cinq pouces de large ,
biais 8c ferme le quarré : il eft pofé de
biais, afin qu’il morde la terre plus facilement. La
charrue s’appelle à bras, parce qu’on ne la fait agir
qu à force de bras. V?yeç Plan, d'Agriculture, fig. 1.
la charrue à. labourer les champs ; a , a , les roues ;
hy la fléché ; c , le coutre ; d 9 le foc ; e , l’oreille \ f , f ,
lé manche ou la queue.
•L-objet qu’on fe propofe en labourant les'terres
\Voy. L abour.} , eft de détruire les mauvaifes herbes
, & de réduire la terre en molécules. La bêche
rempliroit à merveille ces deux conditions ; mais le
travail à la bêche eft long, pénible, & coûteux. On
ne beche que les jardins. La charrue plus expéditive
eft pour les champs. M. de T u ll, dont .M. Duhamel
a mis l’ouvrage utile en notre langue, ayant remarqué
que la charrue ordinaire ne remuoit pas la terre
à une affez grande profondeur, & brifoit mal les mottes,
le coutre coupant le gafon ,1e foc qui fuit l’ouvrant
, & l’oreille ou le verfoir le renverfant tout
d’une.piece, a fongé à perfectionner cette machine,
en y adaptant quatre coutres , placés de maniéré
qu’ils coupent la terre qui doit être ouverte par le
foc , en bandes de deux pouces de largeur ; d’oii il
s’enfuit que le foc ouvrant un fillon de fept à huit
pouces de largeur , le verfoir retourne une terre
bien d ivifée, & que la terre eft meuble dès le fécond.
labour. M. de Tull prétend encore qu’il peut
avec fa charrue fillonner jufqu’à 1 0 ,1 2 , & 14 pouces
de profondeur. Pour qu’on en puiffe juger, nous
allons donner la defeription de la charrue commune, •
& de la charrue de M. de Tull. Voye% les Plane. d 'A-
griculture.
On voit dans figure 2. une charrue ordinaire à
deux roues, pour toutes terres labourables;, excepté
les glaifes & les bourbeüfes ; encore dans ces deux
cas, peut-on l’employer en entourant les cercles de
fer & les raies des roues , de cordes de paille d’un
pouce d’épaifleur: ces cordes préffées par les roues
contre la terre, s’applatiffenj & écartent des roues
la glaife & la boue. La charrue eft divifée. en deux
parties, la tête & la queue.
On voit à la tête les deux roues A , J?; Iëur èflieu
de fer qui paffe le long de la traverfe fixe C , dans '
Jaque lie il tourne & dans les roues ; les deux mon-
tans D y D y aflemblés perpendiculairement, fur la
traverfe C , & percés chacun d’un rang de trous , à
l’aide defquels & de deux chevilles on peut haufler
& baiflër la traverfe mobile E , & partant là fléché
N y félon qu’on veut faire des filions plus ou moins
profonds ; la traverfe d’aflemblage F ; le chaflîs G ,
avec fes anneaux ou crochets, par lefquels la charrue
eft tirée ; la châine //qui affemble la queue de la
charrue à la tête, parle collier ƒ d’un bout, de l’autre
par un anneau qui paflè par upe ouverture de la traverfe
C, &c qui eft arrêté par la tringle K , & de
l ’autre bout par l’autre extrémité m de la même triiv
Tome I I I .
gle: on conçoit que ce collier ne peut fe déranger^
arrêté par un boulon qui traverfe la fléché. La tringle
K eft retenue par un cercle d’ofier pafle comme
on voit.
La queue eft compofée de la fléché N , du coutre
O , du foc P , de la planche Q , de l’étanfon R , qui'
traverfe la fléché ; du manche court S attaché par
une cheville au haut de fétanfon, & par un autre au
haut de la planche ; du montant T qui appartient au
côté droit de la queue de la charrue , &c auquel là
piece d’en - bas V eft attachée, comme l’eft aufli la
planche du deffous ; du long manche X affemblé
avec le montant, & dont on voit la partie antérieure
e n f ; & du double tenon Z qui fupporte la planche
en-haut, & eft porté à vis & écrous par la fléché.
Dans la charrue de M. de T u ll, qu’on voit fig. j .
la fléché eft de dix piés quatre pouces ; elle n’eft que
de huit piés dans l’autre. La figure de cette fléché eft;
aufli différente ; elle n’eft droite dans celle de M. de
Tull que de a à b,-au lieu qu’elle eft droite dans toute
la longueur, à la charrue ordinaire. La courbure de la
fléché de la charrue de M. de Tull lui fait éviter la trop
grande longueur des coutres antérieurs: or un peu de
méchanique expérimentale indiquera bien tous les
inconvéniens de cette longueur, en confidérant ces
coutres comme des leviers. L’angle c de la planche
ne doit pas avoir plus de 41 à 43 degrés. Les quatre
coutres 1 , 2 , 3 ,4 , doivent être placés de maniéré
que les plans tracés dans l’air par leur tranchant,
quand la charrue marche, foient tous parallèles. Ils
font chacun à la diftance de deux pouces & demi plus
à la droite les uns que les autres; diftance comptée
du milieu d’une mortoife au milieu de l’autre. La
pointe du premier coutre 1 doit incliner à gauche
d’environ deux pouces & demi plus que la pointe du
foc :T’infpeûion de la figure fuggérera aifément à
ceux qui ont quelque habitude des machines, la conf-
truftion du refte de cette charrue, & la raifon de cette
conftruûion. Au refte, voye^ pour un plus grand détail,
Vouvrage de M. T u ll, traduit par M. Duhamel,
l’explication de nos Planches d 'Agriculture ; voye?
auffi les articles A gricultur e , C o u t r e , So c
&c. Labo ur , T erre.
Nous n’employons la charrue qu’au labour des ter-
res ; les ancien#s’en fervoient encore à l’atelant d’un
boeuf & d’une vache, à tracer l’enceinte des villes
qu’ils bâtifloient. Ils levoient la charrue aux endroits
deftinés pour les portes: du verbe porto , qui défi-
gnoit cette a&ion , on a fait le nom porta. Quand ils
détruifoient une v ille , ils faifoient aufli paffpr la
charrue fur fes ruines ; & ils répandoient quelquefois
du fel dans les filions, pour empêcher la fertilité.
C harrue , (Jurifpr.) ne peut être faifie, même
pour deniers royaux ou publics. C e privilège introduit
en faveur du labourage , avoit déjà lieu chez
les Romains, fuivant la loi exécutons, & la loi pigno-
rum y & l’authentique agricultores, au code quæ res
pignori obligari poffunt. Il a pareillement été adopté
dans notre Droit françois, & confirmé par différentes
ordonnances ; entre autres par une ordonnance
de Charles VIII. par,celle de François I. en 1540 ,
art. 2c>. par l’édit de Charles IX. du 8 Ôttobre 15 7 1 ;
l’ordonnance d’Henri IV. du 16 Mars 1595, qui eft
générale, & accorde le privilège même contre les
deniers royaux ; au lieu que l’ordonnance de 1571
n’etoit que pour un an, & exceptoit du privilège
des laboureurs les deniers royaux. L’ordonnance dé
i66y ? tit. xxxiij. art. 16. a fixé la jurifprudence fur
ce point, & défend de faifir les.charrues.} charrettes;
& uftenfiles fervant à labourer, même pour deniers
royaux, à peine de nullité.
En 1358, le feigneur.de Mantor, proche Abbeville
, cojnptoit au nombre de fes droits celui dé
E e