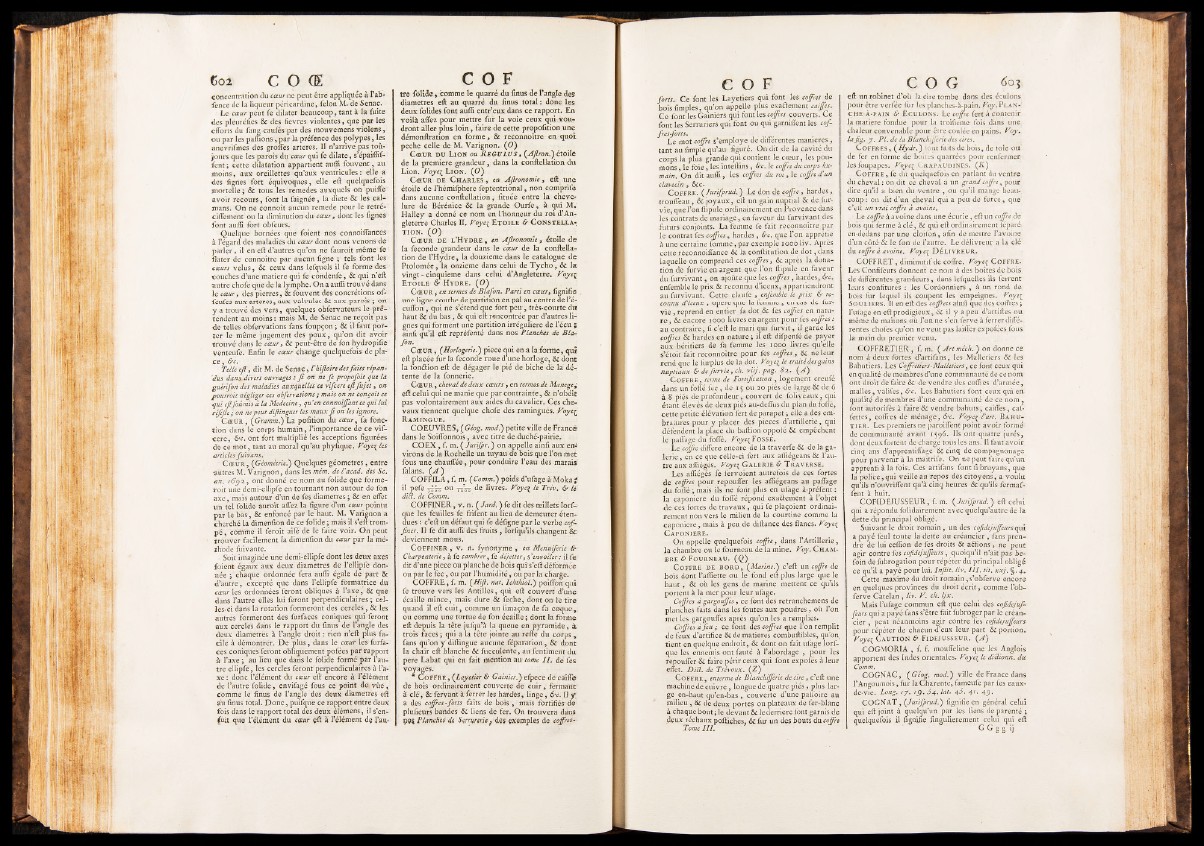
Coi C O OE
concentration du coeur ne peut être appliquée à Tab-
fence de la liqueur péricardine, félon M. de Sénats
Le coeur-peut fe dilater beaucoup, tant à la fuite
d<es pleuréfies S i des fievres violentes, que par les
efforts du fang caufés par des mouvemens v iolens,
ou par les pallions, par la préfence des polypés, les
anevrifmes des greffes arteres. Il n’arrive pas toujours
que les parois d u coeur qui fe dilate, s’épaiffif-
fent ; cette dilatation appartient auffi fouvent, au
moins, au» oreillettes qu’aux ventricules: elle a
des (ignés fort équivoques, elle eft quelquefois
mortelle; S i tous les remedes auxquels on puifle
avoir recours , font la faignée, la diete S i les caïmans.
On ne connoît aucun remede pour le retré-
ciffement ou la diminution du coeur , dontles (ignés
font auffi fort obfcurs.
Quelque bornées que foient nos connoiffanees
à l’égard des maladies du coeur dont nous venons'dê1
parler, il en eft d’autres qu’on ne fauroit même fe
flater de connoître par aucun ligne ; tels font les
coeurs velus, S i ceux dans lefquels il fe forme des
couches d’une matière qui fe condenfe, & qui n’eft
autre chofe que de la lymphe. On a auffi trouvé dans
le coeur, des pierres, & fouvent des concrétions of-
feufes aux arteres, aux valvules S i aux parois ; oii
y a trouvé des v er s , quelques obfervateurs le -prétendent
au moins : mais M. de Senac ne reçoit pas
de telles obfervations fans foupçon ; S i il faut potier
le même jugement des poux, qu’on dit avoir
trouvé dans le coeur, S i peut-être de fon hydropifie
venteufë. Enfin le coeur change quelquefois de plac
e , &c.- — 1 '' ^ f l’\
Telle eft, dit M. de Senac, l'hiftoire des faits répandus
âans^dïvers ouvrages : f i on' ne fe propofoit que la
guérifon des maladies auxquelles ce vifeere eft fuje t, on
pôurroit négliger ces obfervations ; mais on ne conçoit ce
■ qui efl fournis à la Medecint, qu'en connoiffant ce qui lui
rèjifte • on ne peut diftinguer les maux f i on les ignore.
C oe u r , (Gramm.) La pofition du coeur, fa fonction
dans le corps humain, l’importance de ce vifeere
, &c. ont fort multiplié les acceptions figurées
de ce mot, tant au moral qu’au phyfique. Voye^ les
articles fuivans.
C oeur , (Géométrie.) Quelques géomètres, entre
autres M. Varignon, dans les mém. de l'acad. des Sc.
an. r fy z , ont donné ce nom au folide que forme-
roit une demi-ellipfe en tournant non autour de fon
a x e , mais autour d’un de fes diamètres; & en effet
un tel folide auroit affez la figure d’un coeur pointu
par le bas, S i enfoncé par le haut. M. Varignon a
cherché la dimenfion de ce folide ; mais il s’éft trompé
, comme il feroit aifé de le faire voir. On peut
trouver facilement la dimenfion du coeur par la méthode
fuivante.
Soit imaginée une demi-ellipfe dont les deux axes
foient égaux aux deux diamètres de l’ellipfé donnée
chaque ordonnée fera auffi égale de part &
d’autre, excepté que dans Tellipfe formatrice du
coeur les .ordonnées feront obliques à Taxe, S i que
dans l’autre elles lui feront perpendiculaires ; celles
ci dans la rotation formeront des cercles, & les
autres formeront des furfaces coniques qui feront
aux cercles dans le rapport du finus de l’angle des
deux diamètres à l’angle droit : rien n’eft plus facile
à démontrer. De plus, dans le coeur les furfà-
ces coniques feront obliquement pofées par rapport
à l’axe ; au lieu que dans le folide formé par l’autre
ellipfe, les cercles feront perpendiculaires à Tax
e : donc l’élément du coeur eft encore à l’élériient
de l’autre folide, envifagé fous cé point dé; vue
comme le finus de l’angle des deux diamètres eft
au finus total. D on c , puifquè ce rapport entre demi
fois dkns le rapport total des deux élémens, il s’enfuit
que l'élément du coeur eft à l’élément de Tau-
C O F
tfe folide, comme le quarré du finus de l’angle des
diamètres eft au quarré du finus total : donc les
deux folides font auffi entr’eux dans ce rapport. En
voilà affez pour mettre fui* la voie ceux qu iyou -
dront aller plus loin, faire de cette propofition une
démonftration en forme, & reconnoître en quoi
peche celle de M. Varignon. (O)
C oeur du L ion ou R e g u l u s , (Aftron.)étoile
de la première grandeur, dans la conftellation du
Lion. Voye^ Lio n . (O)
Coeur de C harles , en Aftronomie, eft une
étoilé de l’hémifphere feptentrional, non comprife
dans aucune conftellation ; fituée entre la Chevelure
de Bérénice S i la grande Ourfe , à. qui M.-
Halley a donné ce nom en l ’honneur du roi d’Angleterre
Charles II. Voye{ Eto il e & C o nste llat
io n . (O )
C oeur de l’Hydre , en Aftronomie, étoile de
la fécondé grandeur dans le coeur de la conftellation
de l’Hydre, la douzième dans le catalogue de
Ptolomée, la onzième dans celui de T y ch o , S i lav
vingt - cinquième dans celui d’Angleterre. Voyeç
Eto il e & Hyd re. (O )
C oe ur, en termes de Blafon. Parti en coeur, fignifie
une ligne courbe de partition en pal au centre de l’é-
cüffon, qui ne s’étend que fort peu , très-courte du
haut S i du bas, & qui eft rencontrée par d’autres lignes
qui forment une partition irrégulière de l’écu ;
ainfi qu’il eft repréfenté dans nos Planches de Bla-
fon. .
C oeur , (Horlogerie.) piece qui en a la forme, qui
eft placée fur la fécondé roue d’une horloge, S i dont
la fonâion eft de dégager le pié de biche de la dé-,
tente de la fonnerie.
C oeur , cheval de deux coeurs, en termes de Manegei
eft celui qui ne manie que par contrainte, & n’obéit
pas volontairement aux aides du cavalier. Gés chevaux
tiennent quelque chofe dès ramingués. Voyez
RAMrNGUE.
COEUVRES, ( Gèog. mod.) petite ville dé France'
dans-'le Soiffonnois, avec titre de duché-pairie.
C O E X , f. m. ( Jurifpr. ) on appelle ainfi aux en*
virons de la Rochelle un tuyau d'e bois que l’on met
fous une chauffée, pour conduire Teau des marais:
falans. (A )
COFFILA, f. m. ( Comm.) poids d’ufage à Moka i
il pefe ou de livres. Voye^ le Trév. & U
dict. de Comm.
COFFINER, v . n. ( Jàrd. ) fe dit des oeillets Iorf-
qüe les feuilles fê frifent au lieu de demeurer étendues
: e’eft un défaut qui fe défigne par le verbe cof-
finer. 11' fe dit auffi dès fruits , lorfqu’ils changent Sc
deviennent mous.
CoFFlNER , v . n. fynonyme , en Meriuiferie &
Charpenterie, à fe cambrer, fe déjet ter, s'envoiler: il fe
dit d’ime pièce Ou planche de bois qui s’eft déformée
ou pàr le fé e , ou par l’humidité, ou par la charge.
COFFRE, f. m. (Hift. nat. Iehthiol.) poiffon qui-
fe trouve vers lés Antilles, qui eft couvert d’une
écaille mince, mais dure S i feche, dont on1 le tire
quand il eft cuit, comme un limaçon de fa coque,,
ou comme une tortue de fon éeàille; dont la forme
eft depuis la tête jufqii’à la queue en pyramide, à
trois races ; qui à la tête jointe au refte du corps ,
fans qu’on y diftingue aucune féparârion, S i dont
la chair eft blanche S i fueculente, aù fentiment du
pere Labat qui en fait mention au tome I I . dé fes
voyagés.
* C o FFre , (Layetier & Garnier-) efpece dé caille
de bois ordinairement couverte de cu ir, fermant
à cl‘é , & fervant à ferrer les hardès, linge, ère. Il y
a des coffres-forts faits de bois , mais fortifiés'de
plufieuirs bahdes & liens de fer. On trouvera dans
90$ Planches de Serrurerie } des exemples de coffres-
C O F
forts. Ce font les Laÿètiers qui font les coffres de
bois fimples, quion appelle plus exaflement coiffes.
Ce font les Gainiers qui font les coffres couverts. Ce
font les Serruriers qui font ou qui garniffent les fof-, .
fres-foris.
Le mot coffre s’employe de différentes maniérés ,
tant au fimple qu’au figuré. On dit de la cavité du
corps la plus grande qui contient le coeur, les poumons
, le foie, les inteftins, &c. le coffre du corps humain.
On dit auffi, les coffres du roi, le coffre d'un
clavecin , Sic• i . • -
C offre. ( Jurifprud.) Le don de coffre, hardes ,,
trouffeau, Si joyaux, eft un gain nuptial & de fur-
vie, que Ton ftipule ordinairement en Provence dans
les contrats de mariage, en faveur du furvivant des
futurs conjoints. La femme fe fait reconnoître par
le contrat fes coffres, hardes, &c. que Ton apprétie
à une certaine Comme, par exemple iooo liv. Après
cette reconnoiffance Si la conftitution de d o t , dans
laquelle on comprend ces coffres, Si après la donation
de furvie en argent que Ton ftipule en faveur
du furvivant, on ajoute que les coffres, hardes, &c.
enfemble le prix & reconnu d’iceux, appartiendront
au furvivant. Cette claufe , enfemble le prix & reconnu
d'iceux, opéré que la femme , en cas de fur-
v ie , reprend en entier fa dot & fes coffres en nature
, Si èncqre iooo livres en argent pour fes coffres :
au contraire, fi c ’eft le mari qui lurvit, il garde les
coffres Si hardes en nature ; il eft difpenfé de payer
aux héritiers de fa femme les iooo livres qu’elle
s’étoit fait reconnoître pour fes coffres, Si ne leur
rend que le furplus de la dot. Foye{ le traité des gains
nuptiaux & de furvie, ch. viij. pag. 8%. (A )
C o ffre, terme-de Fortification , logement creufé,
dans un foffé feç , de 15 ou 20 piés de large Si de 6
à 8 piés de profondeur, couvert de foliyeaux, qui
étant élevés de deux piés au-deffus du plan du fofl’é,
cette petite élévation fert de parapet ; elle a des ern-
braliires pour y placer des pièces d’artillerie, qui
défendent la place du baftion oppolé Si empêchent
le paffage du foffé. V oye^ FOSSÉ.
Le coffre différé encore de la traverfe Si de la galerie
, en ce que celle-ci fert aux affiégeans Si l’autre
aux affiégés. Voye^ Galerie & T raverse.
Les affiégés fe fer voient autrefois de ces fortes
de coffres pour repouffer les affiégeans au paffage
du foffé ; mais ils ne font plus en ufage à-préfent :
la caponiere du foffé répond exa&ement à l’objet
de ces fortes de travaux, qui fe plaçoient ordinairement
non vers le milieu de la courtine comme la
caponiere, mais à peu de diftance des flancs. Voye^
C aponiere.
On appelle quelquefois coffre, dans l’Artillerie,
la chambre ou le fourneau de la mine. Voy. C hambre
& Fourneau. (Q )
C offre de bo r d , (Marine.) c’eft un coffre de
bois dont Taffiette ou le fond eft plus large que le
h au t, Si oit les gens de marine mettent ce qu’ils
portent à la mer pour leur ufage.
Coffres à gargouffes, ce font des retranchemens de
planches faits dans les foutes aux poudres, où Ton
met les gargouffes après qu’on les a remplies.
Coffres à feu ; ce font des coffres que Ton remplit
de feux d’artifice & de matières combuftibles, qu’on
tient en quelque endroit, Si dont on fait ufage lorf-
que les ennemis ont fauté à l’abordage , pour les
repouffer Si faire périr ceux qui font expofés à leur
effet. Dicl. de Trévoux. (Z )
COFFRE, enterme de Blanchifferie de cire, c’eft une
machine de cuivre, longue de quatre piés, plus large
en-haut qu’en-bas , couverte d’une pafloire au
milieu-, Si de deux portes ou plateaux de fer-blanc
à chaque bout; le devant Si le derrière font garnis de
deux réchaux poftiçhes, Si fur un des bouts du coffre
Tome III.
C O G 603
eft un robinet d’où la cire tombe dans des éculons
pour être verfée fur les planches-à-pâin. Voy. Plan-'
çh e-à-pain & Éculons. Le coffre fert à contenir
la matière fondue pour la troifieme fois dans une
chaleur convenable pour être coulée en pains. Voy .
la fig. y. PI. de la Blanchifferie des cires.
C offres, ( Hydr. ) lont faits de bois, de tôle ou
de fer en forme de boîtes quarrées pour renfermer
lesfoupapes. - C rapaudines. (K )
C o ffr e, fe dit quelquefois en parlant du ventre
du cheval : on dit ce cheval à un grand coffre, pour
dire qu’il a bien du ventre ,.ou qu’il mange beau-,
coup : on dit d’un cheval qui a peu de force, que
c’eft un vrai coffre à avoine.
Le c o ffr e avoine dans une écurie, eft un coffre de
bois qui ferme à c lé, Si qui eft ordinairement féparé
en-dedans par une cldifon, afin de mettre l’àvoine
d’un côté & le fon de l’autre. Le délivreur a la clé
du coffre à avoine. Voye^ DÉLIVREUR.
COFFRET, diminutif de coffre. Voye^ C offre.
Les Confifeurs donnent ce nom à des boîtes de bois
de différentes grandeurs, dans lelquelles ils ferrent
leurs confitures : les Cordonniers , à un rond de
bois fur lequel, ils coupent les empeignes. Voye£
Souliers. Il en eft des coffrets ainfi que des coffres ;
l’ufage en eft prodigieux, & il y a peu d’artiftes ou
même de maitons où l’on ne s’en ferve à ferrer différentes
chofes qu’on ne v.eut pas laiffer expofées fous
la main du premier venu.
COFFRETIER, f. m. ( Art méch. ) on donne ce
nom à deux fortes d’artifans, les Malletiers Si les
Bahutiers. Les Coffréeiers-Malletiers, ce font ceux qui
en qualité de membresd’une communauté de ce nom
ont droit de faire Si1 de vendre des coffrés d’armée,
malles, valifes, &c. Les Bahutiers font ceux qui en
qualité de membres'd’une communauté 'de ce nom ,
(ont autorifés à faire Si vendre bahuts, caiffës, caf-
fettes, coffres de ménagé', &c. Voycç_ l'art. Bahu -
t ie R. Les premiers ne paroiffent point avoir formé
de èommunauté avant 1596. Ils ont-quatre jurés,
dopt deuxfortent de charge tous les ans. Il faut avoir
cinq ans d’apprentiffage Si cinq de compagnonage
pour parvenir à la maîtrife. On ne peut faire qu’un
apprenti à la fois. Ces artifans font fi bruyans, que
la police, qui veille au repos des citoyens, a voulu
qu’ils n’ouvriffent qu’à cinq heures Si qu’ils fermaf-
fent à huit.
COFIDEIUSSEUR, f. m. (Jurifprud.) eft celui
qui a répondu folidairement avec quelqu’autre de la
dette du principal obligé.
Suivant le droit romain, un des cofidejuffeurs qui
a payé feul toute la dette au créancier , fans prendre
de lui ceffion de fes droits & aftions, ne peut
agir contre fes cofidejuffeurs, quoiqu’il n’ait pas be-
foin de fubrogation pour répéter du principal obligé
ce qu’il a payé pour lui. Infiit. liv. I II. tit. xxj. § . 4.
Cette maxime du droit romain,s’obferve encore
en quelques provinces du droit écrit, comme l’ob-
ferve Catelan, liv. V . ch. Ijx.
Mais l’ufage commun eft que celui des cofidejuf-
Çeurs qui a payé fans s’être fait fubroger par le créancier
, peut néanmoins agir contre fes cofidejuffeurs
pour répéter de chacun d ’eux leur part Si portion.
Voye{ Ca u t io n & Fidejusseur. (A )
COGMORIA , f. f. mouffeline que les Anglois
apportent des Indes orientales. Voyeç le diclionn. du
Comm.
CO GNAC, (Gèog. mod.) ville de France dans
l’Angoumois, fur la Charente, fameufe par fes eaux-
de-vie. Long. ty. ig . 64. lat. 4S. 41. 4c).
CO GN A T , (Jurifprud.) fignifie en général celui
qui eft joint à quelqu’un par les liens de parenté ;
quelquefois il fignifie fingulierement celui qui eft
- - ‘........... ' G G g g ij