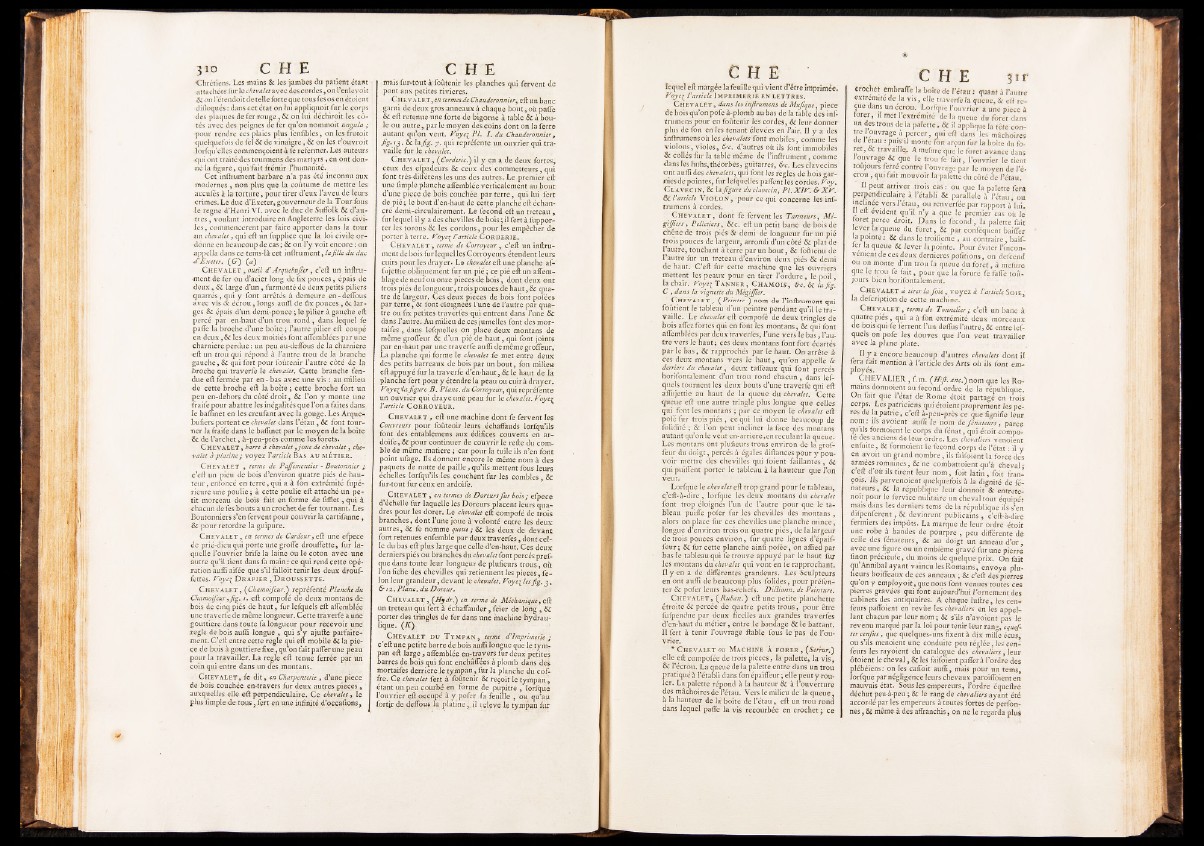
■ Chrétiens. Les mains & les jambes du patient étant
■ attachées fur le chevalet avec des cordes, on l’enle voit
■ 8c on I’étendoit de telle forte que tous fesos en étoient
difloqués : dans cet état on lui appliquoit fur le corps
des plaques de fer rouge, & on lui déchiroit les côtés
avec des peignes de fer qu’on nommoit unguia ;
■ pour rendre ces plaies plus fenfibles, on les frotoit
•quelquefois de fel-& de vinaigre, 8c on les r’ouvroit
îorfqu’elles commençoient à le refermer. Les auteurs
<qui ont traitédes tourmens des martyrs, en ont donné
la figure, qui fait frémir l’humanité.
Cet infiniment barbare n’a pas été inconnu aux
modernes , non plus que la coutume de mettre les
accufés à la torture, pour tirer d’eux l’aveu de leurs
crimes. Le duc d’Exeter, gouverneur de la Tour fous
-le régné d’Henri V I. avec le duc de Suffolk 8c d’autres
, voulant introduire en Angleterre les lois civiles
, commencèrent par faire apporter dans la tour
un chevalet, qui eft un fupplice que la loi civile ordonne
en beaucoup de cas ; 8c on l’y voit encore : on
appella dans ce tems-là cet inftrument, la fille du duc
d’Exeter. (6-) (a)
C h e v a l e t , outil d'Arquebufier, c’eft un inftru-
-ment de fer ou d’acier long de fix pouces, épais ;de
deux, 8c large d’un, furmonté de deux petits piliers
quarrés, qui y font arrêtés à demeure en - de.flqus
avec vis & écrou, longs aufli de fix pouces , & larges
8c épais d’un demi-pouce ; le pilier à gauche eft
percé par en-haut d’un trou rond, dans lequel fe
pafle la broche d’une boîte ; l’autre pilier eft coupé
en deux ,8c les deux moitiés font affemblées par une
charnière perdue : un peu au-deflous de la charnière
eft un trou qui répond à l’autre trou de la branche
gauche, & qui fort pour foûtenir l’autre côté de la
broche qui traverfe le chevalet. Cette branche fendue
eft fermée par en - bas avec une vis :;au milieu
de cette broche eft la boîte ; cette broche fort un
peu en-dehors du côté droit, 8c l’on y monte une
fraife pour abattre les inégalités que l’on a faites dans
le baffinet en les creufant avec la gouge. Les Arque-
bufiers portent ce chevalet dans l’étau, 8c font tourner
la fraife dans le baflinet par le moyen de la boîte
8c de l’archet, à-peu-près comme les forets.
CHEVALET, barre à chevalet,joue de chevalet, chevalet
à platine; v o y e z l’article B a s AU MÉTIER.
CHEVALET , terme de Paffementier - Boutonnier ;
c ’eft un pieu de bois d’environ quatre piés de hauteur,
enfoncé en terre, qui a à fon extrémité fupé-
rieure une poulie ; à cette poulie eft attaché un petit
morceau de bois fait en forme de fifflet, qui à
chacun de fes bouts a un crochet de fer tournant. Les
Boutonniers s’en fervent pour couvrir la cartifanne,
8c pour retordre la guipure.
C h e v a l e t , en termes de Cardeur, eft une e fp ece
de prié-dieu qu i p o rte u n e groffe d ro u ffe tte , fur la qu
elle l’o u v r ie r brife la la in e o u le co ton a v e c une
au tre qu’il tient dan s fa main : c e qu i rend c e tte o p é ra
tion aufli a ifée q u e s’il falloir ten ir le s d eux d ro uf-
fette s. Voye{ D r a p i e r , 'D r o u s s e t t e .
C h e v a l e t , (Chamoifeur.) repréfenté Planche du
Chamoifeur ,fig. i. eft compofé de deux montans de
bois de cinq piés de haut, fur lefquels eft affemblée
une traverfe de même longueur. Cette traverfe a une
gouttière dans toute fa longueur pour recevoir une
réglé de bois aufli longue , qui s’y ajufte parfaite- ,
ment. C ’eft entre cette réglé qui eft mobile & la pièce
de bois à gouttière fixe, qu’on fait paffer une peau
pour la travailler. La réglé eft tenue ferrée par un
coin qui entre dans un des montans.
C h e v a l e t , fe dit, en Charpenterie , d’une piece
de bois couchée en-travers fur deux autres pièces ,
auxquelles elle eft perpendiculaire. Ce chevalet, le
plus fimple de tous, fert en une infinité d’occafions,
mais fur-tout à;foûtenir les planches qui fervent de
pont aux petites rivières.
C hev alet, en termes de Chauderonnitr, eft un banc
garni de deux gros anneaux à chaque bout, où pafle
8c eft retenue une forte de bigorne à table & à boule
ou autre, par le moyen des coins dont on la ferre
autant qu’on veut. Voye{ PL l . du Chauderonnitr,
fig->3. 8c lafig. y. qui repréfente un ouvrier qui travaille
fur le chevalet.
C h e v a l e t , ( Corderie.) il y en a de deux fortes,
ceux des efpadeurs 8c ceux des commetteurs, qui
font très-différens les uns des autres. Le premier eft
une fimple planche affemblée verticalement au bout
d’une piece de bois couchée par terre, qui lui fert
de pié ; le bout d’en-haut de cette planche eft échan-
cré demi-circulairement. Le fécond eft un treteau ,
fur lequel il y a des chevilles de bois ; il fert à fuppor-
ter les torons 8c les cordons, pour les empêcher de
porter à terre, Voye^ l ’article C orderie.
C hev alet , terme de Corroyeur, c’eft un infiniment
de bois fur lequel les Corroyeurs étendent leurs
cuirs pour les drayer. Le chevalet eft une planche af-
fujettie obliquement fur un pié ; ce pié eft un affem-
blage de neuf ou onze pièces de bois, dont deux ont
trois piés de longueur, trois pouces de haut, 8c quatre
de largeur. Ces deux pièces de bois font pofées
par terre , & font éloignées l’une de l’autre par quatre
ou fix petites traverfes qui entrent dans l’une 8c
dans l’autre; Au milieu de ces jumelles font des mor-
taifes, dans lefquelles on place deux montans de
même groffeur 8c d’un pié de haut, qui font joints:
par en-haut par une traverfe aufli de même groffeur.'
La planche qui forme le chevalet fe met entre deux
des petits barreaux de bois par un bout, fon milieu
eft appuyé fur la traverfe d’en-haut, & le haut de la
planche fert pour y étendre la peau ou cuir à drayer.
Vyyei la figure B. Plane, du Corroyeur, qui repréfente
un ouvrier qui draye une peau fiir le chevalet. Voyeç
l’article CORROYEUR.
C hev alet , eft une machine dont fe fervent les
Couvreurs pour foûtenir leurs éçhaffauds lorfqu’ils
font des entablemens aux édifices couverts en ar-
doife, & pour continuer de couvrir le refte du comble
de même matière ; car pour la tuile ils n’en font
point ufage. Ils donnent encore le même nom à des
paquets de natte de paille , qu’ils mettent fous leurs
échelles lorfqu’ils les couchent fur les combles, 8c
fur-tout fur ceux en ardoife.
CHEVALET , en termes de Doreurs fur bois ; efpece
d’échelle fur laquelle les Doreurs placent leurs qua-
dres pour les dorer. Le chevalet eft compofé de trois
branches, dont l’une joue à volonté entre les deux
autres, 8c fe nomme queue; 8c les deux de devant
font retenues enfemble par deux traverfe?, dont celle
du bas eft plus large que celle d’en-haut. Ces deux
derniers piés ou branches du chevalet font percés pref-
que dans toute leur longueur de plufieurs trous, où
l’on fiche des chevilles qui retiennent les pièces, félon
leur grandeur, devant le chevalet. Voyei les fig. g .
& 12. Plane. du Doreur.
CHEVALET , (Hydr.) en terme de Mechanique, eft
un treteau qui fert à échaffauder, feier de long , 8c
porter des tringles de fer dans une machine hydraulique.
(/£)
CHEVALET DU T ym p a n , terme d’imprimerie
c ’eft une petite barre de bois aufli longue que le tymr
pan eft large, affemblée en-travers lur deux petite?
barres de bois qui font enchâffées à plomb dans des
mortaifes derrière le tympan, fur la planche du coffre.
Ce chevalet fert à foûtenir & reçoit le tympan,
étant un peii courbé en forme de pupitre , lorfque
l’ouvrier eft .occupé à y pofer fa feuille , ou qu’au
fortir de deflous la platine il releve le tympan fur
a*
lequel eft margée la feuille qui vient d’être imprimée.
Voye^ ^artlc^ Imprimerie en le ttres.
C h e v al e t , dans les infirumens de Mujique, piece
de bois qu’on pofe à-plomb au bas de la table des inf-
îrumens pour en foûtenir les cordes, & leur donner
plus de fon en les tenant élevées en l’air. Il y a des
inftrumensoùles chevalets font mobiles, comme les
violons, violes, &c. d’autres où ils font immobiles
& collés fur la table même de l’inftrument, comme
dans les luths, théorbes, guirarres, &c. Les clavecins
ont aufli des chevalets, qui font les règles de bois garnies
de pointes, fur lefquelles paflènt les cordes. Voy.
C l a v e c in , 8c la figure du clavecin, PI. XIV. & X V .
&.Varticle V io lo n , -pour ce qui concerne les inf-
trumens à cordes.
C h e v a l e t , dont fe fervent les Tanneurs, Mé-
giffiers , Pelletiers, & c . eft un petit banc de bois de
chêne de trois piés & demi de longueur fur un pié
trois pouces de largeur, arrondi d’un côté 8c plat de
l’autre, touchant à terre par un bout, 8c foûieiiu de
l ’autre fur un treteau d’environ deux piés 8c demi
de haut. C ’eft fur cette machine que les ouvriers
mettent les peaux pour en tirer l’ordure, le p o il,
la chair. Voye{ T anner , C h am o is , &c. 8c la fig.
C , dans la vignette du Mégi [fier.
C hev alet , ( Peintre. ) nom de l’inftrument qui
foûtient le tableau d’un peintre pendant qu’il le travaille.
Le chevalet eft compofé de deux tringles de
bois allez fortes qui en font les montans, 8c qui font
affemblées par deux traverfes, l’une vers le bas, l’autre
vers le haut ; ces deux montans font fort écartés
par le bas, & rapprochés par le haut. On arrête à
ces deux montans vers le haut, qu’on appelle le
derrière du chevalet, deux ta fléaux qui font percés
horifontalement d’un trou rond chacun , dans lefquels
tournent les deux bouts d’une traverfe qui eft
afiujettie au haut de la queue du chevalet. Cette
queue eft une autre tringle plus longue que celles
qui font les montans ; par ce moyen le chevalet eft
pofé fur trois piés , ce qui lui donne beaucoup de
folidité ; & l’on peut incliner la face des montans
autant qu’on le veut en-arriere,en reculant la queue.
Les montans ont plufieurs trous environ de la groffeur
du doigt, percés à égales diftances pour y pouvoir
mettre des chevilles qui foient faillantes, 8c
qui puiflent porter le tableau à la hauteur que l’on
veut.
Lorfque le chevalet eft trop grand pour le tableau,
c’eft-à-dire , lorfque les deux montans du chevalet
font trop éloignés l’un de l’autre pour que le tableau
puifle pofer fur les chevilles des montans ,
alors on place fur ces chevilles une planche mince,
longue d’environ trois ou quatre piés, de la largeur
de trois pouces environ, fur quatre lignes d’épaif-
feur ; & fur cette planche ainfi pofée, on aflied par
bas le tableau qui fe trouve appuyé par le haut fur
les montans du chevalet qui vont en le rapprochant.
Il y en a de différentes grandeurs. Les Sculpteurs
en ont aufli de beaucoup plus folides, pour préfen-
ter 8c pofer leurs bas-reliefs. Dictionn. de Peinture.
C h e v al e t , ( Ruban.) eft une petite planchette
étroite 8c percée de quatre petits trous, pour être
fufpendue par deux ficelles aux grandes traverfes
d’en-haut du métier, entre le bandage & le battant.
Il fert à tenir l’ouvrage ftable fous le pas de l’ouvrier.
* C hevalet ou Machine à forer , (Serrur.)
elle eft compofée de trois pièces, la palette, la vis,
& l’écrou. La queue de la palette entre dans un trou
pratiqué à l’établi dans fon épaiffeur ; elle peut y rouler.
La palette répond à la hauteur & à l’ouverture
des mâchoires de l’étau. Vers le milieu de la queue,
a la hauteur de là boîte de l’ étau, eft un trou rond
dans lequel pafle la vis recourbée en crochet ; ce
Crochet embrafle la boîte de l’étau : quant à l’autre
extrémité de la y is , elle traverfe la queue, & eft reçue
dans un ecrou. Lorfque l’ouvrier a une piece à
forer, il met l’extrémité de là queue du foret dans
un des trous de la palette, & il applique la tête con-
tre l ouvrage a percer , qui eft dans les mâchoires
de 1 etau : purs'il monte fon arçon fur la boîte du foret
, 8c travaillq. A mefure que le foret avance dans
louyrage & que le trou fe fait, l’ouvrier le tient
toujours fetré contre l’ouvrage par le moyen de l’écrou
, qui fait mouvoir la palette du côté de l’étau.
Il peut arriver trois cas : ou que la palette fera
perpendiculaire à l’établi & parallèle à l’étau, ou
inclinée vers l ’étau, ou renverfée par rapport à’ lui.
II eft évident qu’il n’y a que le premier cas où le
foret perce droit. Dans le fécond, la palette fait
lever la queue du foret, 8c par conféquent bailler
la pointe ; & dans le troifieme , au contraire, baif-
fer la queue & lever la pointe. Pour éviter l'inconvénient
de ces deux dernieres polirions, on defeend
ou ôn monte d’un trou la queue du foret, à mefure
que le trou fe fait, pour que la forure fe faffe toujours
bien horifontalement.
C hev alet à tirer la fo ie , voyez à l ’article Soie,
la defeription de cette machine.
C hev alet , terme de Tonnelier ; c’eft un banc à
quatre p iés, qui a à fon extrémité deux morceaux
de bois qui le ferrent l’un deffus l’autre, 8c entre lefquels
on pofe les douves que l’on veut travailler
avec la plane plate.
Il y a encore beaucoup d’autres chevalets dont il
fera fait mention à l ’article des Arts où ils font employés.
CHEVALIER , f.m. Çmjl.anc.') nom que les Romains
donnoient au fécond ordre de la république.
On fait que l’état de Rome étoit partagé en trois
corps. Les patriciens, qui étoient proprement les pe-
res de la patrie, c’eft à-peu-près ce que lignifie leur
nom; ils avoient aufli le nom defenateurs, parce
qu’ils formoient le corps du fénat, qui étoit compote
des anciens de leur ordre. Les chevaliers venoient
enfuite , 8c formoient le fécond corps de l’état : il y-
en avoit un grand nombre, ils faifoient la force des
armées romaines, 8c ne combatroient qu’à cheval •
c’eft d’où ils tirent leur nom, foit latin , foit français.
Ils parvenaient quelquefois à la dignité de fé-
nateurs, 8c la république leur donnoit & entrete-
noir pour le fervice militaire un cheval tout équipé:
mais dans les derniers tems de la république ils s’en
dilpenferent, & devinrent publicains , c’eft-à-dire
fermiers des impôts. La marque de leur ordre étoit
une robe à bandes de pourpre , peu différente de
celle des fénateurs, 8c au doigt un anneau d’o r ,
avec une figure ou un emblème gravé fur une pierre
finon précieufe, du moins de quelque prix. On fait
qu Annibal ayant vaincu les Romains, envoya plufieurs
boiffeaux de, ces anneaux ; 8c c’eft des pierres
qu on y employoit,quenous font venues toutes ces
pierres gravées qui font aujourd’hui l ’ornement des
cabinets des antiquaires. A chaque luftre, les cen-
feurs paffoient en revûe les chevaliers en les appelan
t chacun par leur nom ; & s’ils n’ayoient pas le
revenu marqué par la loi pour tenir leur ran<*, equef-
ter cenfus, que quelques-uns fixent à dix mille écus,
ou s’ils menoient une conduite peu réglée, les cen-
feurs les rayoient du catalogue des chevaliers, leur
ôtoient le cheval, & les faifoient paffer à l’ordre des
plébéiens : on les caffoit aufli, mais pour un tems,
lorfque par négligence leurs chevaux paroifloient en
mauvais état. Sous les empereurs, l’ordre équeftre
déchut peu-à-peu ; & le rang de chevaliers ayant été
accordé par les empereurs à toutes fortes de perfon-
hes, 8c même à des affranchis, on ne le regarda plus