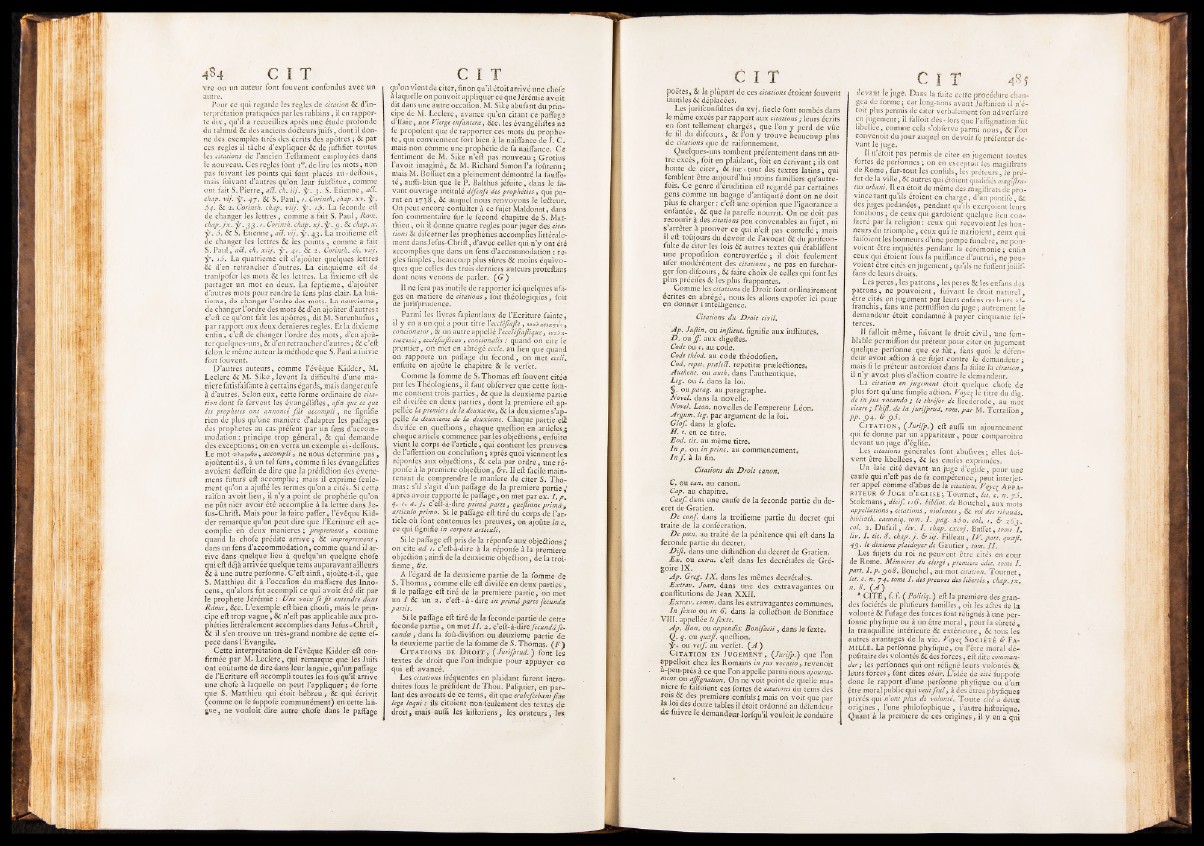
vre ou un auteur font Couvent confondus avec un
autre.
Pour ce qui regarde les réglés -de citation & d’in-
tcrprétation pratiquées par les rabbins, il en rapporte
d ix, qu’il a recueillies après une étude profonde
du talmud &c des anciens doâeurs juifs, dont il donne
des exemples tirés des écrits des apôtres ; & par
ces réglés il tâche d’expliquer de juftifier toutes
les citations de l’ancien Teftament employées dans
le nouveau. Ces réglés font i°. de lire les mots, non
pas fuivant les points qui font placés au-défions,
mais fuivant d’autres qu’on leur fubftitue, comme
ont fait S. Pierre, acl. ch. iij. jp. 3. S. Etienne, acl.
chap. vij. Ÿ - 47. & S. Paul, 1. Corinth. chap. xv. ÿ .
54. & z , Corinth. chap. viij. ÿ . iâ. La fécondé eft
de changer les lettres, comme a fait S. Paul, Rom.
chap.jx. j j . 33 . 1. Corinth. chap. x j . ÿ . C). & chap. x.
■ ÿ. 5. & S. Etienne, acl. vij. jk. 43. La troifieme eft
de changer les lettres & les points , comme a fait
S. Paul, acl. ch. xiij. j f . 41. & z . Corinth. ch. viij.
j.r. i j . La quatrième eft d’ajouter quelques lettres
& d’en retrancher d’autres. La cinquième eft de
tranfpofer les mots & les lettres. La fixieme eft de
partager un mot en deux. La feptieme, d’ajouter
d’autres mots pour rendre le fens plus clair. La huitième,
de changer l’ordre des mots. La neuvième,
de changer l’ordre des mots & d’en ajoûter d’autres :
e’eft ce qu’ont fait les apôtres, dit M. Surenhufius,.
par rapport aux deux dernieres réglés. Et la dixième
enfin, c’eft de changer l’ordre des mots, d’en a'joû-
ter quelques-uns, & d’en retrancher d’autres ; & c’eft
félon le même auteur la méthode que S. Paul a fuivie
fort fouvent.
D ’autres auteurs, comme l’évêque Kidder, M.
Leclerc & M. S ik e , lèvent la difficulté d’une maniè
re fatisfaifante à certains égards, mais.dangereufe
à d’autres. Selon eux, cette forme ordinaire de citation
dont fe fervent les évangéliftes, afin que ce que
les prophètes ont annonce fu t accompli, ne lignifie
rien de plus qu’une maniéré d’adapter les paffages
des prophètes au cas préfent par un fens d’accommodation:
principe trop général, & qui demande
des exceptions ; on en verra un exemple ci-deffous.
Le mot <srX«pMÔ», accompli, ne nous détermine pas ,
ajoutent-ils, à un tel fens, comme li les évangéliftes
avoient delfein de dire que la prédi&ion des évene-
mens futurs eft accomplie ; mais il exprime feulement
qu’on a àjufté les termes qu’on a cités. Si cette
raifon avoit lieu, il n’y a point de prophétie qu’on
ne pût nier avoir été accomplie à la lettre dans Je-
fus-Chrift. Mais pour la faire paffer, l’évêque Kidder
remarque qu’on peut dire que l’Ecriture eft accomplie
en deux maniérés ; proprement, comme
quand la chofe prédite arrive ; & improprement,
dans un fens d’accommodation, comme quand il arrive
dans quelque lieu à quelqu’un quelque chofe
qui eft déjà arrivée quelque tems auparavant ailleurs
& à une autre perfonne. C ’eft ainfi, ajoûte-t-il, que
S. Matthieu dit à l’occafion du maffacre des Inno-
cens , qu’alors fut accompli ce qui avoit été dit par
le prophète Jérémie : .Une voix fe fit entendre dans
Rdma , & c . L’exemple eft bien phoifi, mais le principe
eft trop vague, & n’eft pas applicable aux prophéties
littéralement accomplies dans Jefus-Chrift,
& il s’en trouve un très-grand nombre de cette ef-
pece dans l’Evangile.
Cette interprétation de l’évêque Kidder eft confirmée
par M. Leclerc, qui remarque que les Juifs
ont coutume de dire dans leur langue, qu’un paffage
de l’Ecriture eft accompli toutes les fois qu’il arrive
une chofe à laquelle on peut l’appliquer ; de forte
ue S. Matthieu qui étoit hébreu, & qui écrivit
comme on le fuppofe communément) en cette langue,
ne vouloit dire autre chofe dans le palfage
qufon vient de citer, linon qu’il étoit arrivé une chofe
a laquelle on pouvoit appliquer ce que Jérémie avoit
dit dans une autre occafion. M. Sike abufant du principe
de M. Leclerc, avance qu’en citant ce palfage
d’ifaïe , une Vierge enfantera, & c . les évangéliftes ne
fe propofent que de rapporter ces mots du prophète
, qui conviennent fort bien à la naiflànce de J. C.
mais non comme une prophétie de fa nailfance. Ce
fentiment de M. Sike n’eft pas nouveau ; Grotius
l’a voit imaginé, & M. Richard Simon l’a foûtenu;
mais M. Bofluet en a pleinement démontré la fauffe-
té , auffi-bien que le P. Balthus jéfuite, dans le fa-
vant ouvrage intitulé défenfe des prophéties, qui parut
en 173 8 , & auquel nous renvoyons le leêleur.
On peut encore confulter à ce fujet Maldonat, dans
fon commentaire fur le fécond chapitre de S. Matthieu
, où il donne quatre réglés pour juger des cita*
tions & difeerner les prophéties accomplies littéralement
dans Jefus-Chrift, d’avec celles qui n’y ont été
accomplies que dans un fens d’accommodation : réglés
fimples, beaucoup plus sûres & moins équivoques
que celles des trois derniers auteurs proteftans
dont nous venons de parler. (G )
Il ne fera pas inutile de rapporter ici quelques litiges
en matière de citations, loit théologiques, foit
de jurifprudence.
Parmi les livres fapientiaux de l’Ecriture fainte,
il y en a un qui a pour titre l'ecclèjîajle, sxxPim/aç-iiç,
concionator, & un autre appellé ¥ eccléjiafiique , txx*»-
iricLçixpç, tcclejîajlicus , concionalis : quand on cite le
premier, o,n met en abrégé eccle. au lieu que quand
on rapporte un palfage du fécond, on met ecçlif
enfuite on ajoute le chapitre & le verfet.
Comme la fomme de S. Thomas eft fouvent citée
par les Théologiens, il faut obferver que cette fomme
contient trois parties, & que la deuxieme partie
eft divifée en deux parties, dont la première eft ap-
pellée la première de la deuxieme, & la deuxieme s’appelle
la deuxieme de la deuxieme. Chaque partie eft
divifée en queftions, chaque queftion en articles*
chaque article commence par les objeâions, enfuite
vient le corps de l’article, qui contient les preuves
de l’afferlion ou conclufion ; après quoi viennent les
réponfes aux obje&ions, & cela par ordre, une ré-
ponfe à la première objection, &c. Il eft facile maintenant
de comprendre le maniéré de citer S. Thomas:
s’il s’agit d’un palfage de la première partie ,'
après avoir rapporté le palfage, on met par ex. I.p+
q. 1. a. j . c’eft-à-dire prima parte , quefiione prima g
articulo primo. Si le palfage eft tiré du corps de l’article
où font contenues les preuves, on ajoûte in c,
ce qui lignifie in corpore articulé.
Si le palfage eft pris de la réponfe aux objeftions ;
on cite ad 1. c’eft-à-dire à la réponfe à la première
objeûion ; ainfi de la deuxieme objeélion, de la troifieme,
&c.
A l’égard de la deuxieme partie de la fomme de
S. Thomas, comme elle eft divifée en deux parties,
fi le palfage eft tiré de la première partie , on met
un ƒ & un z . c’eft - à - dire in prima parte fecundx
partis.
Si le paffage eft tiré de la fécondé partie de cette
fécondé partie, on met II. z . c’eft-à-dlféfecundâfe-
cundce, dans la foû-divifion ou deuxieme partie de
la deuxieme partie de la fomme de S. Thomas. ( F j
C it a t io n s de D r o i t , ( Jurifprud. ) font les
textes de droit que l’on indique pour appuyer ce
qui eft avancé.
Les citations fréquentes en plaidant furent introduites
fous le préfident de Thou. Pafquier, en parlant
des avocats de ce tems, dit que erubefeebantfine
lege loqui : ils citoient non-feulement des iextes de
droit, mais auffi les hiftoriens, les orateurs, les
poètes, & la plupart de ces citations étoient fouvent
inutiles &c déplacées.
Les jurifconfultes du xvj. fiecle font tombés dans
le même excès par rapport aux citations; leurs écrits
en font tellement charges, que l’on y perd de vûe
le fil du difeours, & l’on y trouve beaucoup plus
de citations que de raifonnement.
Quelques-uns tombent préfentement dans un autre
exces, foit en plaidant , foit en écrivant ; ils ont
honte d éb iter, & fur-tout des textes latins, qui
femblent etre aujourd’hui moins familiers qu’autre-
fois. Ce genre d’érudition eft regardé par certaines
gens comme un bagage d’antiquité dont on ne doit
plus fe charger : c’eft une opinion que l’ignorance a
enfantee, & que la pareffe nourrit. On ne doit pas
recourir à des citations peu convenables au fujet, ni
s’arrêter à prouver ce qui n’eft pas contefté ; mais
il eft toujours du devoir de l’avocat & du jurifeon-
fulte de citer les lois & autres textes qui établiffent
une proportion controverfée ; il doit feulement
ufer modérément des citations, ne pas en furchar-
ger fon difeours, ôc faire choix de celles qui font les
plus précifes & les plus frappantes.
Comme les citations de Droit font ordinairement
écrites en abrégé , nous les allons expofer ici pour
en donner l’intelligence*
Citations du Droit civil
Ap. Juflin. ou injlitut. fignifie aux inftitutes.
D . ou ff. aux digeftes*
Code ou c. au code.
Code théod. au Code théodofieri.
Cod. repet. prçelect. repetitæ præleftioiles»
Authent. ou auth. dans l’authentique*
Leg. ôu l. dans la loi*
§• o u parag. au.paragraphe.
Novel. dans la novelle.
Novel. Leon, novelles de l’empereur Léon»
Argum. leg. par argument de la loi.
G lof. dans la glofe*
H. t. en ce titre.
Eod. tit. au même titré*
In p, ou in princ. au commencement*
In f . à la fin.
Citations du Droit canon.
C. où can. au canon»
Cap. au chapitre.
Cauf. dans une caufe de la fécondé partie du decret
de Gratien.
De conf. dans la trôifieme partie du decret qui
traite de la confécration.
De poen. au traité de la pénitence qui eft dans la
fécondé partie du decret.
Dijl. dans une diftin&ion du decret de Gratien.
E x . ou extra, c’eft dans les décrétales de Grégoire
IX.
Ap. Greg. IX . dans les mêmes décrétales.
Extrav. Joan. dans une des extravagantes ou
conftitutions de Jean XXII.
Extrav. comm. dans les extravagantes communes.
In fexto ou in C. dans la colle&ion de Boniface
VIII. appellée le fexte.
Ap. Bon. ou appendisc Bonifacii , dans le fexte»
Q. q. ou quoefl. queftion.
ilr.- ou verf. au verfet. (A )
C it a t io n en Ju g em en t , (Jurifp.) que l’on
appelloit chez les Romains in ju s vocatio, revenoit
à-peu-près à ce que l’on appelle parmi nous ajournement
ou affignation. On ne voit point de quelle maniéré
fe faifoient ces fortes de citations du tems des
rois & des premiers confuls ; mais on voit que par
la loi des douze tables il étoit ordonné au défendeur
de fuiyre le demandeur lorfqu’il vouloit le conduire
devant îe pigé. Dans la fuite cette procédure changea
de forme; car long-tems avant Juftinien il n’é-
toit plus permis de citer verbalement fon adverfairc
en jugement; il falloir dès - lors que l’affignation fût
libellée, comme cela s’obferve parmi nous, & l’on
convenoit du jour auquel on devoit fe préfenter devant
le juge.
Il n etoit pas permis de citer en jugement toutes
fortes de perfonnes ; on en exceptoit les magiftrats
de Rome, fur-tout les confuls, les préteurs, le préfet
de la v ille, & autres qui étoient qualifiés magiftra-
tus urbani. Il en étoit de même des magiftrats de province
tant qu’ils étoient en charge, d’un pontife ô£
des juges pedanées, pendant qu’ils exerçoient leurs
fondions ; de ceux qui gardoient quelque lieu con-
facré par la religion : ceux qui recevoient les honneurs
du triomphe, ceux qui fe marioient, ceux qui
faifoient les honneurs d’une pompe funebre, ne pou-
voient être inquiétés pendant la cérémonie ; enfin
ceux qui etoient fous la puiffance d’autrui, ne pou-
voient être cités en jugement, qu’ils ne fuffent joüifi
fans de leurs droits.
Les peres, les patrons, les peres & les enfans des
patrons, ne pouvoient, fuivant le droit naturel,
être cités en jugement par leurs enfans ou leurs affranchis,
fans une permiffion du juge ; autrement le
' demandeur étoit condamné à payer cinquante fef-
terces.
II falloir même j fuivant le droit c iv il, une fem-
blable permiffion du préteur polir citer en jugement
quelque perfonne que ce fût, fans quoi le défendeur
avoit adion à ce fujet contre le demandeur ;
mais fi le préteur autorifoit dans la fuite la citation ,
il n’y avoit plus d’a&ion contre le demandeur.
La citation en jugement étoit quelque chofe de
plus fort qu’une fimple a&ion. Voye[ le titre du dig.
de in ju s vocando ; le thréfor de Brederode, au mot
c'uare ; Vhifl. de la jurifprud. rom. par M. Terraffon,
PP• 9 4 - & 9 3 -
C i t a t i o n , Çlurijp.') eft auffi uh ajournement
qui fe donne par un appariteur, pour comparoître
• devant un juge d’églilè.
Les citations générales font abufives; elles doivent
être libellées, & les caufes exprimées.
Un laïc cité devant un .juge d’églife , pour une
caufe qui n eft pas de fa compétence, peut mtenet-
ter appel comme d’abus de la citatioh. Vcryeç A p p a r
i t e u r & Ju g e d ’ e g l i s e ; Tournet, let. c. n. jS.
Stokmans, décif. 116. bibliot. de Bouchel, aux mots
appellations , citations , Violences , & roi des ribauds.
biblioth. canoniq. torn. I . pag. zô o . col. 1. & zÇ z .
col. z . Dufail, liv. I. chap. exevj. Baffet, tome I .
liv. I. tit. 8. chap. j . & iij. Filleau, IV. part, quoefi.
49' k dixième plaidoyer de Gautier, tom. I I .
Les fujets du roi ne peuvent être cités en cour
de Rome. Mémoires du clergé, première édit, tome I.
part. I.p. <)o8. Bouchel, au mot citation. Tournet,
let. c. n. 74. tome I . des preuves des libertés , chap.jx.
n.’R. { A )
* C IT É , f. f» ( Politiq. ) eft la première des grandes
fociétés de plufieurs familles, où les afles de la
volonté & l’ufage des forces font réfignés à une perfonne
phyfique ou à un être moral, pour la sûreté ,
la tranquillité intérieure & extérieure, & tous les
autres avantages de la vie. Voye^ S o c i é t é & F a m
i l l e . La perfonne phyfique, ou l’être moral dé-
pofitaire des volontés & des forces, eft dite commander
; les perfonnes qui ont réfigné leurs volontés &
leurs forces, font dites obéir. L ’idée de1 cité fuppofe
donc le rapport d’une perfonne phyfique ou d’un
être moral public qui veut feul, à des êtres phyfiques
privés qui n ont plus de volonté. Toute cité a deux
origines , l’une philofophique , l’autre hiftorique»
Quant à la première de ces origines, il y en a qui