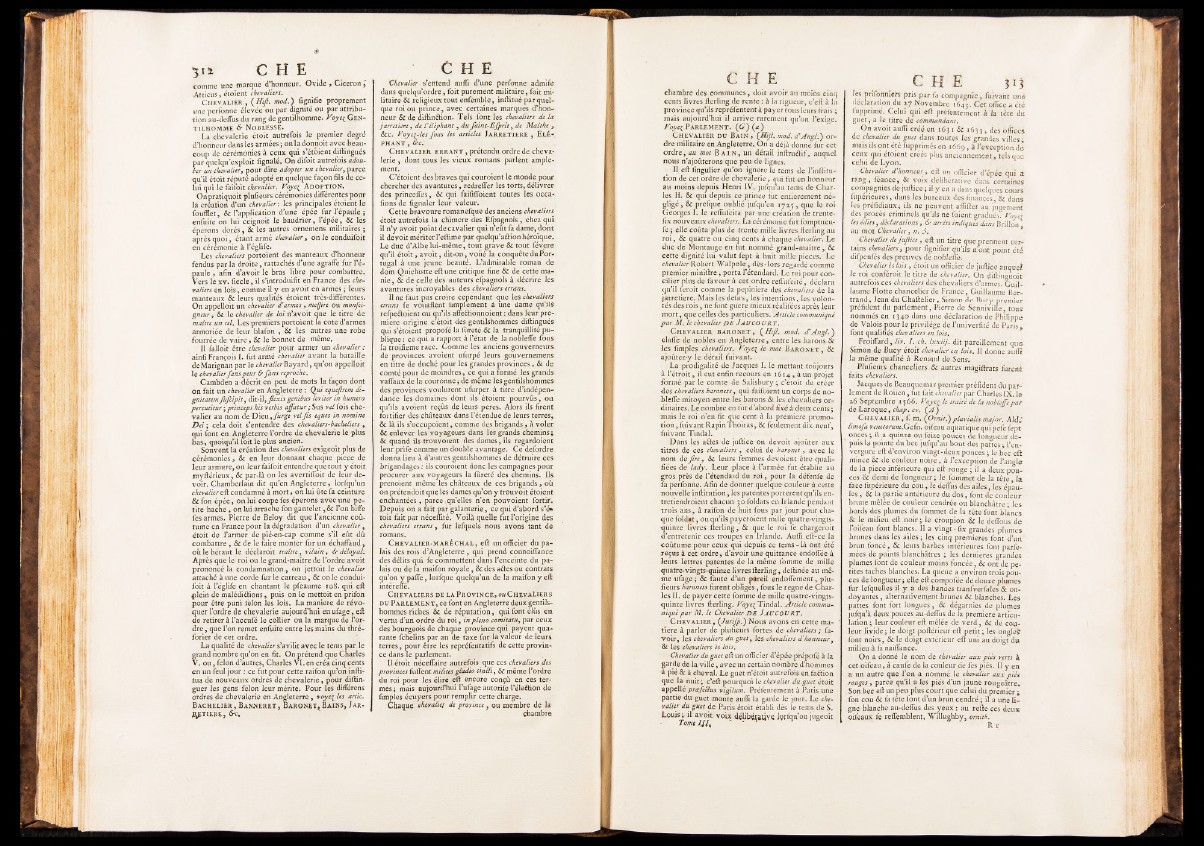
“51 i C H E
•comme une marque d’honneur. O v id e , Cicéron
Atticus, étoient chevaliers.
Ch e v a l ier , {H'fi. mod.) lignifie proprement
une perfonne élevée ou par dignité ou par attribution
au- deiïus du rang de gentilhomme. Voye^ G entilhom
m e & Noblesse. i
La chevalerie étoit autrefois le premier degré
d’honneur dans les armées ; on la donnoit avec beaucoup
de cérémonies à ceux qui s’étoient diftingués
par quelqu’exploit lignale. On difoit autrefois adouber
un chevalier, pour dire adopter un chevalier, parce
qu’il étoit réputé adopté en quelque façon fils de celui
qui le failoit chevalier. Voye{ ADOPTION.
Onpratiquoit plufieurs cérémonies différentes pour
la création d’un chevalier : les principales etoient le
foulïlet, & l’application d’une épée fur l’épaule ;
enfuite on lui ceignoit le baudrier, l’épée, & les
éperons dorés, & les autres ornemens militaires ;
après quoi, étant armé chevalier, on le conduifoit
en cérémonie à l’églife.
Les chevaliers portoient des manteaux d’honneur
fendus par la droite, rattachés d’une agraffe fur l’épaule
, afin d’avoir le bras libre pour combattre.
Vers le xv. fiecle, il s'introduit en France des chevaliers
en lois, comme il y en avoit en armes ; leurs
manteaux & leurs qualités étoient très-différentes.
On appelloit un chevalier d'armes, meflire ou monfei-
gneur, ôt le chevalier de loi n’avoit que le titre de
maître un tel. Les premiers portoient la cote d’armes
armoriée de leur blafon , & les autres une robe
fourrée de vaire, & le bonnet de même.
Il failoit être chevalier pour armer un chevalier :
ainfi François I. fut armé chevalier avant la bataille
deMarignan par le chevalier Bayard, qu’on appelloit
le chevalier fans peur & fans reproche.
Cambden a décrit en peu de mots la façon dont
on fait un chevalier en Angleterre : Qui equeftrem di-
gnitatem fufcipit, dit-il, fiexis genibus leviter in humero
percutitur ; princeps kis verbis ajfatur ; Sus vel fois chevalier
au nom de Dieu,furge velfis eques in nomine
Dei ; cela doit s’entendre des chevaliers-bacheliers ,
qui font en Angleterre l’ordre de chevalerie le plus
bas, quoiqu’il foit le plus ancien.
Souvent la création des chevaliers exigeoit plus de
cérémonies , & en leur donnant chaque piece de
leur armure, on leur faifoit entendre que tout y étoit
myftérieux, & par-là on les avertiffoit de leur devoir.
Chamberlain dit qu’en Angleterre, lorfqu’un
chevalier eft condamné à m ort, on lui ôte fa ceinture
& fon épée, on lui coupe fes éperons avec une petite
hache , on lui arrache fon gantelet, & l’on biffe
fes armes. Pierre de Beloy dit que l’ancienne coutume
en France pour la dégradation d’un chevalier,
étoit de l’armer de pié-en-cap comme s’il eût dû
combattre , & de le faire monter fur un échaffaud,
où le héraut le déclaroit traître, vilain, & déloyal'.
Après que le roi ou le grand-maître de l’ordre avoit
prononcé la condamnation , on jettoit le chevalier
attaché à une corde fur le carreau, & on le conduifoit
à l’églife en chantant le pfeaume to8. qui eft
plein de malédictions, puis on le mettoit en prifon
pour être puni félon les lois. La maniéré, de révoquer
l’ordre de chevalerie aujourd’hui en ufage, eft
de retirer à l’accufé le collier ou la marque de l’ordre
, que l’on remet enfuite entre les mains du thré-
forier de cet ordre.
La qualité de chevalier s’avilit avec le tems par le
grand nombre qu’on en fit. On prétend que Charles
V . ou , félon d’autres, Charles V I. en créa cinq cents
en un feul jour : ce fut pour cette raifon qu’on infti-
tua de nouveaux ordres de chevalerie, pour diftin-
guer les gens félon leur mérite. Pour les différens
ordres de chevalerie en Angleterre, voye^ les artic.
Bache lier, Banneret, Baronet,B ains, JarftJîTIERE,
&c.
C H E
Chevalier s’entend aufli d’une perforine admife
dans quelqu’ordre, foit purement militaire, foit mi*
litaire & religieux tout enfemble, inftitué par quelque
roi ou prince, avec certaines marques d’honneur
& de diftinftion. Tels font les chevaliers de la
jarretière , de Véléphant , du faint-Efprit, de Malthe ,
&c. Voyelles fous les articles Jarretière , ElÉ-,
PHANT, &c.
C hevalier errant , prétendu ordre de cheva*
ler ie , dont tous les vieux romans parlent amplement.
C ’étoient des braves qui couroient le monde pour
chercher des avantures, redreffer les torts, délivrer
des princeffes, & qui faififfoient toutes les occa-
fions de fignaler leur valeur.
Cette bravoure romanefque des anciens chevaliers
étoit autrefois la chimere des Efpagnols , chez qui
il n’y avoit point de cavalier qui n’eût fa dame, dont
il devoit mériter i’eftime par quelqu’aClion héroïque.
Le duc d’Albe lui-même, tout grave & tout févere
qu’il étoit, a vo it, dit-on, voilé la conquête du Portugal
à une jeune beauté. L’admirable roman de
dom Quichotte eft une critique fine & de cette manie,
& de celle des auteurs efpagnols à décrire les
avantures incroyables des chevaliers errans.
Il ne faut pas croire cependant que les chevaliers
errans fe voiiaffent fimplement à une dame qu’ils
refpeâoient ou qu’ ils affe&ionnoient : dans leur première
origine c’étoit des gentilshommes diftingués
qui s’étoient propofé la fûreté & la tranquillité publique
: ce qui a rapport à l’état de la nobleffe fous
la troifieme race. Comme les anciens gouverneurs
de provinces avoient ufurpé leurs gouvernemens
en titre de duché pour les grandes provinces, & de
comté pour de moindres, ce qui a formé les grands
vaflaux de la couronne ; de même les gentilshommes
des provinces voulurent ufurper à titre d’indépendance
les domaines dont ils étoient pourvûs, ou
qu’ils avoient reçûs -de leurs peres. Alors ils firent
fortifier des châteaux dans l’étendue de leurs terres,
& là ils s’occupoient, comme des brigands , à voler
& enlever les voyageurs dans les grands chemins ;
& quand ils trouvoient des dames, ils regardoient
leur prife comme un double avantage. Ce defordre
donna lieu à d’autres gentilshommes de détruire ces
brigandages : ils couroient donc les campagnes pour
procurer aux voyageurs la fûreté des chemins. Ils
prenoient même les châteaux de ces brigands , où
on prétendoit que les dames qu’on y trouvoit étoient
enchantées , parce .qu’elles n’en pouvoient fortif.
Depuis on a fait par galanterie, ce qui d’abord s’é»
toit fait par néceflité. Voilà quelle fut l’origine des
chevaliers errans , fur lefquels nous avons tant de
romans.
C hevalier-m a r é c h a l , eft un officier du palais
des rois d’Angleterre , qui prend connoiffance
des délits qui fe commettent dans l’enceinte du palais
ou de la maifon royale, & des aftes ou contrats
qu’on y paffe, lorfque quelqu’un de la maifon y eft
intéreffé.
C hevaliers de la Pro v in ce , okC hevaliers
du Parlem en t , ce font en Angleterre deux gentilshommes
riches & de réputation, qui font elûs en
vertu d’un ordre du ro i, in pleno comitatu, par ceux
des bourgeois de chaque province qui payent quarante
fehelins par an de taxe fur la valeur de leurs
terres, pour être les repréfentatifs de cette province
dans le parlement.
Il étoit néceffaire autrefois que ces chevaliers des
provinces fuffent milites gladio cincli, & même l’ordre
du roi pour les élire eft encore conçû en ces termes
; mais aujourd’hui l’ufage autorife l’éleftion de
fimples écuyers pour remplir cette charge.
Chaque chevalier de province, ou membre de la
chambre
chambre des communes, doit avoir au moins cinq
cents livres fterling de rente : à la rigueur, c’eft à la
province qu’ils repréfentent à payer tous leurs frais ;
mais aujourd’hui il arrive rarement qu’on l’exige.
Voyt{ Parlement^ (G ) (a )
C hevalier du Bà in , {Hifi. mod. d’Angl.') ordre
militaire en Angleterre. On a déjà donné fur cet
ordre, au mot B a i n , un détail inftru&if, auquel
nous n’ajoûterons que peu de lignes.
Il eft fingulier qu’on ignore le tems de l’inftitu-
tion de cet ordre de chevalerie, qui fut en honneur
au moins depuis Henri IV. jufqu’au tems de Charles
II. & qui depuis ce prince fut entièrement négligé
, & prefque oublié jufqu’en 17 15 , que le roi
Georges I. le reffufeita par une création de trente-
fix nouveaux chevaliers-. La cérémonie fut fomptueu-
fe ; elle coûta plus de trente mille livres fterling au
ro i, & quatre ou cinq cents à chaque chevalier. Le
duc de Montauge en tut nommé grand-maître, &
cette dignité lui valut fept à huit mille pièces. Le
chevalier Robert "Walpole, dès-lors regardé comme
premier miniftre, porta l’étendard. Le roi pour concilier
plus de faveur à cet ordre reffufeité, déclara
qu’il feroit comme la pepiniere des chevaliers de la
jarretière. Mais les defirs, les intentions, les volontés
des rois, ne font guere mieux réalifées après leur
mort, que celles des particuliers. Article communiqué
par M. le chevalier DE J AU CO URT.
C hevalier b a r o n e t , {Hifi. mod. d’Angl.')
claffe de nobles en Angleterre, entre les barons &
les fimples chevaliers. Vlye^ le mot Baron et , &
ajoûtez-y le détail fuivant.
La prodigalité de Jacques I. le mettant toûjours
à l’étroit, il eut enfin recours en 16 14, à un projet
formé par le comte de Salisbury ; c’étoit de créer
des chevaliers baronets, qui faifoient un corps .de nobleffe
mitoyen entre les barons & les chevaliers ordinaires.
Le nombre en tut d’abord fixé à deux cents ;
mais le roi n’en fit que cent à la première promotion
, fuivant RapinThoiras, & feulement dix-neuf,
fuivant Tindal.
Dans les attes de juftice on devoit ajoûter aux
titres de ces chevaliers, celui de baronet, avec le
nom de fire , & leurs femmes dévoient être qualifiées
de lady. Leur place à l’armée fut établie au
gros près de l’étendard du ro i, pour la défenfe de
fa perfonne. Afin de donner quelque couleur à cette
nouvelle inftitution, les patentes portèrent qu’ils en-
tretiendroient chacun 30 foldats en Irlande pendant
trois ans, à raifon de huit fous par jour pour, chaque
foldat, ou qu’ils payeroient mille quatre-vingts-
quinze livres fterling, & que le roi fe chargeroit
d’entretenir ces troupes en Irlande. Aufli eft-ce la
coûtume pour ceux qui depuis ce tems - là ont été
reçus à cet ordre, d’avoir une quittance endoflee à
leurs lettres patentes de la même fomme de mille
quatre-vingts-quinze livres fterling, deftinée au même
ufage ; & faute d’un pareil endoffement, plufieurs
baronets furent obligés, fous le régné de Charles
II. de payer cette fomme de mille quatre-vingts-
quinze livres fterling. Voye{ Tindal.• Article communiqué
par M. le Chevalier DE J AU COU RT.
C hev al ier, {JuriJ'p.) Nous avons en cette ma- 1
tiere à parler de plufieurs fortes de chevaliers ; fa-
vo ir , les chevaliers du guet, les chevaliers d'honneur,
& les chevaliers ès lois.
Chevalier du guet eft un officier d’épée prépofé à la
garde de la v ille , avec un certain nombre d’hommes
à pié & à cheval. Le guet n’étoit autrefois en faâion
que la nuit; c’eft pourquoi le chevalier du guet étoit
appellé proefeclus vigilum. Préfentement à Paris une
partie du guet monte aufli la garde le jour. Le chevalier
du guet de Paris étoit établi dès le tems de S.
Louis ; il avoit voix délibérative lorfqu’on jugeoit
Tnmr. TT T 5
les priïbhnîers jpris par fa compagnie, fuivant une
déclaration du 27 Novembre 1643. Cet office a été
fupprimé. Celui qui eft préfentement à la tête du
guet, a le titre de commandant.
On avoit aufli créé en 1631 & 1633 * des offices
de.chevalier du guet dans toutes les grandes villes;
mais ils ont ete fupprimes en 1669, à l’exception dé
ceux qui etoient créés plus anciennement, tels que
celui de Lyon.
Chevalier d’honneur, eft un officier d’épée qui a
rang, feance, & voix dehberative dans certaines
compagnies de juftice ; il y en a dans quelques cours
fupérieures, dans les bureaux des finances, & dans
les préfidiaux; ils ne peuvent aflifter au jugement
des procès criminels qu’ils ne foient gradués. Voyer
les édits y déclarations 9 & arrêts indiqués dans Brillon *
au mot Chevalier y n. 5.
Chevalier de jufiiee, eft un titre que prennent certains
chevaliers, pour fignifier qu’ils n’ont point été
difpenfés des preuves de nobleffe.
Chevalier ès lois, étoit un officier de jufiiee auqueî
le roi conféroit le titre de chevalier. On diftinguoit
autrefois ces chevaliers des chevaliers d’armes. Guillaume
Flotte chancelier de France, Guillaume Bertrand,
Jean du Chaftelier, Simon de Bucy premier
préfident du parlement, Pierre de Senniville, tous
nommés en 1340 dans une déclaration de Philippe
de Valois pour le privilège de l’imiverfité de Paris,
font qualifiés chevaliers en lois.
Froiffard, liv. I. ch. Ixxiij. dit pareillement que
Simon de Bucy étoit chevalier en lois. Il donne aufli
la même qualité à Renaud de Sens.
Plufieurs chanceliers & autres magiftrats furent
faits chevaliers.
Jacques de Beauquemar premier préfident du parlement
de Rouen, fut fait chevalier par Charles IX. le
2:6 Septembre 15 66. Voyel le traité de la nobleffe par
de Laroque, chap. cv- B I
C h e v al ier , f. m. {Ornitfjpluvialismajor. Aidé
limofa venetorum.Gefn, oifeau aquatique qui pefe fept
onces ; il a quinze ôufeize ppuces de longueur depuis
la pointe du bec jufqu’au bout des pattes ; l’envergure
eft d’environ vingt-deux pouces ; le bec eft
mince & de couleur noire, à l’exception de l’angle
de la piece inférieure qui eft rouge ; il a deux pouces
& demi de longueur ; le fommet de la tête la
face fupérieure du cou, le deffus des ailes, les épaules
y & la partie antérieure du dos, font de couleur
brune mêlée de couleur cendrée ou blanchâtre • les
bords des plumes du fommet de la fête font blancs
& le milieu eft noir ; le croupion & le deffo.us de
l’oifeau font blancs. Il a vingt - fix grandes plumes
brunes dans les ailes ; les cinq premières font d’un
brun foncé, & leurs barbes intérieures font parfe-
mées de points blanchâtres ; les dernieres grandes
plumes font de couleur moins foncée, & ont de petites
taches blanches. La queue a environ trois pouces
de longueur ; elle eft compofée de douze plumes
fur lefquelies il y a des bandes tranfverfales & ondoyantes
, alternativem.ent brunes & blanches. Les
pattes font fort longues, & dégarnies de plumes
jufqu’à deux pouces au-deffus de la première articulation
; leur couleur eft mêlée de verd, & de couleur
livide ; le doigt poftérieur eft petit ; les onglet
font noirs, & le doigt extérieur eft uni au doigt du
milieu à fa naiflance.
On a donné le nom de chevalier aux piés verts à
cet oifeâu, à caufe de la couleur de fes piés. Il y en
a un autre que l’on a nommé le chevalier aux piés
rouges , parce qu’il a les piés d’un jaune rougeâtre.
Son bec eft un peu plus court que celui du premier ;
fon cou & fa tête font d’un brun cendré ; il a une ligne
blanche au-deflus des yeux: au refte cês deux
oil'eaux fe reflemblent. Villughby, ornith.
R r