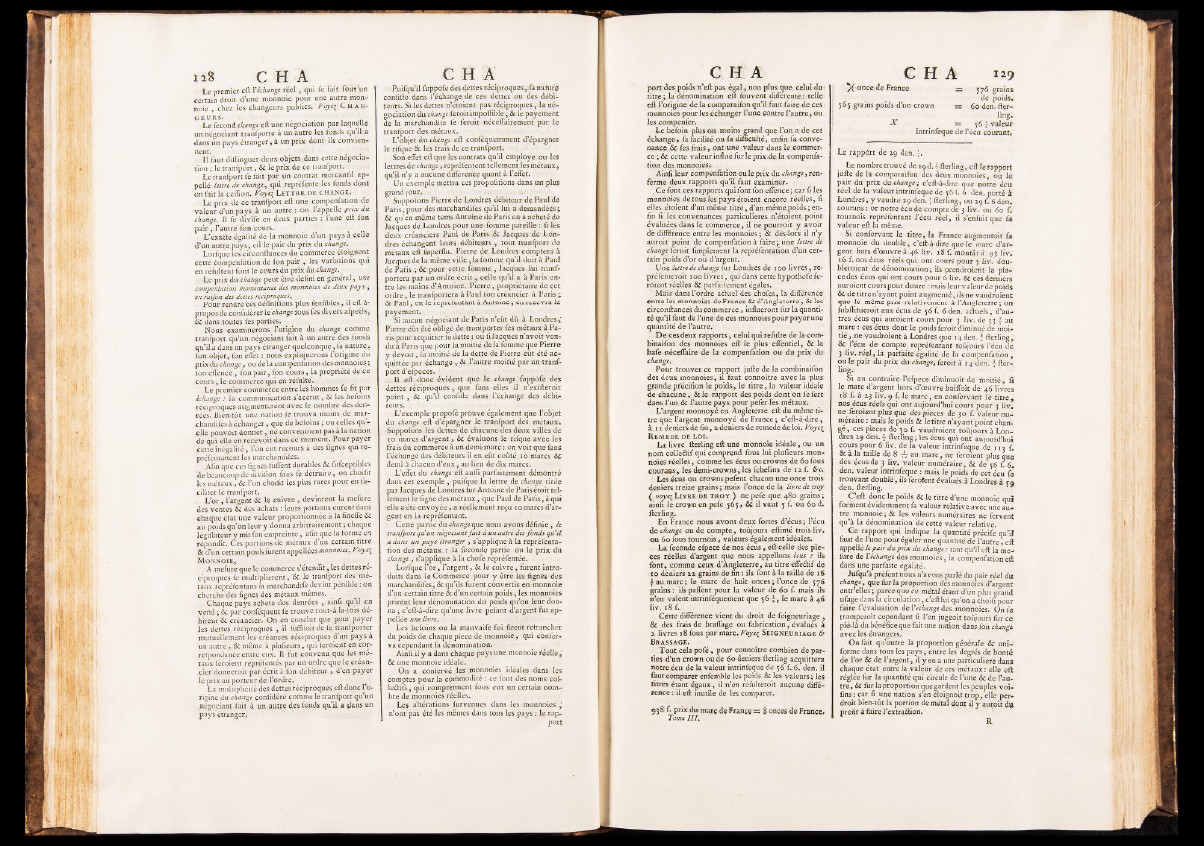
n 8 C H A
Le premier éft Y échange réel , qui fe fait foüs 'un
certain droit, d’une nvonnoie pour une autre mon-
noie , chez les changeurs.publics. V C-H ANGE
U R Si , . . , m
Le fécond change eft une négociation par laquelle
un négociant tranlporte à lin autre les fonds qu i! a
dans un pays étranger, à un prix’ dont ils conviennent
» . ' - , 1
Il faut diftinguer deux objets; danis cette négociation
; le tranfport, & le prix de ce ti anfport. : :
Le tranfport fe fait par un contrat mercantil ap-
pellé lettre de change, qui re.préfente. les fonds dont
on fait la ceflion. Voye^ Le t tr e de ch an ge.
Le prix: de ce tranfport eft une compenfation de
valeur d’un, pays à un autre : on l’appelle prix du
change. Il fe divife en deux parties : l’une eft fon
p a ir , l’autre: fon cours. ' . ‘
L’exa&e égalité de la mohnoie d’un pays à celle
d’un autre pays, eft le pair du prix du change.
Lorfqûe lés. circonftances ; du commerce éloignent
cétte éompenfation de fon pair , les. variations qui
en réfultent font le cours du prix du change. ^
■ Le prix du tkange peut être défini en général , une
compenfation momentanée des monnoies de deux pays ,
én raifon des dettes réciproques.
. Pour rendre ces définitions plus fenfibles, il eft à-
propOs de confidérer le change ioûs fes divers: afpeûs,
6c dans . toutes les parties, |
Nous examinerons l’origine du change comme
tranlport qu’un négociant fait à un autre des fonds
qu’il a dans un pays étranger quelconque, fa nature *
Ion,objet, fon effet : nous expliquerons l’origine du
prix du change y ou delà compenfation des monnoies ;
Ion effence , fort pair, fön cpurs, la propriété de ce
cours;, le commerce qui en rél'ulte.
Le premier commerce entre les hommes fe fit par
échange : la.communication s’accrut, & les befoins
réciproques augmentèrent.avec le nombre des denrées*
Bien-tpt une nation lé trouva moins de marchandises
à échanger, que de b,efoins ; ou celles qu elle
pouyoit donner, ne convenoient pas à la nation
de qui elle en recevoit dans ce moment. Pour payer
cette inégalité, l’on eut recours a des lignes qui re-
préfentalfent les marchandifes. ;
Afin que ces lignes fuffent durables 6c fufceptibles
de beaucoup de divifion fans fe détruire, on choifit
les métaux , &c l ’on choifit les plus rares pour en faciliter
le tranfport. /
- L’or , l’argent 6c le cuivre , devinrent la mefure
des ventes &c des achats : leurs portions eurent dans
chaque état une valeur proportionnée a la fineffe &c
au poids qu’on leur y donna arbitrairement ; chaque
légiflateur y mit fon empreinte, afin que la forme en
répondît. Ces portions de métaux d’un certain titre
& d ’un certain poids furent appellées monnoies. Voye{
Monnoie, , . ,
A mefure que le commerce s’étendit, les.dettes réciproques
fe multiplièrent, & le tranfport des mentaux
repréfentans la marchandife devint penible : on
chercha des fignes des métaux mêmes.
Chaque pays acheté des denrées , ainfi qu’il en
vend par- conféquent fe trouve tout-à ia-fois debiteur
& créancier. On en conclut que pour payer
les dettes réciproques. , il fuffifoit de fe tranfporter
mutuellement les créances réciproques d’un pays à
un autre, & même, à plüfieurs, qui feroient en cor-
refpondance entre eux. Il fut convenu que les métaux
feroient repréfentés par un ordre que le créanc
ie r donneroit par écrit à fon débiteur , d’en payer
le prix au porteurffe l’ordre.
La multiplicité des dettes réciproques eft donc l’origine
du change confidéré comme le tranfport qu’un
négociant fait à un autre des fonds qu’il a dans un
pays étranger.
C H À
Puifqu’il fuppofe des dettes réciproques, fa nafurë
confifte dpns i’éohange de ces. dettes ou des débiteurs.
Si les dettes n’étoient pas réciproques, la- négociation
du change feroitimpoflible, & le payeriient
de la marchandile fe feroit néceffairement-par le
tranfport des métaux. :
L’objet du change e& conféquemment d’épargner
le rifque & les frais de ce tranlporti s-;
' Son effet eft que les contrats qu’il employé ou les
lettres de change, repréfententtellement les métaux,
qu’il n’y a aucune différence quant à l’effet.
Un exemple mettra ces propofitions dans un plus
grand jour. . . -
Suppofons Pierre de Londres débiteur. :de Paul de
Paris, pour des marchandifes.qu’il lui ^demandées;
& qu’en même tems Antoine de .Paris eq a acheté de
Jacques dé Londres, pour une fomme pareille : fr ies
deux créanciers Paul de Paris: •.& Jacque,s.de Londres
échangent leurs, débiteurs;, tout tranfport de
métaux eft fuperflu. Pierre de: Londres comptera à
Jacques de la même v jlle , larfemme qu’il doit à Paul
de Paris ; & pour cette fommé., Jacques lui-tranf-
portera. par un ordre écrit,,, celle qu’il: a à Paris entre
les mains d’Antoine. Piérrei, propriétaire de cet
ordre, le tranfportera à Paul fon créancier à Paris ;
& Paul, en le repréfentant à Antoine, en recevra le
payement.
Si aucun négociant de.Paris, n’eût dû à Londres,’
Pierre eût été obligé de jranfporter fes métaux à Paris
pour acquitter laffette ; pufi 'Jacques rfavoit vendu
à Paris que pour la moitié .de la fomme què Pierre
y de v o it ,. la moitié de la dette, de Pierre eût été acquittée
par échange r d c l’autrè moitié par untranf-,
port d’elpeces.. I ■
Il eft donc, évident que le ,change fuppofe des
dettes'-réciproques, que, fans elles il n’exifteroit
point , 6c qu’il confifte - dans : l’échange des débi-,
teurs.
L ’exemple propofé pro.üve également que l’objet
du change eft d’épargner le tranfport des métaux»
Suppofons les dettes dé chacune des deux villes de
:iô marcs d’argent > 6c évaluons le rifque avec les
frais du commerce à un demi-marc : on voit que fans
l’échange des débiteurs il en eût coûté 10 marcs 6c
demi à chacun d’eu x, au lieu de dix marcs.
L ’effet du change éft aulfi parfaitement démontré
dans, cet exemple , puifque la lettre de change tirée
par Jacques de Londres liir Antoine de Paris.étoit tellement
le figne des métaux, que Paul de Paris, à qui
elle a été envoyée > a réellement reçu ro marcs d’ar-,
gent en la repréfentant.
Cette partie du change que nous avons définie, le
tranfport qu’un négociant fait à un autre des fonds qu'il
a dans un pays étranger , s’applique à la repréfenta-
rion des métaux.: la fécondé partie ou le prix du
change, s’applique à la chofe repréfentée.
Lorfque l’o r , l’argent, & le cuivre, furent introduits
dans le Commerce pour y êtré les fignes des
marchandifes, 6c qu’ils furent convertis en monnoie
d’un certain titre & d’un certain poids :, les monnoies
prirent leur dénomination du poids qu’on leur donna
; c’eftrà-dire qu’une livre pefant d’argent fut ap-
pellée une livre.
Les befoins ou la mauvaife foi firent retrancher
du poids de chaque pieee de monnoie -, qui confer-
va cependant fa dénomination.
Ainfi il y a dans chaque pays une monnoie réelle
6c une monnoie idéale..
On a eonfervé les monnoies idéales dans les
comptes pour la commodité : ce font des noms col-
ledits, qui comprennent fous eux un certain nom-,
bre de monnoies réelles.
Les altérations fur venues dans les monnoies
n’ont pas été lés mêmes dans tous les pays ; le rapport
C H A
port des poids rt’eft pas éga l, non plus que celui du
titre; la dénomination eft feuvent differente.::telle
eft l ’origine de la cppiparaifon qu’il faut faire: dpces ;
monnoies pour les échanger l’une contre l ’autre, ou
les compenfer.
Le befoin plus oü moins grand que; l’on a de cet
échange-, fa facilité: ou fa- idifficulté, enfin fa convenance
, fes .frais, ont une valeur dans le.commerce
; 6c cette valèur influe furie prix.de la eompenfa-
tion.de.s.monnoiesi ,
Ainfi leur compenfation ou le prix du change , renferme
deux.rapports qu’il,faut examiner.
Ce font ces rapports qui font fon effence ; car fi les
monnoies. de .tous, les pays.étoient enepre réelles, fi
elles étoient d’un même titre, d’un meme poids; enfin
fi. les convenances particulières n’étoient. point
évaluées dans le commerce, il ne pourroit y avoir
dé différence entre les monnoies; & dès-lors il n’y
atiroit point de compenfation à faite ;, une lettre de
change feroit Amplement la repréfentation d’un certain
poids d’or ou d’argent.
Unç. lettre de change fur Londres de io o livres, re-
préfenteroit ioo livrés , qui dans cette hypothefe feroient
réelles & parfaitement égales.
Mais dans l’ordre a&uel des chofés , la différence
entre lés monnoies de France & d’Angleterre, ,& lés
circonftances du commerce, influeront fur la quantité
qu’il faut de l’une décès monnoies pour payer une
quantité de l ’autre^
Décesdeux rapports; celui qui-refitlte de la com-
binaifon des monnoies eft; le plus- efTentiel, & la
bafe néceflaire de la compenfation ou du prix du
change.
PoUr trouver, ce rapport jufte de là combinaifon
des deux monnoies, il faut connoître avec la plus
grande: precifion le poids ,, le titre, la valeur idéale
de chacune, & le: rapport des poids dont on fe fert
dans l’un & l’autre pays pour pefer les métaux.
L’argent monnoyé en Angleterre eft du même titre
que. l?argent monnoyé de France ; c ’eft-à-dire ,
à, i i; deniers de fin , » deniers de remede de loi. Voye%
R eMed.e de. LOjt»
La livre, fterling eft une monnoie idéale, ou un
nom colle&if qui comprend fous lui plufieurs mon-
noies réelles, comme les écus ou crovns de 6ofous
couraos, les demi-crowns, les fchelins de la f. &c.
Les écus ou crowns pefent chacun une once trois
deniers treize grains; mais l’once, de 1a- livre de troy
( voyeiLivre de Tr q y ) ne pefe que 480. grains;
ainfi le crovn en pefe 565, ë t il vaut 5: f. ou 60 d.
fterling..
En France nous avons deux fortes d’écus ; l’écu
de change ou de compte, toujours eftimé troisliv.
ou 60 fous tournois, valeurs également idéales.
La fécondé efpece de nos écus, eft celle des pièces
réelles d’argent que nous appelions écus : ils
font, comme ceux d’Angleterre, au titre effe&if de
10 deniers aa grains de fin : ils font à la taille de 16
% au marc ; le marc de huit ortees ; l’once de 576
grains : ils paflent pour la valeur de 60 f. mais ils
iden valent intrinféquement que 56 7 , le marc à 46
liv. 18 fv
Cette différence vient du droit de feigneuriage ,
& des frais de braffage ou fabrication, évalues à
a livres 18 fous par marc. Foye^ Seign eu riage &
Brassage.
Tout cela pofé, pour connoître combien de parties
d’un crown ou de 60 deniers fterling acquittera
notre écu de la valeur intrinfeque de 56 f. 6. den. il
faut comparer enfemble les poids & les valeurs ; les
titres étant égaux, il n’en réfulteroit aucune différence
: il eft inutile de les comparer,
938 f. prix du- marc de France = 8 onces de France»
Tome I I I ,
C H A r n
5 ( once de France as %-j(, grains
de poids.'
5^ 5 grains poids d’un crown =r 60 den. fter*
si. = 5 6 f valeur
intrinfeque de l’écu courant»
Le rapport dé 19 den. v
Le nombre trouvé de aç d. { fterling, eft le rapport
jufte dè la comparaifon des deux monnoies, ou le
pair du prix du change ; c’eft-à-dire que notre écu
réel:de la valeur intrinfeque de 56 f; 6 den. porté à
Londres, y vaudra a9 den. -fterling-, ou a9 {. 6 den.
courans : or notre écu de compte de 3 liv. ou 60 f.
tournois repréfentant l’écu réel, il s’enfuit que fa
valeur eft la même.
Si confervant lé titre, la France augmentait fa
monnoie du double, c’eft-à-dire que le marc d’argent
hors^d?oeuvre^à>46 liv» i8 f. montât à 93 liv .
16X. nos écus réels- qui- onr cours pour y liv. dou-
bleroient de dénomination-; ils prendroient- la pla-
cedes écus qui ont cours pour 6 liv. & ces derniers
auroient cours pour douze : mais leur valeur de poids
& de titre n’ayant point augmenté, ilsne vaudroient
que le même prix relativement' à l’Angleterre ; on
fubftitueroit aux écus de ,56 f. 6 den. aéluels, d’autres
écus qui auroient cours pour 3 liv. de 33 f au
marc : ces écus dont le poids feroit diminué de moit
ié , ne vaudroient à Londres que 14 den. £ fterling,-
& Fécu de compte repréfentant- toûjpürs- i?écu de
3 liv. reel, la parfaite égalité de la compenfation ,
ortie pair du prix dû change, feroit à. 14 den. | ftèr-
ling.
Si au contraire- l’efpeçe diminubit de rtioitié, fii
le marc d’argent hors d’oeuvre baiffoit de 46 livres
18'fi à 23 liv. 9 f. le marc, en confervant le titre ,
nos écus. réels qui ont aujourd’hui cours pour 3 liv.
ne feroient plus que des pièces de 3 0 fi valeur nur
meraire : mais le poids & le titre n’ayant point chan*
g é , ces pièces de 30 fi vaudroient toujours à Londres
29 den. i fterling ; les écus qui ont aujourd’hui
cours poiir 6 liv. de la valeur intrinfeque de 113 fi
& à la taille de 8 7L au marc f ne feroient plus que
des. écus de 3 liv. valeur numéraire, & de 56 fi 6 .
den. valeur intrinfeque : mais le poids de cet écu fe
trouvant doublé, ils feroient évalués à Londres à ta
den. fterling,
C eft donc le poids & le titre d’une monnoie qui
forment évidemment fa valeur relative avec une autre
monnoie; & les valeurs numéraires ne fervent
qu’à la dénomination de cette valeur relative.
Ce rapport qui indique la quantité précife qu’il
fout de l ’une pour égaler une quantité de l’autre, eft:
appelle le pair du prix du change : tant qu’il eft la mefure
de Y échange des monnoies, la compenfation eft
dans une parfaite égalité.
Jufqu’à préfent nous n’avons parlé du pair réel du
change, que fur la proportion des monnoies d’argent
entr’elles ; parce que ce métal étant d’un plus «rand
ufage dans la circulation, c’eftlui qu’on a choifip.oiir
faire l’évaluation de Y échange des monnoies. Onfô
tromperoit cependant fi l ’on jugeoit toujours fur ce
pié-ià du bénéfice que fait une nation dans fqn changé
avec les étrangers.
On fait qu’outre la proportion générale & uniforme
dans tous les pays, entre les degrés de bonté
de. For & de l’argent, il y en a une particulière dans
chaque état entre la valeur de ces métaux : elle eft:
réglée fur la quantité qui circule de l ’une & de l’autre,
& fur la proportion que gardent les peuples voi-
fins: car fi une nation s’en éloignoit trop, elle perdront
bien-tôt la portion de métal dont i| y auroit dtt
profit à foire l’extraftion.
R