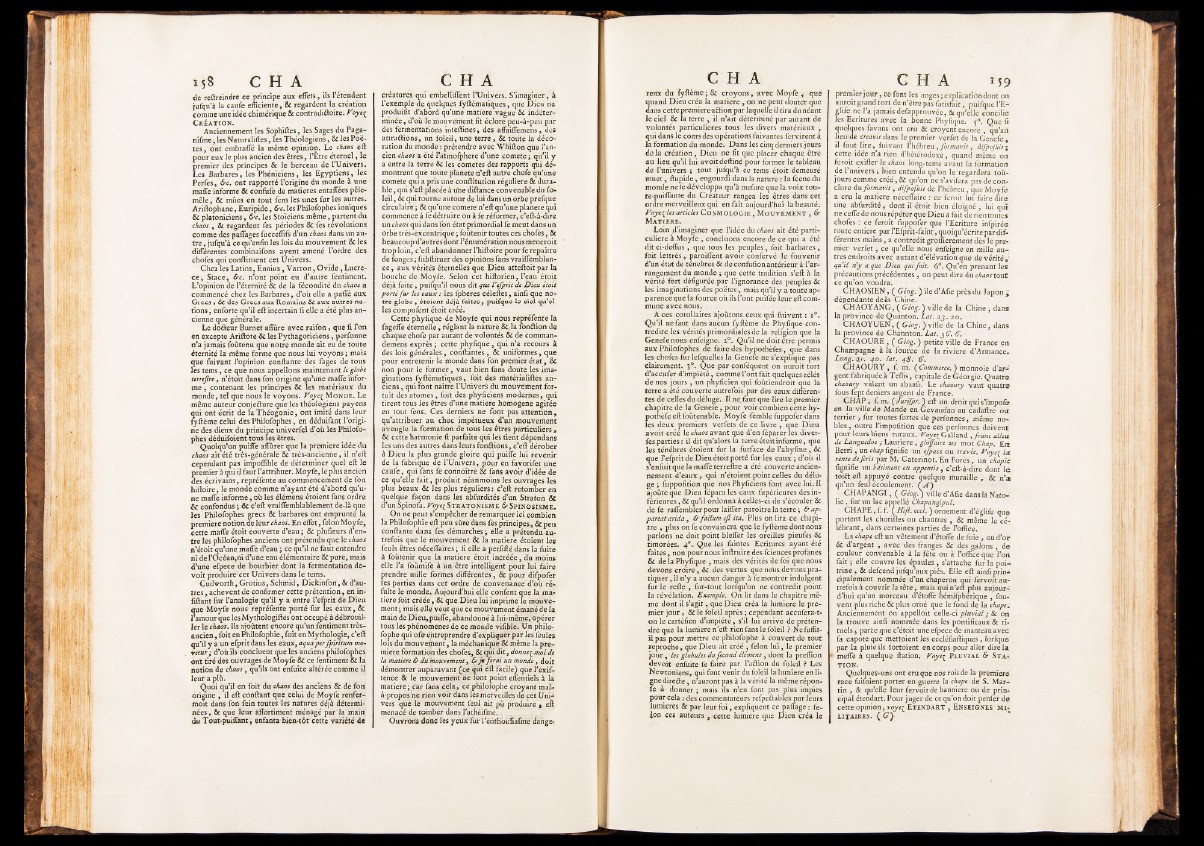
de reftreindre ce principe aux effets, ils l’étendent
jufqu’à la caufe efficiente, ôc regardent la création
comme une idée chimérique & contradictoire. V>yez
C r é a t io n .
Anciennement les Sophiftes, les Sages du Paga-
nifme, les N aturalises, les Théologiens, 8c les Poètes
, ont embraffé la même opinion. Le chaos eft
pour eux le plus ancien des êtres, l’Être éternel, le
premier des principes & le berceau de l’Univers.
Les Barbares, les Phéniciens, les Egyptiens, les
Perfes, &c. ont rapporté l’origine du monde à une
maffe informe & confùfe de matières entaffées pêle-
mêle , 8c mues en tout fens les unes fur les autres.
Ariftophane, Euripide, &c. les Philofophes ioniques
8c platoniciens, &c. les Stoïciens même, partent du
chaos , & regardent fes périodes 8c fes révolutions
comme des paffages fucceffifs d’un chaos dans un autre
, jufqu’ à ce qu’enfin les lois du mouvement 8c les
différentes comibinaifons ayent amené l’ordre des
chofes qui conftituent cet Univers.
Cher les Latins, Ënnius, Varron, O v id e , Lucrèc
e , Stace, 6c. n’ont point eu d’autre fentiment.
L’opinion de l’éternité & de la fécondité du chaos a
commencé chez les Barbares, d’où elle a paffé aux
Grecs, 8c des Grecs aux Romains 8c aux autres nations
, enforte qu’il ell incertain li elle a été plus ancienne
que générale.
Le doéteur Burnet affûre avec raifon, que li l’on
en excepte Ariftote 8c les Pythagoriciens, perfonne
n’a jamais foûtenu que notre monde ait eu de toute
éternité la même forme que nous lui voyons ; mais
que fuivant l’opinion confiante des fàges de tous
les tems, ce que nous appelions maintenant le globe
eerrejlre, n’étoit dans fon origine qu'une maffe informe
, contenant les principes 8c les matériaux du
monde, tel que nous le voyons. Voyez Mondé. Le
même auteur conjeéture que les théologiens payens
qui ont écrit de la Théogonie, ont imité dans leur
ryftème Celui des Philofophes, en déduifant l ’origine
des dieux du principe univerfel d’où les Philofophes
déduifoient tous les êtres.
Quoiqu’on puiffe aflùrer que la première idée du
chaos ait été très-générale 8c très-ancienne, il n’eft
cependant pas impoffible de déterminer quel efl le
premier à qui il faut l’attribuer. Moyfe, le plus ancien
des écrivains, repréfente au commencement de fon
hifloire, le monde comme n’ayant été d’abord qu’une
maffe informe, où les élémens étoiêftt fans ordre
& confondus ; 8c c’efl vraiffemblablement de-là que
les Philofophes grecs 8c barbares ont emprunté la
première notion de Izuxchaos. En effet, félon Moyfe,
cette maffe étoit couverte d’eau ; 8c pluiieurs d’en-»
tre les philofophes anciens ont prétendu que le chaos
n’étoit qu’une maffe d’eau ; ce qu’il ne faut entendre
ni de l’Océattjni d’une eau élémentaire 8c pure, mais
d’une efpece de bourbier dont la fermentation de-
v'oit produire: cet Univers dans le tems.
Cudworth, Grotius, Schmid, Dickinfon, & d’autres
, achèvent de confirmer cette prétention, en in-
fiftant fur l’analogie qu’il y a entre i’efprit de Dieu
que Moyfe nous repréfente porté fur les eaux, 8c
l ’amour que les My thologiftes ont occupé à débrouiller
le chaos. Ils ajoûtent encore qu’un fentiment très-
ancien , foit en Philofophie, foit en Mythologie, c’eft
qu’il y a un efprit dans les eaux, aqua per fpirttum mo-
yctttr ; d’où ils concluent que les anciens philofophes
ont tiré des ouvrages de M oyfe 8c ce fentiment 8c la
notion de chaos, qu’ils ont enfuite altérée comme il
leur a plû.
Quoi qu’il en foit du chaos des anciehS & de fon
origine , il eft confiant que celui de Moyfe renfer-
moit dans fon fein toutes les natures déjà déterminées
, 6c que leur àfiortiment ménagé par la main
du Tout-puiffant, enfanta bien-tôt cette variété de
créatures qui embelliffent l’Univers. S’imaginer, à
l’exemple de quelques fyfiématiques, que Dieu ne
produifit d’abord qu’une matière vague 8c indéterminée
, d’où le'mouvement fit éclore peu-à-peu par
des fermentations inteftines, des affaiffemens, des
attractions, un foleil, une terre, 8c toute la décoration
du mondé : prétendre avec Whifton que l’ancien
chaos z été l’àtmolphere d’une comete; qu’il y
a entre là terre 8c lès cometes des rapports qui démontrent
que toute planete n’eft autre chofe qu’une
comete qui a pris une conftitution régulière & durable
, qui s’eft placée à Uhé diftanCe convenable du f o
leil, 8c qui tourne autour de lui dansun orbe prefque
Circulaire ; 8C qu’une comete n’eft qu’une planete qui
commence à fe détruire ou à fe réformer, c’eft-à-dire
un chaos qui dans fon état primordial fe meut dans uii
orbe très-excentrique ; foûtenir toutes ces cbofes, 8c
beaucoupd’atitres dont l’énumération nous meneroit
trop loin, c’eft abandonner l’hiftoire pour fe repaître
de fonges ; fubftituer des opinions fans vraiffemblan-
c e , aux vérités éternelles que Dieu atteftoit par la
bouche de Moyfe. Selon cet hi'ftorien, l’eau étoit
déjà faite, puifqu’il nous dit que Vefprit de Dieu étoit
porté fur Us eaux : les fpheres céleftes, ainli que notre
globe, étoient déjà faites, puifque le ciel qu’elles
compofent étoit créé.
Cette phylique de Moyle qui nous repréfente la
fageffe éternelle, réglant la nature.8c la fonction de
chaque chofe par autant de volontés 8c dé comman-
demens exprès ; cette phylique, qui n’a recours à
des lois générales, confiantes, 8c uniformes, que
pour entretenir le monde dans fon premier é ta t , 8c
non pour le former, vaut bien fans douté les imaginations
fyfiématiques, foit des matériàliftès anciens
, qui font naître f Univers du mouvement fortuit
des atomes, foit des phyficieris modernes, qui
tirent tous les êtres d’une matière homogène agitée
en tout fens. Ces derniers ne font pas attention,
qu’attribuer au choc impétueux d’un mouvement
avèugle la formation de tous les êtres particuliers ,
8c cette harmonie fi parfaite qui les tient dépendans
les uns des autres dans leurs fondions, c’eft dérober
à Dieu la plus grande gloire qui puiffe lui revenir
de la fabrique de l’Univers, pour en favorifet une
c au fe , qui fans fe connoître 8c farts avoir d’idée de
ce qu’elle f a it , produit néanmoins les ouvrages les
plus beaux 8c les plus réguliers : c ’eft retomber en
quelque façon dans les abfurdités d’un Straton 8c
d’un Spinofa. J^eçSTRÀTÔNÎSMÈ & SPINOSISME.
On ne peut s’empêcher de remarquer ici combien
îa Philofophie eft peu sûre dans fes principes, 8c peu
confiante dans fes démarches; elle a prétendu autrefois
que le mouvement 8c la matière étoient les
feuls êtres né ce flaires ; fi elle a peçfifté dans la fuite
à foûtenir que la matière étoit incréée, du moins
elle l’a foûmifç à un être intelligent pour lui faire
prendre mille formes différentes, 8c pour difpofer
les parties dans cet ordre de convenance d’où ré-
fulte le monde. Aujourd’hui elle cohfent que la matière
foit créée, 8c que Dieu lui imprime le mouvement
; mais elle veut que ce mouvement émané de la
main de D ieu, puiffe, abandonné à lui-même, opérer
tous les phénomènes de ce monde vifible. Ün philo-
fophe qui ofoentreprendre d’expliquer par les feules
lois du mouvement, la méchanique 8c même la première
formation des chofes, 8c qui dit, donnez-moi de
là matière & du mouvement, & j t ferai un monde , doit
démontrer auparavant (ce qui éft facile) que l’exif-
tence & le mouvement ne Ibnt point effentiels à la
matière; car fans cela, ce philolbphe croyant malà
propos ne rien voir dans lès merveilles de cet Univers
que lé mouvement feu! ait pu produire * eft
menacé de tomber dans l’athéifrnê. , „ n
Ouvrons donc les yeüxfur Tenthoüfiafme dangefeux
du fyftème ; 8c croyons, avec Moÿfè ,- qiiê
quand Dieu créa la matière, on ne peut douter que
dans cette première aétion par laquelle il tira du néant
le ciel 8c la terre , il n’ait déterminé par autant de
volontés particulières tous les divers matériaux ,
qui dans le cours des opérations fuivantes fervirent à
la formation du monde. Dans les cinq derniers jours
de la création, Dieu ne fit que placer chaque être
au lieu qu’il lui avoit deftiné pour former le tableau
de l’univers ; tout jufqu’à ce tems étoit demeuré
muet, ftupide, engourdi dans la nature : la fcene du
monde ne fe développa qu’à mefure que la voix tou-
te-puiffante du Créateur rangea les êtres dans cet
ordre merveilleux qui en fait aujourd’hui la beauté.
Voye^éesarticUs G o sm olo g ie , Mo u v em en t , &
Ma tière-,
Loin d ’imaginer que Üidée du chaos ait été particulière
à Moyfe , concluons encore de ce qui a été
dit ci-deffus , que tous les peuples -, foit barbares,
foit lettrés , paroiffent avoir confervé le fouvenir
d’un état de tenebres 8c de confufion antérieur à l’arrangement
du monde ; que cette tradition s’eft à la
vérité fort défigurée par l’ignorance des peuples 8c
les imaginations des poètes , mais qu’il y a toute ap-
parenceque la-four ce où ilsl’ont puifée leur eft commune
avec nous.
A ces corollaires ajoûtons ceux qui fiiivent : i° .
Qu ’il ne faut dans aucun fyftème de Phylique contredire
les vérités primordiales de la religion que la
Genefe nous enfeigne. z°. Qu’il ne doit être permis
aux Philofophes de faire des hypothèfes, que dans
les chofes fur lefquelles la Genefe ne s’explique pas
clairement. 30. Que par eonféquent on aurait tort
d’acc\ifer d’impiété, comme l’ont fait quelques zélés
de nos jours , un phyficien qui foûtiendroit que la
terre a été couverte autrefois par des eaux différentes
de celles du déluge. Il ne. faut que lire le premier
chapitre de la Genefe, ;pour voir combien cette hy-
pothèfe eft foûtenablè. Moyfe femble fuppofer dans
les deux premiers verfets de ce livre , que Dieu
avoit créé le -chaos avant que d’en féparer les diver-
fes parties: il dit qu’alorsla terre étoit informe, que
les ténèbres étoient fut la furface de l’abyfme, 8c
que l’efprit de Dieu étoit porté fur les eaux ; d’où il
s’enfuit que la maffè terreftre a été couverte anciennement
d’eaux , qui n’étoient point celles du déluge
; fuppofition que nos Phyficiens font avec lui. Il
ajoute que Dieu lépara les eaux fupérieures des inférieures
, 8c qu’il ordonna à celles-ci de s’écouler 8c
de fe raffembler pour laiffer paraître la terre ; & ap-
pareat arida, 6.factum ejl ita. Plus on lira ce chapitre
, plus on fe convaincra que le fyftème dont nous
parlons ne doit point bleffer les oreilles pieufes 8c
timorées. 40. Que les faintes Ecritures ayant été
faites, non pour nous inftruire des fciences profanes
& de la Phyfique , mais des vérités de foi que nous
devons croire, 8c des vertus que ndùs devons pratiquer
, il n’y a aucun danger à fe montrer indulgent
fur le relie , fur-tout lorsqu’on ne contredit point
la révélation. Exemple. On lit dans le chapitre même
dont il s’ag it, que Dieu créa la lumière le premier
jour, 8c le foleil après ; cependant accufera-t-
on le cartéfien d’impiété, s’il lui arrive de prétendre
que la lumière n’eft rien fans le foleil ? Ne fuffit-
il pas pour mettre ce philofophe à couvert de tout
reproche, que D ieu ait créé , félon lu i, le premier
jou r , les globules dit fécond élément, dont la preffion
devoit enfuite fe faire par l’aélion du foleil ? Les
Newtoniens, qui font venir du foleil la lumière en li*-
gne direéle, n’auront pas à la vérité la même réponse
à donner ; mais ils n’en font pas plus impies
pour cela : des commentateurs refpeftables par leurs
lumières St par leur fo i, expliquent ce paffage : félon
ces auteurs , cette lumière que Dieu créa le
plémièr jour ,'cè font les anges; explication dont on
aurait grand tort de n’être pas fatisfait, puifque l’E-
glife ne 1 a jamais defapprouvée, 8t qu’elle concilié
lés Écritures avec la bonne Phyfique; 50. Que fi
quelques favans ont cru & croyent encore , qu’au
lieu-de creavit dans le premier verfet de la Genefe ,
il faut lire, fuivant l’hébreu ^formavit, âifpofuit ;
cette idée n a rien d’hétérodoxe, quand même on
ferait exifter \e chaos long-tems avant la formation
de l’univers ; bien entendu qu’on le regardera toujours
comme créé, & qii’on ne s’avifera pas de conclure
ûuformavit, difpofuit dé l’hébreu, que M oyfè
a cru la matière néceffaire : ce ferait lui faire dire
une abfurdité, dont il -étoit bien éloigné , lui qui
ne ceffe de nous répéter qUe Dieu a fait de rien toutes
chofes : ce ferait fuppofer que l’Ecriture infpiréè
toute entière par l’Efprit-fairit, quoiqu’écrite par différentes
mains, a contredit grôffierement dès le premier
v er fe t, ce qu’elle nous enfeigne en mille autres
endroits avec autant d’élévation que de vérité,'
qu'il n'y a que Dieu qui foit. 6°. Qu’en prenant les
précautions précédentes, on peut dire du ckaos tout
ce qu’on voudra.
CHAOSIEN, ( Géog. ) île d’Afie près du Japon }
dépendante delà Chine.
CHAOYANG, ( Géog. ) ville de la Chine, dans
la province de Quanton. Lai. 23. 20.
CHAOYUEN, ( Géog. ) ville de la Chine, dans
la province de Chaftnton. Lat. 3 S. 6.
CHAOURE, ( Géog. ) petite ville de France en
Champagne à la fource de la rivière d’Armance.
Long. 2.1v 40. lat. 48. 6 .
CH AOU RY , f. m. ( 'Commerce. ) monnoie d’argent
fabriquée à Teflis, capitale de Géorgie. Quatre
chaoury valent un abaa.fi. Le chaoury vaut quatre
fous fept deniers argent de France.
CHAP, f. m. (^furifpr. ) eft un droit qui s’impo/e
en la;ville de Mandé en Gevaudan au cadaftre ou
terrier > fur toutes fortes dé perfônnes, même nobles
, outre l’impofition que ces perfônnes doivent
pour leurs biens ruraùx.^ Voyez Galland , franc alleu
de Languedoc ; Lauriere, glàffaire au mot Chap. En
Berri, un chap fignifîe un- efpace ou travée. Voyez lu
rente de feris par M. Cateririot. En Forés, un chapit
fignifie un bâtiment en appentisc’eft-à-dire dont le.
toiél eft appuyé contre quelque muraille , & n’*
qu’un feul écoulement. ( ^ )
CHAPANGI, ( Géog?) ville d’Afie dans là Nato-;
lie , fur un lac appellé Chapangipul.
CHAPE, f. f. ( Hiß. eccl. ) ornement d’églife que
portent les choriftes ou chantres , & même le cé-*
lébrant, dans certaines parties de l’office,
La chape eft un vêtement d’étoffe de foie , ou d’or
& d’argent , avec dés frangés & des galons , dô
couleur convenable à la fête ou à l’office que Port
fait ; elle couvre les épaules , s’attacha fur la poitrine
, & defcend jufqu’aux piés. Elle eft ainfi prin-*
cipalement nommée d’un chaperon qui fer voit autrefois
à couvrir la tête, mais qui n’eft plus aujourd’hui
qu’un morceau d’étoffe némifphérique , fou-
vent plus riche 8c plus orné que le fond de la chapei
Anciennement on appelloit celle-ci pluvial ; & on
la trouve ainfi nommée dans les pontificaux & rituels
, parce que c’étoit une efpece de manteau avec
fa capote que mettoient les eccléfiaftiques, Iorfque
par la pluie ils fôrtoient en corps pour aller dire la
k meffe à quelque ftation. Voyez Pluvial & St a -;
TION.
Quelques-uns ont cru que nos rois de la premier^
race faifoient porter en guerre la chape de S. Martin
, & qu’elle leur fervoit de bannière ou de prin*
cipal étendart. Pour juger de ce qu’on doit penfer dé
cette opinion, voyez Etendart , Enseignes m i<
LI TAIRE S. (G ) -