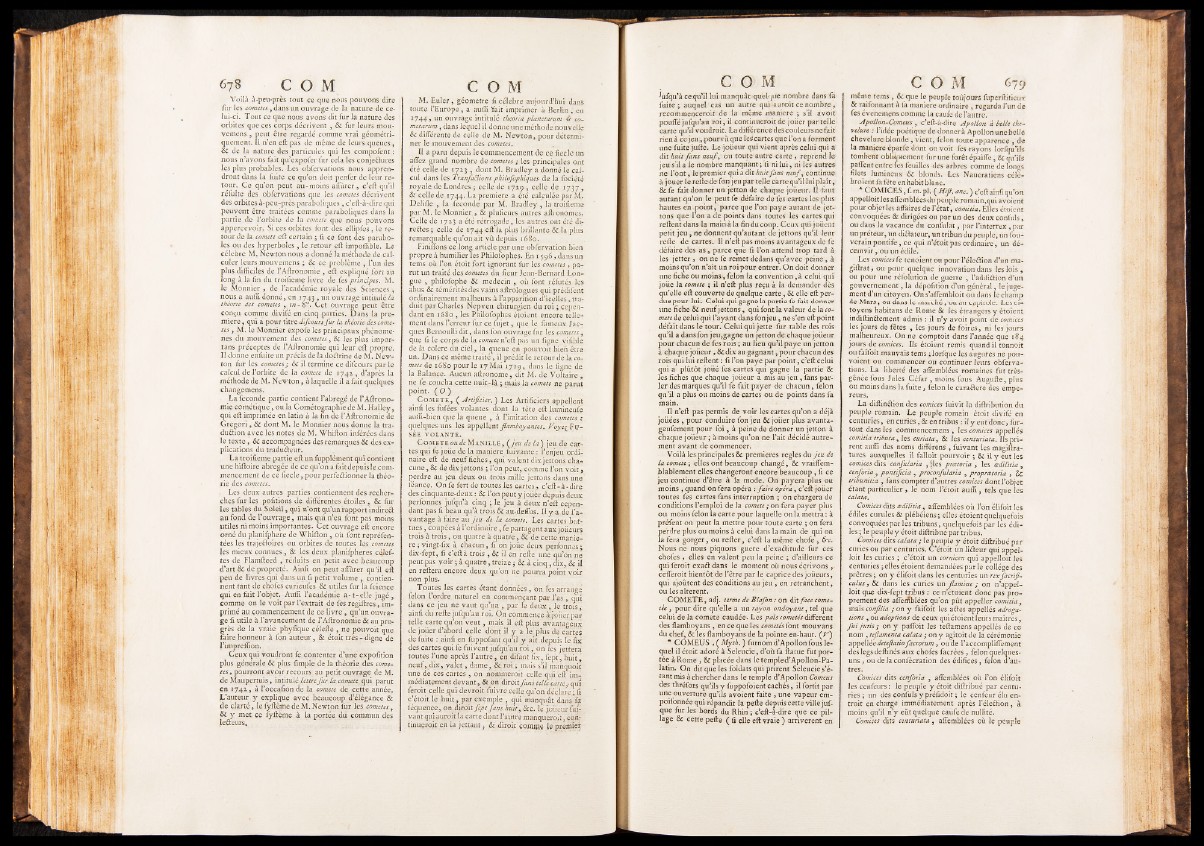
« 1
f ' ffljlM
1. Il
i f t f
l i l i »
f a
67$ C O M C O M
Voilà à-peu-près tout ce que nous pouvons dire
fur les cometes, dans un ouvrage de la nature de celui
ci. Tout ce que nous avons dit fur la nature des
orbites que ces corps décrivent , ôc fur leurs mou-
vemens , peut être regardé comme vrai géométriquement.
Il n’en eft pas de même de leurs queues.,
& de la nature des particules qui les compofent :
nous n’avons fait qu’expofer fur cela les conjeûures
les plus probables. Les obfervations nous apprendront
dans la fuite ce qu’on doit penfer de leur retour.
Ce qu’on peut au-moins affûrer, c’eft qu’il
réfulte des obfervations que les cometes décrivent
dés orbites à-peu-près paraboliques , c’eft-à-dire qui
peuvent être traitées comme paraboliques dans la
partie de l’orbite de la comete que nous pouvons
appercevoir. Si ces orbites font des ellipfes , le retour
de la comete eft. certain ; fi ce font des paraboles
ou des hyperboles , le retour eft impoffible. Le
célébré M. Newton nous a donné la méthode de calculer
leurs mouvemens ; ôc ce problème , l’un des
plus difficiles de l’Aftronomie , eft expliqué fort au
long à la fin du troifieme livre de fes principes. M.
le Monnier , de l’académie royale des Sciences ,
nous a aufîi donné, en 1743 , un ouvrage intitulé la
théorie des cometes , in - 8°. Cet ouvrage peut être
conçu comme divifé en cinq parties. Dans la première
, qui a pour titre dijcours fur la théorie des cometes
, M. le Monnier expofe les principaux phénomènes
du mouvement des cometes, ôc les plus impor-
tans préceptes de l’Aftronomie qui leur eft propre.
Il donne enfuite un précis de la dottrine de M. Newton.
fur les cometes; ÔC il termine ce difeours par le
calcul de l’orbite de la comete de 1742 , d’après la
méthode de M. Newton, à laquelle il a fait quelques
changemens.
La fécondé partie contient l’abrégé de l’Aftronomie
cométique, ou la Cométographie de M. Halley,
qui eft imprimée en latin à la fin de l’Aftronomie de
Gregori, ôc dont M. le Monnier nous donne la traduction
avec les notes de M. Whifton inférées dans
le texte, ôc accompagnées des remarques ôc des explications
du traducteur.
La troifieme partie eft un fupplément qui contient
une hiftoire abrégée de ce qu’on a fait depuis le commencement
de ce fiecle, pour perfectionner la théorie
des cometes.
.■ Les deux autres parties contiennent des recherches
fur les pofitions de différentes étoiles , ôc fur
les tables du Soleil, qui n’ont qu’un rapport indireCt
au fond de l’ouvrage, mais qui n’en font pas moins
utiles ni moins importantes. Cet ouvrage eft encore
orné du planifphere de Whifton , où font repréfen-
tées les trajectoires ou orbites de toutes les cometes
les mieux connues , & les deux planifpheres colef-
tes de Flamfteed , réduits en petit avec beaucoup
d’art ôc de propreté. Ainfi on peut affûrer qu’il eft
peu de livres qui dans un fi petit volume , contiennent
tant de chofes curieufes ôc utiles fur la fcience
qui en fait l’objet. Aufli l’académie a.-1-elle jugé ,
comme on le voit par l’extrait de fes regiftres, imprimé
au commencement de ce livre , qu’un ouvrage
fi utile à l’avancement de l’Aftronomie & au progrès
de la vraie phyfique célefte , ne pouvoit que
faire honneur à fon auteur, & étoit très - digne de
l’impreflion.
Ceux qui voudront fe contenter d’une expofition
plus générale ôc plus fimple de la théorie des cometes,
pourront avoir recours au petit ouvrage de M.
de Maupertuis, intitul é lettre fur la,comete qui parut
en 1742, à l’occafion de la comete de cette année.
L’auteur y explique avec beaucoup d’élégance &
de clarté, le fyftème de M. Newton fur les cometes,
& y met ce fyftème à la portée du commun des
Je&eurs.
M. Euler , géomètre fi célébré aujourd’hui dans
toute l’E u rope, a aufli ’fait imprimer à Berlin f en
1 7 4 4 , un ouvrage intitulé theoria planetarum & co-
metarum , dans lequel il donne une méthode nouvelle
Ôc différente de celle de M. Newton, pour déterminer
le mouvement des cometes.
Il a paru depuis le commencement de ce fiecle un
affez grand nombre de cometes ; les principales ont
été celle de 1723 , dont M. Bradley a donné le calcul
dans les Tranfaclions philofophiques de la fociété
royale de Londres ; celle de 1729 , celle de 1 7 3 7 ,
& celle de 1744. L a première a été calculée par M.
Delifle , la fécondé par M. B rad le y , la troifieme
par M. le Monnier , & plufieurs autres aftronomes.
Celle de 1723 a été rétrogade, les autres ont été directes
; celle de 1744 eft la plus brillante ôc la plus
remarquable qu’on ait vû depuis 1680.
Finiffons ce long article par une obfervation bien
propre à humilier les Philofophes. En 1596, dans un
tems où l’on étoit fort ignorant fur les cometes, par
rut un traité des cometes du fieur Jean-Bernard Longue
, philofophe ôc médecin , où font réfutés les
abus ôc témérités des vains aftrologues qui p.rédifent
ordinairement malheurs à l’apparition d’icelles, traduit
par Charles Nepveu chirurgien du roi ; cependant
en 1680 , les Philofophes étoient encore telle-*
ment dans l’erreur fur ce fu je t, que le fameux Ja c ques
Bernoulli d it, dans fon ouvrage fur les cometes,
que fi le corps de la comete n’eft pas un ligne vifible
de la colere du ciel., la queue en pourroit bien être
un. Dans ce même traité, il prédit le retour de la comete
àe 1680 pour le 17 Mai 1719, dans le ligne de
la Balance. Aucun aftronome, dit M. de Voltaire ,
ne fe coucha cette nuit-là ; niais la comete ne parut
point. ( O )
C o m e t e , ( Artificier. ) Les Artificiers appellent
ainfi les fufées volantes dont la tête eft lumineufe
aufli-bien que la queue , à Limitation des cç/netes t
quelques-uns les appellent flamboyantes. Voyeç Fusée
VOLANTE.
C omete ou de Manille , (jeu de la') jeu de caftes
qui fe joiie de la maniéré luivante : l’enjeu ordinaire
eft de neuf fiches ; qui valent dix jetions chacune
, ôc de dix jettons ; l’on peut, comme l’on voit >
perdre au jeu deux ou trois mille jettons dans une'
féance. On fe fert de toutes les carte.s,, c’eft-à-d ire
des cinquante-deux : Ôc l’on peut y joiièr depuis deux
perfonnes jufqu’à cinq ; le jeu à deux n’eft cependant
pas fi beau qu’à trois ôc au-deflus. II y a,de l’avantage
a faire au jeu de la cotnete. Les cartes battues
, coupées à l’ordinaire, fe partagent aux. joueurs
trois à tro is , ou quatre à quatre, &-de cette maniéré
; vingt-fix à chacun, fi on joiie deux perfonnes ;
dix-fept, fi c’eft à trois , & il en refte une qu’on ne
peut pas voir ; à quatre, treize ; ôc à c inq, dix, Ôc il
en reftera encore deux qu’on ne pourra point voir
non plus. x .
Toutes les cartes étant données, on les arrange
félon l’ordre naturel en commençant par l’as., qui
dans ce jeu ne vaut qu’un , par le d e u x , le trois ;
ainfi du refte jufqu’au roi. On commence à-jouer par
telle carte qu’on v e u t , mais il eft plus avantageux
de joiier d’abord celle dont il y a le, plus de cartes
de fuite : ainfi en fuppofant qu’il y ait .depuis fe fix
des cartes qui fe fuivent jufqu’au f o i , on les jettera
toutes l’une après l’autre, en difant lix , fept, huit^
neu f, d ix , v a le t , dame, & roi ; mais s’il manquoit
une de ces cartes , on nommeroit celle qui eft immédiatement
devant, & on diroit fans telle carte qui
feroit celle, qui devroit fuivre celle qu’on déclaré ; fi
ç’étoit le huit, par exemple , qui manquât dans fit
léquence, on diroit fept fans huit, &c. le joueur fuir
yantquiauroit la carte dont l’aiitre manqueront , cqm
tinueroit en la jettant, & diroit comme le premier
C O M
'ufqu’à cequ’il lui manquât quelque nombre dans fa
fu ite ; auquel cas un autre qui-auroit ce nombre,
recommenceroif de la même maniéré ; s’il av o it
pouffé jufqtflau r o i, il continueroitde joiier p ar telle
carte qu’il voudroit. L a différeneedes couleurs ne fait
rien à ce jeu:, pourvu que leàcartes que l’on a forment
une fuite jufte. L e joueur qui vient après celui qui a
dit huit fans neuf, ou toute autre c a rte , reprend le
jeu s ’il a le nombre manquant ; û ni lu i, ni les autres
ne1 l’o n t , le premier qui a dit huit fans neuf, continue
à jouer le relie de fon jeu par telle carte qu’il-luiplaîc,
ôc fe fait donner un jetton de chaque joueur, il -faut
autant qu’on le peut fe défaire de lès cartes les plus
hautes en poin t, parce que l’on paye autant de jet-
tons que l’on a de points dans toutes les cartes qui
relient dans la main à la fin du coup. C eux qui joiient
petit je u , ne donnent qu’autant de jettons qu’il leur
refte de cartes. Il n’eft pas moins avantageux de fe
défaire des a s , parce que fi l’on-attend trop tard à.
les je tte r, on ne fe remet dedans qu’avec peine, à
moins qu’on n’ait un roi pour, entrer. On doit donner
une fiche ou moins/, félon la convention ,à celui qui
joiie la comete ; il n’eft plus reçu à la demander dès
qu’elle eft couverte de quelque c a rte , & elle eft perdue
pour lui. Celui qui gagne la partie fe fait donner
une fiche ôc neuf jettons, qui font la valeur de la comete
de celui qui l’ayant dans fon je u , n e s’en eft point
défait dans le tour. Celui qui jette fur table des rois
qu’il a dans fon jeu,gagne un jetton de chaque joueur
pour chacun de fes rois ; au lieu qu’il paye un jetton
à chaque joiieur, Ôc dix au gagnant, pour chacun des
rois qui lui relient : fi l’on paye par point, c’eft celui
qui a plûtôt joiié fes cartes qui gagne la partie &
les fiches que chaque joueur a mis au jeu , fans parler
des marques qu’il fe fait payer de chacun, félon
qu’il a plus ou moins de cartes ou de points dans fa
main.
Il n’eft pas permis de voir les cartes qu’on a déjà
jouées , pour conduire fon jeu ôc joiier plus âvanta-
geufement pour f o i , à peine de donner un jetton à
chaque joiieur ; à moins qu’on ne Tait décidé autrement
avant de commencer.
Voilà les principales ôc premières réglés du jeu de
la comete ; elles ont beaucoup changé, ôc vraiffem-
blablement elles changeront encore beaucoup , fi ce
jeu continue d’être à la mode. On payera plus ou
moins , quand on fera opéra : faire opéra, c’eft joiier
toutes fes cartes fans interruption ; on chargera de
conditions l’emploi de la comete ; on fera payer plus
ou moins félon la carte pour laquelle on la mettra : à
préfent on peut la mettre pour toute carte ; on fera
perdre plus ou moins à celui dans la main de qui on
la fera g orge r, ou refter, c’e f t la même chofe , &c.
Nous ne nous piquons guere d’exaélitude fur ces
chofes , elles en valent peu la peine ; d’ailleurs ce
qui feroit exa£l dans le moment où nous éçrivons ,.
cefferoit bientôt de l’être par le caprice des joiieurs,
qui ajoûtent des conditions au je u , en retranchent,
ou les altèrent.
COM E T E , adj. terme de Blafon: on dit face come-
tée , pour dire qu’elle a un rayon ondoyant, tel que
celui de la comete caudée. Les pals cometés different
des flamboyans , en ce que les cometés font mouvans
du chef, ôc les flamboyans de la pointe en-haut. ( V)
* COMEUS , ( Myth. ) furnom d’Apollon fous lequel
il étoit adoré à Seleucie, d’où fa ftatue fut portée
à Rome , ôc placée dans le templed’Apollon-Pa-
latin. On dit que les foldats qui prirent Seleucie s’étant
mis à chercher dans le temple d’Apollon Comeus
des thréfors qu’ils y fuppofoient cachés, il fortit par
une ouverture qu’ils avoient faite , une vapeur em-
poifonnée qui répandit la pefte depuis cette ville juf-
que fur les bords du Rhin ; c’eft-à-dire que ce pillage
ôc cette pefte ( fi elle eft vraie ) arrivèrent en
C O M 6 7 9
même tems , & que le peuple toujours ftiperftitieux
& raifonnant à la maniéré ordinaire, regarda l’un de
fes évenemens comme la caufe de l’autre.
Apollon-Comeus , c’eft-à-dire Apollon à belle chevelure
: l’idée poétique de donner à Apollon une belle
chevelure blonde, vient, félon toute apparence , de
la maniéré éparfe dont on vo it fes rayons lorfqu’iis
tombent obliquement fur une forêt épaiffe, ôc qu’ils
paffent entre fes feuilles des arbres comme de longs
filets lumineux ôc blonds. Les Naueratiens céle-
broient fa fête en habit blanc.
* COM IC ES , f. m. pl-. ( Hifl. anc. ) c’eft ainfi qu’on
appelloitles affemblées du peuple romain,qui avoient
pour objet les affaires de l’éta t; comitia. Elles étoient
convoquées & dirigées ou par un des deux confuls,
ou dans la vacance du confulat, par l’interrex , par
un préteur, un di&ateur, un tribun du peuple, un fou-
verain pontife, ce qui n’étoit pas ordinaire, un décemvir
, ou un édilé.
Les comices fe tenoientou pourTéleftion d’un ma-
giftrat, ou pour quelque innovation dans les lois ,
ou pour une réfolution de guerre , l’addiâion d ’un
gouvernement, la dépofition d’un général, le jugement
d’un citoyen. On s’affembloit ou dans le champ
de Ma rs, ou dans le marché, ou au c jpitole. Les citoyens
habitans de Rome & les étrangers y étoient
indiftinélement admis : il n’y avoit point de comices
les jours de fêtes , les jours de foires, ni les jours
malheureux. On ne comptoit dans l’année que 184
jours de comices. Ils étoient remis quand il tonnoit
ou faifoit mauvais tems ; lorfque les augures ne pou-
yoient ou commencer ou continuer leurs obfervations.
L a liberté des affemblées romaines fut très-
gênée fous Jules Céfar , moins fous Augufte, plus
ou moins dans la fu ite , félon le c araâ ere des empereurs.
La- diftinâion des comices fuivit la diftribution du
peuple romain. L e peuple romain étoit divifé en
centuries, en curies, & en tribus : il y eut donc, fur-
tout dans les commencemens , les comices appelles
comitia tributa, les curiata, & les centuriata. Ils prirent
aufli des noms différens , fuivant les magiftra-,
tures auxquelles il falloit pourvoir ; & il y eut les
comices dits confuiaria , fies preetoria , les ctdilitia ,
cenforia , pontificia , proconfularia , proproetoria , ÔC
tribunitia , fans compter d’autres comices dont l’objet
étant particulier , le nom l’étoit au fli, tels que les
calata.
Comices dits cedilitia, affemblées où l’on élifoit les
édiles curules & plébéiens ; elles étoient quelquefois
convoquées par les tribuns, quelquefois par les édiles
; le peuple y étoit diftribué par tribus.
Comices dits calata ; le peuple y étoit diftribué par
curies ou par centuries. C ’étoit un Iièleur qui appel-,
loit les curies ; c’étoit un cornicen qui appelloit les
centuries ; elles étoient demandées par le collège des
prêtres ; on y élifoit dans les centuries un rex facrifi-
culus, & dans les curies un famine ; on n’appel-
Ioit que dix-fept tribus : ce n’étoient donc pas proprement
des affemblées qu’on put appeller comitia,
mais conflia ; on y faifoit les aéles appeHés adroga-
tions , ou adoptions de ceux qui étoient leurs maîtres,
fui juris ; on y paffoit les teftamens appellés de ce
nom , teflamenta calata ; on y agitoit de la cérémonie
appellée detefatio facrorum, ou de l’accompliffement
des legs deftinés aux chofes fac ré e s, félon quelques-
uns , ou de la confécration des édifices, félon d ’autres
.Comices dits cenforia , affemblées où l’on élifoit
les cenfeurs : le peuple y étoit diftribué par centuries
; un des confuls y préfidoit ; le cenfeur élu entroit
en charge immédiatement après l’éleélion, à
moins qu’il n’y eût quelque caufe de nullité.
Comises dits centuriata, affemblées où le peuple