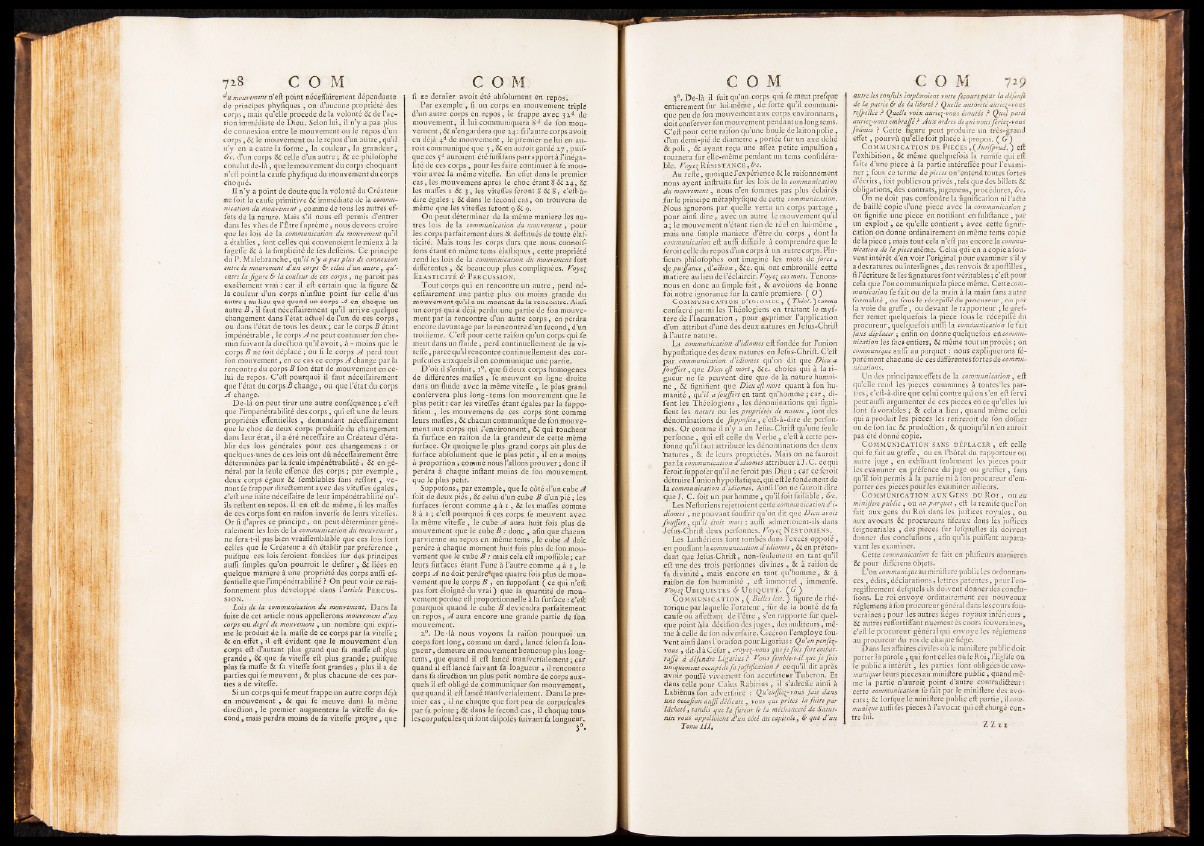
mouvement n’eft point néceflairement dépendante
de principes phyfiques , ou d’aucune propriété des
corps, mais qu’elle procédé de la volonté & de l’action
immédiate de Dieu. Selon lui, il n’y a pas plus
de connexion entre le mouvement ou le repos d’un
corps , 6c le mouvement ou le repos d’un autre, qu’il
n’y en a entre la forme, la couleur , la grandeur,
&c. d’un corps & celle d’un autre ; & ce philofophe
conclut de-là, que le mouvement du corps choquant
n’eft point la caufe phyfique du mouvement du corps
éhoqué.
Il n’y a point de doute que la volonté du Créateur
one foit la caufe primitive & immédiate de la communication
du mouvement, comme de tous les autres effets
de la nature. Mais s’il nous eft permis d’entrer
dans les vues de l’Être fuprème, nous devons croire
que les lois de la communication du mouvement qu’il
a établies, font celles qui convenoient le mieux à la
fageffe & à la fimplicité de fes deffeins. Ce principe
du P. Malebranche, qu'il n'y a pas plus de connexion
entre le mouvement d'un corps & celui d'un autre , qu'entre
la figure & la couleur de ces corps , ne paroît pas
exa&ement vrai : car il eft certain que la figure &
la couleur d’un corps n’influe point fur celle d’un
autre ; au lieu que quand un corps A en choque un
autre B , il faut néceflairement qu’il arrive quelque
changement dans l’état aûuel de l’un de ces corps,
ou dans l’état de tous les deux..; car le corps B étant
impénétrable, le corps A ne peut continuer fon chemin
fuivant la direction qu’il avoit, à - moins que le
corps B ne foit déplacé ; ou fi le corps A perd tout
fon mouvement, en ce cas ce corps A change par la
rencontre du corps B fon état de mouvement en celui
de repos. C ’eft pourquoi il faut néceflairement
que l’état du corps B change, ou que l’état du corps
A change.
De-là on peut tirer une autre conféquence ; c’eft
que l’impénétrabilité des corps, qui eft une de leurs
propriétés elTentielles , demandant néceflairement
que le choc de deux corps produife du changement
dans leur état, il a été néceffaire au Créateur d’établir
des lois générales pour ces changemens : or
quelques-unes de ces lois ont dû néceflairement être
déterminées par la feule impénétrabilité , & en général
par la feule eflence des corps ; par exemple ,
deux corps égaux & femblables fans reflort , venant
fe frapper dire&ement avec des vîteffes égales *
c ’eft une fuite néceffaire de leur impénétrabilité qu’ils
reftent en repos. Il en eft de même, fi les mafles
de ces corps font en raifon inverfe de leurs vîteflfes..
Or fi d’après ce principe, on peut déterminer généralement
les lois de la communication du mouvement,
ne fera-t-il pas bien vraiflemblable que ces lois font
celles que le Créateur a dû établir par préférence ,
puifque ces lois feroient fondées fur des principes
aufli fimples qu’on pourroit le defirer, & liées en
quelque maniéré à une propriété des corps aufli ef-
fentielle que l’impénétrabilité ? On peut voir ce rai-
fonnement plus développé dans l'article Percussion.
Lois de la communication du mouvements Dans la
fuite de cet article nous appellerons mouvement d'un
corps ou degré de mouvement, un nombre qui exprime
le produit de la maffe de ce corps par fa vîtefle ;
& en effet, il eft évident que le mouvement d’un
corps eft d’autant plus grand que fa maffe eft plus
grande, & que fa vîtefle eft plus grande; puifque
plus fa maffe & fa vîtefle font grandes, plus il a de
parties qui fe meuvent, & plus chacune de ces parties
a de vîtefle.
Si un corps qui fe meut frappe un autre corps déjà
en mouvement , & qui fe meuve dans Ja même
direction, le premier augmentera la vîtefle du fécond,
mais perdra moins de fa vîtefle propre, que
fi ee dernier avoit été abfolument en repos ;
Par exemple , fi un corps en mouvement triplé
d’un autre corps en repos, le frappe avec 3 2 d de
mouvement, il lui communiquera 8 d de fon mouvement
, & n’en gardera que 24: fi l’autre corps avoit
eu déjà 4d de mouvement, le premier ne lui en au-
roit communiqué que 5, & en aiifoir gardé 2 7 , puifque
ces 5d auroient été fuffifans parr apport à l’inégalité
de ces corps , pour les faire continuer à fe mouvoir
avec la même vîtefle. En effet dans le premier
cas, les mouvemens après le choc étant 8 & 24, &
les mafles 1 & 3 , les vîteffes feront 8 & 8, c’eft-à-
dire égales ; & dans le fécond, cas, on trouvera de
même que les vîteffes feront yôc 9.
On peut déterminer de la même maniéré les autres
lois de la communication du mouvement, pour
les corps parfaitement durs & deftitués de toute élaf-
ticité. Mais tous les corps durs que nous connoif--
fons étant en même tems élaftiques, cette propriété
rend les lois de la communication du- mouvement fort
différentes , & beaucoup plus compliquées. Voyeç
Élasticité & Percussion.
Tout .corps qui en rencontre un autre, perd né-
ceffairement une partie plus ou moins grande du
mouvement qu’il a au moment de la rencontre. Ainfi
un corps qui a déjà perdu une partie de fon mouvement
par la rencontre d’un autre corps, en perdra
encore davantage par la rencontre d’un fécond, d’un
troifieme. C ’eft pour cette raifon qu’un corps qui fe
meut dans un fluide, perd continuellement de fa vî-
teffe, parce qu’il rencontre continuellement des cor-
pufcules auxquels il en communique une partie.
D ’où il s’enfuit, i°. que fi deux corps homogènes
de différentes ma fles , fe meuvent en ligne droite
dans un fluide avec la même vîtefle , le plus grand
confervera plus long-tems fon mouvement que lé
plus petit : car les vîteffes étant égales par la fiippo*
fition , les mouvemens de ces corps font,comme
leurs mafles, & chacun communique de fon.mouve-
ment aux corps qui l’environnent, & qui' touchent
fa furface en raifon de la grandeur de cette même
furface. Or quoique le plus grand corps ait plus dé
furface abfolument que le plus petit, il en a moins
à proportion, comme nous l’allons prouver ; donc il
perdra à chaque inftant moins de fon mouvèment-
que le plus petit.
Suppofons, par exemple, que le côté d ’un cube A
foit de deux piés , & celui, d’un cube B d’un pié ; les
furfaces feront comme 4 à 1 , & les mafles comme
8 à 1 ; c’eft pourquoi fi ces corps , fe meuvent avec
la même vîtefle , le cube A aura huit fois plus de
mouvement que le cube B : donc ,. afin que chacun
parvienne au repos en même tems , le cube A doit
perdre à chaque moment huit fois plus de fon mouvement
que le cube B : mais cela eft impoffible ; car
leurs furfaces étant l’une à l’autre comme 4 à 1 , le
corps A ne doit perdre*que quatre fois plus de mouvement
que le corps B , en fuppofant ( ce qui n’eft
pas,fort éloigné du vrai ) que la quantité de mouvement
perdue eft proportionnelle à la furface : c’eft
pourquoi quand le cube B deviendra parfaitement
en repos, A aura encore une grande partie de fon
mouvement.
2°. De-là nous voyons la raifon pourquoi un,
corps fort long, comme un dard, lancé félon fa longueur
, demeure en mouvement beaucoup plus long-,
tems, que quand il eft lancé tranfverfalement ; car
quand il eft lancé fuivant fa longueur , il rencontre
dans fa direction un plus petit nombre de corps auxquels
il eft obligé de communiquer fon mouvement,
que quand il eft lancé tranfverfalement. Dans le premier
cas , il ne choque que fort peu de corpufcules
par fa pointe ; & dans le fécond ca s , il choque tous-
36. De-là il fuit qu’un corps qui,fe meut prefque
entièrement fur lui-mêffie, de forte qu’il communique
peu de fon mouvement aux corps environnans,
doit conferver fon mouvement pendant un long tems.
C ’eft pour cette raifon qu’une boule de laiton polie,
d’un demi-pié de diamètre , portée fur un axe délié
& p o li, & ayant reçu une affez petite impulfion,
tournera fur elle^même pendant un tems confidéra-
ble. VoyezRésistance,
Au relie, quoique l’expérience & le raifonnement
nous ayent inftruits fur les lois de la communication
du mouvement, nous n’en fommes pas plus éclairés
ü ir le principe métaphyfique de cette communication.
Nous ignorons par quelle vertu un corps partage,
pour ainfi dire avec un autre le mouvement qu’il
a ; le mouvement n ’étant rien de réel en lui-même ,
mais une fimple maniéré d’être-.du corps , dont la
communication eft aufli difficile à comprendre que le
feroit celle du repos d’un corps à un autre corps. Plu-
fieurs philofophes ont imaginé les mots de force,
de puijfance , faction, & c . qui ont embrouillé cette
matière au lieu de l’éclaircir. Voyez ces mots. Tenons*
nous en donc au fimple fait, & avouons de bonne
foi notre ignorance fur la caufe première. ( O )
C ommunication d’idiomes , (Tkéol. ) terme
confacré parmi les Théologiens en traitant le myf-
tere de l’Incarnation , pour ^primer l’application
d’un attribut d’une des deux natures en Jefiis-Chrift
à l’autre nature.
La communication d'idiomes eft fondée fur l’union
hypoftatique des deux natures en Jefus-Chrift. C’eft
par communication d'idiomes qu’on dit que Dieu a
foujfert, que Dieuejl mort, &c. chofes qui à la ri-,
gueur ne fe peuvent dire que de la nature humaine
, & lignifient que Dieu efi mort quant à fon humanité
, qu 'il a foujfert en tant qu’homme ; ca r , di-
fent les Théologiens , les dénominations qui figni-
fient les nature ou les propriétés de nature , font des
dénominations de fuppojîta, c’eft-à-dire de perfon-
nes. Or comme il n’y a en Jefus-Chrift qu’une feule
perfonne, qui eft celle du V erbe, c’eft à cette per-
lonne qu’il faut attribuer les dénominations des deux
matures , & de leurs propriétés. Mais on ne fauroit
parla, communication d'idiomes attribuer à J. C . ce qui
feroit fuppofer qu’il ne feroit pas Dieu ; car ce feroit
détruire l’union hypoftatique, qui eft le fondement de
la communication d'idiomes. Ainfi l’on ne fauroit dire
que J. Ç. foit un pur homme, qu’il foit faillible, &c.
Les Neftoriensrejettoient cette communicationd'idiomes
, ne pouvant fouffrir qu’on dît que Dieu avoit
foujfert, qu 'il étoit mort : aufli admettoient-ils dans
-Jefus-Chrift deux perfonnes. Voyez Nestoriens.
Les Luthériens, font tombés dans l’excès oppofé ,
en poufîant la communication d'idiomes, & en prétendant
que Jefus-Çhrift, non-feulement en tant qu’il
.eft une des trois perfonnes divines , & à raifon de
fa divinité , mais encore en tant qu’homme, & à
raifon de fon humanité , eft immortel , immenfe.
VoyezUbiquistes & Ubiquité. ( G )
C ommunication , ( Belles lett. ) figure dé rhétorique
par laquelle l’orateur , fur de la bonté de fa
caufe où affe&ant de l’être , s’en rapporté fur quelque
point à/la décifion des juges, des auditeurs, même
à celle de fon adverfaire. Cicéron l’erriploye fou-
Vent ainfi dans i’oraifon pour Ligarxus : Qu'enpenfe{-
vous , dit-il à Céfar, croyez-vous quejefois fort émbar-
rajfé à défendre Ligarius ? Vous femble-t-il que je fois
uniquement occupé de fa jufiification ? ce qu’il dit apres
avoir pouffé vivement fon accufatewr Tuberon. Et
dans celle pour Câius Rabirius , il s’âdrefle ainfi à
Labiènus fon adverfaire : Qu euffiez-vôus fait dans
une occafioh aujfi délicate , vous qui prîtes la fuite par
lâcheté, tandis que là fureur & la méchanceté de Saturnin
vous: appelloient d'un côté au capitole, & que d'un
Tome l l l .
autre les tonfuls imploroient votre feçourspôür la défenft
de la patrie & de la liberté ? Quelle aut&rité auriez-vous
refpeclée ? Quelle voix auriez-vous écoutée ? Quel parti
auriez-vous embràjje ? Aux ordres de qui vous feriez-vous
fournis } Cette figure peut produire un très-grand
effet , pourvû qu’elle foit placée à-propos. CG')
Communication de Pièces^Jurifprud. ) eft
l’exhibition, ôt même quelquefois la remife qui eft
faite d’une pièce à la partie intéreffée pôur l’examiner
; fouS ce terme de pièces on*éntend toutes fortes
d’écrits, foit publics ou privés, tels que des billets ÔC
obligations, dès contrats, jugeoiens, procédures, &c>
On ne doit pas confondre la lignification ni l’afte
de bâillé copie d’une piece avec la communication }
on lignifie une piece en notifiant en fubftance , pat
un exploit, Ce qu’elle contient ; avec cette lignification
On donne ordinairement en même tems copie
de la piece ; mais tout cela n’éft pas encore la commua
nication de la piece même. Celui qüi en a copie a fou-
vent intérêt d’en voir l’original pour examiner s’il ÿ
à des ratures Ou interlignés, des renvois & apo Ailles,
fi l’écriture & les fignatures font véritables ; c’eft pour
Cela que l’on communique la piece même. Cette communication
fe fait Ou de la main à la main fans autre
formalité , Ou fous-Ie récepiffé du procureur, ou par
la voie du greffe, Ou devant le rapporteur ; lé greffier
remet quelquefois la piece fous le fécépilié dû
procureur, quelquefois aiiffi la communication fe fait
fans déplacer ; enfin on donne quelquefois ert communication
lés facs entiers, & même tout un procès ; ort
communique auffi au parquet : nous expliquerons fé-
parémènt chacune de ces différentes fortes de communications.
Un des principaux effets de la communication, eft
qu’elle rend les pièces communes à toutes‘ les parties,
c’eft-à-dire que celui contre quion s’en eft fervi
peut âuffi argumenter dé ces pièces en ce qu’elles lui
font fa vorables ; & cela a lieu, quand même celui
qui a produit les pièces les retireroit de fon doffier
ou.de fon fac & produ&ion, & quoiqu’il n’en aüroit
pas été donné Copie.
~ C ommunication sans déplace!* , eft celle
qui fe.fait au greffe, ou en l’hôtel du rapporteur oit
autre juge , en exhibant feulement les pièces pour
les examiner en préfence du juge ou greffier, fans
qu’il foit permis à la partie ni à fon procureur d’emporter
ces pièces pdurles examiner ailleurs.
. C ommunication aux Gens du Ro i , ou au
minifiere public , Ou au parquet, eft la remife que l’on
fait aux gens du Roi dans les juftices royales-, ou
aux avocats & procureurs fifeaux dans les juftices
feigneuriales , des pièces fur iefquelles ils doivent
donner des conclufions , afin qu’ils puiffent auparavant
les examiner.
Cette communication fe fait en plufieûrs maniérés
& pour différens objets.
L’on communique au miniftere public les ordonnances
, édits, déclarations, lettres patentes ; pourl’en-
regiftrement defquels ils doivent donner des conclufions.
Le roi envoyé ordinairement ces nouveaux
réglemens à fon procureur général dans les cours fou-
veraines ; pour les autres fiéges royaux inférieurs ,
& autres reffortiffant nuement ès cours fouveraines,
c’eft le procureur général qui envoyé les régiemens
au procureur du roi de chaque fiége.
Dans les affaires civiles où le miniftere public doit
porter la parole, qui font celles oîileR o i,l’Eglife où
le public a intérêt, les parties font obligées de cow-
muniquer leurs pièces au miniftere public, quand même
la partie n’auroit point d’autre contfadifteur :
Cette communication fe fait par le miniftere des avocats
; & lorfqiie le miniftere public eft partie, il communique
auffi les pièces à l’avocat qui eft chargé con*
tre lui.
Z Z z z