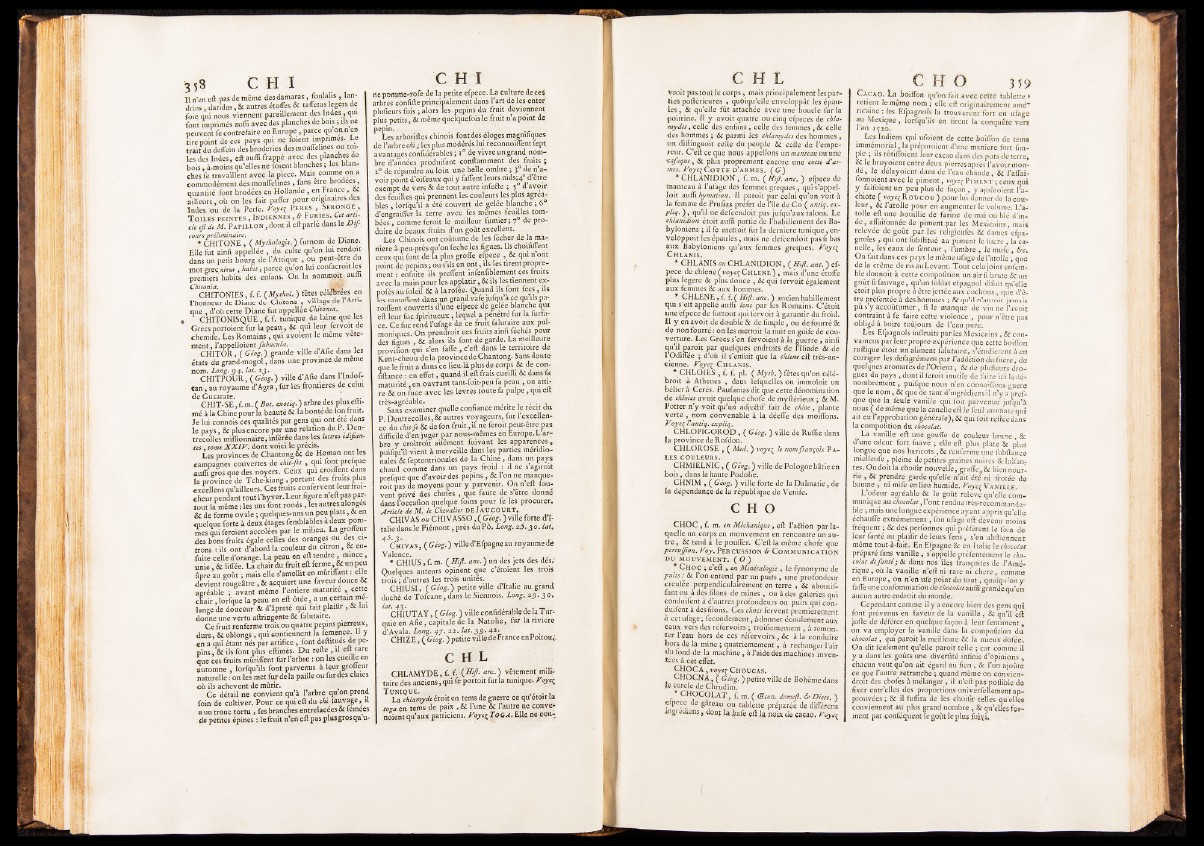
Il n’en eff pas de même des damaras, foulalis , lan-
drins, daridas, & autres étoffes & taffetas légers de
foie qui nous viennent pareillement des Indes, qui
font imprimés auffi avec des.planches de bois -; ils ne
peuvent le contrefaire en Europe, parce qu on nen
tire point de ces pays qui ne l’oient imprimes. Le
trait du deffein des broderies des mouffelines ou toiles
des Indes, eft auffi frappé avec des plapches de
bois, à-moins qu’elles ne ioient blanches ; les; blanches
fe travaillent avec la pièce. Mas comme on a
commodément des mouffelines, fans être brodées,
quantité font brodées en Hollande , en France, ,6c.
ailleurs I oit on les fait paffer. pour originaires des:
Indes ou de la Perfe. Voy^ Pe r e s , S e r o n g e ,
T oiles p e in t e s , In d i e n n e s , * F u r i e s , Cet am-,
fie eft Je M. P a p i l l o n , dont il eft parle dans le JJij-
■ cours préliminaire. .
* CHITONE, ( Mythologie. ) furnom de Diane.
Elle fut ainfi appellée , du culte qu’on lui rendoit
dans un petit bourg de l’Attique , ou peut-etre du
mot grec,xhmv, habit, parce qu’on lui conlacroit les
premiers habits des enfans. On la nommçu aulli
C hit onia. SgsÇ
CHITONIES, f. f. (Mythol. ) fêtes cele"Brees en
l ’honneur de Diane de Chitone , village de 1 Atti-
que , d’où cette Diane fut appellée Chitoma. , ; , ..
• CHITONISQUE, f. f. tunique de laine que les
Grecs portoient fur la peau, 8c qui leur fervoit de
chemife. Les Romains , qui avoient le meme yete-
ment, l’appelloient fubucula.
CHITOR, ( Géog. ) grande ville d Afie dans les
états du grand-mogol, dans une province de même
nom. Lon g.94.lat.z5. , -
CHITPOUR, ( Géog. ) ville d’Afie dans 1 Indol-r
ta n , au royaume d’Agra, fur les frontières de celui
de Guzarate. , , , ».
CHIT-SE, f. m. ( Bot. exotiq. ) arbre des plus efti-
mé à la Chine pour la beauté 8c la bonté de fon fruit.
Je lui connois ces qualités par gens qui ont ete dans
le pays, 8c plus encore par une relation du P. Den-
trecolles millionnaire , inférée dans les lettres édifiantes
, tome X X IV . dont voici le précis.
Les provinces de Chantongôt de Homan ont les
campagnes couvertes de chit-fes , qui font prelque
auffi gros que des noyers. Ceux qui croiffent dans
la province de Tche-kiane, portent des fruits plus
«xcellens qu’ailleurs. Ces fruits confervent leur fraîcheur
pendant tout l’hy ver. Leur figure n eft pas partout
la même : les uns font ronds, les autres alonges
& de forme ovale ; quelques-uns un peu plats, & en
quelque forte à deux étages femblables à deux pommes
qui feroient accolées par le milieu. La grofteur
des bons fruits égale celles des oranges ou des citrons
: ils ont d’abord la couleur du citron, oc en-
fuite celle d’orange. La peau en eft tendre , mince,
unie, 8c liffée. La chair du fruit eft ferme, & un peu
âpre au goût ; mais elle s’amollit en muriffant : elle
devient rougeâtre , & acquiert une faveur douce 8c
agréable ; avant même l’entiere maturité , cette
ch air, lorfque la peau en eft ôtée, a un certain mélangé
de douceur & d’âpreté qui fait plaifir , & lui
donne une vertu aftringente 8c falutaire.
Ce fruit renferme trois ou quatre pépins pierreux,
durs, 8c oblongs, qui contiennent la femence. 11 y
en a qui étant nés par artifice , font deftitues de pépins,
8c ils font plus eftimés. Du refte , il eft rare
que ces fruits mûriffent fur l’arbi« : on les cueille en
automne , lorfqu’ils font parvenus à leur grofteur
naturelle : on les met ftp- delà paille ou fur des claies
oii ils achèvent de mûrir.
Ce détail ne convient qu’à l’arbre qu on prend
foin de cultiver. Pour ce qui eft du chi fauvage, il
a un tronc tortu , fes branches entrelacees 8c fémees
de petites épines : le fruit n’en eft pas plus gros qu une
pomme-fofe de la petite efpece. La cuïtqre de ces
arbres confifte principalement dans l’art de les enter
plufieurs fois ; alors les pépins du fruit deviennent
plus petits, 8c même quelquefois le fruit n’a point de
pépin. ,
Les arboriftes chinois font des éloges magnifiques
de l’arbre chi ; les plus modérés lui reconnoiffent fept
avantages confidérables ; i ° de vivre un grand nombre
d’années produifant conftamment des fruits ;
i ° de répandre au loin une belle ombre ; 30 de n’avoir
point d’oifeaux qui y faffent leurs nids;4° d’être
exempt de vers 8c de tout autre infette ; 50 d’avoir
des feuilles qui prennent les couleurs les plus agréables
, lorfqu’il a été couvert de gelée blanche ; 6°
d’engraiffer la terre avec fes mêmes feuilles tombées
, comme feroit le meilleur fumier ; 70 de produire
de beaux fruits d’un goût excellent.
Les Chinois ont coûtume de les fécher de la maniéré
à-peu-près qu’on feche les figues. Ils choififfent
ceux qui font de la plus große efpece , 8c qui n’ont
point de pépins ou s’ils en ont, ils les tirent proprement
: enfuite ils preffent infenfiblement ces fruits
avec la main pour les applatir, 8c ils les tiennent ex-
pofés au foleil 8c à larofee. Quand ik font fecs , ils
, les ramaffent dans un grand vafe jufqu’à ce qu ils pa-
roiffent couverts d’une efpece de gelée blanche qui
eft leur fuc fpiritueux, lequel a pénétré fur la lurra-
ce. Ce fuc rend l’ufage de ce fruit falutaire aux puL
moniques. On prendrait ces fruits ainfi féchés pour
des figues , 8c alors ils font de garde. La meilleure
provision qui s’en fa ffe, c’eft dans le territoire de
Kent-cheou de la province de Chantong. Sans doute
que le fruit a dans ce lieu-là plus de corps 8c de con-
fiftance : en effet, quand il eft frais cueilli 8c dans fa
maturité, en ouvrant tant-foit-peu fa peau , on attU
re 8c on fuce avec les levres toute fa pulpe, qui eft
très-agréable. , , . . , . ,
Sans examiner quelle confiance mente le récit du
P. Dentrécolles, & autres voyageurs, fur l’excellence
du ckic-fe de fon fruit , il ne feroit peut-être pas
difficile d’en juger par nous-mêmes en Europe.L’ar-
bre y croîtroit aifément fuivant les apparences,
puifqu’il vient à merveille dans les parties méridionales
& feptentrionales de la Chine, dans un pays
chaud comme dans un pays, froid : il ne s’agirait
prefque que d’avoir des pépins, & l’on ne manquerait
pas de moyens pour y parvenir. On n’eft fou-
vent privé des choies , que faute de s’être donné
dans l’occafion quelque foins pour fe les procurer.
Article de M. le Chevalier DE Ja u ç o u r t ,
CHIVAS ou CHIVASSÖ, ( Géog. ) ville forte d’Italie;
dans le Piémont, près du Pô. Long. n i . 30. lac.
BÜkS
C h iv a s , ( Géog. ) ville d’Efpagne au royaume de
Valence. » ,
* CHIUS, f. m. ( Hiß. anc. ) un des jets des des.'
Quelques auteurs opinent que c’étoient les trois
trois ; d’autres les trois unités.
CHIUSI, ( Géog.) petite ville d’Italie au grand
duché de Tofcane, dans le Siennois. Long. 3.9.30,
CH ÎUTAY , ( Géog. ) ville confidérable de la Turquie
en Afie, capitale de la Natolie, fur la riviere
d’Ayala. Long. 47• 22* lat\3 9 ‘ j 2-. .
CHIZÈ, ( Géog. ) petite ville de France en Poitou^
C H L
CHLAMYDE, f. f. an‘ -) vêtement militaire
des anciens, qui fe portoit fur la tunique. Voye^
T unique. ,, .
La chlamyde étoit en tems de guerre ce qu etoit la
toga en tems de paix , 8c l’une & l’autre ne conve-
noient qu’aux patriciens. Voye^ To g a . Elle ne cou-
Vtoit pâs tout lé corps ^ mais principalement les parties
poftérieutes , quoiqu’elle enveloppât les épaules
, & qu’elle fût attachée avec Une boucle fur la
poitrine. Il y avoit quatre ou cinq efpeces de chla-
mydes, celle des enfans, celle des femmes ,8c celle
des hommes ; 6c parmi les chlamydes des hommes ,
son diftinguoit celle du peuple 8c celle de l’empereur.
C ’eft ce que nous appelions un manteau ou une
xafaque, & plus proprement encore une cotte d’armes.
Voyt{Co t t e d’armes. ( G)
* CHLAN1D IO N , f. m. ( Hiß. anc. .) efpece de
manteau à l’ufage des femmes greques, qui s’appel-
loit auffi hymàtion. Il paroît par celui qu’on voit à
la femme de Prufias préfet de l’île de Co ( antiq. ex-
:pliq. ) , qu’il ne defeendoit pas jufqu’aux talons. Le
thlanidion étoit auffi partie de l’habillement des Babyloniens
; il fe mettoit fur la derniere tunique, en-
veloppoit les épaules, mais ne defeendoit pas fi bas
aux Babyloniens qu’aux femmes greques. Voye^
C hlan is.
* CHLANIS ôu CHLANIDION, ( Hiß. anc. ) efpece
de chlene ( vo^ C hlene) , mais d’une étoffe
plus legere 8c plus douce , 8c qui lervoit également
aux femmes 8c aux hommes. .
* CHLENE, f. f. ( Hiß. anc. ) ancien habillement
qui s’eft apjbellé auffi lene par les Romains. Ç ’étoit
une efpece de fitftout qui fer voit à garantir du froid.
Il y en avoit de double 8c de fimple, ou de fourré 8c
de non fourré : on les mettoit la nuit en guife de couverture.
Les Grecs s’en fervoient à la guefre , ainfi
qu’il paroît par quelques endroits de l ’Iliade 8c de
rOdiffée ; d’oii il s’enfuit que la chlene eft très-ancienne.
Voyei. Chlan is.
* CHLOIES , f. fi pl. ( Myth, ) fêtes qu’on célébrait
à Athènes , dans lefquelles on immoloit un
bélier à Cerès. Paufaniasdit que cette dénomination
de chloies avoit quelque chofe de myftérieux ; 8c M.
Potter n’y voit qu’un adjeôif fait de chloe , plante
verte , nom convenable à la déefle des moiffons.
Voye^ Cantiq. expliq.
CHLOPIGOROD , ( Géog. ) ville de Ruffie dans
la province de Rofdon.
CHLOROSE , ( Med. ) voyeç le nomfirançois PALES
COULEURS.
CHMIELNIC, ( Géog. ) ville de Pologne bâtie en
bois, dans la haute Podolie.
CHNIM , ( Géog. ) ville forte de la Dalmatie, de
la dépendance de la république de Venife.
C H O
C H Ö C , f. m. en Méchanique, eft l’aélion par laquelle
un corps en mouvement en rencontre un autre
, 8c tend à le pouffer. C ’eft la même Chofe que
pereußon. Voy. PERCUSSION & COMMUNICATION
DU MOUVEMENT. ( O )
C h o c ; c’eft , en Minéralogie , le fynonyme de
puits .* 8c l’on entend par un puits , une profondeur
çreufée perpendiculairement en terre , 8c aboutif-
fant ou à des filons de mines , pu à des galeries qui
conduifent à d’autres profondeurs ou puits qui con^-
duifent à des filons. Ces chocs fervent premierement
à cetufage; fecondement, à donner écoulement aux
eaux vers des réfervoirs ; troifiemement, à remonter
l’eau hors de ces réfervoirs, 8c à la conduire
«ors de la mine ; quatrièmement, à rechanger l’air
ftu fond de la machine, à l’aide des machines inventées
à cet effet.
CH O C A , voyei C houcas.
CHOCNA, ( Géog. ) petite ville de Bohème dans
le cercle de Chrudim.
CHOCO LAT, f. m. ( OEcon. domeß. & Diete. )
plpece de gateau ou tablette préparée de différens
ingiediens, dont la frafe eft la noix de cacao. Voye^
CACAO. La boiffon qu’on fait avec cettè tablette »
retient le meme noth ; elle eft originairement amé-
ricaine : les Elpagnols la trouvèrent fort en ufage
au Mexique , lorfqu’ils en firent la conquête vers
1 an iç io .
Les Indiens qui üfoiênt de cette boiffon de tems
immémorial, la préparaient d’une maniéré fort fimple
; ils rotiffoient leur cacao dans des pots de terre,
8c le broyoient entre deux pierres après l’avoir mon»
dé, le délayoient dans de l’eau chaude , 8c l’affai-
fonnoient avec le piment, voye^ P im e n t ; ceux qui
y faifoient un peu plus de façon , y ajoûtoient l’a-»
chioté ( voyei R o u c o u ) pour lui donner de la cou*
leur, 8c l’atolle pour en augmenter le volume. L’a-
tolle eft une bouillie de farine de mai ou blé d’in-
d e, affaifonnée de piment.par les Mexicains, mais
relevée dé goût par les religieufes 8c dames efpa-
grroles , qui ont fubftitué au piment le fucre , la ca-
nelîe, les eaux de fenteur , rambre -, le mufe, 6*<rk
On fait dans ces pays le même ufage de l’atolle , quô
de la crème de ris au Levant. Tout cela joint enfem-
ble donnoit à cette compofition un air fi brute 8c un
goût fi fauvage, qu’un foldat efpagnol difoit qu’elle
étoit plus propre à être jettée aux cochons , que d’être
préfentée à des hommes ; 8c qu’il n’aurait jamais
pû s’y accoûtumer, fi le manque de vin ne l’avoit
contraint à fe faire cette violence , pour n’être paS
obligé à boire toujours de l’eau pure.
Les Efpagnols inftruits par les Mexicains, 8c con*
vaincus par leur propre expérience que cette boiffon
ruftique étoit un aliment falutaire, s’étudièrent à en
corriger les defagrémens par l’addition du fucre , de
quelques aromates de l’Orient, & de plufieurs drogues
du pays , dont il feroit inutile de faire ici le dé*
nombrement, puifque nous n’en connoiffons guère
que le nom, 8c que de tant d’ingrédiens il n’y a prefque
que la feule vanille qui foit parvenue jufqu’à
nous ( de même que la canelle eft le feul aromate qui
ait eu l’approbation générale), 8c qui foit reftée dans
la compofition du chocolat.
? La vanille eft une gouffe de couleur brune , 8c
d’une odeur fort fuave ; elle eft plus plate 8t plus
longue que nos haricots , 8c renferme une fubftance
mielleufe, pleine de petites graines noires •& luifanr
tes. On doit la choifir nouvelle, graffe, 8c bien nourrie
, 8c prendre garde qu’elle n’ait été ni frotée de
baume , ni mife en lieu humide. Voye? Vanille.
L’odeur agréable 8c le goût relevé qu’elle communique
au chocolat, l’ont rendue trèsn-ecommanda-
ble ; mais une longue expérience ayant appris quelle
échauffe extrêmement, fon ufage eft devenu moins
fréquent ; 8c des perfonnes qui préfèrent le foin de
leur fanté au plaifir de leurs fens, s’en abftiennent
même tout-à-fait. En Elpagne 8c en Italie le chocolat
préparé fans vanille , s’appelle préfentement le chocolat
de fanté; & dans nos îles françoifes de l’Amé*
rique, où la vanille n’eft ni rare ni chere, comme
en Europe -, on n’en u fe point du tou t, quoiqu ’on y
faffe uneconfommation de chocolat auffi grande qu’en
aucun autre endroit du monde.
Cependant comme il y a encore bien des gens qui
font prévenus en faveur de la vanille , 8c qu’il eft
jufte de déférer en quelque façon à leur fentiment,
on va employer la vanille dans la compofitiôn du
chocolat, qui paroît la meilleure Sc la mieux dofée*
On dit feulement qu’elle paroît telle ; car comme il
y a dans les goûts une diverfité infinie d’opinions ,
chacun veut qu’on ait égard au lien , & l’un ajoûte
ce que l’autre retranche ; quand même on conviendrait
des chofes à mélanger, il n’eft pas poffible de
fixer entr’elles des proportions univerfellement approuvées
; 8c il fuffira de les choifir telles qu elles
conviennent au plus grand nombre , & qu’elles forment
par çonféquent le goût le plus fuiYi.